La Folie, Le Mal De L'afrique Postcoloniale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ken Bugul Interview, Top of Mind
LINGUA ROMANA VOL 14, ISSUE 1 RADIO INTERVIEW Ken Bugul: A Celebrated African Novelist on Migration and Identity Julie Rose BYU Radio Top of Mind SUMMARY Radio interview, originally aired 29 March 2018 JULIE ROSE: This is Top of Mind. I’m Julie Rose. If you look at the list of countries whose citizens have left for other places over the last decade, Syria’s immigrant population has grown the fastest worldwide. The rest of the top ten countries with fastest growing rates of immigration are all in Africa. So, it’s not too surprising that migration was something Ken Bugul spoke passionately about during her recent visit to our studio as a guest of BYU’s Africana Studies program. Ken Bugul is from Senegal. She is one of French-speaking Africa’s most celebrated authors. Her writing deals with independence, loss, inequality, and identity. Her next novel is about migration. It’s unfortunate that only one of her books has been translated into English because there’s a lot Ken Bugul wishes we in the West understood. KEN BUGUL: A lot of things to understand about Africa. I think that Africa is not well known, particularly in the Western world. Africa is not a country, it’s a big continent – huge continent – and even though we have been through… Colonization is a big issue during centuries for some countries like Senegal, by France and England – and mostly older countries, even Germany and Holland, and all those European countries – colonization was already a big mess, which even after we get independences, still we have the consequences in our mentality, in our behavior. -

1 Langue Et Langage Litteraires Chez Ken Bugul
LANGUE ET LANGAGE LITTERAIRES CHEZ KEN BUGUL – TECHNIQUES ET EFFETS DE GLISSEMENT DANS L’ECRITURE DU ROMAN By TOHOUEGNON CHRISTIAN AHIHOU A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2012 1 © 2012 Tohouégnon Christian Ahihou 2 To my Wife, Carolle Yêhouénou 3 ACKNOWLEDGMENTS I thank the French graduate committee of the Department of Languages, Literatures, and Cultures (University of Florida) for the Else Duelund scholarship that I received during the summer 2009 allowing me to travel to Porto-Novo (Benin) and to conduct the interview: “Entretien avec Ken Bugul.” I thank my dissertation director and also chair of my dissertation committee, Dr. Carol J. Murphy, for her continuous invaluable guidance and encouragement. In addition, I thank the other professors, members of my dissertation committee: Dr. Alioune Sow, Dr. William Calin, and Dr. Fiona McLaughlin, for their careful readings, extremely helpful comments and ongoing support. Furthermore, I thank all my instructors from elementary school to now. Last but not least, I thank my parents, Pierrette and Julien, for having built up the educated man that I have become. 4 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGMENTS .................................................................................................. 4 LIST OF TABLES ............................................................................................................ 8 LIST OF OBJECTS ........................................................................................................ -

Dialogue Avec Ken Bugul Et Edem Awumey Mbaye Diouf
Document généré le 29 sept. 2021 05:57 Études littéraires Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey Mbaye Diouf Géographies transnationales du texte africain et caribéen Volume 46, numéro 1, hiver 2015 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1035088ar DOI : https://doi.org/10.7202/1035088ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Département des littératures de l’Université Laval ISSN 0014-214X (imprimé) 1708-9069 (numérique) Découvrir la revue Citer ce document Diouf, M. (2015). Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey. Études littéraires, 46(1), 119–133. https://doi.org/10.7202/1035088ar Tous droits réservés © Université Laval, 2015 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Entretiens d’auteurs ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey MBAYE DIOUF en Bugul (la « bannie », en wolof) est l’une des écrivaines majeures de la littérature sénégalaise et africaine d’expression française. De son vrai Knom Mariétou Mbaye, elle a une trajectoire sociale particulièrement riche d’expériences diverses (sans-abri à Dakar, épouse d’un marabout polygame, immigrante exploitée à Bruxelles, animatrice culturelle à Porto-Novo, fonctionnaire internationale, etc.) qui lui a souvent offert la matière première de ses romans. -

From Local to Global. New Paths for Publishing in Africa. Nathalie Carré
From local to global. New paths for publishing in Africa. Nathalie Carré To cite this version: Nathalie Carré. From local to global. New paths for publishing in Africa.. 2016. hal-01389097 HAL Id: hal-01389097 https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/hal-01389097 Preprint submitted on 27 Oct 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. From local to global. New paths for publishing in Africa1 How can one’s voice be heard on a global scale? Historically, the writing, selling, and reading of books has been a central means through which stories have been shared across distance. Despite the wide-ranging nature of print, however, in Africa, books and publishers still struggle to get their share of attention. Not only is the volume of African book production dramatically underrepresented in the world2 but the African publishing industry has also had to contend with the ongoing legacies of former colonial monopolies. At the same time, if printing books and selling them across national borders has always been one of the main stumbling blocks to the African publishing trade, then it is reasonable to think that the new technologies and media that have emerged at the turn of the millenium might enable the written word to travel more easily across the continent and beyond, expanding the reach and circulation of African publishing, and African knowledge, today. -

Dialogue Avec Ken Bugul Et Edem Awumey Mbaye Diouf
Document généré le 1 avr. 2021 09:30 Études littéraires Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey Mbaye Diouf Géographies transnationales du texte africain et caribéen Volume 46, numéro 1, hiver 2015 URI : https://id.erudit.org/iderudit/1035088ar DOI : https://doi.org/10.7202/1035088ar Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Département des littératures de l’Université Laval ISSN 0014-214X (imprimé) 1708-9069 (numérique) Découvrir la revue Citer ce document Diouf, M. (2015). Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey. Études littéraires, 46(1), 119–133. https://doi.org/10.7202/1035088ar Tous droits réservés © Université Laval, 2015 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ Entretiens d’auteurs ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey MBAYE DIOUF en Bugul (la « bannie », en wolof) est l’une des écrivaines majeures de la littérature sénégalaise et africaine d’expression française. De son vrai Knom Mariétou Mbaye, elle a une trajectoire sociale particulièrement riche d’expériences diverses (sans-abri à Dakar, épouse d’un marabout polygame, immigrante exploitée à Bruxelles, animatrice culturelle à Porto-Novo, fonctionnaire internationale, etc.) qui lui a souvent offert la matière première de ses romans. -

Les Territoires De L'écriture : Dialogue Avec Ken Bugul Et Edem Awumey
Document generated on 09/23/2021 10:49 a.m. Études littéraires Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey Mbaye Diouf Géographies transnationales du texte africain et caribéen Volume 46, Number 1, Winter 2015 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1035088ar DOI: https://doi.org/10.7202/1035088ar See table of contents Publisher(s) Département des littératures de l’Université Laval ISSN 0014-214X (print) 1708-9069 (digital) Explore this journal Cite this document Diouf, M. (2015). Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey. Études littéraires, 46(1), 119–133. https://doi.org/10.7202/1035088ar Tous droits réservés © Université Laval, 2015 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Entretiens d’auteurs ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Les territoires de l’écriture : dialogue avec Ken Bugul et Edem Awumey MBAYE DIOUF en Bugul (la « bannie », en wolof) est l’une des écrivaines majeures de la littérature sénégalaise et africaine d’expression française. De son vrai Knom Mariétou Mbaye, elle a une trajectoire sociale particulièrement riche d’expériences diverses (sans-abri à Dakar, épouse d’un marabout polygame, immigrante exploitée à Bruxelles, animatrice culturelle à Porto-Novo, fonctionnaire internationale, etc.) qui lui a souvent offert la matière première de ses romans. -

LR14 Ken Bugul- Migration Politics
LINGUA ROMANA VOL 14, ISSUE 1 PUBLIC LECTURE Migration and Politics in Africa Ken Bugul SUMMARY Public lecture presented at the BYU Kennedy Center for International Studies, 28 February 2018 MAREN MONSON, KENNEDY CENTER (Introduction): Ken Bugul is the pen name of the acclaimed and influential Senegalese woman writer Mariètou Mbaye Biléoma and means, in the Wolof language, “one who is unwanted.” She is one of the most renowned authors in francophone African literature. Her writings are also some of the most disputed due to her controversial positions on social issues. She is the author of ten novels published to date, the first being Le baobab fou in 1983 and the most recent, titled Cacophonie, published in 2014. In 1999, she was awarded the Grand Prix littéraire de l’Afrique noire for her third novel, Riwan ou le chemin de sable. In addition to the theme of women conditions in Africa, her works also deal with politics and migration. In her writing, she calls for a collective awareness of oppressed African people who can no longer languish in lethargy and feed on endless illusions. The title of her lecture today is “Migration and Politics in Africa.” In addition to discussing these topics, she will address how she includes these themes in her works as an artist writer. Please join me in welcoming Ken Bugul. KEN BUGUL: Good morning or afternoon, yes, afternoon. Bonjour tout le monde, good afternoon everybody. I’m very happy to be here and very glad to be among the students and the directors and teachers and friends; I’m very impressed. -

Cahiers D'études Africaines, 186 | 2007
Cahiers d’études africaines 186 | 2007 Varia Between Fiction and History Modes of Writing Abortion in Africa Nancy Rose Hunt Electronic version URL: http://journals.openedition.org/etudesafricaines/7100 DOI: 10.4000/etudesafricaines.7100 ISSN: 1777-5353 Publisher Éditions de l’EHESS Printed version Date of publication: 31 May 2007 Number of pages: 277-312 ISBN: 978-2-7132-2139-2 ISSN: 0008-0055 Electronic reference Nancy Rose Hunt, « Between Fiction and History », Cahiers d’études africaines [Online], 186 | 2007, Online since 31 May 2010, connection on 17 June 2020. URL : http://journals.openedition.org/ etudesafricaines/7100 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.7100 This text was automatically generated on 17 June 2020. © Cahiers d’Études africaines Between Fiction and History 1 Between Fiction and History Modes of Writing Abortion in Africa1 Nancy Rose Hunt “A history of ... modes of writing would therefore be the best of social phenomenologies.” Roland Barthes, 1953 “The older distinction between fiction and history ... must give place to the recognition that we can only know the actual by contrasting it with or likening it to the imaginable.” Hayden White, 1978 1 “May I comment on illegal abortions that have become a daily resort for our unmarried women in the country today.” So wrote Patrick J. Euppa to the editorial pages of Tanzania’s Sunday Post in 1971. “In such cases, death is a close companion. If it does not end in death, then there is a danger of infection, sometimes leading to sterility [. .]. The high rate of criminal abortion is probably due to the fact that our African women are marrying much later. -

Why Come Back? Sense of Place and Senegalese Student Migration
Why come back? Sense of Place and Senegalese Student Migration Megan Coggeshall Lewis & Clark College Portland, OR A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with honors Environmental Studies Program Second Major: French Studies May 2012 Coggeshall 2 Abstract In this thesis I study sense of place in the context of migration between Senegal and France for educational purposes. In order to determine the ways in which Senegalese people attach meaning to France and Senegal, and the implications of these meanings, I analyze three Senegalese novels: Ambiguous Adventure by Cheikh Hamidou Kane, The Abandoned Baobab by Ken Bugul, and Patera by Aïssatou Diamanka-Besland. I compare these novels to surveys of current Senegalese students to investigate the themes in how sense of place is expressed by individuals. I explore the tensions between nomothetic and idiographic tendencies of place and the external or internal conceptions of place in order to determine the implications of these tensions for environmental discourse. I argue that the tension between embodying meaning in material and ideal elements of place in these migration narratives is intimately linked to Senegal’s colonial past. Furthermore, historical, social, and political elements interestingly intersect in these real and literary accounts and affect how people indentify with their environments. Based on themes that arise in student narratives, place proves to be a useful tool not only for understanding environmental concern, but -
ARTS NÈGRES Du 10 Au 31 Décembre 2010 En Bas De Liste, Vous Trouverez Les Expositions, Ateliers, Évènements Itinérants Ainsi Que Les Festivals Labellisés
Programme du 3ème Festival Mondial des ARTS NÈGRES Du 10 au 31 décembre 2010 En bas de liste, vous trouverez les expositions, ateliers, évènements itinérants ainsi que les festivals labellisés. Mise à jour le 30/12/10. ven 10 Forum: ouverture et conférence structurante 1:" Les diasporas africaines : Géographie-Peuplement- 9-18h Hôtel Méridien Histoire-Situation politique". Runoko Rashidi (USA), V.T. Rajshekar (Inde), Sheila Walker (USA), Julio Cesar de Tavares (Brasil) Cérémonie d'ouverture: grand spectacle avec percussions, vidéos, danse, film et concert avec Stade Léopold Angélique Kidjo, Youssou Ndour, Doudou Ndiaye Rose, Mahotella Queens, Minyeshu, Ismaël Lô, Baba 19-21h Sedar Senghor Maal, Manu Dibango et la participation exceptionnelle de Samba Diabaré Samb, Khar Mbaye Madiaga, Samba Alioune Guissé. sam 11 Biscuiterie de Café littéraire: "Le chant des ténèbres" de Fama Diagne Sene en sa présence 9h Medina Forum: Table ronde sur la Renaissance africaine animée par Théophile Obenga, Iba Der Thiam, Djibril Hôtel Méridien 9-13h Tamsir Niane Stade Léopold 15h30 Sport: match international Sénégal moins de 17 ans - Brésil moins de 17 ans Sedar Senghor Biscuiterie de 16h Littérature, Café littéraire, Ken Bugul, animé par Racine Senghor Medina Stade Léopold 17h30 Sport: football, match international Sénégal moins de 20 ans - São Paulo FC moins de 20 ans Sedar Senghor 17h30 Village des Arts Vernissage de l’exposition: Hommage à Le Kara et Moussa Dabo Fall Cinéma: "Bamako" de Abderrahmane Sissako (Mali) et "Eia pour Césaire" de Sarah Maldoror -
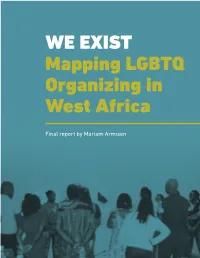
WE EXIST Mapping LGBTQ Organizing in West Africa
WE EXIST Mapping LGBTQ Organizing in West Africa Final report by Mariam Armisen TABLE OF CONTENTS 5 1. INTRODUCTION 5 1.1. THE NEED FOR LGBTQ-LED FUNDING IN WEST AFRICA 6 1.2. THE RESEARCH PROCESS 6 1.3. LIMITATIONS 8 2. SETTING THE CONTEXT 8 2.1 LEGAL ENVIRONMENT 9 2.2. A BRIEF HISTORY OF QUEER ORGANIZING 9 2.2.1 From Social Gathering to Activism 10 2.2.2 Identity-Based Organizing and the Prioritization of Issues 10 2.2.3. Current Types of Activism and Organizing 11 2.2.4. Collaboration and Networking 12 3. THE STATE OF THE MOVEMENT – MAPPING LGBTQ AND MSM ORGANIZING IN WEST AFRICA 12 3.1. LOCATION 12 3.2. ISSUES, PRIORITIES AND RESPONSES 13 3.2.1. Issues Facing LGBTQ Communities and Individuals 14 3.2.2. Strategies and Responses 16 3.3. GAPS 17 3.3.1. Understanding Transgender Identity and Supporting the Rights and Leadership of Trans* People 17 3.3.2. Youth Leadership and Inclusion of Youth Issues 17 3.3.3. Sexual and Reproductive Health of Queer Women 18 3.3.4. Same-sex Partner Violence 18 3.3.5. Reconciling Faith, Religion, and Homosexuality 18 3.3.6. Economic Empowerment 19 3.4. WORKING CONDITIONS OF LGBTQ AND MSM GROUPS AND ORGANIZATIONS 19 3.4.1 External Challenges 19 3.4.2 Internal Challenges 21 3.5. ACHIEVEMENTS 23 4. SOURCE OF SUPPORT – MAPPING TECHNICAL SUPPORT PROVIDERS AND FUNDERS 25 5. SOURCES OF MONEY – FUNDING CHALLENGES 27 6. EXPECTATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR AN LGBTQ-LED FUND 27 TECHNICAL SUPPORT PROVIDERS, LOCAL FUNDERS AND ALLY ORGANIZATIONS MADE RECOMMENDATIONS IN THREE CATEGORIES: 28 INTERNATIONAL FUNDERS RECOMMENDED THAT THE FUND: 29 7. -

Primacy, Polemic, and Paradox in Ken Bugul's the Abandoned Baobab
Asaah, A. H./Legon Journal of the Humanities Vol. 31.1 (2020) DOI: https://dx.doi.org/10.4314/ljh.v31i1.2 Primacy, polemic, and paradox in Ken Bugul’s The abandoned baobab Augustine H. Asaah Professor Department of French University of Ghana, Legon, Ghana E-mail: [email protected], [email protected] Submitted: May 21, 2020 / Accepted: October 22, 2020 / Published: December 30, 2020 Abstract Arguably considered the prototype of African postcolonial feminist writing by reason of its poignant depiction of taboo subjects such as lesbianism, prostitution, drugs, and suicide, Ken Bugul’s The abandoned baobab has elicited sustained interest from the academy. This paper seeks to contribute to the debate by examining the strands of counter-discourse and postcolonial complicity within the context of the primacy ascribed to myths, the baobab, and the mother. It is driven by nativism and postcolonial theory. Far from constituting impregnable defense systems against hegemony, these primal forces prove to be limited in their protection of the protagonist. The paper concludes that even if the narrative foregrounds the mirage of hermetic identities and norms, it also defends Afrocentric development in the postcolony. Keywords: Ken Bugul, postcolonial theory, myth, baobab, mother Epigraph: “The past dissolves in the present, so that the future becomes (once again) an open question.” (Homi Bhabha) Introduction Ken Bugul, “The Unwanted One” in Wolof, is the pseudonym of Mariétou Mbaye-Biléoma1, one of Africa’s foremost writers. Since the publication of her fi rst fi ctional autobiography, Le baobab fou (1982), later translated into 1 Her maiden name is Mariétou Mbaye; Biléoma is the patronymic of her late husband, a Beninese doctor.