08 BECK Art00baseclo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Karst Science Reviews
REVIEWS AND REPORTS / POROčILA world karst science reviews International Journal of Speleology ISSN 0392-6672 October 2008 Volume 37, Number 3 Contact: Jo De Waele [email protected] Website: �ttp://www.ijs.speleo.it/ Special issue on Palaeoclimate, guest editor: Dominique Genty TABLE OF CONTENTS Report of a t�ree-year monitoring programme at Hes�ang Cave, Central C�ina. Hu C., Henderson G.M., Huang J., C�en Z. and Jo�nson K.R., pp. 143 -151. The environmental features of t�e Monte Corc�ia cave system (Apuan Alps, Central Italy) and t�eir effects on spele- ot�em growt�. Piccini L., Zanc�etta G., Drysdale R.N., Hellstrom J., Isola I., Fallick A.E., Leone G., Doveri M., Mussi M., Mantelli F., Molli G., Lotti L., Roncioni A., Regattieri E., Mecc�eri M. and Vaselli L., pp. 153-172. Palaeoclimate Researc� in Villars Cave (Dordogne, SW-France). Genty D., pp. 173-191. Annually Laminated Speleot�ems: a Review. Baker A., Smit� C.L., Jex C., Fairc�ild I.J., Genty D. and Fuller L., pp. 193-206. Environmental Monitoring in t�e Mec�ara caves, Sout�eastern Et�iopia: Implications for Speleot�em Palaeoclimate Studies. Asrat A., Baker A., Leng M.J., Gunn J. and Umer M., pp. 207-220. Monitoring climatological, �ydrological and geoc�emical parameters in t�e Père Noël cave (Belgium): implication for t�e interpretation of speleot�em isotopic and geoc�emical time-series. Ver�eyden S., Genty D., Deflandre G., Quinif Y. and Keppens E., pp. 221-234. BOOK REVIEWS Jo De Waele Inside mot�er Eart� (Max Wiss�ak, Edition Reuss, 152 pages, 2008 - ISBN 978-3-934020-67-2) Arrigo A. -

1422 Dating French and Spanish Prehistoric
DATING FRENCH AND SPANISH PREHISTORIC DECORATED CAVES IN THEIR ARCHAEOLOGICAL CONTEXTS H Valladas1 • E Kaltnecker1 • A Quiles1 • N Tisnérat-Laborde1 • D Genty1 • M Arnold2 • E Delqué-KoliË3 • C Moreau3 • D Baffier4 • J J Cleyet Merle5 • J Clottes6 • M Girard7 • J Monney8 • R Montes9 • C Sainz10 • J L Sanchidrian11 • R Simonnet12 ABSTRACT. The Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) research program on prehistoric art conducts chronological studies of parietal representations with their associated archaeological context. This multidisciplinary approach provides chronological arguments about the creation period of parietal representations. This article presents chrono- logical investigations carried out in several decorated caves in France (La Grande Grotte, Labastide, Lascaux, La Tête-du- Lion, Villars) and Spain (La Garma, Nerja, La Pileta, Urdiales). Several types of organic materials, collected from different areas of the caves close to the walls and in connection with parietal art, were dated to determine the periods of human presence in the cave, a presence that may have been related to artistic activities. These new radiocarbon results range from 33,000– 29,000 (La Grande Grotte) to 16,000–14,000 cal BP (Urdiales). INTRODUCTION Developing a chronological framework for Paleolithic parietal art (paintings and drawings) remains a difficult and controversial issue. Indeed, direct radiocarbon dating on paintings is exceptional, pri- marily because of preservation concerns and also due to the scarcity of organic pigments. Therefore, the results are not numerous and are often challenged. Reservations bear upon the taphonomic evo- lution of cave walls and especially upon the possible presence of extraneous organic materials, which can contaminate the parietal representations and thus distort the dating results. -
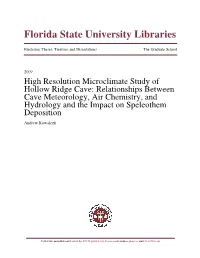
High Resolution Microclimate Study of Hollow Ridge Cave
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2009 High Resolution Microclimate Study of Hollow Ridge Cave: Relationships Between Cave Meteorology, Air Chemistry, and Hydrology and the Impact on Speleothem Deposition Andrew Kowalczk Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES HIGH RESOLUTION MICROCLIMATE STUDY OF HOLLOW RIDGE CAVE: RELATIONSHIPS BETWEEN CAVE METEOROLOGY, AIR CHEMISTRY, AND HYDROLOGY AND THE IMPACT ON SPELEOTHEM DEPOSITION By ANDREW KOWALCZK A Thesis submitted to the Department of Oceanography in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science Degree Awarded: Fall Semester, 2009 Copyright © 2009 Andrew Kowalczk All Rights Reserved The members of the committee approve the thesis of Andrew Kowalczk defended on October 12, 2009. __________________________________ Philip N Froelich Professor Directing Thesis __________________________________ Yang Wang Committee Member __________________________________ Doron Nof Committee Member __________________________________ Tom Scott Committee Member __________________________________ Bill Burnett Committee Member Approved: _____________________________________ William Dewar, Chair, Oceanography The Graduate School has verified and approved the above-named committee members. ii ACKNOWLEDGEMENTS The author would like to thank Nicole Tibbitts, Sammbuddha Misra, Ricky Peterson, Darrel Tremaine, Dr. Bill Burnett, Dr. Tom Scott, and Allen Mosler for editorial comments. The author would like to thank Darrel Tremaine, Craig Gaffka, Brian Kilgore, and Allen Mosler for assistance with field sampling. The author would like to thank Nicole Tibbitts, Sammbuddha Misra, Ricky Peterson, Natasha Dimova, Claire Langford, Dr. Michael Bizimus, Dr. Yang Wang, Dr. Yingfeng Xu, and Dr. Jeff Chanton for assistance in sample analyses and interpretation. -

Aerosol Contributions to Speleothem Geochemistry
AEROSOL CONTRIBUTIONS TO SPELEOTHEM GEOCHEMISTRY Jonathan Dredge A thesis submitted to the University of Birmingham for the University of Birmingham and University of Melbourne joint degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY School of Geography, Earth and Environmental Sciences College of Life and Environmental Sciences University of Birmingham April 2014 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract There is developing interest in cave aerosols due to the increasing awareness of their impacts on the cave environment and speleothems. This study presents the first multidisciplinary investigation into cave aerosols and their potential contribution to speleothem geochemistry. Aerosols are shown to be sourced from a variety of external emission processes, and transported into cave networks. Both natural (marine sea-spray, terrestrial dust) and anthropogenic (e.g. vehicle emissions) aerosol emissions are detected throughout caves. Internal cave aerosol production by human disruption has also been shown to be of importance in caves open to the public. Aerosols produced from floor sediment suspension and release from clothing causes short term high amplitude aerosol suspension events. Cave aerosol transport, distribution and deposition are highly variable depending on cave situation. -

Speleothem Climate Capture of the Neanderthal Demise
Speleothem climate capture of the Neanderthal demise Laura Melanie Charlotte Deeprose BSc (Hons), MSc June 2018 This thesis is submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. i Abstract The Iberian Peninsula is a region of climatic and archaeological interest as it lies upon the boundary between the North Atlantic and Mediterranean climatic zones and was the last refuge of the Neanderthals. The influence of climate changes on Neanderthal populations remains a mystery due to the lack of independently-dated high-resolution terrestrial records of past climate and environmental change from the Iberian Peninsula. The primary aim of this project was to construct a palaeoclimate record using speleothems from Matienzo, northern Iberia, across the period encapsulating the Neanderthal demise. Contemporary cave monitoring of Cueva de las Perlas has demonstrated the potential for speleothems to be used as indicators of past climate and environmental conditions. Assessment of cave dynamics through a comprehensive monitoring programme has classified the karst hydrology, cave ventilation, processes influencing speleothem growth and proxies preserved within speleothem calcite. Three speleothems were used to develop records of past climate and environmental variability between 90,000 and 30,000 years ago. A long-term aridity trend was evident throughout the record which is interpreted as a response to orbital-forcing. Sub-orbital climate instability was superimposed onto this long-term trend as evidenced through wet-dry proxies (δ18O, δ13C, Mg and Sr). Millennial-scale events coincident with the timing of North Atlantic Heinrich Events have been identified and the sub-orbital climate variability resembles that of North Atlantic Dansgaard- Oeschger cycles. -

Life and Death at the Pe Ş Tera Cu Oase
Life and Death at the Pe ş tera cu Oase 00_Trinkaus_Prelims.indd i 8/31/2012 10:06:29 PM HUMAN EVOLUTION SERIES Series Editors Russell L. Ciochon, The University of Iowa Bernard A. Wood, George Washington University Editorial Advisory Board Leslie C. Aiello, Wenner-Gren Foundation Susan Ant ó n, New York University Anna K. Behrensmeyer, Smithsonian Institution Alison Brooks, George Washington University Steven Churchill, Duke University Fred Grine, State University of New York, Stony Brook Katerina Harvati, Univertit ä t T ü bingen Jean-Jacques Hublin, Max Planck Institute Thomas Plummer, Queens College, City University of New York Yoel Rak, Tel-Aviv University Kaye Reed, Arizona State University Christopher Ruff, John Hopkins School of Medicine Erik Trinkaus, Washington University in St. Louis Carol Ward, University of Missouri African Biogeography, Climate Change, and Human Evolution Edited by Timothy G. Bromage and Friedemann Schrenk Meat-Eating and Human Evolution Edited by Craig B. Stanford and Henry T. Bunn The Skull of Australopithecus afarensis William H. Kimbel, Yoel Rak, and Donald C. Johanson Early Modern Human Evolution in Central Europe: The People of Doln í V ĕ stonice and Pavlov Edited by Erik Trinkaus and Ji ří Svoboda Evolution of the Hominin Diet: The Known, the Unknown, and the Unknowable Edited by Peter S. Ungar Genes, Language, & Culture History in the Southwest Pacifi c Edited by Jonathan S. Friedlaender The Lithic Assemblages of Qafzeh Cave Erella Hovers Life and Death at the Pe ş tera cu Oase: A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus, Silviu Constantin, and Jo ã o Zilh ã o 00_Trinkaus_Prelims.indd ii 8/31/2012 10:06:30 PM Life and Death at the Pe ş tera cu Oase A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus , Silviu Constantin, Jo ã o Zilh ã o 1 00_Trinkaus_Prelims.indd iii 8/31/2012 10:06:30 PM 3 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. -

2012 Bizkaiko Arkeologi Indusketak • BAI • 2 La Cueva De Askondo
2012 Bilbao 2012 KOBIE • Serie Excavaciones Arqueológicas - Bizkaiko Arkeologi Indusketak • 2 2012 Bizkaiko Arkeologi Indusketak • BAI • 2 ARTÍCULOS HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CUEVA DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) History of the investigation in Askondo cave (Mañaria, Bizkaia). Por Diego Garate Maidagan, Joseba Rios Garaizar y Ander Ugarte Cuétara LOS RASGOS Y PROCESOS KÁRSTICOS DE LA CUEVA DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) k The karst characteristics and processes in Askondo cave (Mañaria, Bizkaia). Por Eneko Iriarte Avilés, Elena Santos Ureta y Jorge González García EL TERRITORIO DE LA CUEVA DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) o The territory of Askondo cave (Mañaria, Bizkaia) Por Alejandro García Moreno EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CUEVA DE ASKONDO (MAÑARIA, ASKONDO) Archaeological excavation in Askondo cave (Mañaria, Askondo) b Por Joseba Rios Garaizar, Diego Garate Maidagan y Encarnación Regalado Bueno DATACIONES DE RADIOCARBONO EN EL YACIMIENTO DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) Radiocarbon datings from Askondo site (Mañaria, Bizkaia) i Por Joseba Rios Garaizar y Diego Garate Maidagan DATACIÓN MEDIANTE RACEMIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS DE RESTOS DE URSUS SPELAEUS DEL YACIMIENTO DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) Aspartic Acid Racemization dating of Ursus spelaeus remains from Askondo site (Mañaria, Bizkaia) e Por Trinidad Torres Pérez-Hidalgo y José Eugenio Ortiz Menéndez ESTUDIO ARQUEOZOOLOGICO DE LOS MACROMAMIFEROS DEL YACIMIENTO DE ASKONDO (MAÑARIA, BIZKAIA) Archeozoological analysis of macromammal assemblage from Askondo site (Mañaria, Bizkaia) -

L'utilisation Des Reliefs Pariétaux Dans La Réalisation Des Signes Au Paléolithique Supérieur Utilization of Parietal Reli
L’anthropologie 111 (2007) 467–500 http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/ Article original L’utilisation des reliefs pariétaux dans la réalisation des signes au Paléolithique supérieur Utilization of parietal relief for realization of signs during Upper Paleolithic Eric Robert * 7, avenue de la République, 92350 Le Plessis-Robinson, France Résumé La représentation des images du Paléolithique s’est longtemps effectuée de manière à mettre en valeur leurs qualités esthétiques, en ignorant les caractéristiques particulières de leurs supports naturels. L’architecture des grottes ornées, à plusieurs niveaux, participe pourtant pleinement à l’élaboration des dispositifs pariétaux. Eléments omniprésents de ces dispositifs, les signes occupent une place déterminante au sein de cette architecture. L’analyse des relations entre les signes et leurs supports directs permet de mettre en lumière différents modes d’utilisation des reliefs pariétaux, intégration, recherche des volumes et cadrage. Une étude de terrain menée sur un échantillon de 692 signes, répartis dans l’espace paléolithique franco-cantabrique, fait ainsi apparaître la diversité des choix graphiques des artistes face à la paroi. # 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Abstract For a long time, the images of the Upper Paleolithic were represented in a way that emphasized their aesthetic qualities and ignored the specific characteristics of their natural supports. It is more damageable as the architecture of the decorated caves plays a real part, at different levels, in the elaboration of the parietal devices. As omnipresent elements of these devices, the signs play a determining part in this architecture. Analysing the links between the signs and their direct supports brings to light the various ways in which parietal devices can be used and also the integration and research for the volumes and frame. -

Exceptional Warmth and Climate Instability Occurred in the European Alps During the Last Interglacial Period ✉ Paul S
ARTICLE https://doi.org/10.1038/s43247-020-00063-w OPEN Exceptional warmth and climate instability occurred in the European Alps during the Last Interglacial period ✉ Paul S. Wilcox 1 , Charlotte Honiat1, Martin Trüssel2, R. Lawrence Edwards3 & Christoph Spötl 1 Warmer temperatures than today, over a period spanning millennia, most recently occurred 1234567890():,; in the Last Interglacial period, about 129,000 to 116,000 years ago. Yet, the timing and magnitude of warmth during this time interval are uncertain. Here we present a recon- struction of temperatures in the Swiss Alps over the full duration of the Last Interglacial period based on hydrogen isotopes from fluid inclusions in precisely dated speleothems. We find that temperatures were up to 4.0 °C warmer during the Last Interglacial period than in our present-day reference period 1971 to 1990. Climate instability, including an abrupt cooling event about 125,500 years ago, interrupted this thermal optimum but temperatures remained up to 2.0 °C warmer than the present day. We suggest that higher-elevation areas may be more susceptible to warming relative to lowland areas, and that this may hold also for a future climate forced by increasing levels of greenhouse gases. 1 Institute of Geology, University of Innsbruck, 6020 Innsbruck, Austria. 2 Foundation Naturerbe Karst und Höhlen Obwalden (NeKO), 6055 ✉ Alpnach, Switzerland. 3 Department of Earth Sciences, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, USA. email: [email protected] COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | (2020) 1:57 | https://doi.org/10.1038/s43247-020-00063-w | www.nature.com/commsenv 1 ARTICLE COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | https://doi.org/10.1038/s43247-020-00063-w he Last Interglacial period (LIG), roughly equivalent to TMarine Isotope Stage (MIS) 5e, ~129–116 thousand years 5 ago (ka), is currently the focus of increased interest as it provides a potential test bed for warmer conditions on Earth. -

AMBASSADORS and LOCAL PERSONALITIES Meeting with Those Who Love the Périgord
Dordogne-Périgord We set the scene, you write the story...... AMBASSADORS AND LOCAL PERSONALITIES Meeting with those who love the Périgord HERITAGE Exceptional sites and monuments ACCOMMODATION Holiday rentals, THINGS bed and breakfast, to see and do hotels and camping 1 | DORDOGNE PERIGORD Edirial Eggletone © Steve ILOTOPIE 2016 - Cie Mimos Welcome to the Dordogne Périgord region his 2019-2020 edition of the Holiday and berries, walnuts and the excellent wines produced by Leisure Magazine opens new pages on the his- our local Bergerac wine-growers. Join us in the fun and tory of the region and personal testimonials, festivities which express so well the hospitality of our inviting you to come and discover the Périgord region, share many unique experiences with your family for your next holidays. For this fifth edition, or friends, without moderation, as your fancy takes you. Twe have chosen, as our Ambassadors and Local Perso- Come and enjoy a wonderful holiday, whether it be en- nalities, men and women who perpetuate the spirit of ergetic, gourmet or cultural... the Périgord by the diversity and richness of their lives There is gold to be discovered in the Périgord… golden and their experiences. They will charm you with their adventures, golden emotions and the pure gold of our knowledge and love for this region, and invite you to gourmet cuisine. join them in adopting the “Périgord Attitude”! So, make the decision, choose your made-to-measure This magazine is also a long journey through time, as sightseeing and activities programme and… have a great seen in the presence of Man in the Dordogne Périgord holiday in the Périgord! for more than 400 000 years. -

Life and Death at the Pe Ş Tera Cu Oase
Life and Death at the Pe ş tera cu Oase 00_Trinkaus_Prelims.indd i 8/31/2012 10:06:29 PM HUMAN EVOLUTION SERIES Series Editors Russell L. Ciochon, The University of Iowa Bernard A. Wood, George Washington University Editorial Advisory Board Leslie C. Aiello, Wenner-Gren Foundation Susan Ant ó n, New York University Anna K. Behrensmeyer, Smithsonian Institution Alison Brooks, George Washington University Steven Churchill, Duke University Fred Grine, State University of New York, Stony Brook Katerina Harvati, Univertit ä t T ü bingen Jean-Jacques Hublin, Max Planck Institute Thomas Plummer, Queens College, City University of New York Yoel Rak, Tel-Aviv University Kaye Reed, Arizona State University Christopher Ruff, John Hopkins School of Medicine Erik Trinkaus, Washington University in St. Louis Carol Ward, University of Missouri African Biogeography, Climate Change, and Human Evolution Edited by Timothy G. Bromage and Friedemann Schrenk Meat-Eating and Human Evolution Edited by Craig B. Stanford and Henry T. Bunn The Skull of Australopithecus afarensis William H. Kimbel, Yoel Rak, and Donald C. Johanson Early Modern Human Evolution in Central Europe: The People of Doln í V ĕ stonice and Pavlov Edited by Erik Trinkaus and Ji ří Svoboda Evolution of the Hominin Diet: The Known, the Unknown, and the Unknowable Edited by Peter S. Ungar Genes, Language, & Culture History in the Southwest Pacifi c Edited by Jonathan S. Friedlaender The Lithic Assemblages of Qafzeh Cave Erella Hovers Life and Death at the Pe ş tera cu Oase: A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus, Silviu Constantin, and Jo ã o Zilh ã o 00_Trinkaus_Prelims.indd ii 8/31/2012 10:06:30 PM Life and Death at the Pe ş tera cu Oase A Setting for Modern Human Emergence in Europe Edited by Erik Trinkaus , Silviu Constantin, Jo ã o Zilh ã o 1 00_Trinkaus_Prelims.indd iii 8/31/2012 10:06:30 PM 3 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. -
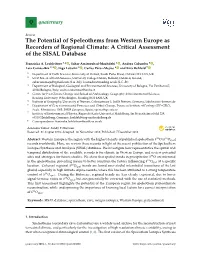
The Potential of Speleothems from Western Europe As Recorders of Regional Climate: a Critical Assessment of the SISAL Database
quaternary Review The Potential of Speleothems from Western Europe as Recorders of Regional Climate: A Critical Assessment of the SISAL Database Franziska A. Lechleitner 1,* , Sahar Amirnezhad-Mozhdehi 2 , Andrea Columbu 3 , Laia Comas-Bru 2,4 , Inga Labuhn 5 , Carlos Pérez-Mejías 6 and Kira Rehfeld 7 1 Department of Earth Sciences, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3AN, UK 2 UCD School of Earth Sciences, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland; [email protected] (S.A.-M.); [email protected] (L.C.-B.) 3 Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna, Via Zamboni 67, 40126 Bologna, Italy; [email protected] 4 Centre for Past Climate Change and School of Archaeology, Geography & Environmental Sciences, Reading University, Whiteknights, Reading RG6 6AH, UK 5 Institute of Geography, University of Bremen, Celsiusstrasse 2, 28359 Bremen, Germany; [email protected] 6 Department of Geoenvironmental Processes and Global Change, Pyrenean Institute of Ecology (IPE–CSIC), Avda. Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Spain; [email protected] 7 Institute of Environmental Physics, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 229, 69210 Heidelberg, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected] Academic Editor: Sandy P. Harrison Received: 31 August 2018; Accepted: 30 November 2018; Published: 7 December 2018 18 18 Abstract: Western Europe is the region with the highest density of published speleothem δ O(δ Ospel) records worldwide. Here, we review these records in light of the recent publication of the Speleothem Isotopes Synthesis and AnaLysis (SISAL) database. We investigate how representative the spatial and temporal distribution of the available records is for climate in Western Europe and review potential sites and strategies for future studies.