2. Les Eaux Souterraines
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
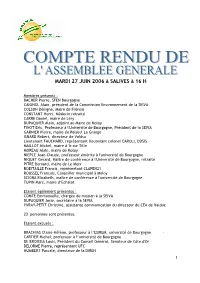
Mardi 27 Juin 2006 À Salives À 16 H
MARDI 27 JUIN 2006 à SALIVES à 16 H Membres présents : BACHER Pierre, SFEN Bourgogne CAIGNOL Alain, président de la Commission Environnement de la SEIVA COLSON Bénigne, Maire de Frénois CONSTANT Henri, Médecin retraité CARRE Daniel, maire de Léry DUPAQUIER Alain, adjoint au Maire de Moloy FINOT Eric, Professeur à l'Université de Bourgogne, Président de la SEIVA GARNIER Pierre, maire de Poiseul La Grange ISNARD Robert, directeur de Valduc Lieutenant FAUCHARD, représentant lieutenant colonel CAROLI, DDSIS MAILLOT Michel, maire d’Is sur Tille MOREAU Alain, maire de Moloy NIEPCE Jean-Claude, professeur émérite à l'université de Bourgogne NIQUET Gérard, Maître de conférence à l'Université de Bourgogne, retraité PITRE Bernard, maire de Le Meix ROBITAILLE Francis, représentant CLAPEN21 ROUSSEL François, Conseiller municipal à Moloy SCIORA Elisabeth, maître de conférence à l'université de Bourgogne TUPIN Marc, maire d’Echalot Etaient également présentes : COMTE Emmanuelle, chargée de mission à la SEIVA DUPAQUIER Josie, secrétaire à la SEIVA YVRAY-PETIT Christine, assistante communication du directeur du CEA de Valduc 23 personnes sont présentes. Etaient excusés : BRACHIAS Claire-Hélène, professeur à l’ESIREM, université de Bourgogne - CARTIER Michel, professeur à l’université de Bourgogne DE BROISSIA Louis, Président du Conseil Général, Sénateur de Côte d'Or DELORME Pierre, représentant UFC HUMBERT Pascale, directrice de la DIREN 1 LAVOREL Bruno, membre du comité scientifique de la SEIVA Henri REVOL, sénateur de la Côte d'Or, Président de l'Office parlementaire d'Evaluation des choix scientifiques et technologiques, conseiller général honoraire, maire de Messigny et Vantoux François SAUVADET, député de Côte d'Or, Vice-Président de la Commission des Affaires Economiques de l'Environnement et du Territoire de l'Assemblée Nationale 1- Informations générales SEIVA : Dans un premier temps, Eric FINOT remercie Alain HOUPERT de nous recevoir à Salives, dans cette magnifique salle. -

Sorties Route 3T 2021
CYCLOS RANDONNEURS DIJONNAIS 21, rue du Général-Fauconnet 20100 DIJON Internet : http:/www.cyclos-rando-dijon.fr/accueil.html Courriel : [email protected] ROUTE VTT Sorties Route du 4ème trimestre 2021 Lundi - Mercredi - Samedi - Dimanche et Jours de fête GROUPES et RESPONSABLES Groupe A : 1 Semaine 40 – du 1er octobre au 03 OCTOBRE Samedi 02/10 A 13H30 Dijon - Ruffey - St Julien - Spoy - Pichanges - Local Gemeaux - Marcilly - Is/Tille - Villecomte - Vernot - 100 km Francheville - Prairay - Cestres - Froideville - Bordes Bricard - Fromenteau - Val Suzon - Messigny - Ahuy – Dijon. (100 km) Dimanche 03/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Brognon – Tanay – Mirebeau – Local Beaumont – Licey – Attricourt – St Seine – Pouilly s 100 km Vingeanne – Mornay – Montigny – La Villeneuve – Fontaine Française – Bourberain – Bèze – Vievigne – Beire – Arcelot – Varois – Dijon. Semaine 41 – du 04 OCTOBRE au 10 OCTOBRE Lundi 04/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé Local 100 km Mercredi 06/10 A 13H30 Dijon – Plombières – D 10 - Lantenay – Mâlain – Baulme Lac Kir la Roche – Fromenteau – St Seine – Cinq Fonts – Prairay 100 km – Francheville – Vernot – Villecomte – Is s Tille – Gemeaux – Pichanges – Flacey – St Julien – Dijon. (100 km - D+ 900) Samedi 09/10 A 13H30 Dijon – Plombières – Pont de Pany – Barbirey – Jaugey – Local L’Oiserolle - Commarin - Sombernon – Puits XV – Val 92 km Courbe – Val Suzon – Messigny - Dijon. (92 km) Dimanche 10/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Flacey – Pichanges – Spoy – Vievigne Local – Bèze – Mirebeau – Oisilly – Renêve – Cheuge – 88 km Bézouotte – Cuiserey – Belleneuve – Arcelot – Varois - Dijon. (88km) Semaine 42 – du 11 OCTOBRE au 16 OCTOBRE Lundi 11/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé. Local 88 km Mercredi 13/10 A 13H30 Ahuy – Messigny – Saussy – Moloy – Lamargelle – St Lidl Ahuy Seine – Bligny le Sec – Fromenteau - Pasques - 95 km Plombières – Dijon. -

Plan Is-Sur-Tille / Marcilly-Sur-Tille
Ambulance Taxis de la Tille Entreprise GUILLOT-LAGRANGE SPORT&MODE… ACHAT • VENTE • LOCATION MAÇONNERIE & TERRASSEMENT estimation gratuite Constructions neuves • Extensions d’habitations sur simple demande Aménagements extérieurs * 12 rue Jean Zay - 21120 Is-sur-Tille 0 950 960 850 21120 MARCILLY-SUR-TILLE Les mêmes prix qu’à Dijon à 2 pas de chez vous ou promotions… *hors catalogues [email protected] Tél-fax 03 80 95 28 49 3 place Dr Grépin - 21120 IS-SUR-TILLE - Tél-fax 03 80 95 29 73 03 80 95 15 20 AGENCE D'IS-SUR-TILLE - 2 RUE MARÉCHAL FOCH [email protected] Retrouvez votre magasin sur www.sport-is.fr D959 Z.I. CHAMPS BEZANÇON d GRANCEY D120 LE CHATEAU AVELANGES SELONGEY CORDIER in in a MYRAL ric SYSTEM é C.T. GROUP r. du Président Wilson Président du r. m CG21 C A h p r . u d e u Ba Américain Camp du route m G a e CR 17 o s C rg du u rue du Triage ruedu e d s M e S t e e SEB ut u r ra e o s y r z Impasse e r CVO 9 STATION DE è i du Pré r rue du Poste A TRAITEMENT r Zone aux Mauves a chemin d’Échevannes DES EAUX chemin de Corberon C artisanale s USÉES e Ligne SNCF IS-SUR-TILLE - CHALINDREY chemi d e CVO 9 n d t u e Petit C d t loch u n o er r h rue de rra c Montchevreuil te o R it CR 8 Z.A. -

Dijon Céréales
Jeudi 13 décembre 2018 | Côte-d’Or Tourisme PALMARÈS Remise des Trophées départementaux 2 18 de la valorisation paysagère Les communes labellisées Le palmarès départemental Le club fleurissement Les partenaires et les donateurs © Rozenn Krebel © Rozenn DIJON CÉRÉALES Notre partenaire depuis 1998 te-d'Or Tour Cô ism de e s d e e ir p a u n i s e t 1 r 9 a 9 P 8 GROUPE DIJON CÉRÉALES © Rozenn Krebel © Rozenn Le partenariat entre Côte-d’Or Tourisme et le groupe Dijon Céréales en quelques dates 1998 2003 Première collaboration en matière Organisation de demi-journées de de conseil personnalisé aux communes sur sensibilisation et de réunions de pays sur lesquelles existe une activité dépendant du l’ensemble de la Côte-d’Or groupe Dijon Céréales 2011 1999 Mise en place d’un accompagnement Signature d’une convention visant à élargi aux communes visant à moyen terme cofinancer un emploi-jeune formé aux tech- l’obtention du label national niques paysagères 2013 2001 Organisation de réunions de sensibilisa- Mise en place du mécénat Dijon Céréales tion sur la gestion paysagère de l’espace public afin de mandater un paysagiste professionnel pour assurer un conseil aux communes toutes 2018 proches de l’obtention du label national « villes et Première édition des « Rendez-vous de villages fleuris » la valorisation paysagère » en Côte-d’Or Marie-Claire BONNET-VALLET Vice-présidente du Conseil départemental (canton d’Auxonne) Présidente de Côte-d’Or Tourisme 20 ans de partenariat fructueux ! Côte-d’Or Tourisme et le groupe Dijon Céréales partagent la même vision pour dynamiser la valorisation paysagère… la belle aventure commune dure déjà depuis vingt ans. -
Guide Côte-D'or
GUIDE CÔTE-D'OR Produits fermiers & accueil à la ferme www.bienvenue-a-la-ferme.com Edito En Côte-d'Or, le réseau des producteurs fermiers Bienvenue à la Ferme vous invite à "goûter notre nature" ! Cette nature est faite : - d'une agriculture responsable et locale, - d'un tourisme à visage humain, - de produits sains et savoureux, - de rencontres conviviales et enrichissantes. Ces femmes et ces hommes cultivent la différence, vous proposent des produits de qualité et un service à la hauteur de vos attentes. A très bientôt à la rencontre des producteurs ! Ce guide vous propose les 5 activités de Bienvenue à la Ferme HEBERGEMENTS : LOISIRS RESTAURATION MAGASINS FERMIERS PRODUITS FERMIERS Sommaire Hébergements ......................................... p.4 à 6 • Gîtes à la ferme ........................................................ p.4 • Chambres d’hôtes .................................................... p.5 • Campings à la ferme ................................................ p.6 Loisirs à la ferme ....................................p.8 et 9 Restauration ................................................p.10 • Fermes auberges .................................................... p.10 Magasins fermiers .............................. p.12 à 13 Produits fermiers ................................. p.16 à 34 • Spécialités .............................................................. p.16 • Légumes - céréales - lentilles .................................p.17 • Fromages et produits laitiers .................................p.23 • Viandes - -
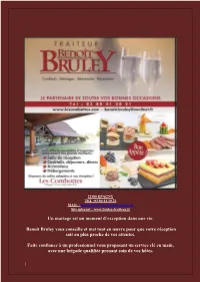
Un Mariage Est Un Moment D'exception Dans Une Vie. Benoit
21380 EPAGNY TEL :03.80.41.30.21 MAIL : [email protected] Site internet : www.bruley-traiteur.fr Un mariage est un moment d’exception dans une vie. Benoit Bruley vous conseille et met tout en œuvre pour que votre réception soit au plus proche de vos attentes. Faite confiance à un professionnel vous proposant un service clé en main, avec une brigade qualifiée prenant soin de vos hôtes. 1 LES COCKTAILS APERITIF 2 LE GOURMET 1 Verrine de guacamole à la chair de tourteaux 1 cube de saumon gravlax, moutarde au miel sur blinis 1 wrap de volaille et crudité fraiche sauce césar 1 Mini cheese burger 1 Crème brûlée de foie gras 1 canapé de foie gras et son chutney de figues 1 rouleau de viande de grison, roquette assaisonnée, parmesan et tomate confite 1 canapé de jambon de parme 1 Verrine de fromage de chèvre, pesto et tomate confite LE BOURGUIGNON 2 gougères Bourguignonnes 1 verrine de tartare de saumon frais mousseline à la graine de moutarde 1 bonbon de foie gras au pain d’épices 1 mini burger de boudin noir et compote d’oignon au cassis 1 croustille d’escargot de bourgogne 1 cromesquis de crémeux de bourgogne truffé 1 brochette charolaise LE CAMPAGNE Hérisson de charcuteries (2 brochettes /pers) 1 toast de pain surprise (50 toasts) 4 canapés (Rosette, œuf de caille, crevette et jambon sec) 2 gougères Bourguignonnes LE CLASSIQUE 3 canapés (rosette, œuf de caille, légume) 2 gougères Bourguignonnes 1 pizza 1 quiche 2 feuilletés Assortiments de 8 canapés Assortiments de mignardises sucrées 3 Voici d’autres idées pour vos cocktails apéritifs : Les verrines : Brochette de tomate, mozzarelle et tapenade d’olive. -
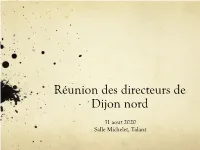
Réunion Directeurs DN R2020
Réunion des directeurs de Dijon nord 31 aout 2020 Salle Michelet, Talant Sommaire • Accueil et changements dans les • Informations sur le plan de postes formation • Point de secrétariat • Information sur la semaine des PEFS • Présentation nouvelle assistante de prévention : Mme Facon Ambre • Informations TICE • Protocole sanitaire • Informations EPS • Autres informations de la dasen • Informations diverses : • L’évolution de la mission de directeur • Élections des parents d’élèves • Informations sur les services • Les priorités nationales civiques • Annexes des programmes • Information sur la réunion du rased • Informations de Mme Brochot, enseignante référente • Information sur la réunion des TR • L’école inclusive • Informations sur les entretiens AESH Avant toute chose… • Carte scolaire : • Mme Fichot, maternelle Langevin. • Autres situations arrivées pendant les vacances ? • Puis visites des écoles de l’IEN ou de l’équipe, dès mardi et cette semaine : Arceau + Marcilly + Pichanges + privé Sainte Jeanne d’Arc, Is + Saint Nicolas, Mirebeau + Renève + Saint Dominique • Remontée des effectifs et des répartitions des services : • fiches numérisées à remplir si ce n’est déjà fait (Belleneuve mat ; Darois mat ; Curie ; Macé). • Noter le nom de l’enseignant dans la case « nom de l’enseignant » et non sa classe. Accueil et changements de postes Informations sur les changements et départs de personnes IEN M. Gombert, IEN Dijon centre M. Colin, IEN Châtillon Mme Pascual, IEN maternelle Docteur de prévention, DSDEN Dr Harduin Directeurs, directrices : Mme Pauget, directrice de Renève Mme Fromholtz, directrice pôle scolaire élémentaire (départ retraite) de Renève Mme Gabrion, directrice Prévert EM, Mme Alexandre, directrice Prévert EM, Talant Talant Mme Lambert, directrice Triolet élém, M. Têtu, directeur Triolet élém, Talant Talant Mme Paillard, directrice Til-Châtel élém Mme Levêque, directrice Til-Châtel élém Mme Cazzoli, directrice sainte Jeanne M. -

PLAN LOCAL D'urbanisme Is-Sur-Tille (Côte D'or)
PLAN LOCAL D’URBANISME Is-sur-Tille (Côte d’Or) 1. RAPPORT DE PRESENTATION Approuvé par le Conseil Municipal le Introduction 5 Situation géographique et administrative 8 PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 10 1. Le territoire dans son contexte physique 11 1.1 Le contexte topographique 11 1.2 Le contexte géologique 13 1.3 Le contexte climatique 15 2. La ressource en eau 17 2.1 Les eaux superficielles 17 2.2 Eaux souterraines et alimentation en eau potable 21 2.3 Assainissement et réseau d’écoulement pluvial 23 2.4 Les politiques publiques en cours 23 3. Les ressources air, énergie et foncière 25 3.1 La qualité de l’air 25 3.2 Les consommations énergétiques 27 3.3 Consommation foncière 29 4. Le patrimoine naturel 31 4.1 Les milieux naturels remarquables 31 4.2 Les espèces remarquables 34 4.3 Les fonctionnalités écologiques 35 5. Les risques, servitudes et nuisances 37 5.1 Risques naturels 37 5.2 Risques technologiques 40 5.3 Les servitudes et les nuisances 40 PARTIE 2. ANALYSE PAYSAGERE ET URBAINE 44 1. Le paysage communal 45 1.1 Approche historique 45 1.2 Approche globale 46 2. Les silhouettes et entrées de ville 49 2.1 Perceptions visuelles et silhouettes de ville 49 2.2 Vues remarquables 50 2.3 Covisibilités 51 2.4 Les entrées sur la commune 52 3. Analyse urbaine 57 3.1 Evolution historique 57 3.2 Analyse urbaine et du tissu bâti 58 3.2 Espaces publics 62 4 Le patrimoine 68 4.1 Patrimoine archéologique 68 4.2 Monuments protégés 69 4.3 ZPPAUP 69 PARTIE 3. -

Rapport Et Conclusions Du Commissaire Enquêteur
Rapport du Commissaire Enquêteur ENQUETE PUBLIQUE / ICPE SAS BONGARZONE A SACQUENAY 21260 ________________________________________________________________________________________________ Département de la Côte d'Or Commune de SACQUENAY (21260) ENQUÊTE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 2020 RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRESENTEE PAR LA SAS BONGARZONE SISE A 52500 POINSON-LES-FAYL EN VUE D’OBTENIR LE RENOUVELLEMENT AVEC EXTENTION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE A CIEL OUVERT DE ROCHES CALCAIRES A 21260 SACQUENAY RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR Page 1/49 Rapport du Commissaire Enquêteur ENQUETE PUBLIQUE / ICPE SAS BONGARZONE A SACQUENAY 21260 ________________________________________________________________________________________________ SOMMAIRE I – GENERALITES ............................................................................................................................................................ 3 I – 1. OBJET DE L’ENQUETE ...................................................................................................................................................... 3 I – 2. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE ...................................................................................................................................... 3 I – 3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ...................................................................................................................................... 4 I – 4. CAPACITES TECNIQUES ET FINANCIERES - GARANTIES FINANCIERES -

Horaires Des Messes De L'assomption 2020
Horaires des Messes de l’Assomption 2020 DOYENNES Paroisses Vendredi 14 août Samedi 15 août 10h15 : Départ de la procession depuis la ferme de la 20h : Messe à Echalot suivie d’une Corvée (Baigneux-les-Juifs) Aignay-Baigneux procession 11h : Messe à l’Ermitage Notre Dame du Val de Seine 18h : Brémur-et-Vaurois 18h30 : Châtillon-sur-Seine (Notre- Châtillon-sur-Seine 11h : Châtillon-sur-Seine (Notre-Dame) Dame) VAL DE SEINE Laignes / / Montigny-sur-Aube 9h30 : Montigny-sur-Aube 10h : Recey-sur-Ource Recey-sur-Ource / 15h : chapelet à Notre-Dame de la Guette 18h : Leuglay Sainte-Colombe-sur-Seine / / Epoisses 18h : Epoisses 10h30 : Moutiers-Saint-Jean Semur-en-Auxois 18h : Montigny-sur-Armançon 11h : Semur-en-Auxois 9h30 : Nogent-lès-Montbard Montbard / 11h : Montbard (Saint-Urse) AUXOIS NORD Précy-sous-Thil / / 15h : Pèlerinage à Villy-en-Auxois Vitteaux / 17h : Pèlerinage à Velogny 9h30 : Frôlois 11h : Boux-Sous-Salmaise Venarey-Les Laumes 18h : Bussy-Le-Grand 11h : Venarey-Les Laumes (Sainte-Chantal) 11h : Hauteroche (temps de prière) Arnay-le-Duc / 9h30 : Arnay Bligny-sur-Ouche 18h30 : Veuvey sur Ouche 11h : Bligny-sur-Ouche AUXOIS-MORVAN Liernais / 9h30 : Liernais 18h : Champeau-St-Léger-de- Saulieu 11h : Saulieu Fourches 18h30 : Pouilly-en-Auxois (église St Pouilly-en-Auxois 10h30 : Pouilly-en-Auxois Pierre) 9h30 : Marsannay-le-Bois Les Hauts du Suzon / 11h : Ahuy Plombières-lès-Dijon / 9h30 : Velars-sur-Ouche SEINE ET SUZON Sombernon 18h30 : Prâlon (Saint-Bernard) 11h : Sombernon 10h : rendez-vous au cimetière de Bligny-le-Sec pour -

L'inhumation Au Prieuré
L’inhumation au prieuré : une pratique seigneuriale rapidement dépassée Guillaume Grillon* * Docteur en histoire Au même titre que n’importe quel édifce religieux, le prieuré est susceptible d’abriter une sépulture. Son implantation presque exclusivement rurale fait que l’aristocratie féodale est la plus à même de bénéfcier de la quiétude et de la piété du lieu. L’étude de l’inhumation priorale à l’échelle de la Bourgogne ducale permet de confrmer que ce sont majoritairement les châtelains en lien avec le prieuré qui font le choix d’y reposer. Très souvent, les inhumations dans l’église priorale revêtent un caractère familial. Certains prieurés concentrent toutefois les sépultures des familles seigneuriales des environs qui ne sont pas toujours celles qui ont favorisé l’installation de la communauté. Cet intérêt pour l’inhumation au prieuré ne dépasse cependant pas le milieu du XIVe siècle. Considéré au départ comme une solution intermédiaire honorable entre une inhumation abbatiale prestigieuse et une inhumation paroissiale par défaut, il ne correspond plus aux attentes des membres de l’aristocratie bourguignonne. Le souci d’honorer la mémoire d’un individu ou d’un groupe social a amené les populations médiévales à favoriser la sépulture de prestige. Longtemps remise en question et plus tolérée qu’acceptée par l’Église, la pratique de l’inhumation ad ecclesiam s’intensife à compter du xiie siècle1. À cette période, seuls les grands prélats et les princes 1. Grillon, L’ultime parviennent à se faire enterrer dans les églises. Afn d’assurer le salut message… p. 496 et sq. de leur âme et de pérenniser le souvenir de leur passage sur terre, ils sollicitent les édifces les plus prestigieux. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°Bfc-2019-014 Publié Le 18 Février
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°BFC-2019-014 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2019 FRANCHE-COMTÉ 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté BFC-2019-02-18-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-155 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de l'Hôpital Nord Franche-Comté (90) (4 pages) Page 4 BFC-2019-02-18-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-164 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Baume-les-Dames (25) (4 pages) Page 9 BFC-2019-02-13-001 - Arrêté n° DOS/ASPU/020/2019 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « Pharmacie DAVAL » du 20 bis rue Bienvenu Martin à SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89 530) au 3 chemin des Vaux de Villiers de la même commune (3 pages) Page 14 BFC-2019-02-12-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/022/2019 portant constat de la caducité de la licence n° 387 renumérotée n° 71#000387 de l’officine de pharmacie sise 29-31 rue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240) (1 page) Page 18 BFC-2019-02-11-003 - Décision portant nomination des membres du comité de protection des Personnes "EST II (CPP EST II) : Madame le Docteur Christine GUILLERMET FROMENTIN (2 pages) Page 20 BFC-2019-02-04-005 - Retrait d'agrément SARL AMBULANCES JANNET (3 pages) Page 23 Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon BFC-2019-01-01-032 - Délégation signature David CANAVERO 1er janvier 2019 (3 pages) Page 27 BFC-2019-01-01-033 - Délégation signature Emmanuel BERENGER 1er janvier 2019 (2 pages) Page