L'inhumation Au Prieuré
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
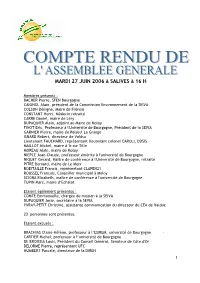
Mardi 27 Juin 2006 À Salives À 16 H
MARDI 27 JUIN 2006 à SALIVES à 16 H Membres présents : BACHER Pierre, SFEN Bourgogne CAIGNOL Alain, président de la Commission Environnement de la SEIVA COLSON Bénigne, Maire de Frénois CONSTANT Henri, Médecin retraité CARRE Daniel, maire de Léry DUPAQUIER Alain, adjoint au Maire de Moloy FINOT Eric, Professeur à l'Université de Bourgogne, Président de la SEIVA GARNIER Pierre, maire de Poiseul La Grange ISNARD Robert, directeur de Valduc Lieutenant FAUCHARD, représentant lieutenant colonel CAROLI, DDSIS MAILLOT Michel, maire d’Is sur Tille MOREAU Alain, maire de Moloy NIEPCE Jean-Claude, professeur émérite à l'université de Bourgogne NIQUET Gérard, Maître de conférence à l'Université de Bourgogne, retraité PITRE Bernard, maire de Le Meix ROBITAILLE Francis, représentant CLAPEN21 ROUSSEL François, Conseiller municipal à Moloy SCIORA Elisabeth, maître de conférence à l'université de Bourgogne TUPIN Marc, maire d’Echalot Etaient également présentes : COMTE Emmanuelle, chargée de mission à la SEIVA DUPAQUIER Josie, secrétaire à la SEIVA YVRAY-PETIT Christine, assistante communication du directeur du CEA de Valduc 23 personnes sont présentes. Etaient excusés : BRACHIAS Claire-Hélène, professeur à l’ESIREM, université de Bourgogne - CARTIER Michel, professeur à l’université de Bourgogne DE BROISSIA Louis, Président du Conseil Général, Sénateur de Côte d'Or DELORME Pierre, représentant UFC HUMBERT Pascale, directrice de la DIREN 1 LAVOREL Bruno, membre du comité scientifique de la SEIVA Henri REVOL, sénateur de la Côte d'Or, Président de l'Office parlementaire d'Evaluation des choix scientifiques et technologiques, conseiller général honoraire, maire de Messigny et Vantoux François SAUVADET, député de Côte d'Or, Vice-Président de la Commission des Affaires Economiques de l'Environnement et du Territoire de l'Assemblée Nationale 1- Informations générales SEIVA : Dans un premier temps, Eric FINOT remercie Alain HOUPERT de nous recevoir à Salives, dans cette magnifique salle. -

Plan Is-Sur-Tille / Marcilly-Sur-Tille
Ambulance Taxis de la Tille Entreprise GUILLOT-LAGRANGE SPORT&MODE… ACHAT • VENTE • LOCATION MAÇONNERIE & TERRASSEMENT estimation gratuite Constructions neuves • Extensions d’habitations sur simple demande Aménagements extérieurs * 12 rue Jean Zay - 21120 Is-sur-Tille 0 950 960 850 21120 MARCILLY-SUR-TILLE Les mêmes prix qu’à Dijon à 2 pas de chez vous ou promotions… *hors catalogues [email protected] Tél-fax 03 80 95 28 49 3 place Dr Grépin - 21120 IS-SUR-TILLE - Tél-fax 03 80 95 29 73 03 80 95 15 20 AGENCE D'IS-SUR-TILLE - 2 RUE MARÉCHAL FOCH [email protected] Retrouvez votre magasin sur www.sport-is.fr D959 Z.I. CHAMPS BEZANÇON d GRANCEY D120 LE CHATEAU AVELANGES SELONGEY CORDIER in in a MYRAL ric SYSTEM é C.T. GROUP r. du Président Wilson Président du r. m CG21 C A h p r . u d e u Ba Américain Camp du route m G a e CR 17 o s C rg du u rue du Triage ruedu e d s M e S t e e SEB ut u r ra e o s y r z Impasse e r CVO 9 STATION DE è i du Pré r rue du Poste A TRAITEMENT r Zone aux Mauves a chemin d’Échevannes DES EAUX chemin de Corberon C artisanale s USÉES e Ligne SNCF IS-SUR-TILLE - CHALINDREY chemi d e CVO 9 n d t u e Petit C d t loch u n o er r h rue de rra c Montchevreuil te o R it CR 8 Z.A. -
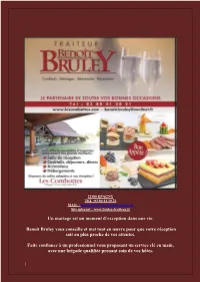
Un Mariage Est Un Moment D'exception Dans Une Vie. Benoit
21380 EPAGNY TEL :03.80.41.30.21 MAIL : [email protected] Site internet : www.bruley-traiteur.fr Un mariage est un moment d’exception dans une vie. Benoit Bruley vous conseille et met tout en œuvre pour que votre réception soit au plus proche de vos attentes. Faite confiance à un professionnel vous proposant un service clé en main, avec une brigade qualifiée prenant soin de vos hôtes. 1 LES COCKTAILS APERITIF 2 LE GOURMET 1 Verrine de guacamole à la chair de tourteaux 1 cube de saumon gravlax, moutarde au miel sur blinis 1 wrap de volaille et crudité fraiche sauce césar 1 Mini cheese burger 1 Crème brûlée de foie gras 1 canapé de foie gras et son chutney de figues 1 rouleau de viande de grison, roquette assaisonnée, parmesan et tomate confite 1 canapé de jambon de parme 1 Verrine de fromage de chèvre, pesto et tomate confite LE BOURGUIGNON 2 gougères Bourguignonnes 1 verrine de tartare de saumon frais mousseline à la graine de moutarde 1 bonbon de foie gras au pain d’épices 1 mini burger de boudin noir et compote d’oignon au cassis 1 croustille d’escargot de bourgogne 1 cromesquis de crémeux de bourgogne truffé 1 brochette charolaise LE CAMPAGNE Hérisson de charcuteries (2 brochettes /pers) 1 toast de pain surprise (50 toasts) 4 canapés (Rosette, œuf de caille, crevette et jambon sec) 2 gougères Bourguignonnes LE CLASSIQUE 3 canapés (rosette, œuf de caille, légume) 2 gougères Bourguignonnes 1 pizza 1 quiche 2 feuilletés Assortiments de 8 canapés Assortiments de mignardises sucrées 3 Voici d’autres idées pour vos cocktails apéritifs : Les verrines : Brochette de tomate, mozzarelle et tapenade d’olive. -

PLAN LOCAL D'urbanisme Is-Sur-Tille (Côte D'or)
PLAN LOCAL D’URBANISME Is-sur-Tille (Côte d’Or) 1. RAPPORT DE PRESENTATION Approuvé par le Conseil Municipal le Introduction 5 Situation géographique et administrative 8 PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 10 1. Le territoire dans son contexte physique 11 1.1 Le contexte topographique 11 1.2 Le contexte géologique 13 1.3 Le contexte climatique 15 2. La ressource en eau 17 2.1 Les eaux superficielles 17 2.2 Eaux souterraines et alimentation en eau potable 21 2.3 Assainissement et réseau d’écoulement pluvial 23 2.4 Les politiques publiques en cours 23 3. Les ressources air, énergie et foncière 25 3.1 La qualité de l’air 25 3.2 Les consommations énergétiques 27 3.3 Consommation foncière 29 4. Le patrimoine naturel 31 4.1 Les milieux naturels remarquables 31 4.2 Les espèces remarquables 34 4.3 Les fonctionnalités écologiques 35 5. Les risques, servitudes et nuisances 37 5.1 Risques naturels 37 5.2 Risques technologiques 40 5.3 Les servitudes et les nuisances 40 PARTIE 2. ANALYSE PAYSAGERE ET URBAINE 44 1. Le paysage communal 45 1.1 Approche historique 45 1.2 Approche globale 46 2. Les silhouettes et entrées de ville 49 2.1 Perceptions visuelles et silhouettes de ville 49 2.2 Vues remarquables 50 2.3 Covisibilités 51 2.4 Les entrées sur la commune 52 3. Analyse urbaine 57 3.1 Evolution historique 57 3.2 Analyse urbaine et du tissu bâti 58 3.2 Espaces publics 62 4 Le patrimoine 68 4.1 Patrimoine archéologique 68 4.2 Monuments protégés 69 4.3 ZPPAUP 69 PARTIE 3. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°Bfc-2019-014 Publié Le 18 Février
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°BFC-2019-014 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE PUBLIÉ LE 18 FÉVRIER 2019 FRANCHE-COMTÉ 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté BFC-2019-02-18-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-155 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance de l'Hôpital Nord Franche-Comté (90) (4 pages) Page 4 BFC-2019-02-18-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-164 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Baume-les-Dames (25) (4 pages) Page 9 BFC-2019-02-13-001 - Arrêté n° DOS/ASPU/020/2019 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) « Pharmacie DAVAL » du 20 bis rue Bienvenu Martin à SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89 530) au 3 chemin des Vaux de Villiers de la même commune (3 pages) Page 14 BFC-2019-02-12-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/022/2019 portant constat de la caducité de la licence n° 387 renumérotée n° 71#000387 de l’officine de pharmacie sise 29-31 rue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240) (1 page) Page 18 BFC-2019-02-11-003 - Décision portant nomination des membres du comité de protection des Personnes "EST II (CPP EST II) : Madame le Docteur Christine GUILLERMET FROMENTIN (2 pages) Page 20 BFC-2019-02-04-005 - Retrait d'agrément SARL AMBULANCES JANNET (3 pages) Page 23 Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon BFC-2019-01-01-032 - Délégation signature David CANAVERO 1er janvier 2019 (3 pages) Page 27 BFC-2019-01-01-033 - Délégation signature Emmanuel BERENGER 1er janvier 2019 (2 pages) Page -

Le Bassin Versant De La Tille Carte D'identité
Le bassin versant de la Tille Carte d’identité Gouvernance, territoires de projets et milieux humains - Novembre 2010 - Claire Duprez & Yannick Arama (ACTeon) Baptiste Chemery (Contrechamp) TABLE DES MATIÈRES SIMPLIFIÉE Table des matières simplifiée 3 Table des matières complète 4 Tables des illustrations 7 Abréviations 9 Lexique 10 Note au lecteur 11 1 Milieux Physiques et géographie : introduction 15 2 Infrastructure : un territoire ouvert 26 3 Sociographie : un territoire rurbain dynamique en interaction avec Dijon 32 4 Economie : entre grandes entreprises industrielles, agriculture et dynamisme dijonnais 37 5 Patrimoine culturel et environnemental : une richesse en amont 50 6 Eau : déséquilibre quantitatif et préoccupation qualitative 56 7 Organisation territoriale : une scission entre amont et aval 61 8 Des territoires de projets : SCOT Dijonnais et Pays Seine et Tille 68 9 Conclusion : synthèse analytique 73 Bibliographie 83 3 3 TABLE DES MATIÈRES COMPLÈTE Table des matières simplifiée ............................................................................................ 3 Table des matières complète ............................................................................................. 4 Tables des illustrations ...................................................................................................... 7 Les figures................................................................................................................................. 7 Les encadrés ............................................................................................................................ -

Règlement Régional Des Transports Scolaires De
RÈGLEMENT RÉGIONAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE CÔTE-D’OR TITRE I - CHAMP D'APPLICATION Article 1 - Définition des transports scolaires Les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte-d’Or entre leur domicile et l’établissement scolaire de secteur, lorsque celui-ci est situé sur une autre Commune. Article 1.1 - Création d’un point d’arrêt Une Commune est desservie ou un point d’arrêt est créé si : le nombre d’élèves en âge de scolarisation obligatoire à transporter est au moins de quatre, la distance à parcourir entre la Commune et l’établissement, ou entre deux points d’arrêts, est au moins de deux kilomètres à vol d’oiseau. En règle générale, un seul point d’arrêt est créé par Commune. La distance minimale entre deux points d'arrêt est fixée à deux kilomètres. Plusieurs points d’arrêts peuvent être mis en place au sein d’une même Commune pour des trajets intercommunaux. L’opportunité de création d’un point d’arrêt est appréciée au regard du nombre d’élèves qu’il dessert. Le seuil à partir duquel un point d’arrêt peut être créé est fixé à quatre élèves. La création d’un point d’arrêt dans une Commune pour desservir une école privée sous contrat avec l’État peut être accordée, s’il n’y a pas d’incidence financière et si le temps de trajet global n’est pas excessif. Chaque création de point d’arrêt des circuits scolaires est sollicitée par le Maire de la Commune concernée, puis examinée au regard de la sécurité par les Services Régionaux, l'entreprise de transport, le gestionnaire de voirie et le Maire de la Commune. -

Liste De La Documentation Touristique Mise En Libre Service
LISTE DE LA DOCUMENTATION TOURISTIQUE MISE EN LIBRE SERVICE Dernière mise à jour : 29/06/2019 CÔTE-D'OR TYPE DE SUPPORT LOCALITÉ VALLÉES DE LA TILLE ET DE L’IGNON Plan touristique des Vallées de la Tille et de plan COVATI l’Ignon 2019-2020 Plan de ville Is-sur-Tille plan IS-SUR-TILLE Ecole de musique dépliant COVATI Mont de Marcilly (chemin de rando) dépliant MARCILLY/TILLE L’Escargot Bourguignon dépliant VERNOT Circuit automobile terre (motocross) dépliant IS-SUR-TILLE Le petit train des Lavières dépliant IS-SUR-TILLE L’Aéro-club dépliant TIL-CHÂTEL L’Auberge Côté Rivière (restaurant-hôtel) dépliant IS-SUR-TILLE L’Auberge Côté Rivière (restaurant-hôtel) carte de visite IS-SUR-TILLE Chambres et Tables d’hôtes Le Fournil flyer TARSUL Gîte le Relais de la Poste carte de visite TIL-CHÂTEL La Charmerie flyer SPOY Chambres d'Hôtes La Pitchounière carte de visite TIL-CHÂTEL Chambres d'Hôtes La Maison d'Is carte de visite IS-SUR-TILLE Escale 21 dépliant MARCILLY/TILLE Horaires déchetterie flyer MARCILLY/TILLE Gaston dépliant IS-SUR-TILLE Ferme équestre de Valbertier flyer IS-SUR-TILLE La Ruche qui dit "Oui" flyer DIENAY Écurie de JAM flyer IS-SUR-TILLE Atelier FA SOL flyer SAULX-LE-DUC Chambres d'hôte "Rives Gauche" flyer MOLOY Chambres d'hôte "Rives Gauche" carte de visite MOLOY Roomandvilla (location) carte de visite IS-SUR-TILLE Les Créations de STOUF carte de visite VILLEY-SUR-TILLE Cheval Blanc carte de visite IS-SUR-TILLE Atelier "Lumière de Verre" carte de visite MAREY-SUR-TILLE O'Dix d'Is carte de visite IS-SUR-TILLE l'hôte antique flyer -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021
PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Trouvons Les Solutions Pour Vos Travaux
CMJN CMJN CMJN LE RÉFLEXELE RÉFLEXELE RÉFLEXE pourpour bienpour bien rénover bienrénover rénover C’est un C’estdispositif un dispositifC’est public un mis dispositifpublic en place mis public en par place mis par en place le par le Pays Seine-et-TilleslePays Pays Seine-et-Tilles Seine-et-Tillesle Pays en Seine-et-TillesBourgogne en en Bourgogne Bourgogne pendant en jusqu’enBourgogne pendant pendant 3 ans (2016-2019).3avril ans 2021 (2016-2019).3 Il ans vise (2016-2019). à : Il vise à : Il vise à : Aider les Aiderhabitants les habitants Aider à faire les des habitantsà faire économies des à économies faire des économies N/B N/B N/B d’énergied’énergie d’énergie Accompagner les habitants Accompagner dans lesleur habitants projet de dans leur projet de Accompagner les habitants dans leur projet de — Le Point Réno Point — Le Réno Point — Le Réno Point — Le rénovationrénovationrénovation S S S i i i Améliorer Améliorer la performance Améliorerla performance énergétique la performance énergétique du parc énergétique du parc du parc de logementde logementde logement Busserotte- Busserotte- Busserotte- et-Montenaille et-Montenaille et-Montenaille Bussières Bussières BussièresVernois-les-VesvresVernois-les-Vesvres Vernois-les-Vesvres GRANCEY- GRANCEY- GRANCEY- Courlon LE-CHÂTEAUCourlon LE-CHÂTEAUCourlon LE-CHÂTEAU 56 avenue du Drapeau 56 avenue 21000 DIJON du Drapeau 56 avenue 21000 DIJON du Drapeau 56 avenue 21000 DIJON URBAN URBAN URBAN Fraignot- Fraignot- Fraignot- Cussey-les-Forges Cussey-les-Forges Cussey-les-Forges et-Vesvrotte et-Vesvrotte -

N° 41 Recueil Des Administratifs
N° 41 Du 24 septembre 2015 PREFET DE LA COTE D'OR RECUEIL DES SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DFIRECTION DES RESSOURCES DE LA PRÉFECTURE Service de la Stratégie Budgétaire et Immobilière CTES Ahlème CAREME A 03.80.44.65.28 [email protected] ADMINISTRATIFS La version de ce recueil peut être consultée sur le site internet de la préfecture : http://www.cote-dor.gouv.fr – Rubrique Publications/Recueils des Actes Administratifs SOMMAIRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Bureau de la sécurité routière et de la gestion des crises ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 636 du 18 septembre 2015 autorisant Enduro Top le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre 2015 à Salives.................................................................................................................................................................................................3 ARRETE PREFECTORAL N° 637 du 18 septembre 2015 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE MANIFESTATION AERIENNE DE FAIBLE IMPORTANCE A LOUESME (21) LE DIMANCHE 20 septembre 2015 .................................................................4 Service Economie Agricole et Environnement des Exploitations Décision d’agrément GAEC n° 1264 du 15 septembre 2015.........................................................................................................................6 Décision d’agrément GAEC n° 1267 du 15 septembre 2015.........................................................................................................................7 Décision d’agrément GAEC n° 1268 du 15 septembre -

Communes ZRR De Métropole Et Communes Des Bassins De Vie De
CC de la Plaine Dijonnaise Aiserey Beire-le-Fort Bessey-lès-Cîteaux Cessey-sur-Tille Chambeire Collonges-lès-Premières Echigey Fauverney Genlis Izeure Izier Labergement-Foigney Longchamp Longeault Côte d'Or Longecourt-en-Plaine Marliens Pluvault Pluvet Premières Rouvres-en-Plaine Tart-l'Abbaye Tart-le-Bas Tart-le-Haut Thorey-en-Plaine Varanges Duesme Nicey CC du Pays Châtillonnais Echalot Nod-sur-Seine Aignay-le-Duc Essarois Noiron-sur-Seine Aisey-sur-Seine Etalante Obtrée Ampilly-les-Bordes Etormay Oigny Ampilly-le-Sec Etrochey Origny Autricourt Faverolles-lès-Lucey Orret Baigneux-les-Juifs Fontaines-en-Duesmois Poinçon-lès-Larrey Balot Gevrolles Poiseul-la-Ville-et-Laperrière Beaulieu Gomméville Pothières Beaunotte Grancey-sur-Ource Prusly-sur-Ource Belan-sur-Ource Griselles Puits Bellenod-sur-Seine Gurgy-la-Ville Quemigny-sur-Seine Beneuvre Gurgy-le-Château Recey-sur-Ource Billy-lès-Chanceaux Jours-lès-Baigneux Riel-les-Eaux Bissey-la-Côte La Chaume Rochefort-sur-Brévon Bissey-la-Pierre Laignes Saint-Broing-les-Moines Boudreville Larrey Sainte-Colombe-sur-Seine Côte d'Or Bouix Les Goulles Saint-Germain-le-Rocheux Brémur-et-Vaurois Leuglay Saint-Marc-sur-Seine Brion-sur-Ource Lignerolles Savoisy Buncey Louesme Semond Bure-les-Templiers Lucey Terrefondrée Busseaut Magny-Lambert Thoires Buxerolles Maisey-le-Duc Vannaire Cérilly Marcenay Vanvey Chambain Massingy Vertault Chamesson Mauvilly Veuxhaulles-sur-Aube Channay Menesble Villaines-en-Duesmois Charrey-sur-Seine Meulson Villedieu Châtillon-sur-Seine Minot Villers-Patras Chaugey Moitron