Declaration D'intention SAGE Tille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
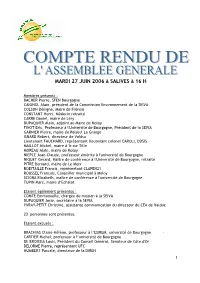
Mardi 27 Juin 2006 À Salives À 16 H
MARDI 27 JUIN 2006 à SALIVES à 16 H Membres présents : BACHER Pierre, SFEN Bourgogne CAIGNOL Alain, président de la Commission Environnement de la SEIVA COLSON Bénigne, Maire de Frénois CONSTANT Henri, Médecin retraité CARRE Daniel, maire de Léry DUPAQUIER Alain, adjoint au Maire de Moloy FINOT Eric, Professeur à l'Université de Bourgogne, Président de la SEIVA GARNIER Pierre, maire de Poiseul La Grange ISNARD Robert, directeur de Valduc Lieutenant FAUCHARD, représentant lieutenant colonel CAROLI, DDSIS MAILLOT Michel, maire d’Is sur Tille MOREAU Alain, maire de Moloy NIEPCE Jean-Claude, professeur émérite à l'université de Bourgogne NIQUET Gérard, Maître de conférence à l'Université de Bourgogne, retraité PITRE Bernard, maire de Le Meix ROBITAILLE Francis, représentant CLAPEN21 ROUSSEL François, Conseiller municipal à Moloy SCIORA Elisabeth, maître de conférence à l'université de Bourgogne TUPIN Marc, maire d’Echalot Etaient également présentes : COMTE Emmanuelle, chargée de mission à la SEIVA DUPAQUIER Josie, secrétaire à la SEIVA YVRAY-PETIT Christine, assistante communication du directeur du CEA de Valduc 23 personnes sont présentes. Etaient excusés : BRACHIAS Claire-Hélène, professeur à l’ESIREM, université de Bourgogne - CARTIER Michel, professeur à l’université de Bourgogne DE BROISSIA Louis, Président du Conseil Général, Sénateur de Côte d'Or DELORME Pierre, représentant UFC HUMBERT Pascale, directrice de la DIREN 1 LAVOREL Bruno, membre du comité scientifique de la SEIVA Henri REVOL, sénateur de la Côte d'Or, Président de l'Office parlementaire d'Evaluation des choix scientifiques et technologiques, conseiller général honoraire, maire de Messigny et Vantoux François SAUVADET, député de Côte d'Or, Vice-Président de la Commission des Affaires Economiques de l'Environnement et du Territoire de l'Assemblée Nationale 1- Informations générales SEIVA : Dans un premier temps, Eric FINOT remercie Alain HOUPERT de nous recevoir à Salives, dans cette magnifique salle. -

Sorties Route 3T 2021
CYCLOS RANDONNEURS DIJONNAIS 21, rue du Général-Fauconnet 20100 DIJON Internet : http:/www.cyclos-rando-dijon.fr/accueil.html Courriel : [email protected] ROUTE VTT Sorties Route du 4ème trimestre 2021 Lundi - Mercredi - Samedi - Dimanche et Jours de fête GROUPES et RESPONSABLES Groupe A : 1 Semaine 40 – du 1er octobre au 03 OCTOBRE Samedi 02/10 A 13H30 Dijon - Ruffey - St Julien - Spoy - Pichanges - Local Gemeaux - Marcilly - Is/Tille - Villecomte - Vernot - 100 km Francheville - Prairay - Cestres - Froideville - Bordes Bricard - Fromenteau - Val Suzon - Messigny - Ahuy – Dijon. (100 km) Dimanche 03/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Brognon – Tanay – Mirebeau – Local Beaumont – Licey – Attricourt – St Seine – Pouilly s 100 km Vingeanne – Mornay – Montigny – La Villeneuve – Fontaine Française – Bourberain – Bèze – Vievigne – Beire – Arcelot – Varois – Dijon. Semaine 41 – du 04 OCTOBRE au 10 OCTOBRE Lundi 04/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé Local 100 km Mercredi 06/10 A 13H30 Dijon – Plombières – D 10 - Lantenay – Mâlain – Baulme Lac Kir la Roche – Fromenteau – St Seine – Cinq Fonts – Prairay 100 km – Francheville – Vernot – Villecomte – Is s Tille – Gemeaux – Pichanges – Flacey – St Julien – Dijon. (100 km - D+ 900) Samedi 09/10 A 13H30 Dijon – Plombières – Pont de Pany – Barbirey – Jaugey – Local L’Oiserolle - Commarin - Sombernon – Puits XV – Val 92 km Courbe – Val Suzon – Messigny - Dijon. (92 km) Dimanche 10/10 A 8H00 Dijon – St Julien – Flacey – Pichanges – Spoy – Vievigne Local – Bèze – Mirebeau – Oisilly – Renêve – Cheuge – 88 km Bézouotte – Cuiserey – Belleneuve – Arcelot – Varois - Dijon. (88km) Semaine 42 – du 11 OCTOBRE au 16 OCTOBRE Lundi 11/10 A 13H30 Parcours du Dimanche inversé. Local 88 km Mercredi 13/10 A 13H30 Ahuy – Messigny – Saussy – Moloy – Lamargelle – St Lidl Ahuy Seine – Bligny le Sec – Fromenteau - Pasques - 95 km Plombières – Dijon. -

PRESERVER À Pouilly-Sur-Loire
167245_BNHS1.qxd 4/02/2008 16:59 Page 81 Le plan régional d’actions chauves-souris en Bourgogne - Préserver PRESERVER à Pouilly-sur-Loire. Nous avons utilisé comme outil un jeu sur les chauves-souris réalisé et prêté par la CPEPESC Franche- Une simple protection des Comté. espèces n’est pas suffisante pour Pour engager une préservation durable, lors de la sauvegarder les populations de découverte d’un site hébergeant des chauves-souris, la chiroptères. La préservation de leurs rédaction d’une fiche simplifiée à destination du maire ou des gîtes (cavités, bâtiments...) est plus propriétaires est une première étape. C’est donc dans ce but importante encore, voire qu’une fiche descriptive de site (Annexe 6, page 99) a été fondamentale, tout comme celle de conçue et sera appliquée aux sites ayant obtenu une note leurs terrains de chasse. élevée par la hiérarchisation. Actuellement, de nombreuses Un cahier technique a été réalisé et comprend notamment mesures peuvent être prises pour les fiches suivantes : Qu’est-ce qu’une chauve-souris ?; Les informer tout d’abord et protéger espèces bourguignonnes; Les bâtiments; Les ouvrages d’art; Les ensuite les gîtes et terrains de chasse. arbres; Le milieu souterrain; L’entretien de l’espace rural. Ce Hors-série de la Revue Scientifique Bourgogne Nature L’information présentant ce plan d’actions et les résultats obtenus, ainsi que le cahier technique, est envoyé à l’ensemble des mairies de Informer, c’est protéger ! En effet, Bourgogne et aux diverses administrations. Suite à nos il faut avant tout sensibiliser les élus, campagnes de prospections estivales, nous ferons aussi les propriétaires de sites, les parvenir aux communes et propriétaires accueillants des utilisateurs du milieu naturel et le chauves-souris dans leurs bâtiments un courrier avec une fiche grand public. -

Les Châteaux Et Moulins
les châteaux et Moulins COMMUNE DFCF NOM DU SITE CP CANTO LOC Agencourt 21.129 Château des Bruyères 21700 21.23 JN27LC Agey 21.003 Château d'Agey 21410 21.32 JN27IG Aignay le Duc Château d'Aigney le Duc 21510 21.01 JN27IP Aignay le Duc Moulin de la Maladière 21510 21.01 JN27IP Aiserey 21.085 Château 21110 21.13 JN27NE Aisey sur Seine Château Chavannes 21400 21.08 JN27GR Aisey sur Seine Château des Ducs de Bourgogne 21400 21.08 JN27GR Aisey sur Seine Château Bon Espoir 21400 21.08 JN27GR Aisy sous Thil Château 21390 21.26 JN27DJ Aisy sous Thil Moulin Quatre Sous 21390 21.26 JN27DJ Aloxe Corton 21.073 Château Corton André 19° S 21420 21.05 JN27KB Aloxe Corton Château Corton Grancey 18°S 21420 21.05 JN27KB Aloxe Corton Château de Corton 19° S 21420 21.05 JN27KB Ampilly le Sec Château 21400 21.08 JN27FT Ampilly le Sec Moulin à eau 21400 21.08 JN27FT Antheuil Château-Mignon 21360 21.07 JN27ID Arc sur Tille Moulin à eau 21560 21.10 JN27NI Arceau 21.036 Château 21310 21.19 JN27NJ Arceau 21.003 Moulin à vent 21310 21.19 JN27NJ Arcelot 21.041 Château d' Arcelot 21700 21.19 JN27NI Arcenant Château de Beau 21700 21.23 JN27JD Arconcey Château des Prince de Condé 21320 21.25 JN27FF Argilly Château d'Antilly 21700 21.23 JN27LB Arnay le Duc Château des Prince de Condé 16° S 21230 21.02 JN27FC Arnay le Duc Tour de la Motte Forte 16° S 21230 21.02 JN27FC Arnay le Duc Moulin Roche 21230 21.02 JN27FC Arnay le Duc Moulin Franchi 21320 21.02 JN27FC Arnay le Duc Moulin Fouche 21320 21.02 JN27FC Arnay le Duc Moulin Rouge 21320 21.02 JN27FC Arnay le Duc Moulin -

Plan Is-Sur-Tille / Marcilly-Sur-Tille
Ambulance Taxis de la Tille Entreprise GUILLOT-LAGRANGE SPORT&MODE… ACHAT • VENTE • LOCATION MAÇONNERIE & TERRASSEMENT estimation gratuite Constructions neuves • Extensions d’habitations sur simple demande Aménagements extérieurs * 12 rue Jean Zay - 21120 Is-sur-Tille 0 950 960 850 21120 MARCILLY-SUR-TILLE Les mêmes prix qu’à Dijon à 2 pas de chez vous ou promotions… *hors catalogues [email protected] Tél-fax 03 80 95 28 49 3 place Dr Grépin - 21120 IS-SUR-TILLE - Tél-fax 03 80 95 29 73 03 80 95 15 20 AGENCE D'IS-SUR-TILLE - 2 RUE MARÉCHAL FOCH [email protected] Retrouvez votre magasin sur www.sport-is.fr D959 Z.I. CHAMPS BEZANÇON d GRANCEY D120 LE CHATEAU AVELANGES SELONGEY CORDIER in in a MYRAL ric SYSTEM é C.T. GROUP r. du Président Wilson Président du r. m CG21 C A h p r . u d e u Ba Américain Camp du route m G a e CR 17 o s C rg du u rue du Triage ruedu e d s M e S t e e SEB ut u r ra e o s y r z Impasse e r CVO 9 STATION DE è i du Pré r rue du Poste A TRAITEMENT r Zone aux Mauves a chemin d’Échevannes DES EAUX chemin de Corberon C artisanale s USÉES e Ligne SNCF IS-SUR-TILLE - CHALINDREY chemi d e CVO 9 n d t u e Petit C d t loch u n o er r h rue de rra c Montchevreuil te o R it CR 8 Z.A. -

Dijon Céréales
Jeudi 13 décembre 2018 | Côte-d’Or Tourisme PALMARÈS Remise des Trophées départementaux 2 18 de la valorisation paysagère Les communes labellisées Le palmarès départemental Le club fleurissement Les partenaires et les donateurs © Rozenn Krebel © Rozenn DIJON CÉRÉALES Notre partenaire depuis 1998 te-d'Or Tour Cô ism de e s d e e ir p a u n i s e t 1 r 9 a 9 P 8 GROUPE DIJON CÉRÉALES © Rozenn Krebel © Rozenn Le partenariat entre Côte-d’Or Tourisme et le groupe Dijon Céréales en quelques dates 1998 2003 Première collaboration en matière Organisation de demi-journées de de conseil personnalisé aux communes sur sensibilisation et de réunions de pays sur lesquelles existe une activité dépendant du l’ensemble de la Côte-d’Or groupe Dijon Céréales 2011 1999 Mise en place d’un accompagnement Signature d’une convention visant à élargi aux communes visant à moyen terme cofinancer un emploi-jeune formé aux tech- l’obtention du label national niques paysagères 2013 2001 Organisation de réunions de sensibilisa- Mise en place du mécénat Dijon Céréales tion sur la gestion paysagère de l’espace public afin de mandater un paysagiste professionnel pour assurer un conseil aux communes toutes 2018 proches de l’obtention du label national « villes et Première édition des « Rendez-vous de villages fleuris » la valorisation paysagère » en Côte-d’Or Marie-Claire BONNET-VALLET Vice-présidente du Conseil départemental (canton d’Auxonne) Présidente de Côte-d’Or Tourisme 20 ans de partenariat fructueux ! Côte-d’Or Tourisme et le groupe Dijon Céréales partagent la même vision pour dynamiser la valorisation paysagère… la belle aventure commune dure déjà depuis vingt ans. -
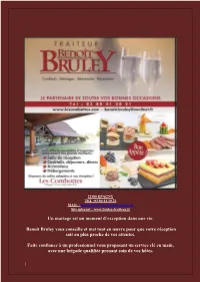
Un Mariage Est Un Moment D'exception Dans Une Vie. Benoit
21380 EPAGNY TEL :03.80.41.30.21 MAIL : [email protected] Site internet : www.bruley-traiteur.fr Un mariage est un moment d’exception dans une vie. Benoit Bruley vous conseille et met tout en œuvre pour que votre réception soit au plus proche de vos attentes. Faite confiance à un professionnel vous proposant un service clé en main, avec une brigade qualifiée prenant soin de vos hôtes. 1 LES COCKTAILS APERITIF 2 LE GOURMET 1 Verrine de guacamole à la chair de tourteaux 1 cube de saumon gravlax, moutarde au miel sur blinis 1 wrap de volaille et crudité fraiche sauce césar 1 Mini cheese burger 1 Crème brûlée de foie gras 1 canapé de foie gras et son chutney de figues 1 rouleau de viande de grison, roquette assaisonnée, parmesan et tomate confite 1 canapé de jambon de parme 1 Verrine de fromage de chèvre, pesto et tomate confite LE BOURGUIGNON 2 gougères Bourguignonnes 1 verrine de tartare de saumon frais mousseline à la graine de moutarde 1 bonbon de foie gras au pain d’épices 1 mini burger de boudin noir et compote d’oignon au cassis 1 croustille d’escargot de bourgogne 1 cromesquis de crémeux de bourgogne truffé 1 brochette charolaise LE CAMPAGNE Hérisson de charcuteries (2 brochettes /pers) 1 toast de pain surprise (50 toasts) 4 canapés (Rosette, œuf de caille, crevette et jambon sec) 2 gougères Bourguignonnes LE CLASSIQUE 3 canapés (rosette, œuf de caille, légume) 2 gougères Bourguignonnes 1 pizza 1 quiche 2 feuilletés Assortiments de 8 canapés Assortiments de mignardises sucrées 3 Voici d’autres idées pour vos cocktails apéritifs : Les verrines : Brochette de tomate, mozzarelle et tapenade d’olive. -

Enfance-Jeunesse, Affaires Sociales Président De Commission Catherine BURILLE Présidente De Commission
2020 Le Mag de la Comcom Un territoire grandeur nature Poiseul- la-Grange Carte CHÂTILLON-SUR-SEINE Léry d’identité Lamargelle Chanceaux Frénois Pellerey IS-SUR-TILLE Poncey- sur-l’Ignon Vaux-Saules Saussy Champagny Francheville Curtil-Saint-Seine Saint-Seine-L’Abbaye Savigny- Bligny-le-Sec le-Sec Villote- Saint-Martin- Messigny- Saint-Seine du-Mont Val-Suzon Étaules et-Vantoux Turcey Trouhaut DIJON MÉTROPOLE Darois Panges Prenois NOM NATURE Communauté de Communes Établissement Public Forêts, Seine et Suzon de Coopération Intercommunale (EPCI) DATE DE NAISSANCE à fiscalité propre 1er janvier 2014 NOMBRE DE COMMUNES SIÈGE 4 bis rue des Écoles 25 à Messigny-et-Vantoux SUPERFICIE (21380) 447 km² NOMBRE D’HABITANTS 6902 édito L’année 2020 a été marquée par les élections municipales et communautaires mais demeurera l’année troublée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Cette pandémie a et aura des impacts profonds sur l’économie, sur une nouvelle organisation du travail, de la consommation, sur les modes de transport, sur la solidarité... Cette crise sanitaire implique un nouveau schéma de réflexion des élus pour s’engager sur le monde d’après. La communauté de communes Forêts, Seine et Suzon a renouvelé ses instances suite aux élections du 15 juillet dernier et ce magazine a pour objet de vous présenter le fonctionnement de la collectivité, avec ses champs d’intervention sur un territoire composé de communes périurbaines et d’autres plus rurales. Un nouveau mandat, de nouveaux élus, de nouvelles responsabilités, des projets structurants pour répondre aux attentes de tous les habitants. Aujourd’hui, les élus sont en ordre de marche, conscients des enjeux en matière de relance économique et de transition écologique. -

PLAN LOCAL D'urbanisme Is-Sur-Tille (Côte D'or)
PLAN LOCAL D’URBANISME Is-sur-Tille (Côte d’Or) 1. RAPPORT DE PRESENTATION Approuvé par le Conseil Municipal le Introduction 5 Situation géographique et administrative 8 PARTIE 1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 10 1. Le territoire dans son contexte physique 11 1.1 Le contexte topographique 11 1.2 Le contexte géologique 13 1.3 Le contexte climatique 15 2. La ressource en eau 17 2.1 Les eaux superficielles 17 2.2 Eaux souterraines et alimentation en eau potable 21 2.3 Assainissement et réseau d’écoulement pluvial 23 2.4 Les politiques publiques en cours 23 3. Les ressources air, énergie et foncière 25 3.1 La qualité de l’air 25 3.2 Les consommations énergétiques 27 3.3 Consommation foncière 29 4. Le patrimoine naturel 31 4.1 Les milieux naturels remarquables 31 4.2 Les espèces remarquables 34 4.3 Les fonctionnalités écologiques 35 5. Les risques, servitudes et nuisances 37 5.1 Risques naturels 37 5.2 Risques technologiques 40 5.3 Les servitudes et les nuisances 40 PARTIE 2. ANALYSE PAYSAGERE ET URBAINE 44 1. Le paysage communal 45 1.1 Approche historique 45 1.2 Approche globale 46 2. Les silhouettes et entrées de ville 49 2.1 Perceptions visuelles et silhouettes de ville 49 2.2 Vues remarquables 50 2.3 Covisibilités 51 2.4 Les entrées sur la commune 52 3. Analyse urbaine 57 3.1 Evolution historique 57 3.2 Analyse urbaine et du tissu bâti 58 3.2 Espaces publics 62 4 Le patrimoine 68 4.1 Patrimoine archéologique 68 4.2 Monuments protégés 69 4.3 ZPPAUP 69 PARTIE 3. -

Les Communes Labellisées Les Partenaires Et Les Donateurs Le Club
Jeudi 14 décembre 2017 | Côte-d’Or Tourisme PALMARÈS Remise des Trophées départementaux 2 17 de la valorisation paysagère Les communes labellisées Le palmarès départemental Le club fleurissement Les partenaires et les donateurs © hunterkitty - Fotolia.com LES communes labellisÉES villes et villages fleuris Combertault - 1 fleur © A. Guillaume Tourisme Côte-d’Or Une fleur Deux fleurs Trois fleurs Arc-sur-Tille Arnay-le-Duc Chenôve Alise-Sainte-Reine Auxonne Bonnencontre Bèze Darois - primée en 2017 Chamesson Billey Charmes Châteauneuf-en-Auxois Fontaine-lès-Dijon Chaumont-le-Bois Châtillon-sur-Seine Longvic Chevigny-Saint-Sauveur Missery Combertault - primée en 2017 Darcey Faverolles-lès-Lucey Montagny-lès-Beaune - Courtivron Is-sur-Tille primée en 2017 Drée Lacanche Foncegrive Levernois Montbard Frénois Marcellois Nuits-Saint-Georges Ladoix-Serrigny Marcilly-sur-Tille Poiseul-la-Grange Marsannay-la-Côte Saint-Apollinaire Merceuil Mirebeau-sur-Bèze - Talant Messigny-et-Vantoux primée en 2017 Venarey-Les Laumes Minot Vignoles Nolay Pouilly-en-Auxois Perrigny-les-Dijon Roilly Premeaux-Prissey Santenay Quatre fleurs Selongey Saulieu Beaune Senailly Savigny-lès-Beaune Quetigny Seurre Semur-en-Auxois Soirans Trouhaut Velars-sur-Ouche Velogny Villers-la-Faye Villaines-les-Prévôtes LES communes labellisÉES Côte-d’Or Tourisme © A. Guillaume Tourisme Côte-d’Or 1 1. Mirebeau-sur-Bèze - 2 fleurs 2. Darois - 3 fleurs 3. Montagny-lès-Beaune - 3 fleurs Côte-d’Or Tourisme © A. Guillaume Tourisme Côte-d’Or 2 3 © A. Guillaume Tourisme Côte-d’Or LE palmaRÈS -

Recueil Des Actes Administratifs N°Bfc-2020-068 Publié Le 13 Août 2020
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°BFC-2020-068 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2020 FRANCHE-COMTÉ 1 Sommaire ARS Bourgogne Franche-Comté BFC-2020-08-04-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-126relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de sage-femme, conformément à l’article L1434-4 du code de la santé publique (151 pages) Page 5 BFC-2020-08-04-008 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-127relatif au contrat type régional d’aide à l’installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 157 BFC-2020-08-04-006 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-128relatif au contrat type régional d’aide à la première installation des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 163 BFC-2020-08-04-007 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/20-129relatif au contrat type régional d’aide au maintien des sages-femmes dans les zones « très sous-dotées » et « sous-dotées » (5 pages) Page 169 BFC-2020-08-05-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-767 transformant le statut du groupe hospitalier de la Haute-Saône, établissement public de santé de ressort intercommunal en établissement public de santé de ressort départemental (FINESS EJ : 70 000 49 1) (2 pages) Page 175 BFC-2020-08-04-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-766 portant autorisation du remplacement d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à utilisation clinique au profit du GIE IRM La Vallée de l’Image 4 rue Capitaine -

Préfet De La Region Bourgogne
PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant autorisation d’exploiter (Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement) Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent SAS Energies Entre Tille et Venelle - 20, Avenue de la Paix – 67000 STRASBOURG Le Préfet de la région Bourgogne Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu le code de l’environnement ; Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ; Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2012 approuvant le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Bourgogne ; Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2013 portant mise en œuvre du droit d’évocation du préfet de région en matière d’éolien terrestre ; Vu l’arrêté préfectoral du 19 juin 2014 portant autorisation de défrichement sur les territoires communaux de Avelanges, Avot, Crécey-sur-Tille, Marey-sur-Tille et Villey-sur-Tille ; Vu l’arrêté préfectoral du 19 juin 2014 portant autorisation