TRAFICS Diagnostic Du Fonctionnement Et Perspectives D'évolution De La LGV Paris – Lyon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
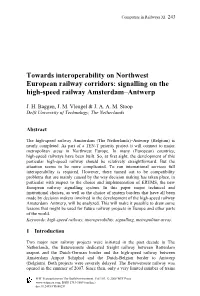
Signalling on the High-Speed Railway Amsterdam–Antwerp
Computers in Railways XI 243 Towards interoperability on Northwest European railway corridors: signalling on the high-speed railway Amsterdam–Antwerp J. H. Baggen, J. M. Vleugel & J. A. A. M. Stoop Delft University of Technology, The Netherlands Abstract The high-speed railway Amsterdam (The Netherlands)–Antwerp (Belgium) is nearly completed. As part of a TEN-T priority project it will connect to major metropolitan areas in Northwest Europe. In many (European) countries, high-speed railways have been built. So, at first sight, the development of this particular high-speed railway should be relatively straightforward. But the situation seems to be more complicated. To run international services full interoperability is required. However, there turned out to be compatibility problems that are mainly caused by the way decision making has taken place, in particular with respect to the choice and implementation of ERTMS, the new European railway signalling system. In this paper major technical and institutional choices, as well as the choice of system borders that have all been made by decision makers involved in the development of the high-speed railway Amsterdam–Antwerp, will be analyzed. This will make it possible to draw some lessons that might be used for future railway projects in Europe and other parts of the world. Keywords: high-speed railway, interoperability, signalling, metropolitan areas. 1 Introduction Two major new railway projects were initiated in the past decade in The Netherlands, the Betuweroute dedicated freight railway between Rotterdam seaport and the Dutch-German border and the high-speed railway between Amsterdam Airport Schiphol and the Dutch-Belgian border to Antwerp (Belgium). -

Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States
Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 First Printing 2013 Copyright © 2013, Parsons Brinckerhoff Group Inc. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, mechanical (including photocopying), recording, taping, or information or retrieval systems—without permission of the pub- lisher. Published by: Parsons Brinckerhoff Group Inc. One Penn Plaza New York, New York 10119 Graphics Database: V212 CONTENTS FOREWORD XV PREFACE XVII PART 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 1 INTRODUCTION TO THE RESEARCH 3 1.1 Unprecedented Support for High Speed Rail in the U.S. ....................3 1.2 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the U.S. .....4 1.3 Research Objectives . 6 1.4 William Barclay Parsons Fellowship Participants ...........................6 1.5 Host Manufacturers and Operators......................................7 1.6 A Snapshot in Time .................................................10 CHAPTER 2 HOST MANUFACTURERS AND OPERATORS, THEIR PRODUCTS AND SERVICES 11 2.1 Overview . 11 2.2 Introduction to Host HSR Manufacturers . 11 2.3 Introduction to Host HSR Operators and Regulatory Agencies . -

Une Interconnexion Des TGV Indispensable Pour Faire Face À La Saturation De La Ligne Actuelle
Depuis plus de 12 ans, le CESER Poitou-Charentes demande et soutient la réalisation indispensable de l'interconnexion de la LGV Atlantique au réseau ferré européen à grande vitesse. Membre de l'association "Interconnexion Sud TGV en Ile-de-France" (120 adhérents dont 12 régions), le CESER Poitou-Charentes se prononce aujourd'hui, dans le cadre de la consultation organisée par la CPDP (Commission particulière du débat public), en faveur d'un projet de ligne nouvelle dédiée aux LGV. Une interconnexion des TGV indispensable pour faire face à la saturation de la ligne actuelle L'interconnexion des LGV au Sud de l'Ile-de-France se fait Malgré la modernisation en cours du réseau sur la ligne actuellement sur la ligne entre Massy et Valenton. C'est le actuelle entre Massy et Valenton, l'augmentation du trafic seul axe de liaison reliant le TGV Atlantique vers Paris et les prévue à l'horizon 2020 ne pourra être absorbée par ce seul autres pays européens. tronçon, sans compter les projets de LGV après 2020. Sur cette ligne, qui compte deux tronçons à voie unique à A ces perspectives s'ajoutent les déplacements de province à Massy et Orly, cohabitent TGV, RER et trains de fret (200 province en augmentation de 8 % par an, contre 4 % pour les trains circulent quotidiennement). déplacements de Province à Paris. Les vitesses moyennes des TGV n'excèdent pas 40 km/h et les retards moyens sont de 14 à 30 minutes. Les prévisions de trafic sur les TGV province/province sont estimées à 6 millions de voyageurs en 2020 contre Au-delà de la saturation du trafic de banlieue, ce tronçon 3,5 millions aujourd'hui, quasiment un doublement d'ici est un véritable goulet d'étranglement pour les voyageurs 2020. -

3.1 Les Objectifs Du Projet D'interconnexion Sud 3.2 Un Territoire Mieux Desservi 3.3 Les Couloirs De Passage Proposés
Quel projet pour l’InterconnexIon Sud deS lGV en Île-de-France ? le projet d’Interconnexion Sud doit poursuivre le réseau de contournement de paris en Île-de-France en complétant l’Interconnexion est. Il vise à créer le maillon manquant du réseau des lignes à grande vitesse (LGV), en réalisant une infrastructure dédiée aux TGV, reliant la LGV Atlantique et la LGV Sud-Est, pour rejoindre la LGV Nord et la LGV Est européenne. Cette ligne nouvelle permettra également de répondre 3.1 les objectifs du projet d’Interconnexion Sud sur le long terme aux besoins de développement d’un trafic en forte croissance et de mieux desservir l’Île-de-France, via une ou plusieurs gares 3.2 un territoire mieux desservi nouvelles, dont celle d’Orly. Elles constitueront autant de portes d’entrée vers l’ensemble des destinations offertes par les TGV intersecteurs. 3.3 les couloirs de passage proposés L’itinéraire de la nouvelle infrastructure dépendra dans une large mesure du choix des gares à desservir. L’insertion de la ligne est envisagée 3. soit en tunnel, soit en jumelage le long de la ligne existante. 52 Quel projet pour l’interconnexion sud des lgv en île-de-france Quel projet pour l’InterconnexIon Sud deS lGV en Île-de-France ? le projet d’Interconnexion Sud doit poursuivre le réseau de contournement de paris en Île-de-France en complétant l’Interconnexion est. Il vise à créer le maillon manquant du réseau des lignes à grande vitesse (LGV), en réalisant une infrastructure dédiée aux TGV, reliant la LGV Atlantique et la LGV Sud-Est, pour rejoindre la LGV Nord et la LGV Est européenne. -
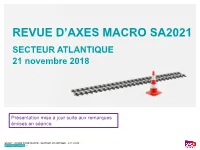
SA2021- Revue Des Axes Macro
REVUE D’AXES MACRO SA2021 SECTEUR ATLANTIQUE 21 novembre 2018 Présentation mise à jour suite aux remarques émises en séance SA2021 - REVUE D'AXE MACRO - SECTEUR ATLANTIQUE - 21/11/2018 DIFFUSION LIMITÉE – Slide mise à jour Ordre de passage des Portions d’Axe 2 HEURES DE NOM DE LA PORTION D’AXE PASSAGE IDF + MANTES – VILLENEUVE (ligne 985 : Mantes – Villeneuve) 9h00 – 9h15 IDF, CL, MP + IDF PARIS RIVE GAUCHE 9h15 – 9h45 IDF,CL,BPL + PARIS – MONTAUBAN 9h45 – 10h15 CL + ORLEANS – TOURS 10h15 – 10h30 CL, BFC + SPDC – VIERZON – SAINCAIZE 10h30– 10h45 IDF,CL, APC,BPL + LGV ATLANTIQUE 10h45 – 11h00 CL,APC + TOURS – BORDEAUX 11h00 – 11h15 APC + BORDEAUX – HENDAYE 11h15 – 11h30 APC, MP + BORDEAUX – TOULOUSE – NARBONNE 11h30 – 11h45 APC,MP + TOULOUSE – TARBES – BAYONNE – DAX 11h45 – 12h00 APC + POITIERS – LA ROCHELLE – NIORT – BORDEAUX 12h00 – 12h15 BPL,CL + BRETAGNE PAYS DE LOIRE 12h15 – 13h00 SA2021 - REVUE D'AXE MACRO - SECTEUR ATLANTIQUE - 21/11/2018 DIFFUSION2 LIMITÉE – 3 OBJECTIF DE LA CONCERTATION Présenter et recueillir les avis des EF et CA sur : + Les impacts des chantiers FIC. + Les premières versions des macro-ordonnancements des principaux chantiers du SA2021. Les macro-ordonnancements présentés en revue d’axes V0 n’intègrent pas l’ensemble des travaux du SA2021 mais uniquement les chantiers FIC et certains chantiers non FIC mais néanmoins impactants. Les ordonnancements V1 de l’ensemble des chantiers du SA2021 seront présentés lors de la revue d’axes V1 du 17 avril 2019. + Les premières courbes de cumuls des pertes de temps par axe et/ou segment LTV. Les courbes de cumuls de pertes de temps sont présentées en annexe sur la base des documents de travail DGOP. -

A European High-Speed Rail Network: Not a Reality but an Ineffective Patchwork
EN 2018 NO 19 Special Report A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork (pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU) AUDIT TEAM The ECA’s special reports set out the results of its audits of EU policies and programmes, or of management-related topics from specific budgetary areas. The ECA selects and designs these audit tasks to be of maximum impact by considering the risks to performance or compliance, the level of income or spending involved, forthcoming developments and political and public interest. This performance audit was carried out by Audit Chamber II Investment for cohesion, growth and inclusion spending areas, headed by ECA Member Iliana Ivanova. The audit was led by ECA Member Oskar Herics, supported by Thomas Obermayr, Head of Private Office; Pietro Puricella, Principal Manager; Luc T’Joen, Head of Task; Marcel Bode, Dieter Böckem, Guido Fara, Aleksandra Klis- Lemieszonek, Nils Odins, Milan Smid, Auditors. Richard Moore provided linguistic support. From left to right: Thomas Obermayr, Guido Fara, Milan Smid, Aleksandra Klis-Lemieszonek, Richard Moore, Luc T’Joen, Marcel Bode, Pietro Puricella, Dieter Böckem, Oskar Herics. 2 CONTENTS Paragraph Abbreviations and glossary Executive summary I - XI Introduction 1 - 13 High-speed rail in Europe 1 - 2 The EU’s high-speed rail network is growing in size and in rate of utilisation 3 - 4 EU policies for high-speed rail 5 - 9 Transport policy 5 - 7 Cohesion policy 8 - 9 EU support for building high-speed lines: significant, but a fraction -

Analyse De La Deuxième Phase De La Branche Est De La Ligne À Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Analyse de la deuxième phase de la branche Est de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône Rapport n° 012304-01 établi par Michel ROSTAGNAT P UNovembre B 2018 L I É PUBLIÉ Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable PUBLIÉ PUBLIÉ Sommaire Résumé.....................................................................................................................4 Liste des recommandations...................................................................................5 Introduction..............................................................................................................6 1. Où en est-on ?.......................................................................................................8 1.1. Bilan de la première phase.........................................................................................8 1.1.1. Modalités d’établissement du bilan LOTI.........................................................9 1.1.2. Evolution du trafic voyageurs...........................................................................9 1.1.3. Bilan financier................................................................................................12 1.2. Le service.................................................................................................................14 -
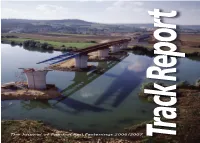
Track Report 2006-03.Qxd
DIRECT FIXATION ASSEMBLIES The Journal of Pandrol Rail Fastenings 2006/2007 1 DIRECT FIXATION ASSEMBLIES DIRECT FIXATION ASSEMBLIES PANDROL VANGUARD Baseplate Installed on Guangzhou Metro ..........................................pages 3, 4, 5, 6, 7 PANDROL VANGUARD Baseplate By L. Liu, Director, Track Construction, Guangzhou Metro, Guangzhou, P.R. of China Installed on Guangzhou Metro Extension of the Docklands Light Railway to London City Airport (CARE project) ..............pages 8, 9, 10 PANDROL DOUBLE FASTCLIP installation on the Arad Bridge ................................................pages 11, 12 By L. Liu, Director, Track Construction, Guangzhou Metro, Guangzhou, P.R. of China PANDROL VIPA SP installation on Nidelv Bridge in Trondheim, Norway ..............................pages 13,14,15 by Stein Lundgreen, Senior Engineer, Jernbanverket Head Office The city of Guangzhou is the third largest track form has to be used to control railway VANGUARD vibration control rail fastening The Port Authority Transit Corporation (PATCO) goes High Tech with Rail Fastener............pages 16, 17, 18 in China, has more than 10 million vibration transmission in environmentally baseplates on Line 1 of the Guangzhou Metro by Edward Montgomery, Senior Engineer, Delaware River Port Authority / PACTO inhabitants and is situated in the south of sensitive areas. Pandrol VANGUARD system has system (Figure 1) in China was carried out in the country near Hong Kong. Construction been selected for these requirements on Line 3 January 2005. The baseplates were installed in of a subway network was approved in and Line 4 which are under construction. place of the existing fastenings in a tunnel on PANDROL FASTCLIP 1989 and construction started in 1993. Five the southbound track between Changshoulu years later, the city, in the south of one of PANDROL VANGUARD TRIAL ON and Huangsha stations. -

Perspectives De Trafic Et De Circulation Sud-Est : LGV Paris
Ligne à Grande Vitesse Paris − Orléans − Clermont-Ferrand − Lyon TRAFICS PERSPECTIVES DE TRAFIC ET DE CIRCULATIONS SUD-EST : LGV PARIS – LYON ET LGV POCL Juin 2011 setec international Réseau ferré de France (RFF), propriétaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage du projet, a initié des études générales et techniques d’une ligne à grande vitesse (LGV) Paris – Orléans – Clermont-Ferrand – Lyon. Ces études sont cofinancées par l’Etat, la Région Ile-de-France, la Région Centre, la Région Bourgogne, la Région Auvergne, la Région Rhône-Alpes et RFF. Au stade amont actuel, les études visent à éclairer les fonctionnalités et les enjeux majeurs qui constituent le fondement des orientations possibles. Dans ce contexte, et si l’opportunité de la ligne était confirmée par le débat public, les analyses feront l’objet d’études de plus en plus détaillées, selon les processus habituels. Dans ce cadre, ce document constitue le rapport de présentation des trafics et circulations sur la LGV Paris - Lyon et des premiers éléments concernant l’exploitation d’un doublet de ligne LGV Paris – Lyon et LGV POCL. Il a été établi par Setec international et son contenu reste de sa propre responsabilité. Sommaire 1. PREAMBULE – CONTENU DU RAPPORT 1 2. LA SITUATION ACTUELLE DE LA LGV PARIS - LYON 2 2.1. LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE 2 2.2. LE TRAFIC DE LA LIGNE EN 2008 4 3. METHODE ET HYPOTHESES POUR LA SIMULATION DU BESOIN EN SILLONS AUX DIFFERENTS HORIZONS 5 3.1. INTRODUCTION 5 3.2. CALAGE DU MODULE D’AFFECTATION DE LA DEMANDE DANS LES TRAINS 5 3.3. -

ETUDE D'impact SUR L'environnement Etude LGV Kenitra -Tanger
Etude LGV Kenitra -Tanger ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Maître d’Ouvrage Direction Projets LGV Groupement de Bureaux d’Etudes Mandataire du Groupement Sous-traitant du Groupement A 3 8 7 L G V K T 0 I E N 0 0 0 2 C 5 Code affaire Projet Tronçon Phase Discipline Type document Emetteur N° document Indice 143 Type d'ouvrage Localisation N° page Nom du fichier : A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C4.doc Sous-traitant du Groupement Mandataire du Groupement Etude LGV Kenitra-Tanger APPROBATION ET MISE A JOUR DES DOCUMENTS C5 07-07-2010 R. EL OUAFI Mise à jour suite aux remarques du CNEIE C4 17-06-2010 R. EL OUAFI Mise à jour suite aux remarques du CNEIE C3 11-03-2010 Mise à jour suite à revue interne C2 25-jan-09 A MEKKAOUI M. ATTOU D. CHAZELLE Mise à jour suite à revue interne C1 18-jan-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Mise à jour suite à réunion avec la CNEIE B3 29-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Observations de SYSTRA B2 28-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA B1 13-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Observations de INEXiA et de SYSTRA A4 13-fev-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A3 12-fev-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A2 27-dec-08 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A1 21-oct-08 A MEKKAOUI M. ATTOU Indice Date Etabli Vérifié Validation BE Visa MOE Description A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 2 / 143 Sous-traitant du Groupement Mandataire du Groupement Etude LGV Kenitra-Tanger SOMMAIRE 1 PREAMBULE _________________________________________________________________________ -

The Economics of High Speed 2
HOUSE OF LORDS Economic Affairs Committee 1st Report of Session 2014‒15 The Economics of High Speed 2 Ordered to be printed 10 March 2015 and published 25 March 2015 Published by the Authority of the House of Lords London : The Stationery Office Limited £price HL Paper 134 Select Committee on Economic Affairs The Economic Affairs Committee is appointed by the House of Lords in each session “to consider economic affairs”. Membership The Members of the Select Committee on Economic Affairs are: Baroness Blackstone Lord Carrington of Fulham Lord Griffiths of Fforestfach Lord Hollick (Chairman) Lord Lawson of Blaby Lord May of Oxford Lord McFall of Alcluith Lord Monks Lord Rowe-Beddoe Lord Shipley Lord Skidelsky Lord Smith of Clifton Baroness Wheatcroft Declaration of interests See Appendix 1 A full list of Members’ interests can be found in the Register of Lords’ Interests: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/register-of-lords-interests Publications All publications of the Committee are available at: http://www.parliament.uk/hleconomicaffairs Parliament Live Live coverage of debates and public sessions of the Committee’s meetings are available at: http://www.parliamentlive.tv Further information Further information about the House of Lords and its Committees, including guidance to witnesses, details of current inquiries and forthcoming meetings is available at: http://www.parliament.uk/business/lords Committee staff The staff who worked on this inquiry were Robert Whiteway (Clerk), Ben McNamee (Policy Analyst), Stephanie Johnson (Committee Assistant) and Oswin Taylor (Committee Assistant). Contact details All correspondence should be addressed to the Clerk of the Economic Affairs Committee, Committee Office, House of Lords, London SW1A 0PW. -

Médiation Relative Aux Nuisances Générées Par Les TGV Auprès Des Riverains Des Lignes Bretagne-Pays-De-La-Loire Et Sud-Europe- Atlantique
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe- Atlantique Rapport n° 012345-01 établi par Emmanuelle BAUDOIN, Sylvain LEBLANC et Catherine MIR Avril 2019 Les auteurs attestent qu’aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n’a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable Sommaire Résumé.....................................................................................................................6 Liste des recommandations.................................................................................11 Introduction............................................................................................................14 1. Les nuisances induites par l’exploitation des trains à grande vitesse........17 1.1. Le bruit ferroviaire....................................................................................................17 1.1.1. Les nuisances sonores..................................................................................17 1.1.2. Effets sur la santé du bruit ferroviaire............................................................22 1.1.3. Réglementation française en matière de protection contre le bruit d’origine ferroviaire ................................................................................................................25