ETUDE D'impact SUR L'environnement Etude LGV Kenitra -Tanger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
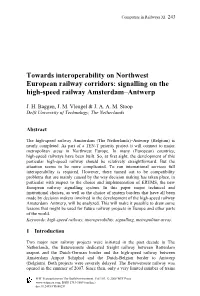
Signalling on the High-Speed Railway Amsterdam–Antwerp
Computers in Railways XI 243 Towards interoperability on Northwest European railway corridors: signalling on the high-speed railway Amsterdam–Antwerp J. H. Baggen, J. M. Vleugel & J. A. A. M. Stoop Delft University of Technology, The Netherlands Abstract The high-speed railway Amsterdam (The Netherlands)–Antwerp (Belgium) is nearly completed. As part of a TEN-T priority project it will connect to major metropolitan areas in Northwest Europe. In many (European) countries, high-speed railways have been built. So, at first sight, the development of this particular high-speed railway should be relatively straightforward. But the situation seems to be more complicated. To run international services full interoperability is required. However, there turned out to be compatibility problems that are mainly caused by the way decision making has taken place, in particular with respect to the choice and implementation of ERTMS, the new European railway signalling system. In this paper major technical and institutional choices, as well as the choice of system borders that have all been made by decision makers involved in the development of the high-speed railway Amsterdam–Antwerp, will be analyzed. This will make it possible to draw some lessons that might be used for future railway projects in Europe and other parts of the world. Keywords: high-speed railway, interoperability, signalling, metropolitan areas. 1 Introduction Two major new railway projects were initiated in the past decade in The Netherlands, the Betuweroute dedicated freight railway between Rotterdam seaport and the Dutch-German border and the high-speed railway between Amsterdam Airport Schiphol and the Dutch-Belgian border to Antwerp (Belgium). -

Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States
Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 First Printing 2013 Copyright © 2013, Parsons Brinckerhoff Group Inc. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, mechanical (including photocopying), recording, taping, or information or retrieval systems—without permission of the pub- lisher. Published by: Parsons Brinckerhoff Group Inc. One Penn Plaza New York, New York 10119 Graphics Database: V212 CONTENTS FOREWORD XV PREFACE XVII PART 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 1 INTRODUCTION TO THE RESEARCH 3 1.1 Unprecedented Support for High Speed Rail in the U.S. ....................3 1.2 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the U.S. .....4 1.3 Research Objectives . 6 1.4 William Barclay Parsons Fellowship Participants ...........................6 1.5 Host Manufacturers and Operators......................................7 1.6 A Snapshot in Time .................................................10 CHAPTER 2 HOST MANUFACTURERS AND OPERATORS, THEIR PRODUCTS AND SERVICES 11 2.1 Overview . 11 2.2 Introduction to Host HSR Manufacturers . 11 2.3 Introduction to Host HSR Operators and Regulatory Agencies . -

Cutaneous Leishmaniasis in Ouazzane and Sidi Kacem
Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:376-380 DOI 10.1007/s13149-016-0522-1 SANTÉ PUBLIQUE / PUBLIC HEALTH Cutaneous leishmaniasis in Ouazzane and Sidi Kacem provinces, Morocco (1997-2012) Leishmaniose cutanée dans les provinces d’Ouazzane et Sidi Kacem, au Maroc (1997-2012) H. El Miri · C. Faraj · O. Himmi · A. Hmamouch · S. Maniar · T. Laaroussi · M. Rhajaoui · F. Sebti · A. Benhoussa Reçu le 18 août 2015 ; accepté le 14 juin 2016 © Société de pathologie exotique et Lavoisier SAS 2016 Abstract Cutaneous leishmaniasis (CL) is a major public from neighboring endemic areas and establishment of habi- health problem in Morocco. Three distinct parasites are tation in areas where housing conditions are unfavorable involved; Leishmania tropica, Leishmania major and Leish- favored the emergence of the disease. mania infantum. The objective of this study is to investigate the epidemiological and the clinical features of endemic foci Keywords Cutaneous leishmaniasis · Leishmania tropica · of CL in Sidi Kacem and Ouazzane provinces in the north of Leishmania infantum · molecular identification · Sidi Morocco including molecular identification of parasites. We Kacem · Ouazzane · Morocco · Maghreb · Northern Africa studied the evolution and the distribution of 1,656 CL cases coming from 39 sectors in these provinces between 1997 and Résumé La leishmaniose cutanée (LC) est un problème 2012. The causative agents of CL in these areas were identi- majeur de santé publique au Maroc. Trois parasites distincts fied by using the ITS1-PCR-RFLP method. A tendency of sont impliqués : Leishmania tropica, Leishmania major et seasonality in incidence was observed, showing a peak in Leishmania infantum.L’objectif de cette étude est d’étudier April. -

Liste Des Guichets Des Banques Marocaines Par Localite Et Par Region
Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 4 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 5 L’ORIENTAL 13 FÈS - MEKNÈS 21 RABAT - SALÉ- KÉNITRA 29 BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA 39 CASABLANCA- SETTAT 45 MARRAKECH - SAFI 65 DARÂA - TAFILALET 73 SOUSS - MASSA 77 GUELMIM - OUED NOUN 85 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA 87 DAKHLA-OUED EDDAHAB 89 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION 5 TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 6 RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA BANQUE LOCALITES GUICHET TELEPHONE AL BARID BANK AIT YOUSSEF OU ALI AIT YOUSSEF OU ALI CENTRE 0539802032 AJDIR CENTRE RURALE AJDIR 35052 TAZA 0535207082 AL AOUAMRA CENTRE AL AOUAMRA 92050 AL AOUAMRA 0539901881 AL HOCEIMA AVENUE MOULAY DRISS AL AKBAR AL HOCEIMA 0539982466 BV TARIK BNOU ZIAD AL HOCEIMA 0539982857 ARBAA TAOURIRT ARBAA TAOURIRT CENTRE 0539804716 ASILAH 1 PLACE DES NATIONS UNIES 90055 ASILAH 0539417314 ASMATEN CENTRE ASMATEN EN FACE EL KIADA AL HAMRA 93250 ASMATEN 0539707686 BAB BERRET CENTRE BAB BERRET 91100 BAB BERRET 0539892722 BAB TAZA CENTRE BAB TAZA 91002 BAB TAZA 0539896059 BENI BOUAYACHE BENI BOUAYACHE CENTRE 0539804020 BENI KARRICH FOUKI CENTRE BENI KARRICH FOUKI 93050 BENI KARRICH FOUKI 0539712787 BNI AHMED CENTRE BNI AHMED CHAMALIA 91100 BNI AHMED 0539881578 BNI AMMART -

Leishmaniasis in Northern Morocco: Predominance of Leishmania Infantum Compared to Leishmania Tropica
Hindawi BioMed Research International Volume 2019, Article ID 5327287, 14 pages https://doi.org/10.1155/2019/5327287 Research Article Leishmaniasis in Northern Morocco: Predominance of Leishmania infantum Compared to Leishmania tropica Maryam Hakkour ,1,2,3 Mohamed Mahmoud El Alem ,1,2 Asmae Hmamouch,2,4 Abdelkebir Rhalem,3 Bouchra Delouane,2 Khalid Habbari,5 Hajiba Fellah ,1,2 Abderrahim Sadak ,1 and Faiza Sebti 2 1 Laboratory of Zoology and General Biology, Faculty of Sciences, Mohammed V University in Rabat, Rabat, Morocco 2National Reference Laboratory of Leishmaniasis, National Institute of Hygiene, Rabat, Morocco 3Agronomy and Veterinary Institute Hassan II, Rabat, Morocco 4Laboratory of Microbial Biotechnology, Sciences and Techniques Faculty, Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fez, Morocco 5Faculty of Sciences and Technics, University Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Morocco Correspondence should be addressed to Maryam Hakkour; [email protected] Received 24 April 2019; Revised 17 June 2019; Accepted 1 July 2019; Published 8 August 2019 Academic Editor: Elena Pariani Copyright © 2019 Maryam Hakkour et al. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In Morocco, Leishmania infantum species is the main causative agents of visceral leishmaniasis (VL). However, cutaneous leishmaniasis (CL) due to L. infantum has been reported sporadically. Moreover, the recent geographical expansion of L. infantum in the Mediterranean subregion leads us to suggest whether the nonsporadic cases of CL due to this species are present. In this context, this review is written to establish a retrospective study of cutaneous and visceral leishmaniasis in northern Morocco between 1997 and 2018 and also to conduct a molecular study to identify the circulating species responsible for the recent cases of leishmaniases in this region. -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Maroc : La Production De Cannabis Dans Le
Février 2002 - N° 13 OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES OFDT DROGUES ET DES TOXICOMANIES TraficDrogues international Bulletin mensuel MAROC : LA PRODUCTION sud, les communes de Mokrisset et de Zoumi. À ces deux provinces tra- DE CANNABIS DANS LE RIF ditionnelles s’ajoutent les zones de développement récent des cultures: Les dérivés du cannabis sont les drogues illicites les plus consommées les provinces de Tétouan au nord, de en France et en Europe. Selon le récent rapport Drogues et dépendan- Larache à l’Ouest et de Sidi-Kacem ces. Indicateurs et tendances de l’OFDT1, un individu sur cinq entre 18 au Sud. Dans cette dernière, l’ex- à 75 ans les ont expérimentées. Chez les jeunes arrivant à l’âge adulte, tension des cultures se fait aujour- la moitié des garçons déclare en avoir déjà consommés « et cette pro- d’hui au détriment de périmètres portion atteint même 54,9 % à 18 ans et 60,3 % à 19 ans »2. irrigués de bonnes terres loués par des paysans de Bab Berred et de Ketama. Un tel marché, qui représente des 200, voir 300 habitants au km2 dans millions d’individus, sous-entend certaines zones rurales. La popula- Étendue des superficies des importations importantes même tion des provinces de Al Hoceima de culture. si en France, comme dans le reste du (65 % de ruraux) et de Chefchaouen monde, on observe le développe- (90 % de ruraux) est passée au cours Il est très difficile d’avoir une esti- ment des cultures en intérieur. Selon des 28 dernières années de 620000 mation précise de l’ampleur des l’OCRTIS3, en 2000, les saisies de habitants à 1 140 000, soit de 71 cultures et plus encore du volume haschisch (ou résine de cannabis) se personnes au km2 à 1 636. -

Contribution À La Mesure De L'effet De L'innovation
Contribution à la mesure de l’effet de l’innovation sociale sur le développement territorial durable : Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Driss El Ghoufi To cite this version: Driss El Ghoufi. Contribution à la mesure de l’effet de l’innovation sociale sur le développement territorial durable : Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc. Economies et finances. Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc), 2019. Français. tel-02936971 HAL Id: tel-02936971 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02936971 Submitted on 21 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE CADI AYYAD FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES MARRAKECH Centre des Etudes Doctorales : Droit, Economie et Gestion Laboratoire de recherche : Innovation, Responsabilité et Développement Durable (INREDD) THESE DE DOCTORAT EN : SCIENCES ECONOMIQUES CONTRIBUTION A LA MESURE DE L’EFFET DE L’INNOVATION SOCIALE SUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra Par Driss EL GHOUFI Présentée et soutenue publiquement le 13/06/2019 Sous la direction du Professeur Fatima ARIB Jury : Mr. -

A European High-Speed Rail Network: Not a Reality but an Ineffective Patchwork
EN 2018 NO 19 Special Report A European high-speed rail network: not a reality but an ineffective patchwork (pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU) AUDIT TEAM The ECA’s special reports set out the results of its audits of EU policies and programmes, or of management-related topics from specific budgetary areas. The ECA selects and designs these audit tasks to be of maximum impact by considering the risks to performance or compliance, the level of income or spending involved, forthcoming developments and political and public interest. This performance audit was carried out by Audit Chamber II Investment for cohesion, growth and inclusion spending areas, headed by ECA Member Iliana Ivanova. The audit was led by ECA Member Oskar Herics, supported by Thomas Obermayr, Head of Private Office; Pietro Puricella, Principal Manager; Luc T’Joen, Head of Task; Marcel Bode, Dieter Böckem, Guido Fara, Aleksandra Klis- Lemieszonek, Nils Odins, Milan Smid, Auditors. Richard Moore provided linguistic support. From left to right: Thomas Obermayr, Guido Fara, Milan Smid, Aleksandra Klis-Lemieszonek, Richard Moore, Luc T’Joen, Marcel Bode, Pietro Puricella, Dieter Böckem, Oskar Herics. 2 CONTENTS Paragraph Abbreviations and glossary Executive summary I - XI Introduction 1 - 13 High-speed rail in Europe 1 - 2 The EU’s high-speed rail network is growing in size and in rate of utilisation 3 - 4 EU policies for high-speed rail 5 - 9 Transport policy 5 - 7 Cohesion policy 8 - 9 EU support for building high-speed lines: significant, but a fraction -

M a Is O N C O M M U N a Le C a Ïd a T G E N D a Rm E Rie Ro Y a Le A
Nombre Existence Nombre d'équipements des équipements d'équipements et services administratifs socio-culturels sanitaires Commune rurale Caïdat Code Géographique Souk Souk hebdomadaire Pharmacie Foyer féminin Infirmier privé Bureau deBureau poste Maison de jeunes Dispensaire rural Maison communale Mécanicien dentiste Gendarmerie royale Agence de crédit agricole Centre de santé communal Centre de travaux agricoles 066. Aousserd Aghouinite 066.03.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aousserd 066.03.05 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bir Gandouz 066.05.03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tichla 066.03.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zoug 066.03.09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391. Oued Ed-Dahab Bir Anzarane 391.05.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El Argoub 391.09.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gleibat EL Foula 391.05.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imlili 391.09.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mijik 391.05.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oum Dreyga 391.05.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/160 La commune Nombre d'établissements est Réseaux d'enseignement et de accessible d'infrastructure formation par Commune rurale Train Lycée Collège Autocar de développement ? Grand taxi Autre moyen Réseau d'électricité Réseau d'eau potable Ecole primaire satellite Ecole primaire centrale professionnelle publique Ecole coranique ou Msid Réseau d'assainissement La commune dispose-t-elle d'un plan Ecole primaire autonome Etablissement de formation 066. -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

Analyse De La Deuxième Phase De La Branche Est De La Ligne À Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Analyse de la deuxième phase de la branche Est de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône Rapport n° 012304-01 établi par Michel ROSTAGNAT P UNovembre B 2018 L I É PUBLIÉ Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable PUBLIÉ PUBLIÉ Sommaire Résumé.....................................................................................................................4 Liste des recommandations...................................................................................5 Introduction..............................................................................................................6 1. Où en est-on ?.......................................................................................................8 1.1. Bilan de la première phase.........................................................................................8 1.1.1. Modalités d’établissement du bilan LOTI.........................................................9 1.1.2. Evolution du trafic voyageurs...........................................................................9 1.1.3. Bilan financier................................................................................................12 1.2. Le service.................................................................................................................14