La Révolution Française, 12
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
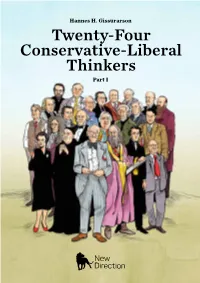
Twenty-Four Conservative-Liberal Thinkers Part I Hannes H
Hannes H. Gissurarson Twenty-Four Conservative-Liberal Thinkers Part I Hannes H. Gissurarson Twenty-Four Conservative-Liberal Thinkers Part I New Direction MMXX CONTENTS Hannes H. Gissurarson is Professor of Politics at the University of Iceland and Director of Research at RNH, the Icelandic Research Centre for Innovation and Economic Growth. The author of several books in Icelandic, English and Swedish, he has been on the governing boards of the Central Bank of Iceland and the Mont Pelerin Society and a Visiting Scholar at Stanford, UCLA, LUISS, George Mason and other universities. He holds a D.Phil. in Politics from Oxford University and a B.A. and an M.A. in History and Philosophy from the University of Iceland. Introduction 7 Snorri Sturluson (1179–1241) 13 St. Thomas Aquinas (1225–1274) 35 John Locke (1632–1704) 57 David Hume (1711–1776) 83 Adam Smith (1723–1790) 103 Edmund Burke (1729–1797) 129 Founded by Margaret Thatcher in 2009 as the intellectual Anders Chydenius (1729–1803) 163 hub of European Conservatism, New Direction has established academic networks across Europe and research Benjamin Constant (1767–1830) 185 partnerships throughout the world. Frédéric Bastiat (1801–1850) 215 Alexis de Tocqueville (1805–1859) 243 Herbert Spencer (1820–1903) 281 New Direction is registered in Belgium as a not-for-profit organisation and is partly funded by the European Parliament. Registered Office: Rue du Trône, 4, 1000 Brussels, Belgium President: Tomasz Poręba MEP Executive Director: Witold de Chevilly Lord Acton (1834–1902) 313 The European Parliament and New Direction assume no responsibility for the opinions expressed in this publication. -
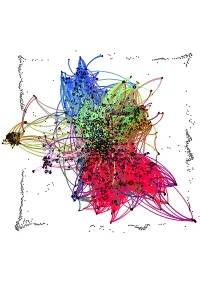
Network Map of Knowledge And
Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -

Anssi Halmesvirta the British Conception of the Finnish
Anssi Halmesvirta The British conception of the Finnish 'race', nation and culture, 1760-1918 Societas Historica Finlandiae Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Studia Historica 34 Anssi Häme svida The British conception of the Finnish 'race', nation and culture, 1760 1918 SHS / Helsinki / 1990 Cover by Rauno Endén "The Bombardment of Sveaborg" (9-10 of August, 1855). A drawing by J. W. Carmichael, artist from the Illustrated London News ISSN 0081-6493 ISBN 951-8915-28-8 GUMMERUS KIRJAPAINO OY JYVÄSKYLÄ 1990 Contents PREFACE 7 INTRODUCTION 8 1. THE EIGHTEENTH-CENTURY IMAGE OF THE FINN 29 1.1. Some precedents 29 1.2. The naturalists' view 36 1.3. The historians' view 43 1.4. Travel accounts 53 2. ON THE NORTH-EASTERN FRONTIER OF CIVILIZATION: THE EVOLUTION OF THE FINNS 81 2.1. The science of race 81 2.2. The place of the Finn in British pre-evolutionary anthropology, 1820-1855 88 2.3. Philology, ethnology and politics: the evolution of Finnish 111 2.4. The political and cultural status of Finland, 1809-1856: British perceptions 130 2.5. Agitation, war and aftermath 150 3. ARYANS OR MONGOLS? — BRITISH THEORIES OF FINNISH ORIGINS 167 4. THE FINNS, THEIR KALEVALA AND THEIR CULTURE.. 191 5. COMPARATIVE POLITICS AND BRITISH PERCEPTIONS OF THE PROGRESS OF THE FINNS, 1860-1899 209 5 6. BRITISH RESPONSES TO THE FINNISH-RUSSIAN CONSTITUTIONAL CONTENTION, 1899-1918 239 6.1. Immediate reactions 239 6.2. The Finnish question: variations on a Liberal theme 253 6.2.1. The constitutionalist argument 253 6.2.2. A compromise 266 6.2.3. -

Revolutionary Education at the Height of Sans-Culottes Power" (2007)
UNLV Retrospective Theses & Dissertations 1-1-2007 Gabriel Bouquier: Revolutionary education at the height of sans- culottes power Jonathan Douglas Deverse University of Nevada, Las Vegas Follow this and additional works at: https://digitalscholarship.unlv.edu/rtds Repository Citation Deverse, Jonathan Douglas, "Gabriel Bouquier: Revolutionary education at the height of sans-culottes power" (2007). UNLV Retrospective Theses & Dissertations. 2286. http://dx.doi.org/10.25669/a7at-svnd This Thesis is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Scholarship@UNLV with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Thesis in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Thesis has been accepted for inclusion in UNLV Retrospective Theses & Dissertations by an authorized administrator of Digital Scholarship@UNLV. For more information, please contact [email protected]. GABRIEL BOUQUIER: REVOLUTIONARY EDUCATION AT THE HEIGHT OF SANS-CULOTTES POWER by Jonathan Douglas Deverse Bachelor of Arts University of California, Santa Cruz 2002 A thesis submitted in partial fiilfillment of the requirements for the Master of Arts Degree in History Department of History College of Liberal Arts Graduate College University of Nevada, Las Vegas May 2008 UMI Number: 1456335 Copyright 2008 by Deverse, Jonathan Douglas All rights reserved. INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. -

PUBLISHER S French Revolutionary Pamphlets Usteri Collection
Guide AMPHLETS P French Revolutionary Pamphlets Usteri Collection, Zentralbibliothek, Zürich (Installments I-IV) Advisor: Prof. Dr. Erich Pelzer University of Freiburg, Germany EVOLUTIONARY R RENCH F AIDC PUBLISHERP U R L 1 5H E R S S BRILLB RI LL French RevolutionaryRevolutionary Pamphlets USUsteriteri Collection, Zentralbibliothek, Zurich Editor: Prof. Dr. Erich Pelzer, University of Freiburg, Germany Installment I Contents Catalogue 3 Bibliographical references references 209 Author index . 211 Guide toto thethe microformmicroform collectioncollection Installment I, Usteri 1-21651-2165 (Fiche(Fiche 1-500)1-500) RM IDC1996IDC 1996 French Revolutionary Pamphlets -3- Usteri Collection on microfiche Catalogue 1 A basla tete de Carrier et toutes celles qui luiressemblent..C'est le moyen de ne plus Z Usteri 1864 avoir ni Tete niQueue.S.te du Dialogue entre un Domingois et unNantais. -Paris : Fiche 423 Imprimerie des Droits du Peuple, s.d.. - 16 S. M/W 4:2, 1 2.. A nosseigneurs de l'assembleenationale.Memoire pour les maitres depostes. -Paris : Z Usteri 937 Imp.. deCailleau,s..d. - 31 S. Fiche 208/209 M/W 4:2,136 3.. A tous lespeuples de la terse sur 1'etat de la religion enFrance.. -Paris : sn., 1791.. - 24 S.. Z Usteri 291 M/W 4:2,166 Fiche 89/90 4. Abjuration des petites filles Jacobites des departemens a leur Maman Jacobite de Paris.. - Z Usteri 1026 Paris : Imprimerie de Gorsas, s, d. - 16 S.. Fiche 225 M/W 4:2,175 5.. Abolitionde la peine de mort ou Dangers d'admettre les supplices dans un Etat sagement Z Usteri1043 gouverne. -Paris : Chez Caillot, anIIIe. -

Suggested Reading and Viewing
Suggested Reading and Viewing If you enjoyed Sweden: Lessons for America?, you might also enjoy the following materials: SUGGESTED READING FROM JOHAN NORBERG Here is my own brief introduction to Sweden’s economic and political history and welfare state: https://www.libertarianism.org/publications/essays/how-laissez-faire-made-sweden-rich Mauricio Rojas is an immigrant from Sweden and an economic historian who went from being a Marxist to a free marketeer after meeting the Swedish model. Here is a very good and fairly short introduction to Sweden: https://timbro.se/app/uploads/2017/02/9175665891.pdf Andreas Bergh is a smart economist, who has explained Sweden’s peculiar combination of free enterprise and a welfare state: https://www.amazon.com/Revival-Capitalist-Welfare-Thinking-Political/dp/1783473495 Nima Sanandaji, an immigrant from Iran, who explains why Scandinavian welfare states aren’t so great as most foreigners think: https://www.amazon.com/Scandinavian-Unexceptionalism-Third-Way-Socialism-Political/dp/025536704X ADDITIONAL READING SUGGESTIONS Anticipating The Wealth of Nations: The Selected Works of Anders Chydenius, 1729–1803 (Routledge Studies in the History of Economics) 1st Edition by Anders Chydenius https://www.amazon.com/Anticipating-Wealth-Nations-Chydenius-1729-1803/dp/0415551331 The National Gain by Anders Chydenius https://www.amazon.com/national-gain-Anders-Chydenius/dp/B00086NYNQ Progress: 10 Reasons to Look Forward to the Future by Johan Norberg https://www.amazon.com/Progress-Reasons-Look-Forward-Future/dp/1786070650 -

Imagereal Capture
| 2 Fre dom of Information R view j Freedom of Information, a Finnish clergyman’s gift to democracy Constitutional rights, guarantees of freedom of speech reporting. Among the many facts which emerged was an and freedom of the press tend to be thought of as analo initially surprising revelation that one strand of the evolu gous with republicanism and the Constitution of the tion of Fol was deeply rooted in Seventh Century China. It United States. It is a matter of record that the First was also discovered that the first legislative moves Amendment to the United States Constitution — a docu towards freedom of information in any Western nation, ment guaranteeing freedoms of religion, speech, the and probably the world, occurred in Sweden and Finland press, assembly, and petition — has been seen as a (which was part of the Swedish Realm at the time) in model and a benchmark in other democratic nations. So 1707. In that year a statute was adopted compelling the too, have United States freedom of information laws and publishers of all printed literature to lodge ‘legal deposit its Bill of Rights. In fact many of the nearly 40 nations copies’ of everything they produced with government around the world which have some form of freedom of approved libraries.11 While not a freedom of information information (Fol) statute today,1 have at least partly act in the broad sense of making all government-held based their own legislation on the United States model.2 documents available to all citizens, it was a very signifi In reality, however, the United States was far from the cant forerunner of later laws for three reasons. -

The Philosophical Age
THE PHILOSOPHICAL AGE THE NORTHERN LIGHTS SOCIAL PHILOSOPHIES AND UTOPIAS OF THE ENLIGHTENMENT IN NORTHERN EUROPE AND RUSSIA THE NORTHERN LIGHTS Social Philosophies and Utopias of the Enlightenment in Northern Europe and Russia Александровский институт университета Хельсинки Санкт-Петербургский центр истории идей ____________________________________________ ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК АЛЬМАНАХ 39 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ Социальная философия и утопии Просвещения в Северной Европе и России Ответственные редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин, В. Ойттинен Санкт-Петербургский центр истории идей Санкт-Петербург — Хельсинки 2013 The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki St. Petersburg Center for the History of Ideas ____________________________________________ THE PHILOSOPHICAL AGE ALMANAC 39 THE NORTHERN LIGHTS Social Philosophies and Utopias of the Enlightenment in Northern Europe and Russia Edited by Tatiana Artemyeva, Mikhail Mikeshin, Vesa Oittinen St. Petersburg Center for the History of Ideas St. Petersburg — Helsinki 2013 Ответственные редакторы альманаха: Т.В. Артемьева, М.И. Микешин В оформлении использовано аллегорическое изображение философии из книги «Иконология, объясненная лицами, или полное собрание аллегорий, емблем и пр.» (Т. 2. М., 1803). В 39-м выпуске альманаха «Философский век» опубликованы мате- риалы международного научного симпозиума «Северное сияние: Соци- альная философия и утопия Просвещения в Северной Европе и России», проведенного 14–15 сентября 2012 г. в Александровском институте университета Хельсинки в сотрудничестве с Санкт-Петербургским цен- тром истории идей. Симпозиум продолжил серию семинаров «Северное сияние», являющуюся составной частью проекта «Centre of Excellence» Александровского института, исследующего модернизационные про- цессы в России. Семинары «Северное сияние» изучают историческую роль мысли эпохи Просвещения и ее влияние на создание современных обществ в Скандинавии и России. Философский век. Альманах. Выпуск 39. Северное сияние: Соци- альная философия и утопии Просвещения в Северной Европе и России / Отв. -

Avant-Propos
Avant-propos e dossier de ce numéro 24 de la Revue d’histoire nordique est consacré à l’une des Lsouveraines les plus connues et les plus mystérieuses du XVIIe siècle, la reine Christine de Suède. Placée encore enfant à la tête de l’un des États alors les plus puissants d’Europe, celle-ci renonce assez jeune au trône au profit de l’un de ses cousins, s’installe à Rome, abjure le luthéranisme et se convertit au catholicisme. Très attirée par les débats intellectuels, elle invite à sa cour, tant en Suède qu’à Rome, de nombreux artistes, philosophes ou théologiens avec lesquels elle échange volontiers, annonçant ainsi avec presque un siècle d’avance ce qui va devenir une sorte de mode chez maints souverains de l’ère des Lumières, ne serait-ce que la Grande Catherine de Russie. Pour ce qui est de la gestion du Royaume et de la politique extérieure, elle montre moins de dispositions, laissant en grande partie au chancelier Axel Oxenstierna le soin de mener les affaires. Il lui arrive cependant d’avoir des différends politiques avec ce dernier, en particulier au moment des négociations des traités de Westphalie, ce qui lui vaut les foudres de l’ancien conseiller et ami de son père, Gustave II Adolphe. Le présent dossier, mené de mains de maîtres par Didier Foucault et Véronique Castagnet-Lars, s’intéresse prioritairement aux liens tissés entre la célèbre souveraine et divers cercles d’intellectuels, poètes et artistes ayant bénéficié de ses largesses. Plusieurs contributions mettent en lumière le rôle de certains réseaux (les rosicruciens étudiés par Federic Barbierato ou les académiciens royaux présents à Rome présentés par Valentina Gallo) ou de certains individus (Pierre Chanut pour Cécile Peter, Pierre Michon Bourdelot pour Didier Foucault, Athanasius Kircher pour Susanna Åkerman) dans la formation intellectuelle et religieuse de Christine. -

The Success of the Finnish Model: an Economic Analysis
Journal of Management Policies and Practices June 2019, Vol. 7, No. 1, pp. 12-20 ISSN: 2333-6048 (Print), 2333-6056 (Online) Copyright © The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute for Policy Development DOI: 10.15640/jmpp.v7n1a2 URL: https://doi.org/10.15640/jmpp.v7n1a2 The Success of the Finnish Model: An Economic Analysis Jordi Franch Parella1 Abstract Finland is considered an example of how interventionist governmental policies work and a success under many socio-economic standards. From social indicators like inequality and crime to economic indicators like productivity and innovation the Nordic country gathers near the top. We inquire into the causes of the Finnish economic success, ascertaining which is the role of the Welfare State and the public sector in it. In fact, we examine which is the relation of causality between the good socio-economic performance and the public sector. Finland is a competitive market economy that has developed a functional Welfare State within a context of liberalisation and free choice. In this paper, we research the causes of this successful model. Keywords: Nordic model, Finland, capitalism, socialism, Welfare State JEL Classification: I00, O52, P00 1. Introduction Finland, the most northerly country in the European Union (EU), disposes of an inhospitable and extreme climatology. The low temperatures and the cold Baltic wind make life in public outdoor spaces unattractive. The differences with the southern European countries are very noticeable from the first moment (Franch, 2017). The Nordic economies are usually seen, not only in Europe but also in the USA (Aleem, 2015) as an example of efficient Welfare States where the government provides a large range of social benefits. -

Sjuttonhundratal Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies Volume 12
Sjuttonhundratal Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies Volume 12 2015 Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies An international multidisciplinary peer reviewed open access scholarly journal Published by Svenska sällskapet för 1700-talsstudier in cooperation with Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura/Finska sällskapet för 1700-talsstudier Norsk selskap for 1700-tallsstudier Dansk selskab for 1700-talsstudier Félag um átjándu aldar fræði, Ísland Editor-in-chief: Professor David Dunér, Lund University, Sweden Co-editors: PhD, Associate Professor Johanna Ilmakunnas, University of Helsinki/ University of Turku, Finland; PhD Per Pippin Aspaas, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway; Assistant Professor Søren Peter Hansen, Technical University of Denmark, Ballerup, Denmark; Professor Lasse Horne Kjældgaard, Roskilde University, Denmark; PhD Hrefna Róbertsdóttir, National Archives of Iceland, Reykjavík, Iceland Review editors: PhD My Hellsing, Uppsala University, Sweden; Associate Professor Henrika Tandefelt, University of Helsinki, Finland; PhD Øystein Lydik Idsø Viken, University of Oslo, Norway; PhD Jens Bjerring-Hansen, University of Copenhagen, Denmark; Research Professor Margrét Eggertsdóttir, The Árni Magnússon Institute for Icelandic studies, Reykjavík, Iceland Language consultant: PhD Mark Davies, Lund University, Sweden Open Access adviser: Jan Erik Frantsvåg, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway Editorial board: Professor Anna Agnarsdóttir, University of Iceland, Reykjavík, -

The Swedish Freedom of Print Act of 1776 – Background and Significance
The Swedish Freedom of Print Act of 1776 – Background and Significance Jonas Nordin* The first Swedish Freedom of Print Act was adopted on 2 December 1766. Thus, it celebrated its 250th anniversary in 2016.1 It was the first legislation in the world with clearly determined limits for the freedom of print. Its contemporary importance is illustrated by the fact that it was promulgated as a constitutional law. The Swedish Freedom of Print Act contained fifteen paragraphs outlining the extent and limits to the press in detail.2 The law was formulated according to an exclusivity principle: only those offenses that were clearly specified in the law could be indicted. If a topic was not explicitly excluded it could be freely discussed in print without fear of reprisal. The exceptions in the law were four (§§1–3). Everything was allowed to print, except for: challenges to the Evangelical faith; attacks on the constitution, the royal family or foreign powers; defamatory remarks about civil servants or fellow citizens; and indecent or obscene literature. * Jonas Nordin, Secretary of the Research Council, Kungliga biblioteket/The National Library of Sweden, gave this speech at Southwestern Law School’s symposium commemorating “Freedom of Information laws on the Global Stage: Past, Present and Future” (November 4, 2016). 1. In 2016 the Swedish Parliament (Sveriges Riksdag) published an extensive scholarly volume relating to the anniversary. Twenty-two experts treat the story of freedom of print in Sweden from 1766–2016 in various historical, legal, and cultural viewpoints. An English translation is due to be published in 2017: Press Freedom 250 Years.