World Bank Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MAURITANIA Honour – Fraternity – Justice
ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA Honour – Fraternity – Justice AFRICAN RISK CAPACITY (ARC) Operations Plan in Support of the Populations Affected by Drought 2016-2017 1 TABLE OF CONTENTS 1 GENERAL INFORMATION ......................................................................................................................................................................................... 5 1.1 STATUS OF MAURITANIA IN TERMS OF RISKS .................................................................................................................................................................. 5 1.2 PURPOSE OF THIS OPERATIONS PLAN .............................................................................................................................................................................. 7 2 COUNTRY DROUGHT PROFILE.................................................................................................................................................................................. 7 2.1 GENERAL GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF DROUGHT ................................................................................................................................................. 7 2.2 GENERAL RAINFALL FEATURES OF THE COUNTRY .......................................................................................................................................................... 13 2.3 SEASONAL AGRICULTURAL CALENDAR ......................................................................................................................................................................... -

Ethnicity, Discrimination, and Other Red Lines Repression of Human Rights Defenders in Mauritania
HUMAN ETHNICITY, DISCRIMINATION, RIGHTS AND OTHER RED LINES WATCH Repression of Human Rights Defenders in Mauritania Ethnicity, Discrimination, and Other Red Lines Repression of Human Rights Defenders in Mauritania Copyright © 2018 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 978-1-6231-35683 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch defends the rights of people worldwide. We scrupulously investigate abuses, expose the facts widely, and pressure those with power to respect rights and secure justice. Human Rights Watch is an independent, international organization that works as part of a vibrant movement to uphold human dignity and advance the cause of human rights for all. Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich. For more information, please visit our website: http://www.hrw.org FEBRURARY 2018 ISBN: 978-1-6231-35683 Ethnicity, Discrimination, and Other Red Lines Repression of Human Rights Defenders in Mauritania Summary ........................................................................................................................... 1 Recommendations .............................................................................................................. 7 To the Mauritanian Government ............................................................................................... -

Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N
!ho o Õ o !ho !h h !o ! o! o 20°0'0"W 15°0'0"W 10°0'0"W 5°0'0"W 0°0'0" Laayoune / El Aaiun HASSAN I LAAYOUNE !h.!(!o SMARAÕ !(Smara !o ! Cabo Bu Craa Algeria Bojador!( o Western Sahara BIR MOGHREIN 25°0'0"N ! 25°0'0"N Guelta Zemmur Ad Dakhla h (!o DAKHLA Tiris Zemmour DAJLA !(! ZOUERAT o o!( FDERIK AIRPORT Zouerate ! Bir Gandus o Nouadhibou NOUADHIBOU (!!o Adrar ! ( Dakhlet Nouadhibou Uad Guenifa !h NOUADHIBOU ! Atar (!o ! ATAR Chinguetti Inchiri Mauritania 20°0'0"N Mali 20°0'0"N AKJOUJT o ! ATLANTIC OCEAN Akjoujt Tagant TIDJIKJA ! o o o Tidjikja TICHITT Nouakchott Nouakchott Hodh Ech Chargui (!o NOUAKCHOTT Nbeika !h.! Trarza ! ! NOUAKCHOTT MOUDJERIA o Moudjeria o !Boutilimit BOUTILIMIT ! Magta` Lahjar o Mal ! TAMCHAKETT Aleg! ! Brakna AIOUN EL ATROUSS !Guerou Bourem PODOR AIRPORTo NEMA Tombouctou! o ABBAYE 'Ayoun el 'Atrous TOMBOUCTOU Kiffa o! (!o o Rosso ! !( !( ! !( o Assaba o KIFFA Nema !( Tekane Bogue Bababe o ! o Goundam! ! Timbedgha Gao Richard-Toll RICHARD TOLL KAEDI o ! Tintane ! DAHARA GOUNDAM !( SAINT LOUIS o!( Lekseiba Hodh El Gharbi TIMBEDRA (!o Mbout o !( Gorgol ! NIAFUNKE o Kaedi ! Kankossa Bassikounou KOROGOUSSOU Saint-Louis o Bou Gadoum !( ! o Guidimaka !( !Hamoud BASSIKOUNOU ! Bousteile! Louga OURO SOGUI AIRPORT o ! DODJI o Maghama Ould !( Kersani ! Yenje ! o 'Adel Bagrou Tanal o !o NIORO DU SAHEL SELIBABY YELIMANE ! NARA Niminiama! o! o ! Nioro 15°0'0"N Nara ! 15°0'0"N Selibabi Diadji ! DOUTENZA LEOPOLD SEDAR SENGHOR INTL Thies Touba Senegal Gouraye! du Sahel Sandigui (! Douentza Burkina (! !( o ! (!o !( Mbake Sandare! -

2. Arrêté N°R2089/06/MIPT/DGCL/ Du 24 Août 2006 Fixant Le Nombre De Conseillers Au Niveau De Chaque Commune
2. Arrêté n°R2089/06/MIPT/DGCL/ du 24 août 2006 fixant le nombre de conseillers au niveau de chaque commune Article Premier: Le nombre de conseillers municipaux des deux cent seize (216) Communes de Mauritanie est fixé conformément aux indications du tableau en annexe. Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles relatives à l’arrêté n° 1011 du 06 Septembre 1990 fixant le nombre des conseillers des communes. Article 3 : Les Walis et les Hakems sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel. Annexe N° dénomination nombre de conseillers H.Chargui 101 Nema 10101 Nema 19 10102 Achemim 15 10103 Jreif 15 10104 Bangou 17 10105 Hassi Atile 17 10106 Oum Avnadech 19 10107 Mabrouk 15 10108 Beribavat 15 10109 Noual 11 10110 Agoueinit 17 102 Amourj 10201 Amourj 17 10202 Adel Bagrou 21 10203 Bougadoum 21 103 Bassiknou 10301 Bassiknou 17 10302 El Megve 17 10303 Fassala - Nere 19 10304 Dhar 17 104 Djigueni 10401 Djiguenni 19 10402 MBROUK 2 17 10403 Feireni 17 10404 Beneamane 15 10405 Aoueinat Zbel 17 10406 Ghlig Ehel Boye 15 Recueil des Textes 2017/DGCT avec l’appui de la Coopération française 81 10407 Ksar El Barka 17 105 Timbedra 10501 Timbedra 19 10502 Twil 19 10503 Koumbi Saleh 17 10504 Bousteila 19 10505 Hassi M'Hadi 19 106 Oualata 10601 Oualata 19 2 H.Gharbi 201 Aioun 20101 Aioun 19 20102 Oum Lahyadh 17 20103 Doueirare 17 20104 Ten Hemad 11 20105 N'saveni 17 20106 Beneamane 15 20107 Egjert 17 202 Tamchekett 20201 Tamchekett 11 20202 Radhi -

Senegal River Basin Health Master Plan Study
SENEGAL RIVER BASIN HEALTH MAETER PLAN STUDY WASH Field Report No. 453 December 1994 SANITATION fbr --- ~.rea+r.rr~fi PROJECT -- Sponsored by the U.S. Agency for International Development Operated by CDM and Associates WASH Field Report No. 453 Senegal River Basin Health Master Plan Study Prepared for the USAlD Mission to Senegal U. S. Agency for International Development under WASH Task No. 5 12 Mbarack Diop William R. Jobin with Nicolas G. Adrien Fereydoun Arfaa Judith Auk1 Sax& Bertoli-Minor Ralph W~~PP Jan Rozendaal December 1994 Water and Slnimtion for Hdth Project C-t No. DPJi-5973-Z4WO81-00, Project No. 936-5973 is sponsod by Me Bumu for Glow Programs, Field Suppoh and Resurch Offh of Hdth rad Nuaitibn U.S. Agency for IntennW Development Wdingmn, DC 20523 Senegal River Basin Health Master Plan Shady ERRATA P. xix, paragraph 6, line 1 : "The Senegal River rises in Guinea.." P. 21, paragraph 4, lines 4-5: "Giventhe decrease in midalls in the Lawer€.,c~..." P. 35, Current Findings/Epiderniological Survey, paragraph 2, line 1: "Inthe Delta, three schools on the Mauritanian bank of the river (Finuresand 14)..." - P. 57, Figure 20: Green line = St. Louis, red line = Dagana P. 68, fourth full paragraph, line 3: "...toallow fanners to harvest a normal crop and Figure 25)." !~ENEGALRIVHIBASMHEALTHMASLPZPLANST~Y CONTENTS ... Acknowledgements ............................................... xu1 Acronyms ...................................................... xv Preface ........................................................ xix ExecutiveSummary -

The World Bank
- I Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized ReportNo. 9787-MAU STAFF APPRAISAL REPORT ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA Public Disclosure Authorized HEALTHAND POPULATIONPROJECT OCTOBER 28, 1991 Public Disclosure Authorized Populationand Human Resources Operations Division Sahelian Department Africa Region Public Disclosure Authorized This documenthas a restricteddistribution and may be used by recipientsonly in the performanceof their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without WorId Bank authorization. CURRENCY EOUIVALENTS Currency Unit = ouguiya (UM) / US$1.0 = 84 UM (August 1991) MEASURES metric system ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AfDB African Development Bank BHU Village Basic Health Unit BMZ German Ministry for Economic Cooperation CEDS Centre d'Etudes Démographiques et Sociales (Center for Demographic and Social Studies) CHN Centre Hospital,er National (National Hospital Center) CPF Centre de Promotion Féminine (Center for the Promotion of Women) DAFA Directorate of Administrative and Financial Affairs DHE Directorate of Health Education DHR Directorate of Human Resources DHHP Directorate of Hygiene and Health Protection DPM Direction de la Pharmacie et de Médicaments (Directorate of Pharmacy and Drugs) DPC Directorate of Planning and Coordination DRASS Direction Régionale de l'Action Socio-Sanitaire (Regional Health Directorate) EC European Community ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique (National School of Public Health) FPU Family Planning Unit HC Departmental Health -

Rapport De La Mission D'evaluation De La Securite Alimentaire Et
RAPPORT DE LA MISSION D’EVALUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLLE EN MAURITANIE (FEVRIER 2020) (Moudjéria au TAGANT, Barkeol à ASSABA, Mbout au GORGOL et Ouild Yenje au GUIDIMAGHA) Mars 2020 Avec l’appui de : INDEX ACRONYME .................................................................................................................................. 3 Résumé exécutif ........................................................................................................................... 4 1. Contexte ............................................................................................................................... 6 2. Objectifs de l’évaluation........................................................................................................ 9 3. Méthodologie de la mission ................................................................................................ 11 3.1. Préparation et élaboration des outils ........................................................................... 12 3.2. Mission d’évaluation ................................................................................................... 12 4. Profil des moyens d’existence dans les zones concernées par l’évaluation ............................ 14 5. Impact de la sécheresse sur la sécurité économique des ménages ........................................ 19 5.1. Impact sur les capitaux de moyens d’existence ............................................................. 19 5.1.1. Détail du changement du capital naturel ..................................................................... -

Poverty and the Struggle to Survive in the Fuuta Tooro Region Of
What Development? Poverty and the Struggle to Survive in the Fuuta Tooro Region of Southern Mauritania Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Christopher Hemmig, M.A. Graduate Program in Near Eastern Languages and Cultures. The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Sabra Webber, Advisor Morgan Liu Katey Borland Copyright by Christopher T. Hemmig 2015 Abstract Like much of Subsaharan Africa, development has been an ever-present aspect to postcolonial life for the Halpulaar populations of the Fuuta Tooro region of southern Mauritania. With the collapse of locally historical modes of production by which the population formerly sustained itself, Fuuta communities recognize the need for change and adaptation to the different political, economic, social, and ecological circumstances in which they find themselves. Development has taken on a particular urgency as people look for effective strategies to adjust to new realities while maintaining their sense of cultural identity. Unfortunately, the initiatives, projects, and partnerships that have come to fruition through development have not been enough to bring improvements to the quality of life in the region. Fuuta communities find their capacity to develop hindered by three macro challenges: climate change, their marginalized status within the Mauritanian national community, and the region's unfavorable integration into the global economy by which the local markets act as backwaters that accumulate the detritus of global trade. Any headway that communities can make against any of these challenges tends to be swallowed up by the forces associated with the other challenges. -

Etudes Techniques Du Reseau Cible
ETUDES TECHNIQUES DU RESEAU CIBLE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 7. Etude technique du réseau cible 1 7.1 Contexte 1 7.2 Objectifs 1 7.3 Contexte actuel, contexte engagé (moyen terme) du système de transport et choix techniques en vigueur 1 7.3.1 Objectifs et critères d’analyse 1 7.3.1.1 Objectifs 1 7.3.1.2 Critères 2 7.3.2 Analyse de la situation existante 2 7.3.2.1 Lignes 3 7.3.2.2 Calculs de répartition à la pointe de charge 6 7.3.2.3 Calculs de court-circuit 9 7.3.2.4 Calculs de stabilité transitoire 10 7.3.2.5 Situation au creux de charge 14 7.3.2.6 Conclusion 15 7.4 Projets annoncés (projets SOMELEC et OMVS) 15 7.4.1 Projets supposés engagés 15 7.4.1.1 Projets d’extension de réseau 15 7.4.1.2 Projets de production d’électricité 16 7.4.2 Projets moins certains 16 7.5 Rappels du contexte futur: Prévisions de la demande et plan de production long terme 17 7.5.1 Prévisions de la demande 17 7.5.1.1 Charge des localités des Réseaux Autonomes (RA ou "Réseaux Araignées") 17 7.5.1.2 Charge des localités du Réseau Interconnecté (RI) 18 7.5.1.3 Charge de Nouakchott et Nouadhibou 18 7.5.2 Année de raccordement des autres grandes localités 19 7.5.3 Plan de production 19 7.6 Projets "Plan Directeur" : calculs de répartition 20 7.6.1 Variantes envisageables 20 7.6.2 Plan de tension et compensation de la puissance réactive 22 7.6.3 Niveau de charge des lignes et transformateurs 25 7.6.4 Pertes à la pointe en 2030 25 7.6.5 Introduction -

Commission Nationale Des Concours
Commission Nationale des Concours Concours d' Entrée aux Enis 2017-2018 Aioun Liste des Admissibles par ordre Alphabétique l'entretion oral aura lieu le jeudi 23 ,vendredi 24 et samedi 25 Novembre 2017 Option : Instituteurs Français N° Ins Nom Complet Année Naiss Lieu Naiss 0045 Abdallahi Oumar Kane 1987 Nteikane 0008 Abdoul Alassane Borol 1990 Blajmil 0020 Abdoulaye Mohamedou Dia 1989 Boghe 0017 Abdoulaye Moussa Dieng 1989 Aere M'Bar 0009 Bouki Ouma Diallo 1993 Blajmil 0041 Chriva inejih Sidaty 1997 Aioun 0039 Ebaye Ahmed EL Abd 1992 Guetee Teydouma 0010 Fatimetou Med Ahmed Mousatpha 1996 Aioun 0038 Mahfoudh Abdallahi Abdallahi 1996 Ghoub Nwamer 0031 M'Hamdy Saleh Beibou 1989 Aioun 0015 Mouna Brahim El Wely 1993 Aioun 0047 Selmane ahmed Abdel Kader 1993 Kobenni 0026 Sidi Med Med Mahmoud Vadoua 1994 Kiffa 0024 Zeinebou Cheikh Horma 1997 Magta Lehjar Effectif 14 Le Président Les Membres Page 1 of 9 18/11/2017 09:50:38 Commission Nationale des Concours Concours d' Entrée aux Enis 2017-2018 Kaédi Liste des Admissibles par ordre Alphabétique l'entretion oral aura lieu le jeudi 23 ,vendredi 24 et samedi 25 Novembre 2017 Option : Instituteurs Français N° Ins Nom Complet Année Naiss Lieu Naiss 0005 Abdallahi Djibril Samba 1990 Tifonde Civé 0074 Abou Mohamed Diallo 1995 Kaédi 0115 Aboubacry Maoula Traoré 1989 Kaédi 0103 Ainetou Ahmed Mahmoud Ahmed T'Ch 1994 Tevragh Zeina 0015 Aissata Bocar Ba 1988 Bagodine 0036 Aissata Youro Sarr 1987 Teyaret 0011 Alassane Al Housseynou N'Diaye 1987 Boghé 0006 Ali Sid'Ahmed Lahmar 1994 Chelkhet Tiyab 0093 Aly -
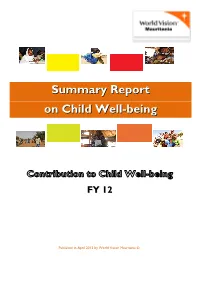
Summary Report on Child Well-Being
SSuummmmaarryy RReeppoorrtt oonn CChhiilldd WWeellll--bbeeiinngg FFYY 1122 Published in April 2013 by World Vision Mauritania © Table of Contents ACRONYMS .......................................................................................................................................... 4 1. Executive Summary ......................................................................................................................... 5 2. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 6 3. Challenges and Enablers .................................................................................................................. 8 4. Influencing Factors .......................................................................................................................... 9 5. ACHIEVEMENTS ............................................................................................................................. 10 5.1. Improved the number of children in preschool prepared .................................................... 10 5.2. Improved Access and Quality of Education ........................................................................... 12 5.3. Improved nutritional status of children ................................................................................ 14 5.4. Improve the immunization status of children ....................................................................... 17 5.5. Increased households’ capacities to ensure -

Prevision De La Demande
PREVISION DE LA DEMANDE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 3. Prévision de la demande 1 3.1 Introduction 1 3.2 Développement démographique 2 3.2.1 Période 2000 - 2010 2 3.2.2 Période 2011 - 2030 3 3.3 Développement économique 4 3.3.1 L'objectif primordial - réduction de la pauvreté 4 3.3.2 Développement du PIB dans la période 1995 - 2010 4 3.3.3 Le secteur minier et le secteur de la pêche 6 3.3.3.1 Statistique de production 6 3.3.3.2 Secteur minier 7 3.3.3.3 Secteur de la pêche 7 3.3.4 Perspectives de développement 8 3.4 Demande d'électricité dans le passé 10 3.4.1 Cadre institutionnel 10 3.4.2 Ventes BT et MT de la SOMELEC dans la période 2000 - 2012 10 3.4.3 Période 2006 - 2012 : Abonnés BT et ventes BT 11 3.4.4 Période 2006 - 2012 : Abonnés MT et ventes MT 14 3.4.5 Résumé de la situation en 2010 20 3.4.6 Le secteur minier 21 3.5 Modèle de demande des localités déjà électrifiées 22 3.5.1 Développement du taux d'électrification 24 3.5.2 Développement de la demande spécifique des abonnés domestiques 25 3.5.2.1 Nouakchott et Nouadhibou 25 3.5.2.2 Autres localités 25 3.5.3 Développement de la demande des abonnés BT non domestiques 27 3.5.4 Développement de la demande MT 28 3.5.5 Demande en puissance (pointes annuelles) 29 3.6 Demande potentielle des localités NON électrifiées 30 3.7 Demande du secteur minier 33 3.8 Résultats 34 3.8.1 Localités déjà électrifiées en 2011 34 3.8.1.1 Demande en énergie électrique 34 3.8.1.2 Demande