[Pdf] MINDANAO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Counter-Insurgency Vs. Counter-Terrorism in Mindanao
THE PHILIPPINES: COUNTER-INSURGENCY VS. COUNTER-TERRORISM IN MINDANAO Asia Report N°152 – 14 May 2008 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 II. ISLANDS, FACTIONS AND ALLIANCES ................................................................ 3 III. AHJAG: A MECHANISM THAT WORKED .......................................................... 10 IV. BALIKATAN AND OPLAN ULTIMATUM............................................................. 12 A. EARLY SUCCESSES..............................................................................................................12 B. BREAKDOWN ......................................................................................................................14 C. THE APRIL WAR .................................................................................................................15 V. COLLUSION AND COOPERATION ....................................................................... 16 A. THE AL-BARKA INCIDENT: JUNE 2007................................................................................17 B. THE IPIL INCIDENT: FEBRUARY 2008 ..................................................................................18 C. THE MANY DEATHS OF DULMATIN......................................................................................18 D. THE GEOGRAPHICAL REACH OF TERRORISM IN MINDANAO ................................................19 -

Southern Philippines, February 2011
Confirms CORI country of origin research and information CORI Country Report Southern Philippines, February 2011 Commissioned by the United Nations High Commissioner for Refugees, Division of International Protection. Any views expressed in this paper are those of the author and are not necessarily those of UNHCR. Preface Country of Origin Information (COI) is required within Refugee Status Determination (RSD) to provide objective evidence on conditions in refugee producing countries to support decision making. Quality information about human rights, legal provisions, politics, culture, society, religion and healthcare in countries of origin is essential in establishing whether or not a person’s fear of persecution is well founded. CORI Country Reports are designed to aid decision making within RSD. They are not intended to be general reports on human rights conditions. They serve a specific purpose, collating legally relevant information on conditions in countries of origin, pertinent to the assessment of claims for asylum. Categories of COI included within this report are based on the most common issues arising from asylum applications made by nationals from the southern Philippines, specifically Mindanao, Tawi Tawi, Basilan and Sulu. This report covers events up to 28 February 2011. COI is a specific discipline distinct from academic, journalistic or policy writing, with its own conventions and protocols of professional standards as outlined in international guidance such as The Common EU Guidelines on Processing Country of Origin Information, 2008 and UNHCR, Country of Origin Information: Towards Enhanced International Cooperation, 2004. CORI provides information impartially and objectively, the inclusion of source material in this report does not equate to CORI agreeing with its content or reflect CORI’s position on conditions in a country. -

{Name of Organisation}
UNCLASSIFIED Jamiat ul-Ansar (JuA) (Also known as: Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat ul-Ansar, Harakat ul-Mujahideen, Harakat ul-Mujahidin, HuA, HuM) The following information is based on publicly available details about Jamiat ul-Ansar (JuA), formerly known as Harakat ul-Mujahideen (HuM), the name that is still commonly used for the group. To the Australian Government’s knowledge, these details are accurate and reliable and have been corroborated by classified information. Basis for listing a terrorist organisation Division 102 of the Criminal Code provides that for an organisation to be listed as a terrorist organisation, the Attorney-General must be satisfied on reasonable grounds that the organisation: (a) is directly or indirectly engaged in, preparing, planning, assisting in or fostering the doing of a terrorist act (whether or not a terrorist act has occurred or will occur); or (b) advocates the doing of a terrorist act (whether or not a terrorist act has occurred or will occur). Details of the organisation Objectives JuA wants to unite all of Kashmir with Pakistan and establish a caliphate based on Sharia law. JuA has advocated the use of Pakistan’s nuclear weapons against India, and opposes efforts to normalise relations between the two countries. JuA also has pledged support for Afghan militants fighting Coalition forces in Afghanistan. Some elements within JuA have wanted to re-focus their activities and bring them more into line with Usama bin Laden’s global jihad against the US and Israel and their allies. Leadership The leader of JuA is Fazlur Rehman (sometimes Rahman) Khalil (also known as Maulana Farzul Ahmed Khalil and Maulana Ahmed Khalil). -

Counter Terrorism Measures in Southeast Asia: How Effective Are They?
Yuchengco Center – De La Salle University-Manila Counter Terrorism Measures in Southeast Asia: How Effective Are They? Rommel C. Banlaoi Yuchengco Center De La Salle University Manila i Counter Terrorism Measures in Southeast Asia: How Effective Are They? © Copyright 2009 by the Yuchengco Center Printed in the Philippines. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the permission in writing from the Center. ISBN: 978-971-94089-2-5 Please address all inquiries to: Yuchengco Center 2nd Floor, Don Enrique T. Yuchengco Hall De La Salle University 2401 Taft Avenue, Manila 1004 Philippines email: [email protected] fax: (632) 525-3457 url: http://yc.dlsu.edu.ph ii Yuchengco Center – De La Salle University-Manila TABLE OF CONTENTS List of Figures …………………………………………….….………………… iv List of Tables …………………………………………….…..………………… v List of Acronyms …………………………...…………….…..……………… vi Acknowledgement …………………………………………....……………… xi Foreword …………………………………………………….………………… xiii Abstract ………………………………………………………………………… xix Introduction …………………………………….……….……………………… 1 Chapter I: Conceptualizing Terrorism in Southeast Asia: Definition, Evolution and Causes ………………………..……………… 5 Chapter II: Terrorist Groups in Southeast Asia and Modes of Operation ……………….………………….….…....………… 31 Chapter III: Impact of Terrorism on Socio-Economic Development in the Region -

NCTC Annex of the Country Reports on Terrorism 2008
Country Reports on Terrorism 2008 April 2009 ________________________________ United States Department of State Publication Office of the Coordinator for Counterterrorism Released April 2009 Page | 1 Country Reports on Terrorism 2008 is submitted in compliance with Title 22 of the United States Code, Section 2656f (the ―Act‖), which requires the Department of State to provide to Congress a full and complete annual report on terrorism for those countries and groups meeting the criteria of the Act. COUNTRY REPORTS ON TERRORISM 2008 Table of Contents Chapter 1. Strategic Assessment Chapter 2. Country Reports Africa Overview Trans-Sahara Counterterrorism Partnership The African Union Angola Botswana Burkina Faso Burundi Comoros Democratic Republic of the Congo Cote D‘Ivoire Djibouti Eritrea Ethiopia Ghana Kenya Liberia Madagascar Mali Mauritania Mauritius Namibia Nigeria Rwanda Senegal Somalia South Africa Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe Page | 2 East Asia and Pacific Overview Australia Burma Cambodia China o Hong Kong o Macau Indonesia Japan Republic of Korea (South Korea) Democratic People‘s Republic of Korea (North Korea) Laos Malaysia Micronesia, Federated States of Mongolia New Zealand Papua New Guinea, Solomon Islands, or Vanaatu Philippines Singapore Taiwan Thailand Europe Overview Albania Armenia Austria Azerbaijan Belgium Bosnia and Herzegovina Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Georgia Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Kosovo Latvia Page | 3 Lithuania Macedonia Malta Moldova Montenegro -

The Philippines: Local Politics in the Sulu Archipelago and the Peace Process
THE PHILIPPINES: LOCAL POLITICS IN THE SULU ARCHIPELAGO AND THE PEACE PROCESS Asia Report N°225 – 15 May 2012 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................................... i I. INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 II. AIMS OF CONVERGENCE AND STAKEHOLDER REACTIONS ......................... 3 A. POLITICS OF THE CONVERGENCE STRATEGY ................................................................................ 3 B. REACTION OF THE SULU-BASILAN ELITE ..................................................................................... 5 III. POWER SHIFT ON BASILAN ....................................................................................... 7 A. THE RISE AND FALL OF WAHAB AKBAR ...................................................................................... 7 B. THE 2010 ELECTIONS AND ARMM REFORM ............................................................................... 9 C. THE AL-BARKA INCIDENT .......................................................................................................... 10 D. LOOKING AHEAD TO 2013 ......................................................................................................... 11 IV. CONSOLIDATING POWER IN SULU ....................................................................... 12 A. REALIGNMENT AHEAD OF THE 2010 ELECTION ......................................................................... -

Information on Abu Sayyaf Group (ASG), Jamiat Ul-Ansar (Jua)
ABU SAYYAF GROUP (ASG) Also known as: Al-Harakat Al-Islamiyya; Al-Harakat-ul Al-Islamiyya; Al- Harakatul-Islamia; Al-Harakat Al-Aslamiya; Abou Sayaf Armed Band; Abu Sayaff Group; Abou Sayyef Group and Mujahideen Commando Freedom Fighters The following information is based on publicly available details about Abu Sayyaf Group (ASG). ASG is listed in the United Nation’s 1267 Committee’s Consolidated List as an entity associated with al-Qa’ida and as a proscribed organisation by the governments of Canada, New Zealand, the United Kingdom and the United States of America. Current status of the ASG The Abu Sayyaf Group (ASG) was founded in 1991 as a militant Islamic movement by Abdurajak Janjalani (a.k.a. Abdulrajik Janjalani), who deployed to Afghanistan in the late 1980’s as a mujahid, where he was influenced by radical Wahhabi thought. His original intent was to fuse Salafi Wahhabist thought with a southern Philippines separatist agenda. Following the death of Abdurajak Janjalani in a shootout with police in Basilan, December 1998, his brother Khadaffy Janjalani became titular head or ‘emir’ until the latter’s death in 2006. It is currently unclear whether a single leader has emerged to lead the ASG since Khaddaffy Janjalani’s death. In mid-2007 the Philippines military announced that Middle Eastern trained religious scholar, Yasir Igasan, had taken command of the group, although there is information that ASG elder statesman, Commander Radullan Sahiron, may be the group’s nominal leader. The current primary linkage of the ASG to anti-Western terrorism is its provision of assistance to Jemaah Islamiyah (JI) fugitives. -

Kelompok Abu Sayyaf Dan Radikalisme Di Filipina Selatan 119
Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan 119 Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara Adhe Nuansa Wibisono Fisip Universitas Al-Azhar dan Freedom Foundation Jakarta [email protected] Abstract: This writing describes a group of Abu Sayyaf (Arabic: Abű Sayyâf, means ‘swordman,’ or ‘father of sword) from its diverse facets: leader and figures, organizational stucture, motive and political ideology, as well as strategy in conducting terrorism actions. Abu Sayyaf is an alias name for the founder, Abdulrajak Janjalani, who is born in Basilan, Philipine. Using an Arabic forename, and Philipine becoming a location for its apearance and establishment, Abu Sayyaf has relation with the struggle of Moro nation, Philipine. Keywords: Abdulrajak Janjalani, Mujahidin troops, Moro nation Abstrak: Tulisan ini mendeskripsikan kelompok Abu Sayyaf (Arab: Abű Sayyâf, pembawa pedang, atau ayah dari pedang) dari sisi-sisi: pemimpin dan tokoh-tokoh, struktur organisasi, motivasi dan ideologi politik, serta strategi dalam melakukan aksi terorisme. Abu Sayyaf adalah nama alias dari Abdulrajak Janjalani, sang pendiri, yang dilahirkan di Basilan Filipina. Penggunaan nama Arab (Islam), dan Filipina sebagai lokasi kemunculannya, Abu Sayyaf punya keterkaitan dengan perjuangan bangsa Moro. Katakunci: Abdulrajak Janjalani, Pasukan Mujahidin, Bangsa Moro Pendahuluan tiga militan Abu Sayyaf tewas, dan sekitar Perdamaian dan stabilitas politik nampak- 20 orang militer Filipina -

The Philippines Chips Away at the Abu Sayyaf Group's Strength
APRIL 2010 . VOL 3 . ISSUE 4 The Philippines Chips notoriety for brazen raids on Philippine MILF worked closely with the ASG, and Malaysian dive resorts and the employing them in bombing campaigns Away at the Abu Sayyaf taking of Western hostages.2 These to give the MILF a degree of plausible Group’s Strength included the April 2000 raid on the deniability.8 More importantly, ties to Malaysian island of Sipadan, and the the ASG gave the MILF a beachhead in the By Zachary Abuza May 2001 raid on the Philippine resort Tausig-dominated Sulu archipelago and island of Palawan; together, the two began to undermine the Moro National since the launch of Operation attacks netted approximately 50 foreign Liberation Front’s (MNLF) hold in the Ultimatum in August 2006, the Armed hostages.3 Between 2000 and 2001, region. Although the MILF remains Forces of the Philippines (AFP) have the ASG abducted approximately 140 overwhelmingly an ethnic Maguindanao scored significant victories against hostages including school children, and Maranao organization, it always the Abu Sayyaf Group (ASG).1 In the teachers, priests and Western tourists; sought to challenge its rival Tausig- past four months, there has been a 16 of those hostages were killed.4 dominated organization. renewed intensity against the ASG. In mid-March 2010, Philippine President Bolstered by U.S. training and assistance, Re-Degeneration Maria Gloria Macapagal-Arroyo the AFP scored some early successes, The sustained AFP offensive against dispatched 700 additional Philippine including the neutralization of ASG the ASG that began in August 2006 led Marines and Ranger Scouts as well as a leaders Abu Sabaya and Ghalib Andang.5 to the death of the group’s commander, naval task force to the Sulu archipelago By 2004, however, most kidnappings Khadaffy Janjalani (the founder’s to reinforce the existing deployments. -
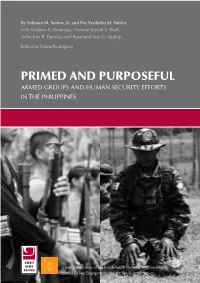
Primed and Purposeful
South-South Network for Non-State Armed Group Engagement By Soliman M. Santos, Jr. and Paz Verdades M. Santos 18 Mariposa St., Cubao, 1109 Quezon City, Philippines with Octavio A. Dinampo, Herman Joseph S. Kraft, PURPOSEFUL PRIMED AND p +632 7252153 Artha Kira R. Paredes, and Raymund Jose G. Quilop e [email protected] Edited by Diana Rodriguez w www.southsouthnetwork.com Small Arms Survey Graduate Institute of International and Development Studies 47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland PRIMED AND PURPOSEFUL p +41 22 908 5777 f +41 22 732 2738 ARMED GROUPS AND HUMAN SECURITY EFFORTS e [email protected] IN THE PHILIPPINES w www.smallarmssurvey.org Soliman M. Santos, Jr. and Paz Verdades M. Santos and Paz Verdades Soliman M. Santos, Jr. Primed and Purposeful: Armed Groups and Human Security Efforts in the Philippines pro- vides the political and historical detail necessary to understand the motivations and probable outcomes of conflicts in the country. The volume explores related human security issues, including the willingness of several Filipino armed groups to negotiate political settlements to the conflicts, and to contemplate the demobilization and reintegration of combatants into civilian life. Light is also shed on the use of small arms—the weapons of choice for armed groups—whose availability is maintained through leakage from government arsenals, porous borders, a thriving domestic craft industry, and a lax regulatory regime. —David Petrasek, Author, Ends and Means: Human Rights Approaches to Armed Groups (International Council on Human Rights Policy, 2000) At the centre of this book are the ‘primed and purposeful’ protagonists of the Philippines’ two major internal armed conflicts: the nationwide Communist insurgency and the Moro insurgency in the Muslim part of Mindanao. -

21St Century Philippines Piracy
21st Century Philippines Piracy 21st Century Philippines Piracy: The Abu Sayyaf Adds a New Dimension to Terror By Bob East 21st Century Philippines Piracy: The Abu Sayyaf Adds a New Dimension to Terror By Bob East This book first published 2018 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2018 by Bob East All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-0938-9 ISBN (13): 978-1-5275-0938-2 TABLE OF CONTENTS List of Illustrations .................................................................................... vii Acknowledgements .................................................................................... ix Preface ........................................................................................................ xi Introduction ................................................................................................. 1 Chapter One ................................................................................................. 5 Pre-2016 Abu Sayyaf Piracy Chapter Two .............................................................................................. 23 March & April 2016 Chapter Three ........................................................................................... -

Understanding the Rise of the Rajah Solaiman Movement and Balik Islam in the Philippines
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Calhoun, Institutional Archive of the Naval Postgraduate School Calhoun: The NPS Institutional Archive Faculty and Researcher Publications Faculty and Researcher Publications Collection 2009 Global development and human (in)security: understanding the rise of the Rajah Solaiman Movement and Balik Islam in the Philippines Borer, Douglas A. Routledge/Taylor & Francis Third World Quarterly, V. 30, no.1, 2009, pp. 181-204 http://hdl.handle.net/10945/47779 Third World Quarterly, Vol. 30, No. 1, 2009, pp 181–204 Global Development and Human (In)securiy: understanding the rise of the Rajah Solaiman Movement and Balik Islam in the Philippines DOUGLAS A BORER, SEAN F EVERTON & MOISES M NAYVE, JR ABSTRACT Over the past 30 years rapid advances in the realm of digital technology and the establishment of an ever expanding globally networked communications infrastructure have radically altered the infrastructure of the global economy. Combined with new rules for international finance, the de- regulation of capital and labour markets and the embracing of a ‘free trade’ ethos by most states in the international system, today’s ‘information age’ bears little resemblance to the economic world experienced by previous generations. Rapid economic changes have been accompanied by the broad dissemination of social, cultural and political information to all corners of the globe, a phenomenon that has contributed to a number of important socio-political developments. Using social movement theory to frame our analytical narrative, we investigate how the demands and pressures of globalisation have helped to foment ‘Balik Islam’, a religious-based social movement concentrated among the ranks of returned overseas Filipino workers in the northern island of Luzon.