1909 —L'année Lumière :Vue Par Le Biais De La Collection
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Early Powered Flight a Talk by Mr
Early Powered Flight A talk by Mr. R. A. Rostron given to the members of the Malta Philatelic Society on 3rd November, 2010 As a schoolboy I enjoyed collecting stamps (and still do). I also liked to build and fly model aeroplanes and as a young man worked for De Havillands.. Consequently, after about 50 years I have been able to connect the two interests in the form of a talk. It has always amazed me how quickly the development of the wood, wire and canvas planes progressed from the first successful flight by the American Wright Brothers at Kitty Hawk in 1903, to the first Airmail Postal Services in 1911 and then passenger aircraft, etc. The subject has been very well researched and documented by specialists. All I have tried to do is to put my material into an interesting 'story' mainly from 1903 to 1911. Pictures of various designs of the first flying machines were shown starting with a Wright Flyer 111 of 1905. Whilst the Americans slowly made improvements 'behind closed doors', in Europe things moved rapidly. By 1909 there were several designs mainly monoplanes and biplanes, some with pusher engines, some with pullers; some had skids some wheels; some designs looked almost the same front and back. Designers, manufacturers and aviators all wanted their machines to fly faster and over greater distances. The world's first Airshow was held in Rheims, France in August 1909. There was much competition and record setting. Meanwhile, another record had been set, namely the first ever flight across the English Channel. -

Milestonesofmannedflight World
' J/ILESTONES of JfANNED i^LIGHT With a short dash down the runway, the machine lifted into the air and was flying. It was only a flight of twelve seconds, and it was an uncertain, waiy. creeping sort offlight at best: but it was a realflight at last and not a glide. ORV1U.E VPRK.HT A DIRECT RESULT OF OnUle Wright's intrepid 12- second A flight on Kill Devil Hill in 1903. mankind, in the space of just nine decades, has developed the means to leave the boundaries of Earth, visit space and return. As a matter of routine, even- )ear millions of business people and tourists travel to the furthest -^ reaches of our planet within a matter of hours - some at twice the speed of sound. The progress has, quite simpl) . been astonishing. Having discovered the means of controlled flight in a powered, heavier-than-air machine, other uses than those of transpon were inevitable and research into the militan- potential of manned flight began almost immediatel>-. The subsequent effect of aviation on warfare has been nothing shon of revolutionary', and in most of the years since 1903 the leading technological innovations have resulted from militan- research programs. In Milestones of Manned Flight, aviation expen Mike .Spick has selected the -iO-plus events, both civil and militan-, which he considers to mark the most significant points of aviation histon-. Each one is illustrated, and where there have been significant related developments from that particular milestone, then these are featured too. From the intrepid and pioneering Wright brothers to the high-technology' gurus developing the F-22 Advanced Tactical Fighter, the histon' of manned flight is. -

A Bove the Pacific
Lieutenant Colonel William J. Horvat A bove the Pacific Printed and Published in the United States by Aero Publishers, Inc., 1966 ABOVE THE PACIFIC By LT. COL. WILLIAM J. HORVAT This is the first complete story of the flights “Above the Pacific” from the first Hawaiian balloon ascent in 1880 and the first Curtiss flights in1910 up to the prevent time (1966). Modern day coverage includes a discussion of the airlines that serve the area, as well as information on the satellite tracking facilities located on the island. This fascinating page of history includes the story of Hawaii’s vital role in the development of World Aviation History. Hawaii can truthfully be called the “Springboard to Aerospace” in the Pacific. As a halfway spot across the ocean, it has been used by sea-faring navigators for thousands of years; and the island’s strategic position in the midst of 5,000 miles of ocean has focused attention on this Garden Spot as an aid to aviation development. This authentic book is truthfully a documentary of flights “Above the Pacific.” Included are stories of the military interest, in addition to the civilian interest, in Hawaiian aviation. The succession of events is given in chronological order, with military as well as commercial activities being covered. An illustrated story of Pearl Harbor and World War II is also included. Editor’s Note: Above the Pacific was published by Aero Publishers, Inc. in 1966. The book is no longer in print. The publisher is no longer in business. The author Lt. Col. William J. -

The Boys' Book of Airships
ll!liBiBli;iPlilillMI!l!ili!lili!l3i!li|liMaii!iiM^^^^ i || ; 1 § iiil |1 Hi ISIJ! ! S;» THE l1«ilMli!i*nnMl)Mrll(MliMIIIM'I!t(HUil!i*1tM»!rM!nitV!liliJi!lii(till«ll5i,ltjBOYS' BOOK r AIRSHIPS Heights Attained by Various Aeroplanes at the Time of Going TO Press as Compared with the Height of St. Paul's Cathedral, London. THE BOYS' BOOK OF AIRSHIPS BY H. DELACOMBE WITH NINETY-THREE ILLUSTRATIONS NEW YORK FREDERICK A. STOKES COMPANY PUBLISHERS NATIONAL AIR AND SPACE 5EUM-LIBRARY Copyright, 1909, By FREDERICK A. STOKES COMPANY December, igog To My Friend Olnlntt^l Jaw^a H. ©jmpbr who devoted over thirty years of his life to Aeronautics for the benefit of his country, and through whose conversation I was first interested in the subject. CONTENTS PART I-BALLOONS PAGE I. Some Early History i II. Names and Uses of the Various Parts of a Balloon 17 III. Something About Gases—Lifting Power—Variations IN Atmospheric Pressure—Effects on a Balloon of (o) Increasing Altitudes, (&) Sun's Radia- tion, (c) Rain 20 IV. The Practice of Ballooning—Laying Out—Inflating —Weighing and Letting Go—Sensations of Ascent — — —How to Descend Landing Packing Up . 25 V. Military Ballooning—First French Balloon Corps— Service in American Civil War—Episodes During Siege of Paris 31 VI. Military Ballooning Continued—The School at Woolwich—Two Important English Inventions— A Perilous Adventure — Campaigns in Egypt, Africa, and China—American and French De- velopment 36 VII. Ballooning as a Sport—Formation of Aero Clubs- — Gordon Bennett Races Other Competitions . -

1910 Los Angeles International Aviation Meet Research Collection SPC.1996.001
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt4m3nc8jw Online items available Inventory of the 1910 Los Angeles International Aviation Meet Research Collection SPC.1996.001 Jennifer Allan Goldman, 1996; updated in 2019 by Reyes Contreras California State University Dominguez Hills, Gerth Archives and Special Collections updated 2019 University Library South -5039 (Fifth Floor) 1000 E. Victoria St. Carson, CA 90747 [email protected] URL: https://www.csudh.edu/libarchives/ SPC.1996.001 1 Contributing Institution: California State University Dominguez Hills, Gerth Archives and Special Collections Title: 1910 Los Angeles International Aviation Meet Research Collection source: Grenier, Judson Identifier/Call Number: SPC.1996.001 Physical Description: 10 boxes Physical Description: 4 Linear Feet Date (inclusive): 1909-1999; undated Abstract: This collection includes newsclippings, photos, books, journal articles, ephemera, correspondence, and minutes related to the aviation meet held on Dominguez Hill in 1910. Subjects include: early aviation history and early aviators; the Aviation Meet of Los Angeles (1910-1911); anniversaries; a commemorative airshow; and the Aviation Meet Committee. Material from the collection is available online by visiting the 1910 Los Angeles International Aviation Meet Research Digital Collection . oversize material related to this collection is located in map case 2, drawer 11. Language of Material: Collection material is in English. Conditions Governing Access There are no access restrictions on this collection. Conditions Governing Use All requests for permission to publish or quote from manuscripts must be submitted in writing to the Director of Archives and Special Collections. Permission for publication is given on behalf of Special Collections as the owner of the physical materials and not intended to include or imply permission of the copyright holder, which must also be obtained. -

Wilbur & Orville Wright
WILBUR & ORVILLE WRIGHT A Rei ssue of A Chronol ogy Commemorati ng the Hundredth Anni versary of the A Reissue of A Chronology Commemorating the 100th Anniversary of the BIRTH OF ORVILLE WRIGHT • AUGUST 19, 1871 By Arthur George Renstrom WILBUR & ORVILLE WRIGHT Birth of Orville Wright • August 19, 1871 A Joint Publication of the U.S. Centennial of Flight Commission and the National Aeronautics and Space Administration Monographs in Aerospace History Number 32 NASA Publication SP-2003-4532 National Aeronautics and Space Administration Office of External Relations NASA History Office NASA Headquarters Washington, DC 20546 NASA SP-2003-4532 WILBUR & ORVILLE WRIGHT A Reissue of A Chronology Commemorating the Hundredth Anniversary of the BIRTH OF ORVILLE WRIGHT • AUGUST 19, 1871 By Arthur George Renstrom A Joint Publication of the U.S. Centennial of Flight Commission and the National Aeronautics and Space Administration Monographs in Aerospace History, Number 32 September 2003 NASA Publication SP-2003-4532 National Aeronautics and Space Administration Office of External Relations NASA History Office NASA Headquarters Washington, DC 20546 On the cover: The classic photograph of the first powered flight at Kitty Hawk, North Carolina, on December 17, 1903. Orville Wright is on the airplane; older brother Wilbur looks on from the sidelines. Library of Congress Cataloging in Publication Data R enstrom, Arthur George, 1905–1991 Wilbur & Orville Wright: a chronology: commemorating the hundredth anniversary of the birth of Orville Wright, August 19, 1871/ compiled by Arthur G. Renstrom. p. cm.—(monographs in aerospace history; no.) (NASA history series) (NASA SP; 2003-4532) Includes bibliographical references and index. -

Alberto Santos-Dumont and His Demoiselle Airplanes
1 Superbly Small: Alberto Santos-Dumont and his Demoiselle Airplanes The classic Demoiselle, the fourth version of the Santos-Dumont 20, in flight September 1909. Stuart Wier May 5, 2019 Boulder, Colorado Original text Copyright © 2017-2019 Stuart K. Wier. Reproduction, reuse, or retransmission prohibited without prior written permission of the author. 2 Original text Copyright © 2017-2019 Stuart K. Wier. Reproduction, reuse, or retransmission prohibited without prior written permission of the author. 3 The Demoiselle – the Dragonfly or Damselfly – is the name of five or more versions of one early airplane in 1907-1909, and later built for sale by a manufactuer. In its final form it was the first small light airplane with reasonably good performance for its time. In the earliest days of aviation it and its creator were famous. The Demoiselle is so appealing, partly due to its appearance in a movie from 1965, that more than a dozen modern flying “replicas” (of varying authenticity) have been made, and dozens of modern aircraft of similar configuration have been built and flown for recreation, incorporating improvements based on a century of aircraft construction and flying. The original Demoiselle, Santos-Dumont's 19, of 1907, in Neuilly. The Demoiselles were creations of Alberto Santos-Dumont, a wealthy young Brazilian residing in Paris, beginning in 1907. He was an accomplished and leading inventor, designer, and pilot of balloons and small pressurized non-rigid airships who operated his own workshop and hanger in Paris. In October 1906 Santos-Dumont achieved the first powered flight of a heaver-than-air airplane in Europe, in a flying machine he called 14bis, and was celebrated then in France as the first man to fly. -

Wilbur & Orville Wright
Wilbur & OrvilleWright Pictorial Materials Preface This guide is the fifth commemorative tribute to the Wright brothers prepared by the Library of Congress since 1949, when the Wright papers were given to the Library by the Orville Wright estate, and is one of two publications originating in con nection with the seventy-fifth anniversary of powered flight. Its companion, entitled Photographs by the Wright Brothers: Prints from the Glass Negatives in the Library of Congress (Washing ton: Library of Congress, 1978), includes all hut two of 303 pho tographic glass-plate negatives taken by the Wright brothers in highly reduced form as positive images on five microfiche. The publication was prepared for the press by Leonard C. Bruno. Twenty-five years earlier, to celebrate the fiftieth anni versary of powered flight, a two-volume edition of The Papers of Wilbur and Orville Wright, Including the Chanute- Wright Let ters and Other Papers of Octave Chanute (New York: McGraw McGraw-Hill Book Company, 1953) was published under the sponsorship of Oberlin College. In that major initial tribute, the Wrights’ letters, diaries, notebooks, and other records of their scientific and technical work in inventing and perfecting the air plane were edited by Marvin W. McFarland of what was then the Library’s Aeronautics Division. As a contributor to that work, the present writer com piled several auxiliary files to supplement and help in organizing the wealth of material in the Wright papers. Two of these, later expanded, updated, and published to mark other anniversaries, were Wilbur & Orville Wright: A Bibliography Commemorating the Hundredth Anniversary of the Birth of Wilbur Wright, April 16, 1867 (Washington: Library of Congress, 1968) and Wilbur & Orville Wright: A Chronology Commemorating the Hundredth Anniversary of the Birth of Orville Wright, August 19, 1871 (Washington: Library of Congress, 1975). -
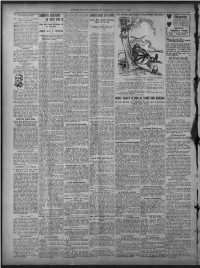
Suicide— Izes the Issue of $290,569,000 in Pan- Dreds of Injured Persons Crowded the Your Case Thoroughly Absolutely Free
MUNYON’S EMINENT DOCTORS AT 1909. Sole leather, 5 per cent.; “MY BUT THESE MOSQUITOES ARE BAD!” YOUR SERVICE FREE. grain, buff and spilt leather, 7 % per WORD, COMMITTEE AGREEMENT cent.; boots and shoes, 10 per cent;.; JAPAN’S GREAT CITY BURNS harness and saddlery, 20 per cent. f Hearts Hot a Penny to Pay For the Fullest Photographic film negatives im- are hard to win when one’s for use in moving picture ex- Osaka, With 20,000 Buildings, Medical Examination. ON TARIFF SENT IN ported complexion is marred hibitions and moving picture films, by If you are in doubt as to the cause Destroyed by Fire. ^ pimples, blackheads and 25 per cent. The conference restored H blotches. of your disease mail us a postal re- the House which authorizes Strengthen your Hides and Crude Petroleum Go provision W charms, by fluesting a medical examination blank, free reciprocal trade in farming tools. keeping your The Buddhist in the V complexion clear, with which you will fill out and return to on Free List Oleo stearin, which was put upon Largest Temple World and the Stock us. Our doctors will carefully diag- the free list by the Senate, was adopt- Exchange ed .the conference. Radium' re- Arc in Rains. Glenn’s nose your case, and if you can be by mains on the free list. cured you will be told so; if you can- LUMBER $1.25 A THOUSAND The conferees adopted the corpora- Sulphur Soap not be cured you will be told so. You tion tax amendment, as it was pre- Osaka, Japan.—As a result of the W.'e not to us in any way, for by H0T< Hair and Wbiakar Dye, obligated pared and submitted to them by At- fire which swept a great part of thi3 druggists. -

Harriet Quimby
32 such as Dover Regatta. We are to make a difference in Dover. We all constantly looking for further know the difficulties the global volunteers to help with the bookstall economy has left us facing, but at local as well as the rubbish clearances that level we simply cannot afford to sit we do from time to time, so why not back and bemoan our lot whilst doing join in. LRCF can be contacted through nothing about it. With your help, LRCF the 'Contact Us' tab on our website will continue to make a difference for www.londonroad.info or just by years to come. We enjoy support from walking into The White Horse in St Councillors, Dover District Council James's Street where, over a pint, the Officers, the White Cliffs Countryside landlady will wax lyrical about a Partnership and even Kent Police. Can community group that really is trying we add you to our list of supporters? * * * * * One of a series of articles covering the lives of Dovorians of international renown. Harriet Quimby - the first woman to fly the Channel by Lorraine Sencicle B.A. (econ) hons few days before Louis Bleriot miles before his engine failed. On the Aentered the history books as the morning of Bleriot's epic flight, 25 first person to cross the English July 1909, as it was windy, Latham's Channel in a heavier-than-air flying advisors let him sleep. Nonetheless, machine, Hubert Latham (1883-1914) there is a statue to Latham near Cap had taken off from France. He flew 8 Blanc Nez, outside Calais. -

La Grande Semaine D'aviation De La Champagne 1909
La Grande Semaine d’Aviation de la Champagne, Reims du 22 au 29 août 1909 Affiche officielle de la Grande semaine d’aviation de Champagne 1909. (Musée de l’affiche). 1 La Grande Semaine d’Aviation de la Champagne, Reims du 22 au 29 août 1909 La Grande Semaine d’Aviation de la Champagne, Reims du 22 au 29 août 1909 par Gérard Hartmann L’annonce Directeur depuis 1907 de la maison des vins bles) et aux aéroplanes, des machines récem- de Champagne Pommery, le marquis Melchior ment apparues et qui fascinent le public. de Polignac (1880-1950), patron de l’Association Dès janvier 1909, de très nombreux concur- Viticole Champenoise (AVC, une organisation rents sont inscrits, des aviateurs, aérostiers et connue pour avoir lutté avec succès contre le aéronautes de tous les horizons. Ce nombre éle- phylloxéra) lance en 1908 aux membres des vé va contraindre les organisateurs à voir grand. producteurs de vin l’idée d’organiser à Reims un Etant donné leur importance au sol, l’installation grand meeting aérien. Le docteur Lenglet, maire des stands et de la piste à Bétheny (longue de de Reims, lui apporte son plein soutien. Les dix kilomètres) commence dès mars. Le meeting membres de l’Aéro-Club de France se rallient à occupe dans les journaux de toute l’Europe vingt son idée en janvier 1909. Le meeting est prévu semaines d’actualité. C’est déjà une belle réus- pendant l’été 1909. site. Ce premier meeting international d’aviation Les Champenois ont prévu quatre épreuves, de l’histoire n’aurait pu être qu’une foire au vin durée, vitesse, hauteur et passagers, mais (de Champagne, quand même). -
MS-1: Wright Brothers Collection, Special Collections & Archives, Wright State University Libraries 1
MS-1 The Wright Brothers Collection Special Collections & Archives, University Libraries Wright State University, Dayton, Ohio First flight, December 17, 1903 (photo # ms1_16_2_8) Last revised: October 25, 2019 MS-1: Wright Brothers Collection, Special Collections & Archives, Wright State University Libraries 1 Contents Collection Information ...................................................................................................................11 Collection Number: ............................................................................................................11 Collection Title: .................................................................................................................11 Collection Dates: ................................................................................................................11 Creators: .............................................................................................................................11 Summary/Abstract: ............................................................................................................11 Quantity/Physical Description: ..........................................................................................11 Language(s): ......................................................................................................................11 Repository: .........................................................................................................................11 Restrictions on Access: ......................................................................................................11