P Atornay (39)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Courrier Préfet Du Jura ESOD
Lons-le-Saunier, le 20 décembre 2018 Monsieur le Préfet du Jura Préfecture du Jura 8, rue Saint Désiré 39000 LONS LE SAUNIER Monsieur le Préfet, Vous allez prendre très prochainement un arrêté concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les échanges que nous avons pu avoir en CDCFS dans sa commission spécialisée ne nous paraissent pas satisfaisants quant aux arguments qui ont été retenus Aussi, nous souhaitions vous faire part des quelques éléments qui nous semblent importants, aux vues du contexte actuel et des dernières études pour au moins deux de ces espèces. Concernant le renard, Notre souhait est aujourd’hui de faire sortir cet animal de cette liste car il est désormais démontré que cette espèce est capable d’adapter sa stratégie de reproduction en fonction des aléas qu’elle subit, ce qui signifie que la tuer ne règle pas le problème, voire même engendre une augmentation des jeunes individus en recherche de territoire au détriment des plus vieux. Puisque néanmoins, il est encore difficile d’accepter cela pour certains, car le tir du renard reste hélas un loisir, nous aimerions au moins avoir la possibilité qu’il soit désormais classé comme la fouine l’est depuis plusieurs années. C’est-à-dire uniquement à proximité des élevages et habitations, et, puisque la question a également été soulevée lors de la CDCFS, à proximité et dans les aires protégées pour le Grand Tétras. Pour information, le département du Doubs, semble vouloir partir sur une gestion adaptative. Cette décision devra figurer dans l'arrêté ministériel. Les modalités précises de cette gestion restent à définir, mais elles seront mises en place sous la responsabilité des services de la préfecture et seront confiées aux membres de la formation spécialisée “ESOD” auxquels viendront s'ajouter des représentants de la santé publique et de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Franche-Comté. -

De Belvédères En Belvédères
CIRCUIT N°10 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA De belvédères en belvédères Départ : ORGELET Arrivée : ORGELET Circuit : une journée - Distance : 117 Km Praticable : Toute l’année - Tous les jours MANDÉ P M OU O R C … E R Lac de Chalain depuis le belvédère de Fontenu les amateurs de Vous aimerez… beaux paysages La vue depuis un belvédère est toujours impressionnante. A travers ce circuit, vous dominerez les plus beaux paysages de la région et observerez les abords des lacs aux couleurs changeantes. Zoom sur… Lac d’Ilay ou de la Motte La petite île sur le lac d’Ilay lui doit son nom de lac de la Motte. Cette île abritait l’un des plus anciens monastères de Franche-Comté, le prieuré Saint-Vincent. Il fut détruit pendant les guerres du 17e siècle. Il était relié à la terre par une chaussée, actuellement immergée, mais dont on peut suivre la trace aux joncs qui la recouvrent. L’été, cette île est le domaine d’archéologues qui fouillent cette zone. Focus : Chalain, cité lacustre En juin 1904, suite à une captation d’eau pour une usine électrique et une grande sécheresse, le niveau du lac est abaissé de 7 mètres. Apparurent alors des vestiges de cité lacustre vieille de 5 millénaires. Parmi les objets découverts, exposés au musée d’archéologie de Lons-Le-Saunier, on remarque une pirogue longue de 9 mètres creusée dans un tronc de chêne. Une exposition à Clairvaux Les Lacs durant l’été retrace cette période à Chalain et Clairvaux-Les-Lacs. Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : Offi ce de Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne 36, Grande Rue – 39130 Clairvaux-les-Lacs Tél : 03 84 25 27 47 [email protected] www.juralacs.com Document édité par l’Offi ce de Tourisme avec le soutien fi nancier du Conseil général du Jura et l’appui technique du Comité Départemental du Tourisme. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Liste Des Communes Par Bureau De L'enregistrement
Archives départementales du Jura Liste des communes comprises dans le ressort de chaque bureau de l’Enregistrement dans le département du Jura de 1790 à 1955 Arbois Abergement-le-Grand, Arbois, Les Arsures, Certemery, Chamblay, Champagne-sur-Loue, La Chatelaine, Cramans, Ecleux, La Ferté, Grange-de-Vaivre, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Montmalin, Mouchard, Ounans, Pagnoz, Les Planches-près-Abois, Port-Lesney, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans, Villeneuve-d’Aval, Villers-Farlay, Villette-lès-Arbois. Arinthod (rattaché au bureau de Lons-le-Saunier en 1934) Arinthod, Aromas, La Boissière, Céffia, Cernon, Cézia, Charnod, Chatonnay, Chemilla, Chisséria, Coisia, Condes, Cornod, Dramelay, Fetigny, Genod, Legna, Marigna-sur-Valouse, Saint-Hymetière, Savigna, Thoirette, Valfin-sur-Valouse, Vescles, Viremont, Vosbles. Beaufort 1819 – 1942 (avant 1819 voir Cousance ; rattaché àau bureau de Lons-le-Saunier en 1942) Arthenas, Augea, Augisey, Beaufort, Bonnaud, Cesancey, Cousance, Gizia, Grusse, Mallerey, Maynal, Orbagna, Rosay, Rotalier, Saint-Laurent-La-Roche, Sainte-Agnès, Vercia, Vincelles. Bletterans Arlay, Bletterans, Bois-de-Gand (avant 1945 voir Sellières), Brery (avant 1945 voir Sellières), Chapelle-Voland, La Charme (avant 1945 voir Sellières), La Chassagne (avant 1945 voir Sellières), Chaumergy (avant 1945 voir Sellières), Chêne-Sec (avant 1945 voir Sellières), Commenailles (avant 1945 voir Sellières), Cosges, Darbonnay (avant 1945 voir Sellières), Desnes, Les Deux-Fays (avant 1945 voir Sellières), Fontainebrux, Foulenay -

Bienvenue Au Camping Le Moulin
Au cœur de la région des lacs, à proximité du lac de Vouglans, le Camping des Pêcheurs vous accueille dans un parc boisé de 3.5 ha en bor- dure de rivière. Venez découvrir la douceur du Bienvenue camping dans un environnement familial et re- posant. Dans l’eau, sur terre, dans les airs, choi- sissez votre élément. De nombreuses activités ex- térieures s’offrent à vous. A pied, à cheval ou à vélo, découvrez nos lacs, cascades et rivières. Voi- là l’endroit rêvé pour passer d’agréable vacances. Camping Les Pêcheurs, set along the Ain river, welcomes you in a green, natural and shady setting. The campsite counts 163 grassy camping pitches spread over 3.5 ha. Free wifi at the reception. Fishing permits are for sale at the reception. You can rent a mooring ring or a boat in the village (Port de la Saisse at 500m). Aan de oevers van rivier de Ain heet Camping Les Pêcheurs u welkom in een groene en schaduwri- jke omgeving. De camping biedt 163 grasrijke kampeerplaatsen op een terrein van 3.5 ha. Gratis wifi bij de receptie. Bij de receptie kunt u visvergunningen kopen. In het dorp kunt u een aanlegring of boot huren (Port de la Saisse op 500m). au camping Les infos pratiques Camping de 163 emplacements. La baignade Ouvert du 18/06 au 04/09 Le camping dispose d’une plage her- beuse en bordure de la rivière d’Ain. les Pêcheurs La réception Vous pourrez aussi vous détendre Nos réceptionnistes parlent français dans les nombreux lacs que compte et anglais. -

ADLFI. Archéologie De La France - Informations Une Revue Gallia Bourgogne-Franche-Comté | 1999
ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Bourgogne-Franche-Comté | 1999 Patornay – Zone artisanale de La Léchère Fouille d’évaluation d’urgence (1999) Patrice Pernot Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/adlfi/25979 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la Culture Référence électronique Patrice Pernot, « Patornay – Zone artisanale de La Léchère » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Bourgogne-Franche-Comté, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 15 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/25979 Ce document a été généré automatiquement le 15 décembre 2020. © ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Patornay – Zone artisanale de La Léchère 1 Patornay – Zone artisanale de La Léchère Fouille d’évaluation d’urgence (1999) Patrice Pernot NOTE DE L’ÉDITEUR Organisme porteur de l’opération : Afan 1 Le projet d’implantation d’une zone artisanale, localisée à environ 1 km à l’est de la commune, le long de la RN78 menant à Clairvaux-les-Lacs, a motivé la réalisation d’un diagnostic archéologique. Première étape d’une opération plus complète, il n’a concerné que l’emprise de la voirie de la future zone artisanale, soit 82 ares pour une superficie totale de 8,50 ha. Au total, 33 sondages différents ont été réalisés sur une superficie de 1 150 m2, soit presque 14 % de la surface de la voirie. 2 Cette opération avait une réelle justification archéologique. En effet, outre la recherche dans l’absolu de toute trace d’occupations anciennes, elle devait permettre de vérifier la pertinence d’écrits du XIXe s. -

20140307 Bilan Depot Candida
Lons-le-Saunier, le 07 mars 2014 Bilan du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales 2014 PRÉFET DU JURA Le dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales est clos depuis le jeudi 6 mars à 18h. C À cette date, le nombre de candidatures enregistrées est le suivant : O • 6 596 candidats pour les communes de moins de 1 000 habitants, répartis sur 499 communes M • 1 685 candidats pour les communes de 1 000 habitants et plus, correspondant M à 79 listes réparties sur les 42 communes concernées. U Les candidatures enregistrées seront définitivement validées quatre jours après le dernier jour de dépôt possible, à savoir le 10 mars au plus tôt, et seront mises en N ligne le 11 mars dans la rubrique « élections » du site du Ministère de l’Intérieur. I Vous trouverez en annexe de ce communiqué les listes (pour les communes de 1000 habitants et plus) et candidatures déposées (pour les communes de moins Q de 1000 habitants). U Attention : ces listes et candidatures sont provisoires. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’examen des dossiers par la préfecture et par le É tribunal administratif. D E P R E S S PRÉFECTURE DU JURA - 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - E : 03 84 86 84 00 - :[email protected] Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « horaires » ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Page 1 Elections municipales 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 39 - JURA Candidat au conseil communautaire 39 JURA 013 - Arbois 01 POUR ARBOIS, UNE AUTRE VOIE (VOIX) 1 M. -

M Onnet-La-Ville (39)
M ONNET-LA-VILLE (39) Extrait du Dictionnaire GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE et STATISTIQUE Des communes de la Franche-Comté De A. ROUSSET Tome IV (1854) MONNET LA VILLE ( Molneth, Muneth, Mugnet, Mulnet, Munnet, Mulnez ) Village de l’arrondissement de Poligny, canton et bureau de poste de Champagnole, perception de Crotenay; succursale dont dépendent Montigny sur l’Ain et Pont du Navoy. A 10 km de Champagnole, 16 de Poligny, 25 d’Arbois et 27 de Lons le Saunier. Altitude : 506 m. Le territoire est limité au nord par Pont du Navoy, Champagnole et Ney ; au sud par Montigny et Mont sur Monnet ; à l’est par Ney et Mont sur Monnet ; à l’ouest par Pont du Navoy et Montigny. Le Vieux Bourg, Les Maisons du Bois, Barré, La Forge ou le Martine - Paillard, font partie de la commune. Il est traversé par la route départementale n° 2, de Chalon en Suisse ; par les chemins de grande communication n° 27, de Salins à Dortans et40 du Pont du Navoy au Pont de La Chaux des Crotenay ; par les chemins vicinaux tirant à Montigny, au Pont du Navoy à la route départementale n° 2, à la Buchille et de la Maison du Bois au Moulin des Anes ; par la rivière d’Ain, celle de Balerne, le ruisseau du Moulin du Tilleul et celui des Fosses. Le village est situé sur la rive gauche de l’Ain, dans une position agréable. Les maisons sont, les unes groupées, les autres isolées, construites en pierres et couvertes en tuiles ou tavaillons. Elles sont généralement mal bâties et composées d’un simple rez de chaussée. -

Ddrm 2017 Vf
XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 23 Y 20 Y 40 Y 80 0 XZ Y 22 M C B X Y XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 21 M 20 M 40 M 80 X M Y C XZ Y 20 M C B M C XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 19 C 20 C 40 C 80 0 XZ Y 18 M C B XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 17 Z M Y C XZ Y 16 M C BB ZZ X Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 15 0 B 20 B 40 B 80 XZ Y 14 M C B Y M C Y M C Y M C Y M C XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 13 12 1 Prinect Micro−6i Format 74 Dipco 16.0d (pdf) © 2013 Heidelberger Druckmaschinen AG PRÉFACE DU PREFET XZ Y M C B −−−−−−−−−−−−−−− 11 Y 20 Y 40 Y 80 0 Le Préfet du Jura XZ Dans un contexte où des événements climatiques majeurs ont frappé la France Y 10 et le monde ces dernières années, les pouvoirs publics – Etat comme collectivités M C locales – portent la responsabilité de protéger les populations, notamment la mise en B Y M œuvre de mesures d'information et de prévention. C Y M C Y M C Y M C Le département du JURA est exposé à des risques naturels et technologiques XZ majeurs susceptibles de mettre en danger des vies humaines et d'engendrer des Y dommages matériels, économiques et environnementaux importants. M C B L'information préventive sur ces risques est un droit légitime inscrit dans le Code −−−−−−−−−−−−−−− 9 de l'Environnement. -
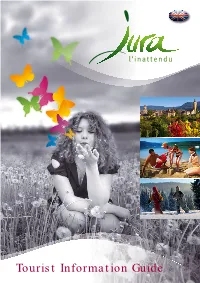
Tourist Information Guide Che-Com an Té Fr
Tourist Information Guide che-Com an té Fr Jura… Getting to the Jura area The name itself implies character, mystery – and indeed, visitors discover not one but several Juras, each one more breathtaking than the last. From the poetic ponds of Bresse to the snowy peaks of the Dôle, Jura’s wonder unfurl like Russian dolls: the magic of the Chaux forest, Vignoble’s good living, the gentle pace of the lake district and the “Low Mountains”, the sumptuous Haut-Jura… Every step of the way, you will rave about another landscape, another spread of colour, another playground… And just when you think you have seen it all, the best is yet to be discovered: and it is all so unexpected! www.jura-tourism.com Table of Contents Getting here P.2 Taste Jura p.78 Jura Maps P.3 Our most surprising nature sites p.80 13 highlights of the Jura P.4 Towns and villages to be visited p.82 4 micros région of the Jura P.17 Spas p.83 Pays Dolois et Bresse Jurassienne P.18 Treks p.84 Pays Vignoble et Revermont P.28 Outdoor activities p.89 Pays Lacs et Petite Montagne P.40 Oenotourism p.94 Pays Haut-Jura P.50 Winter activities p.96 Discovering Jura by Themes p.70 Families p.102 A page of history p.70 Tourism and Disability p.106 Museums p.72 Index p.107 Craftsmanship and know-how p.76 Useful addresses p.110 Tel. +33(0)3 25 71 20 20 Reproduction forbiddenMaps by ACTUAL www.actual.tm.fr 129-39/JMP/12-04 10 km Le Pays Dolois et Bresse Jurassienne Le Pays Vignoble et Revermont Le Pays Lacs et Petite Montagne Le Pays Haut-Jura 3 MUST-SEE PLACES Dole The town of liberty of the Franche-Comté inhabitants Take a town with a strong personality - and if possible enjoying the status of a ‘Ville d’Art et d’Histoire’. -

De Franche- Comté Et Du Massif Du Jura
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 4, 2006 – Société Botanique de Franche-Comté Inventaire des Gentianacées (y compris les Ményanthacées) de Franche- Comté et du massif du Jura Coordination SBFC : Yorick Ferrez ngagé en 2002, ce programme commune (ou le nom du départe- Delafollye L. d’inventaire a fait l’objet d’un ment suivi du nom de la commune) / Delonglee S. Ebilan provisoire dans le premier date d’observation (au moins l’année) Didier B. numéro des Nouvelles archives de la / le(s) noms de(s) observateur(s). Druart P. flore jurassienne, puis d’un second Dumont J. article dans le numéro deux de la Vous pouvez faire parvenir vos contri- Esseiva N. même revue. En mars 2003, la base butions sur papier ou sous forme Ferrez Y. de données TAXA ©SBFC /CBFC comp- numérique (texte tabulé) à : Foucault B. de tait 1 565 informations concernant Gillet F. les 19 espèces inventoriées. En mars Max André : 30 rue Louis Pergaud Giroud M. 2004, nous disposions de 2 111 don- 25300 Pontarlier. Tel. : 03 81 39 35 05 Guillaume Y. nées, soit une progression de pres- – courriel : [email protected] Guinchard M. que 35%. Au premier janvier 2007, Guinchard P. la base de données comprend 4 267 Yorick Ferrez : 32b rue Gabriel Guyonneau J. données (soit une progression de Plançon 25000 Besançon. Tel. : Hans E. plus de 100%), dont 1 715 données 03 81 81 86 13 – courriel : yorick. Hennequin C. nouvelles, acquises entre 2004 et fin [email protected] Henriot P. 2006 grâce aux efforts particulière- † Hillier L. -

Inventaire Pour La Cartographie Des Risques Du Département Du Jura
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie MINISTÈRE DE< L'ENVIRONNEMENT RIRE FRANCHE COMTE Inventaire pour la cartographie des risques du département du Jura Phénomènes naturels et principaux enjeux Etude réalisée dans le cadre des actions de Service Public du BRGM 98-H-112 octobre 1998 R 40032 2 2. MAR. 1999 BRGM Inventaire pour la cartographie des nsques du département du Jura (39) Mots clés : Cartographie, Risque naturel. Phénomène naturel. Enjeu, Prévention, Procédure réglementaire. Système d'information géographique. Bassin de risque, Jura, Franche-Comté. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : BRGM (1998) - Inventaire pour la cartographie des risques du département du Jura - Phénomènes naturels et principaux enjeux - Rap. BRGM R 40032, 71 p., dont 22 cartes. © BRGM, 1998, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. Rapport BRGM R 40032 Inventaire pour la cartographie des risques du département du Jura (39) Synthèse L'inventaire pour la cartographie des risques du département du Jura vise à bâtir un outil de synthèse des connaissances cartographiques relatives aux événements naturels historiques, aux principaux enjeux du département et aux moyens de surveillance. Il fait le bilan des connaissances actuelles et des informations disponibles auprès de divers organismes (ministères, services déconcentrés, établissements publics, etc.). Cet inventaire a été mis en place fin 1996 à la demande du Ministère de l'Environnement et a été piloté par le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la Préfecture du Jura. Les informations collectées sont des données cartographiques et renseignées.