1. Rapport De Présentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
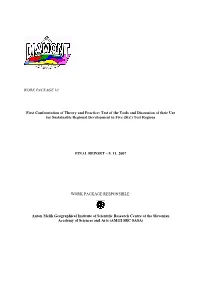
Part Report for Each Region Was Prepared
WORK PACKAGE 10 First Confrontation of Theory and Practice: Test of the Tools and Discussion of their Use for Sustainable Regional Development in Five (Six!) Test Regions FINAL REPORT – 9. 11. 2007 WORK PACKAGE RESPONSIBLE: Anton Melik Geographical Institute of Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (AMGI SRC SASA) CONTENT I. Introduction II. Methodology III. Searching for sustainable regional development in the Alps: Bottom-up approach IV. Workshops in selected test regions 1. Austria - Waidhofen/Ybbs 1.1. Context analysis of the test region 1.2. Preparation of the workshop 1.2.1. The organizational aspects of the workshop 1.3. List of selected instruments 1.4. List of stakeholders 1.5. The structure of the workshop 1.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 1.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 1.7. Revised answers 1.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 1.9. Starting points for the second workshop 1.10. Conclusion 2. France – Gap 2.1. Context analysis of the test region 2.2. Preparation of the workshop 2.2.1. The organizational aspects of the workshop 2.3. List of selected instruments 2.4. List of stakeholders 2.5. The structure of the workshop 2.5.1. Information on the selection of respected thematic fields/focuses 2.6. Questions for each part of the workshop/ for each instrument 2.7. Revised answers 2.8. Confrontation of the context analysis results with the workshop results 2.9. Starting points for the second workshop 2.10. -

Hautes-Alpes En Car Lignes Du Réseau
Lignes du LER PACA N 21 NICE - DIGNE - GAP OE 29 MARSEILLE - BRIANÇON Ligne 35 du LER PACA 30 GAP-BARCELONNETTE Briançon - Grenoble 31 MARSEILLE-NICE-SISTERON-GRENOBLE LA GRAVE 35 VILLARD D’ARÉNE 33 DIGNE - VEYNES - GAP - BRIANÇON OULX S 35 BRIANÇON - GRENOBLE COL DU LA LE LAUZET NÉVACHE ITALIE 4101 GAP - GRENOBLE VIA TRANSISÈRE UTARET PLAMPINET Numéros Utiles Le Monêtier-les-Bains G1 S33 ISÈRE SERRE CHEV S33 CESANA Région LE ROSIER G (38) S32 CLAVIÈRE ◗ LER PACA : 0821 202 203 ALLIER Montgenèvre H LA VACHETTE ◗ TER : 0800 11 40 23 V LE PRÉ DE ALLÉE S31 Département MME CARLE ◗ PUY-ST PIERRE BRIANÇON 05 Voyageurs PUY-ST ANDRÉ ( Hautes-Alpes) : 04 92 502 505 AILEFROIDE Pelvoux ◗ Transisère : 0820 08 38 38 CERVIÈRES ST ANTOINE PRELLES Ligne 4101 du LER PACA F ENTRAIGUES Vallouise Intra Hautes-Alpes Gap - Grenoble S30 QUEYRIÈRES ◗ Réseau Urbain de Gap, 1800 1600 F2 ABRIÈS Puy st vincent LES VIGNEAUX S28 Linéa : 04 92 53 18 19 Brunissard ◗ FREISSINIÈRES L’ARGENTIÈRE AIGUILLES Transport Urbain de Briançon ASPRES La Chapelle CHÂTEAU (TUB) : 04 92 20 47 10 Corps LES CORPS LA-BESSÉE QUEYRAS Ristolas en Valgaudemar S26 VILLE-VIEILLE Arvieux LE COIN 4101 ST FIRMIN F1 ESTÉYÈRE MOLINES CHAUFFAYER 29 FONTGILLARDE S27 PIERRE LES COSTES 33 GROSSE S25 La Joue C2 St-Véran LA MOTTE EN CHAMPSAUR Orcières du Loup MAISON DU ROY C1 Station MONT-DAUPHIN S24 Ligne 31 du LER PACA ST-ETIENNE Ceillac CHAILLOL S12 GUILLESTRE EN DÉVOLUY St Bonnet ORCIÈRES SNCF Marseille-Nice-Sisteron-Grenoble D1 D2 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS RISOUL A LA SAULCE - GAP AGNIÈRES S22 S23 -

Plan De Gestion De La Ressource En Eau Du Bassin Versant Du Drac
Plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant du Drac version approuvée en Commission Locale de l’Eau du SAGE Drac Amont du 13 juin 2018 plan de gestion de la ressource en eau du bassin versant du Drac - version approuvée en Commission Locale de l’Eau du SAGE Drac Amont du 13 juin 2018 1 Table des matières CHAPITRE 1: PREAMBULE............................................................................................................................5 1.1. Contexte...............................................................................................................................................5 1.2. Orientations du SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE Haut-Drac...................................................5 1.3. Étude d’évaluation des volumes prélevables........................................................................................7 1.4. Objectifs du plan de gestion de la ressource en eau............................................................................7 1.5. Gouvernance : les instances de pilotage, de concertation et de suivi technique du PGRE...................8 CHAPITRE 2: ACTEURS DE LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU....................................10 2.1. La CLEDA.............................................................................................................................................10 2.2. La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes.......................................................................................10 2.3. Les services de l’Etat...........................................................................................................................11 -
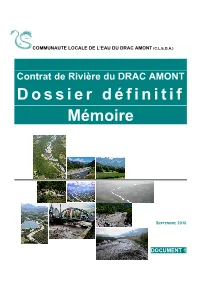
Dossier Définitif Mémoire
COMMUNAUTE LOCALE DE L’EAU DU DRAC AMONT (C.L.E.D.A.) Contrat de Rivière du DRAC AMONT Dossier définitif Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont (CLEDA) Mémoire Novembre SEPTEMBRE 2010 DOCUMENT 1 COMMUNAUTE LOCALE DE L’EAU DU DRAC AMONT (C.L.E.D.A) Contrat de Rivière du DRAC AMONT Dossier définitif – Document 1 Page 2/71 COMMUNAUTE LOCALE DE L’EAU DU DRAC AMONT (C.L.E.D.A) SOMMAIRE SSSooommmmmmaaaiiirrreee............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................333 111 PPPrrréééaaammmbbbuuullleee..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................777 222 PPPAAARRRTTTIIIEEE 111 EEEtttaaattt dddeeesss LLLiiieeeuuuxxx......................................................................................................................................................................................................................................................................................................999 -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

La Fibre Poursuit Son Déploiement Dans Les Alpes Du Sud Et Arrive Dans Le Briançonnais !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Briançon, le 09 avril 2021 La fibre poursuit son déploiement dans les Alpes du Sud et arrive dans le Briançonnais ! 20 mois après le démarrage du chantier et malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, les déploiements fibre réalisés par Xp Fibre dans le cadre de l’AMEL porté par la Région Sud et les 3 Départements - Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Bouches-du-Rhône – se poursuivent : 26 Nœuds de Raccordement Optique sont en service et 492 Points de Mutualisation installés 120 000 prises fibre sont construites sur le terrain, dont près de 40 000 dans les Hautes-Alpes 85 745 logements et locaux professionnels sont éligibles à la fibre, dont 21 146 dans les Hautes- Alpes La fibre arrive dans le Briançonnais – à Briançon, Saint-Chaffrey et La Salle-les-Alpes - où 3 000 logements sont éligibles à la fibre dès avril. 10 000 le seront d’ici cet été. Aujourd’hui, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France, Jean-Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes, Arnaud Murgia, Maire de Briançon, Alain Weill, Président directeur général de Altice France et Lionel Recorbet, Président de Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) étaient présents à Briançon pour annoncer l’éligibilité des premiers logements à la fibre optique sur 3 communes du Briançonnais et faire un point plus global sur ce chantier de très grande ampleur. Ouverture du service fibre dans le Briançonnais Les premières prises fibre sont disponibles pour les habitants et les entreprises dès ce mois-ci à Briançon, Saint-Chaffrey et La Salle-les-Alpes, après l’installation d’ 1 Nœud de Raccordement Optique et de 30 Points de Mutualisation permettant la desserte en fibre de 6 181 logements. -

Présentation Générale De La Commune De Saint Jean Saint Nicolas
Présentation générale de la commune de Saint Jean Saint Nicolas UNE COMMUNE AU COEUR DE LA VALLEE DU CHAMPSAUR La commune de Saint Jean Saint Nicolas compte 1041 habitants (INSEE 2017) et s’étend sur 3 750 ha. Elle est située à 22 km de Gap et 17 km de St Bonnet en Champsaur. St Jean St Nicolas est nichée dans la vallée du Champsaur, entre le confluent du Drac noir et du Drac blanc en amont, et la plaine de Chabottes en aval. Le centre de la commune est constitué par le village de « Pont du Fossé ». Les communes limitrophes de St Jean St Nicolas sont : Saint-Léger-les-Mélèzes, Ancelle, Chabottes, Saint-Michel-de-Chaillol, Champoléon et Orcières. La commune occupe un espace transitionnel entre la fin de la plaine du Drac et le début du haut Champsaur. Contrefort du massif des Écrins, l’ensemble de son territoire est situé dans l’aire optimale d’adhésion du Parc National des Écrins. La commune a signé la charte du parc. L’urbanisation est composée d’un bourg centre commerçant : « Pont du Fossé » et d’une vingtaine de hameaux situés principalement sur le versant adret jusqu’à 1 500 m d’altitude. Pont du Fossé est un « village-rue » construit le long de la RD 944 reliant la commune d’Orcières à Gap ou à St Bonnet. Le village est aussi un passage obligé pour les personnes souhaitant se rendre à la station de ski d’Orcières 1850. La population actuelle de St Jean St Nicolas est de 1041 habitants. -

Histoire La Motte En Champsaur 1
Début XVIIe Carte du Chenssaut de Jean de Beins Carte générale du Dauphiné / Par privilège du Roy Jean de Beins (1577-1651) 1706 carte de Jaillot Partie du Briançonnois, du Graisivaudan, du Gapençois et l'Ambrunois dans le Daufiné la vallée est dessinée, pas de mention de lieux Fin XVIIIe Carte des Alpes depuis Nice jusqu'au lac de Genève. Début XIXe, reproduction en 1875 Carte des Alpes depuis Nice jusqu'au lac de Genève. Mentions La Motte, Molines et détails de la vallée Dernières glaciations Avant dernier épisode glaciaire - 130 000 ans Riss III Altitude du glacier 1650 m La Valette 1200 m Molines 1250 m Le Roy 1400 m Boyer 1400 m La Londonnière 1540 m Le Sellon 1560 m La Motte 1100 m Dernier épisode - 21 000 maximum wurmien La méditerranée est à – 120 m À partir de - 21 000, le réchauffement commence par toucher l'hémisphère Nord. Dans les Alpes, le retrait est rapide. En - 17 000 av. J.-C, une grande partie des Alpes est déjà dégagée Aspres squelette avec bracelets urne avec restes d’incinération Néolithique Occupation ancienne Découvertes archéologiques St Firmin Les Lauzons Sépultures Structures pastorales Âge du Bronze -2 200 à -800 av. J.-C. Palastre La Motte Lame silex Bénévent Ancien -2 200 à –1 600 Dépôt Structures pastorales Dépôt 2 Jujal Moyen –1 600 à –1 400 Structures pastorales Final -1 400 à -800 La Fare 2 Dépôt Boussensayes Tombes et mobilier Âge du Fer Piolit -800 à –52 av. J.-C. Chauvet Pointe de flèche Hache en pierre polie 1 Hallstatt (période des tumuli) -800 à -450 1Tumuli Manse Faudon Tombe Tesson 2 La Tène -750 à -52 Néolithique final le "bel Âge du Bronze" du Champsaur Le Bronze final III (- 850 à -700) / Hallstatt ancien Dépôt de Roussier à La Motte-en-Champsaur Dépôt de La Loubière à Bénévent-et-Charbillac Dépôt découvert dans une petite fosse sous un bloc erratique. -

10MEN054 VP DRAC AMONT Phase II 12-09-28
ÉTUDES D’ESTIMATION 2015 DES VOLUMES - 2010 SDAGE PRÉLEVABLES Rhône-Méditerranée GLOBAUX Sous bassin versant du Haut Drac Rapport de phase 1 et 2 • septembre 2012 CLEDA Rapport de phases I - II Détermination des volumes maximum prélevables – Bassin versant du Drac amont TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 CARACTERISATION DU BASSIN VERSANT...................................3 1 Présentation générale ..............................................................................................4 1.1 Géographie – topographie ...................................................................................4 1.2 Occupation du sol................................................................................................6 2 Hydrologie ................................................................................................................9 2.1 Climat..................................................................................................................9 2.2 Description du réseau hydrographique..............................................................10 2.3 Eléments d’hydrologie ......................................................................................11 2.4 Masses d’eau superficielles...............................................................................12 2.5 Qualité des eaux du bassin versant....................................................................15 2.6 Qualité piscicole des cours d’eau ......................................................................17 3 Hydrogéologie.........................................................................................................21 -

DSDEN05 Sectorisation Collèges
SECTEURS SCOLAIRES ZONES DE RECRUTEMENT DES COLLEGES PAR COMMUNES L’Argentière -la -Bessée L’Argentière-la Bessée, Champcella, Freissinières, « Les Giraudes » La Roche-de-Rame, Les Vigneaux, Pelvoux, Puy- Saint-Vincent, Vallouise, Saint-Martin-de-Queyrières : choix Les Giraudes ou Les Garcins La Bâtie -Neuve « Simone Avançon, La Bâtie-Neuve, La Bâtie-Vieille, Veil » Chorges, Montgardin, Prunières, Rambaud, La Rochette, Saint-Etienne-le-Laus, Valserres Briançon « Les Garcins » Briançon : selon adresse Cervières, La Salle-les-Alpes, Le Monétier-les- Bains, Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint- Chaffrey, Villard-Saint-Pancrace Saint-Martin-de-Queyrières : choix Les Giraudes ou Les Garcins Briançon « Vauban » Briançon : selon adresse Montgenèvre, Névache, Val des Prés La Grave et Villar-d’Arêne : choix Vauban ou Les Six Vallées (38) Embrun « Les Ecrins » Baratier, Châteauroux-les-Alpes, Crévoux, Crots, Embrun, Le Sauze-du-Lac, Les Orres, Puy-Saint- Eusèbe, Puy-Sanières, Réallon, Saint-Apollinaire, Savines-le-Lac, Saint-André-d’Embrun, Saint- Sauveur Gap « Centre » Gap : selon adresse Gap « Fontreyne » Gap : selon adresse La Freissinouse, Pelleautier La Roche-des-Arnauds, Manteyer et Rabou : choix Fontreyne ou F. Mitterrand Gap « Mauzan » Gap : selon adresse Guillestre « Les Hautes Abriès, Aiguilles, Arvieux,Château-Ville-Vieille, Vallées » Ceillac, Eygliers, Guillestre, Molines-en-Queyras, Mont-Dauphin, Réotier, Risoul, Ristolas, Saint- Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Véran, Vars Laragne « Les Hauts de Barret-sur-Méouge, Eourres, -

Die Leidenden Bauern
AZ 3900 Brig | Dienstag, 21. Juli 2015 Nr. 166 | 175. Jahr gang | Fr. 2.50 Wissen, Schnell, was im Wallis aktuell, läuft! informiert! www.1815.ch Re dak ti on Te le fon 027 922 99 88 | Abon nen ten dienst Te le fon 027 948 30 50 | Mediaverkauf Te le fon 027 948 30 40 Auf la ge 2 2 213 Expl. INHALT Wallis Wallis Sport Wallis 2 – 11 Traueranzeigen 10 Das Meer lockt Umfassend Kein Kandidat Ausland 12/13/16 Schweiz 14 «Einmal im Jahr muss ich Matthias Taugwalder trug Der neue FIFA-Präsident Wirtschaft/Börse 15 ans Wasser», sagt Pierre- alle Originaldokumente zur wird am 26. Februar gewählt. Sport 17 – 19 TV-Programme 22 Alain Grichting, wenn es um Matterhorn-Erstbesteigung Sepp Blatter wird nicht Wohin man geht 23 Ferien geht. | Seite 2 zusammen. | Seite 9 Kandidat sein. | Seite 17 Wetter 24 Oberwallis | Die anhaltende Hitze macht den hiesigen Landwirten zu schaffen KOMMENTAR Zwiespältiger Die leidenden Bauern Sieg Von einem «Sieg der Vernunft» sprach IG-«Bächi»-Präsident Leo Durch die aktuelle Hitzeperiode Garbely, nachdem das Stimm - werden Bauern im ganzen Kanton vor grosse Herausforderungen ge - volk von Reckingen-Gluringen stellt. Es leiden die Pflanzen, die am vergangenen Sonntag das Tiere und die Landwirte selber. Lawinen- und Hochwasser - schutzprojekt Bächi bachab Durch die hohen Temperaturen erlangen schickte. die Bewässerungsanlagen einen immensen Dem Urnengang ging ein jahre - Stellenwert. So verrichten Landwirte viele langes Hickhack voraus, das vor zusätzliche Wässerstunden, um der brüten - allem beim Gemeindepräsidenten den Hitze etwas entgegenzusetzen. Auf - Norbert Carlen Spuren hinterliess. grund der Wetterverhältnisse werden viele Das klare Abstimmungsresultat von ihnen beim sogenannten «zweiten hat er verdaut, die persönlichen Schnitt» aber gleichwohl unterschiedlich Anfeindungen und Tiefschläge grosse Einbussen in Kauf nehmen müssen. -

Slovan - Ludogorec 2:1
NAJLEPŠIE KURZY – SUPERŠANCA 1 X 2 12349 IFK GÖTEBORG – TRENČÍN 1,65 4,00 5,75 19:00 12350 MACCABI HAIFA – CHAZAR LANKARAN 1,42 5,00 8,00 19:00 12351 MALMÖ – HIBERNIAN 1,55 4,10 7,15 19:00 12352 ROSENBORG – ST. JOHNSTONE 1,45 4,50 8,45 19:00 12354 DIFFERDANGE – UTRECHT 9,10 5,25 1,37 19:30 12355 SPARTA PRAHA – HÄCKEN 1,50 4,40 7,35 20:15 12348 RUSKO – ŠPANIELSKO 6,50 4,00 1,60 20:30 12356 CZ BELEHRAD – VESTMANNAEYJAR 1,25 6,50 13,0 20:30 Štvrtok • 18. 7. 2013 • 67. ročník • číslo 165 • cena 0,55 12358 BREIDABLIK – STURM GRAZ 5,55 4,10 1,65 21:15 Denník Šport aj v App Store pre iPad a iPhone Kompletnú ponuku nájdete v pobočkách a na www.nike.sk Halenárove rany nádeje Strany 8 a 9 WWW.SPORT.SK Slovan - Ludogorec 2:1 To bol zvrat! V prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov Slovan prehrával 0:1, nepremenil penaltu, prišiel o vylúčeného hráča, no v závere v oslabení víťazstvo zariadil striedajúci Halenár: najprv parádnym gólom vyrovnal a potom premenil pokutový kop. FOTO MILAN ILLÍK Brankár Ján Mucha: Daniela Hantuchová Ktorý Slovák Najdôležitejšia je o štvorhre s Hingisovou: zarobil v NHL šanca chytať! Bude zábava! doteraz najviac? Strany 6 a 7 Strana 16 Strany 26 a 27 2 CYKLISTIKA štvrtok ❘ 18. 7. 2013 100. TOUR DE FRANCE ● 29. 6. – 21. 7. 2013 V druhej tohtoročnej časovke na Tour z dvojice Slovákov podľa očakávania lepší PETER VELITS Na pódiu už s Froomom dvaja zo Saxo - Tinkoff Posledná tohtoročná časovka na Tour de France bola výrazne ťažšou záležitosťou pre celé štartové TELEGRAM Z TOUR pole ako prvé individuálne kilometre proti chro- ● Nezastaviteľný Froome, vyhral aj časovku nometru, ktoré sa uskutočnili pred týždňom na ● Contador už druhý, Kreuziger tretí severe Francúzska.