Correspondance A.S.B.L
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Z-Info 3/2003 DE
Z-Info 3/2003 LEITARTIKEL Ein langwieriges Kapitel in der Geschichte des Z Neben stehendes Photo soll Ihnen die Wartezeit ein Club 92 scheint dann doch noch einen guten Ab- wenig verkürzen. Es zeigt eine der ”neuen” V 60 der schluß zu finden: Der Club-Zug. Sie, liebe Mitglie- Mittelweserbahn Anfang November in Oberhausen- der, haben sich in der Abstimmung für den Bauzug Osterfeld. Die Lok ist erst im Sommer von der MWB der Mittelweserbahn entschieden. Die Verträge mit in Dienst gestellt worden. Umfangreiche Gleisarbei- Märklin sind unterzeichnet und wir alle harren der ten von Oktober bis Dezember im Ruhrgebiet im Dinge die da kommen werden. Leider sind wir der- Zuge der S 9, führten zu zahlreichen Einsätzen der zeit immer noch nicht in der Lage verbindliche Aus- MWB mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. sagen dazu zu machen, wann denn letztendlich die Die Mittelweserbahn informiert Eisenbahnfreunde recht Jahresgaben 2002 und 2003 auf den Postweg ge- ausführlich auf ihrer web-site über ihren Fuhrpark: bracht werden können. Dennoch glauben wir, daß http://www.mittelweserbahn.de/fancorner/fancor- der Zug im Endeffekt unser aller Fuhrpark ein ner.html (Eingabe ohne den Trennungsstrich im Glanzlicht aufsetzten wird. zweiten ”fancorner”). Wir haben mit uns gerungen, ob wir das Heft so ge- stalten sollen, wie es jetzt vor Ihnen liegt. Der Kata- log der Werbemodelle nimmt fast ungebührlich viel Platz ein. Ausschlaggebend waren folgende Überle- gungen. Der wichtigste Grund ist das Ergebnis der Umfrage im letzten Jahr. Die Mehrheit der Mitglieder und wesentlich mehr als von uns erwartet, halten diese Auflistung für eine wichtige und unverzichtba- re Leistung des Clubs. -

Indice Analitico Dal Num. 1 (Set. 1980) Al Num
Indice analitico completo dal numero 1 (settembre 1980) al numero 345 (febbraio 2012) INDICE CRONOLOGICO 1980 1 - settembre 1980 Editoriale: stavolta ho preso il rapido 3 - novembre 1980 "Sospesa" anche la linea di Valdagno: addio FTV (Alessandro Muratori) In servizio le due piani sulle FNM (Giovanni Cornolò) Editoriale: potenza oraria o continuativa? Giovanni Paolo II e la ferrovia (Marcello Cruciani, Roberto Zannotti) Ancora novità ad Arezzo Novità ad Arezzo Pisa: collegamento ferroviario con l'aeroporto (Enzo Perondi) Storia e curiosità: Tranvie Provinciali Cremonesi (I) (Claudio Cerioli) Un accessorio discusso, il preriscaldatore sulle locomotive a vapore (Erminio Pietrarsa fra passato e futuro (Pietro Ferrari) Mascherpa) Un modo nuovo di concepire il treno speciale (Enzo Perondi) Le ferrovie italiane dopo l'8 settembre 1943 (II) (Bruno Bonazzelli) Città e binari: Domodossola (Domenico Molino) Vapore oggi (Gian Guido Turchi) Dall'«Adriatica» al museo di Pietrarsa, breve storia del Gruppo 290 FS (Gian Guido E.428, l'equivoco delle serie Turchi) Da Rocchetta ad Avellino: viaggio su una secondaria da rinnovare (Domenico Nuova ferrovia Caltagirone–Gela (Giuseppe Sergi) Molino) Siena rilancia la ferrovia, riaperta la linea per Buonconvento e Monte Antico (Adriano Betti Carboncini) MODELLISMO La composizione dei treni MODELLISMO Quadruplicati i modelli Lima disponibili in Italia (Gian Guido Turchi) Il primo impianto Idee e progetti: una ferrovia a scartamento ridotto (Giancarlo Ganzerla) Un'idea per cominciare Costruzioni modellistiche: -

Bortom Järnvägsknuten SOU 2015:110 Volym 2 Total Bilagedel
En annan tågordning – bortom järnvägsknuten Bilagedel med underlagsrapporter Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: [email protected] Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Omslagsidé: Gunnar Alexandersson. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24396-1 ISSN 0375-250X Innehåll Bilaga 7 Gränssnittet avtalad och kommersiell trafik Rapport av Lars Henriksson ..................................... 7 Bilaga 8 De statliga företagens roll – samhällsuppdrag till SJ AB Rapport av Lars Henriksson ........................................... 57 Bilaga 9 Samspel och samverkan angående gemensamma risker Rapport av Lars Henriksson ........................................... 91 Bilaga 10 Relationen mellan kommersiell och upphandlad subventionerad trafik på den avreglerade svenska järnvägsmarknaden Rapport av Staffan Hultén ............................................ 125 Bilaga 11 Transaktionskostnader, -
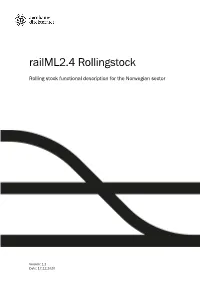
Railml2.4 Rollingstock
railML2.4 Rollingstock Rolling stock functional description for the Norwegian sector Version: 1.2 Date: 17.12.2020 Content Summary The following documents the Norwegian use of the railML2.4 Rollingstock (RS) schema. It contains information about the application of railML2.4 RS, general modelling rules and an example. railML2.4 RS Documentation 2 General Information Content 1 General Information....................................................................................................................................... 4 1.1 What is railML2.4 RS ...................................................................................................................... 4 1.2 Why do we need railML2.4 RS ....................................................................................................... 4 1.3 What do we use railML2.4 RS for .................................................................................................. 4 1.4 Reader information ......................................................................................................................... 4 1.5 Syntax guide .................................................................................................................................... 5 2 Norwegian use of railML2.4 RS on element level ..................................................................................... 6 3 General Modelling Rules ............................................................................................................................... 8 3.1 Vehicles -

Nmj.No CATALOGUE
20 NOK / 2,5 € www.nmj.no CATALOGUE NMJ - Passion for trains NMJ - Passion for trains - lidenskap for tog 1980-2010; Et eventyr av norske modeller gjennom 30 år. 1980-2010; An adventure of model trains through 30 years. I februar fyller NMJ 30 år. En suksess historie som egentlig ikke skulle være mulig In February 2010 NMJ celebrate 30 years anniversary. NMJ is a story of success and should i et lite marked og et lite land som Norge. Desto større blir gleden av å kunne not have been possible in such a small country and such a small market. Therefore it is a presentere vår jubileumskatalog for 2010 med hele 88 sider. pleasure to present our 88 pages full color catalog for 2010. Ingen jubileer uten et tilbakeblikk: I februar 2010 er det nøyaktig 30 år siden den første annonsen i NJK`s ”På Spo- No anniversary without a short retrospect glance: ret” nummer 26. De første agenturene med bl.a Perl Modell og modellen av In February it is 30 years since the first ad appeared in the Magazine “På Sporet”. The ”Padda” og NSB Cmb 16 kom også i 1980. first agency, Perl Modell, came 1980. This resulted in the model of “Padda” (The Frog) and Forretningen på Strømmen åpnet i 1981, samme år ble vi konsulenter for Lima‘s Cmb16. The shop in Strømmen was opened 1981, the very same year we started as con- norske modeller. I 1990 overtok vi Lima agenturet. Det brakte over 100 norske sultants for Lima`s Norwegian models. NMJ took over the Lima agency in 1990, and this og svenske modeller. -

Green Train Basis for a Scandinavian High-Speed Train Concept
Green train Basis for a Scandinavian high-speed train concept FINAL REPORT, PART A Oskar Fröidh KTH Railway Group, publication 12-01 Trains for tomorrow’s travellers Trains for tomorrow’s travellers www.gronataget.se www.railwaygroup.kth.se Printed in Stockholm 2012 Green Train Basis for a Scandinavian high-speed train concept Final report, Part A Oskar Fröidh Stockholm 2012 KTH Railway Group Publication 12-01 ISBN 978-91-7501-232-2 Green Train. Basis for a concept English translation: Ian Hutchinson All illustrations, if otherwise not mentioned: Oskar Fröidh © Oskar Fröidh, 2012 Contact the author: Div. of Transport and Logistics Royal Institute of Technology (KTH) SE-100 44 Stockholm Sweden [email protected] KTH Railway Group Sebastian Stichel [email protected] Phone: +46 8 790 60 00 www.railwaygroup.kth.se 2 Final report, part A Foreword The Green Train (in Swedish ―Gröna Tåget‖) is rather unique as a research and development programme since it brings together both institutes of higher education and infrastructure managers and railway companies and train manufacturers in a common programme. Since its inception in 2005 the objective has been to develop a concept proposal for a new, attractive high- speed train adapted to Nordic conditions that is flexible for several different tasks on the railway and interoperable in the Scandinavian countries. The concept proposal can act as a bank of ideas, recommendations and technical solutions for railway companies, track managers and the manufacturing industry. It is an open source, which means that it is accessible to all conceivable stakeholders. The research programme has already attracted the interest of the industry both in Sweden and other countries during the years we have been working on it. -

Jernbanenyheder Fra BL Indholdsfortegnelse
Jernbanenyheder fra BL Sendt onsdag 31. december 2014 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Indholdsfortegnelse I denne indholdsfortegnelse er anført alle kapitler og de fleste overskrifter. Der er ud for overskrifterne angivet på hvilken side, kapitlet begynder. Ved at læse sidetallet på næste kapitel kan der dannes et indtryk af kapitlets omfang. Står der intet under et kapitel, bringes der intet. Rækkefølgen er kronologisk i hvert kapitel og dækker hovedsagelig perioden i uge 26 mandag 23. juni 2014 – søndag 29. juni 2014. Side Emne DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) DEN DAGLIGE DRIFT (ØST) 6 PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER Militærsærtog i Ho Militærtog og Cheminova-godstog Sprøjtetog i Ho 7 KØREPLANER Godstog Fa-Hr-Fa Godstog Fa-Hr Kørsel med veterantog Rd-Ar-Sl 7 TRÆKKRAFT Spor 33 i Fa 7 GODSVOGNE Ventende godsvogne i Vj på tog 8615 PERSONVOGNE TOGSÆT S-TOG METRO FÆRGER 8 VETERANMATERIEL OSV. DJM Jylland rundt SPECIALKØRETØJER SKROTBUNKEN 8 FASTE ANLÆG Rettelsesblade 73-76 til TIB-S Efter otte år er Eu fjernet fra TIB (V)/TIB-S men ikke fra TKV 15 Halvering af antal La på Vestkystbanen Rettelsesblade 78-79 til TIB-S Banedanmark må arbejde uden for dagtimerne i Tølløse og Vipperød Side 1 af 24 9 UDLAND Oplevelser i Gudbrandsdalen Otta og Otta-Sel Kort over Eidsvoll-Dombåsbanen Tre tog i Otta på én gang Fra Otta rejses 203,96 km til Støren Støren km 501,20 Norsk Jernbaneklubb, Trøndelag Ombygning af spor og perron i Trondheim af afsluttet SDS Hansteen Kørsel på Thamshavnbanen Orkla Industrimuseum Mdt Marienborg Di.4-krydsning i Leangen? 22 DIVERSE Tour de Tog Kørestole: Rejseplanen giver en hjælpende hånd DSB kører dig til Orange scene Shuttle-tog direkte til musikken 23 Nu er de her! Jernbanenyheder Overrubrikker sat med Arial 12 pkt. -

Annual Report 2018
Annual Report 2018 Annual Report 2018 1 Contents Introduction 3 CEO’s comment 16 Norske tog’s goals 22 Organisation 26 Sustainability and corporate social responsibility 32 The local train – the everyday hero 44 Internet coverage - an important element of good travel experiences 52 Innovation and digitalisation – arriving safely and on time 60 Corporate governance 66 Board of Director’s report 72 Financial statements 78 Auditor’s Report 78 Introduction Norske tog’s fleet Norske tog owns and manage aprox 90% of Norwegian railway vehicles used for passenger traffic Class 5 Subseries: A5-1 B5-3 B5-5 BC5-3 FR5-1 56 160 km/h A5 has 48 seats, B5 has 68 seats and BC5 has 40 seats ** Day/Night train Dovre line, Bergens line and Nordlands line i A5 has comfort class, BC5 has family carriage and FR5 is a restaurant carriage Class 69 Underserier: Class 69 B Class 69 D 52 130 km/h 69C has 286 seats, 69D has 302/303 seats, 69G has 269 seats and 69H has 238/240 seats* Local train Eastern Norway and Voss line Class 70 Class 72 16 160 km/h 233/238* Regional train Eastern Norway i Only used as an entry train Class 74 36 200 km/h 240* Regional train Eastern Norway Class 92 Class 93 14 140 km/h 143* 15 140 km/h 87* Local train Trønder line, Meråker line and Røros line Regional train Rauma line, Røros line and Nordlands line Class 7 Subseries: A7-1 B7-4 B7-5 59 160 km/h A7 has 48 seats, B7 has 68 seats and BC7 has 36 seats ** Day/Night train Bergen line and Sørlands line i A7 has comfort class, BC7 has family carriage and FR7 is a restaurant carriage Class -

R744 HVAC Unit for NSB Flirt Trains
R744 HVAC unit for NSB Flirt trains Eirik Trygstad Master of Energy Use and Energy Planning Submission date: June 2017 Supervisor: Armin Hafner, EPT Co-supervisor: Trygve Eikevik, EPT Norwegian University of Science and Technology Department of Energy and Process Engineering i ii Abstract The vast majority of current air conditioning systems, for railway HVAC applications, utilize high global warming potential (GWP) hydrofluorocarbon (HFC) refrigerants in a vapor compression cycle. In Europe, the dominating refrigerants are R134a and R407C, constituting 75 and 25% of the total stock, respectively. Fluorinated greenhouse gases (GHG), such as HFCs, accounts for 2.5% of the overall GHG emissions, expressed in GWP (EU 2013), and are as a consequence being regulated at an increasing rate, through the revised F-Gas regulation of 2014, (EU) No 517/2014, that aims to reduce EU fluorinated GHG emissions by two thirds of the 2010 levels by 2030. Because of the legislations and incentives put into place, both at the national and international level, the demand for environmentally benign HVAC&R technology, with viability in terms of achieved system efficiency and cost, is high, and can be expected to increase in a range of sectors the forthcoming years. A review of current railway HVAC technology, gives strong indication that R744 (CO2) vapor compression units are one of the most viable candidates for the future, able to meet virtually all requirements with regard to environmental impact, safety, reliability and energy efficiency. A newly developed, energy efficient and environmentally friendly prototype R744 HVAC unit, will be tested onboard a commuter trainset, operated in the Oslo area, during a test campaign to be initiated late 2017. -

Be Careful to Read the Respective Modder´S Notes for Each Download to Make Sure That You Have Everything You Need!
Locomotives by country Be careful to read the respective modder´s notes for each download to make sure that You have everything You need! USA & Canada: Steam locomotives: Iron Horse by DasMatze, a fictional Westernstyle locomotive. Mikado type locomotive by xAlex666, a standard heavy steam locomotive built in the USA from around 1917 to 1944. Big boy type locomotive by DukeaufDune, probably the largest steam locomotive ever built, a classic... Union Pacific Big Boy by Svelbeard,A major rework for Trainfever.net: The classic Union Pacific version of the classic locomotive type, please note the Authors text on the download page. Pennsylvania RR T1 type express train locomotive by RogerMurdock, a powerful streamlined locmotive built in the 1940s. Diesel locomotives: Union Pacific SD60 by DasMatze, a special duty diesel built between 1984 and 1991. Amtrak & Canadian National SD60s by TrainRAT, a special duty diesel built by EMD between 1984 and 1991. Alaska Railroad SD70 by DukeaufDune, a special duty diesel built between 1993 and 2004. Union Pacific DDA40X by Thorty and Grimes, an experimental or prototype locomotive built in 1969-1971 for Union Pacific, all had retired from regular service in 1986. United Kingdom: Steam locomotives: Thomas the tank engine by SwissCH, a fictional tank locomotive from the childrens TV-series with the same name. Midland Railway 1000 Class by RogerMurdock, a steam locmotive built in 1902-1909. Shannon locomotive by BritishTrains, a small shunting engine built in 1857 that managed to survive in service until 1945. Diesel locomotives: BR Class 55 Deltic by Svelbeard, the classic Deltic locomotive that was built as an Express locomotive in 1961-1962. -

Norsk Tempoklubb
Norsk Tempoklubb Formann: Utgiver: Bankforbindelse: Hans Tore Bråten Norsk Tempoklubb Tolga og Os Sparebank, Eirik Raudes vei 4 Postboks 577, avd. Tynset, konto nr.: 1472 Fjellhamar 4304 Sandnes 1885. 12. 26512 Tlf: 67 90 60 50 (pr.) [email protected] E-post: formannen @ Orgnr: 981 989 597 Innmelding: tempoklubben.com Innmeldning i klubben sendes Redaktør/layout: til klubbens post -adresse, Nestformann/Webmaster: Ole-Petter Aareskjold eller på E-post: innmelding Terje Flåt Tlf 51 66 15 08 (pr.) @tempoklubben.com Granmeisveien 27 (før kl. 21.00) 4328 Sandnes E-post: tempoposten Kontakt styret: Tlf: 51 62 04 96 (pr.) @tempoklubben.com Styre kan kontaktes på E-post: webmaster følgende E-post: @tempoklubben.com Faste bidragsytere: [email protected] Dagfinn Johnsen Styremedlem/kasserer: John Medhus Medlemsregister: Hans Dahl Ørstavik Trygve Larsen For spørsmål vedrørende Torkelholsveien 11 Helge Aabak medlemsregister, adresser eller 4342 Undheim endring av adresser, ta kontakt Tlf: 922 24 226 (mob.) Deadline / utgivelse: med Hans Tore Bråten E-post: kassereren Nr. 1 01.feb. / ca 15. mars Eirik Raudes vei 4 @tempoklubben.com Nr. 2 01.mai / ca 15. juni 1472 Fjellhamar. Nr. 3 01.aug./ ca 15. sept. Tlf: 67 90 60 50 (pr) Nr. 4 15.okt. / ca 25. nov. E-post: formannen Styremedlem/LMK kontakt: @tempoklubben.com Rune Viestad Annonsering: Fjellveien Privatannonser er gratis, andre må Tempoposten: 2016 Frogner ta kontakt med redaktøren. Spørsmål vedrørende Tempo- Tlf: 930 06 492 (mob.) posten rettes til redaktøren. E-post: LMK-kontakt @ Ettertrykk: E-post: tempoposten tempoklubben.com Ettertrykk kan tillates kun etter @tempoklubben.com avtale med redaktøren. Har du ikke mottatt Tempo- Styremedlem/redaktør: posten, kontakt Hans Tore Ole-Petter Aareskjold Utgis: Bråten Raunabakken 4 A Fire ganger pr. -

Annual Report 2019
Annual Report 2019 Annual Report 2019 1 Contents Introduction 3 CEO’s comment 16 Norske tog’s goals 22 Organisation 26 Sustainability and corporate social responsibility 32 This year’s articles 42 Corporate governance 62 Board of Director’s report 68 Financial statements 74 Auditor’s Report 114 Introduction Norske tog’s fleet Norske tog owns and manage aprox 90 % of Norwegian railway vehicles used for passenger traffic Class 5 Subseries: A5-1 B5-3 B5-5 BC5-3 FR5-1 56 160 km/h A5 has 48 seats, B5 has 68 seats and BC5 has 40 seats ** Day/Night train Dovre line, Bergens line and Nordlands line i A5 has comfort class, BC5 has family carriage and FR5 is a restaurant carriage Class 69 Underserier: Class 69 B Class 69 D 43 130 km/h 69C has 286 seats, 69D has 302/303 seats, 69G has 269 seats and 69H has 238/240 seats* Local train Eastern Norway and Voss line Class 70 16 160 km/h 233/238* Regional train Eastern Norway i Only used as an entry train Class 74 36 200 km/h 240* Regional train Eastern Norway Class 92 Class 93 14 140 km/h 143* 15 140 km/h 87* Local train Trønder line, Meråker line and Regional train Rauma line, Røros line and Røros line Nordlands line Class 7 Subseries: A7-1 B7-4 B7-5 59 160 km/h A7 has 48 seats, B7 has 68 seats and BC7 has 36 seats ** Day/Night train Bergen line and Sørlands line i A7 has comfort class, BC7 has family carriage and FR7 is a restaurant carriage Class 69 H Class 69 CII Local train Eastern Norway and Voss line i Series B is two car sets with fewer seats Class 72 Class 73 Subseries: Class 73A 36 160 km/h