Le Pare National De Tfil, Cote D'ivoire I. Synthese Des Connaissances II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Overview of Upland Rice Research Proceedings of the 1982 Bouaké, Ivory Coast Upland Rice Workshop
AN OVERVIEW OF UPLAND RICE RESEARCH PROCEEDINGS OF THE 1982 BOUAKÉ, IVORY COAST UPLAND RICE WORKSHOP 1984 INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE LOS BAÑOS, LAGUNA, PHILIPPINES P. O. BOX 933, MANILA, PHILIPPINES The International Rice Research Institute (IRRI) was established in 1960 by the Ford and Rockefeller Foundations with the help and approval of the Government of the Philippines. Today IRRl is one of 13 nonprofit international research and training centers supported by the Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR). The CGIAR is sponsored by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank), and the United Nations Development Programme (UNDP). The CGIAR consists of 50 donor countries, international and regional organizations, and private foundations. IRRl receives support, through the CGIAR, from a number of donors including: the Asian Development Bank the European Economic Community the Ford Foundation the International Development Research Centre the International Fund for Agricultural Development the OPEC Special Fund the Rockefeller Foundation the United Nations Development Programme the World Bank and the international aid agencies of the following governments: Australia Belgium Brazil Canada China Denmark Fed. Rep. Germany India Italy Japan Mexico Netherlands New Zealand Philippines Saudi Arabia Spain Sweden Switzerland United Kingdom United States The responsibility for this publication rests with the International Rice Research Institute. ISBN 971-104-121-9 CONTENTS FOREWORD v BASE PAPERS Upland rice in Africa IITA 3 WARDA 21 Upland rice in Asia IRRI 45 Upland rice in India 69 D. M. Maurya and C. P. Vaish Upland rice in Latin America CIAT 93 EMBRAPA 121 ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION AND CLASSIFICATION Rice production calendar for the Ivory Coast 137 J. -
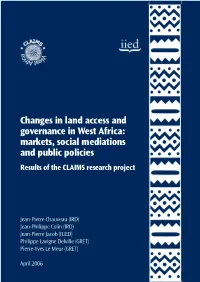
Changes in Land Access and Governance in West Africa: Markets, Social Mediations and Public Policies Results of the CLAIMS Research Project
Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 Changes in land access and governance in West Africa: markets, social mediations and public policies Results of the CLAIMS research project Jean-Pierre Chauveau (IRD) Jean-Philippe Colin (IRD) Jean-Pierre Jacob (IUED) Philippe Lavigne Delville (GRET) Pierre-Yves Le Meur (GRET) April 2006 This document brings together the results of the research project “Changes in Land Access, Institutions and Markets in West Africa (CLAIMS)”, which ran from 2002 to 2005. The project was funded by the European Union (Directorate General for Research), with contributions from DFID (Department for International Development, UK) and AFD (Agence Française de Développement, France). The publication of this synthesis has been funded by DFID, which supports policies, programmes and projects to promote international development. DFID provided funds for this study as part of that objective but the views and opinions expressed are those of the authors alone. Co-ordinated by IIED, CLAIMS involved fieldwork in four West African countries (Benin, Burkina Faso, Ivory Coast and Mali) and mobilised a network of eight research institutions: • GIDIS-CI (Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales – Côte d’Ivoire; Abidjan, Ivory Coast) • GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques; -
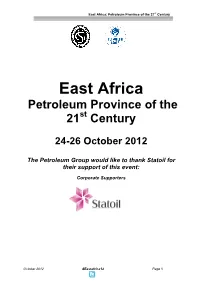
Comparative Review of Key Licence Terms and Conditions in the Context
East Africa: Petroleum Province of the 21st Century East Africa Petroleum Province of the 21st Century 24-26 October 2012 The Petroleum Group would like to thank Statoil for their support of this event: Corporate Supporters October 2012 #Eastafrica12 Page 1 East Africa: Petroleum Province of the 21st Century Conference Sponsors October 2012 #Eastafrica12 Page 2 East Africa: Petroleum Province of the 21st Century CONTENTS PAGE Conference Programme Pages 4 - 6 Oral Presentation Abstracts Pages 7 – 106 Poster Presentation Abstracts Pages 107 - 109 Fire and Safety Information Pages 110 - 111 October 2012 #Eastafrica12 Page 3 East Africa: Petroleum Province of the 21st Century PROGRAMME Wednesday 24 October 08.30 Registration 09.00 Welcome Session 1: Regional Perspectives 09.15 Keynote Speaker: François Guillocheau (Université Rennes) Palaeogeographic Evolution of East Africa from Carboniferous to Present-Day: Deformation and Climate Evolutions 10.00 John G. Watson (Fugro Robertson International) The Evolution of Offshore East African Margins and Intracontinental East African Rift: A Combined Rigid/Deformable Tectonic Reconstruction 10.30 Peter Purcell (P&R Geological Consultants) Oil and Gas Exploration in East Africa: Past Trends and Future Challenges 11.00 Break 11.30 Keynote Speaker: Jim Harris (Fugro Robertson International) The Palaeogeographic and Palaeo-Climatic History of East Africa: The Predictive Mapping of Source and Reservoir Facies 12.15 Paul Markwick (Getech) The Evolution of East African Rivers Systems, Tectonics and Palaeogeography Since the Late Jurassic 12.45 Lunch Session 2: Regional Perspectives 14.00 Keynote Speaker: Ian Davison (Earthmoves) Geological History and Hydrocarbon Potential of the East African Continental Margin 14.45 Nick J. -

Implications to the Late Cretaceous Plate Tectonics Between India and Africa M
Author version: Mar. Geol., vol.365; 2015; 36-51 Re-examination of geophysical data off Northwest India: Implications to the Late Cretaceous plate tectonics between India and Africa M. V. Ramana1, Maria Ana Desa*,2 and T. Ramprasad2 1 Mauritius Oceanographic Institute, Victoria Avenue 230 427 4434 Mauritius 2 CSIR-National Institute of Oceanography, Dona Paula, Goa, India-403 004 * Corresponding author, Email: [email protected] Tel: 91-832-2450428 Fax: 91-832-2450609 ABSTRACT The Gop and Laxmi Basins lying off Northwest India have been assigned ambiguous crustal types and evolution mechanisms. The Chagos-Laccadive Ridge (CLR) complex lying along the southwest coast of India has been attributed different evolutionary processes. Late Cretaceous seafloor spreading between India and Africa formed the Mascarene Basin, and the plate reconstruction models depict unequal crustal accretion in this basin. Re-interpretation of magnetic data in the Gop and Laxmi Basins suggests that the underlying oceanic crust was accreted contemporaneously from 79 Ma at slow half spreading rates (0.6 to 1.5 cm/yr) separating the Seychelles-Laxmi Ridge complex from India. The spreading ridge became extinct at 71 Ma in the central region between 19-20°N and 65.5-67°E, and at 68.7 Ma in the Gop Basin. Extinction progressed southwards with time until 64.1 Ma at ~14.5°N in the Laxmi Basin. This spreading probably limited the seafloor spreading in the northern Mascarene Basin, while normal to fast spreading continued in the south. The fracture zone FZ2 acted as a major boundary between the northern and southern Mascarene Basin, and may have also restricted the southward propagation of the Laxmi Basin spreading ridge. -

Biogeographic Mechanisms Involved in the Colonization Of
Biogeographic mechanisms involved in the colonization of Madagascar by African vertebrates: Rifting, rafting and runways Judith Masters, Fabien Génin, Yurui Zhang, Romain Pellen, Thierry Huck, Paul Mazza, Marina Rabineau, Moctar Doucouré, Daniel Aslanian To cite this version: Judith Masters, Fabien Génin, Yurui Zhang, Romain Pellen, Thierry Huck, et al.. Biogeographic mechanisms involved in the colonization of Madagascar by African vertebrates: Rifting, rafting and runways. Journal of Biogeography, Wiley, 2020, 48 (4), pp.492 - 510. 10.1111/jbi.14032. hal- 03079038 HAL Id: hal-03079038 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03079038 Submitted on 17 Dec 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Received: 1 April 2020 | Revised: 16 October 2020 | Accepted: 29 October 2020 DOI: 10.1111/jbi.14032 SYNTHESIS Biogeographic mechanisms involved in the colonization of Madagascar by African vertebrates: Rifting, rafting and runways Judith C. Masters1,2 | Fabien Génin3 | Yurui Zhang4 | Romain Pellen3 | Thierry Huck4 | Paul P. A. Mazza5 | Marina Rabineau6 | Moctar Doucouré3 | Daniel Aslanian7 1Department of Zoology & Entomology, University of Fort Hare, Alice, South Africa Abstract 2Department of Botany & Zoology, Aim: For 80 years, popular opinion has held that most of Madagascar's terrestrial Stellenbosch University, Stellenbosch, South vertebrates arrived from Africa by transoceanic dispersal (i.e. -

Detection of Mycobacterium Ulcerans DNA in the Environment, Ivory Coast
RESEARCH ARTICLE Detection of Mycobacterium ulcerans DNA in the Environment, Ivory Coast Roger Bi Diangoné Tian1,2, Sébastian Niamké2, Hervé Tissot-Dupont1, Michel Drancourt1* 1 Aix Marseille Université, URMITE, UMR, CNRS 7278, IRD 198, INSERM 1095, Faculté de Médecine, Marseille, France, 2 Laboratoire de biotechnologies, UFR Biosciences, Université Félix Houphouet Boigny Abidjan, Côte d’Ivoire * [email protected] Abstract Background Ivory Coast is a West African country with the highest reported cases of Buruli ulcer, a dis- abling subcutaneous infection due to Mycobacterium ulcerans. However, the prevalence of environmental M. ulcerans is poorly known in this country. Methods We collected 496 environmental specimens consisting of soil (n = 100), stagnant water (n = OPEN ACCESS 200), plants (n = 100) and animal feces (n = 96) in Ivory Coast over five months in the dry Citation: Tian RBD, Niamké S, Tissot-Dupont H, and wet seasons in regions which are free of Buruli ulcer (control group A; 250 specimens) Drancourt M (2016) Detection of Mycobacterium and in regions where the Buruli ulcer is endemic (group B; 246 specimens). After appropri- ulcerans DNA in the Environment, Ivory Coast. PLoS ate total DNA extraction incorporating an internal control, the M. ulcerans IS2404 and KR-B ONE 11(3): e0151567. doi:10.1371/journal. gene were amplified by real-time PCR in samples. In parallel, a calibration curve was done pone.0151567 for M. ulcerans Agy99 IS2404 and KR-B gene. Editor: Baochuan Lin, Naval Research Laboratory, UNITED STATES Results Received: October 21, 2015 Of 460 samples free of PCR inhibition, a positive real-time PCR detection of insertion Accepted: March 1, 2016 sequence IS2404 and KR-B gene was observed in 1/230 specimens in control group A Published: March 16, 2016 versus 9/230 specimens in group B (P = 0.02; Fisher exact test). -

The Walking Whales
The Walking Whales From Land to Water in Eight Million Years J. G. M. “Hans” Thewissen with illustrations by Jacqueline Dillard university of california press The Walking Whales The Walking Whales From Land to Water in Eight Million Years J. G. M. “Hans” Thewissen with illustrations by Jacqueline Dillard university of california press University of California Press, one of the most distinguished university presses in the United States, enriches lives around the world by advancing scholarship in the humanities, social sciences, and natural sciences. Its activities are supported by the UC Press Foundation and by philanthropic contributions from individuals and institutions. For more information, visit www.ucpress.edu. University of California Press Oakland, California © 2014 by The Regents of the University of California Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Thewissen, J. G. M., author. The walking whales : from land to water in eight million years / J.G.M. Thewissen ; with illustrations by Jacqueline Dillard. pages cm Includes bibliographical references and index. isbn 978-0-520-27706-9 (cloth : alk. paper)— isbn 978-0-520-95941-5 (e-book) 1. Whales, Fossil—Pakistan. 2. Whales, Fossil—India. 3. Whales—Evolution. 4. Paleontology—Pakistan. 5. Paleontology—India. I. Title. QE882.C5T484 2015 569′.5—dc23 2014003531 Printed in China 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 The paper used in this publication meets the minimum requirements of ansi/niso z39.48–1992 (r 2002) (Permanence of Paper). Cover illustration (clockwise from top right): Basilosaurus, Ambulocetus, Indohyus, Pakicetus, and Kutchicetus. -

2190-IJBCS-Article-Casimir Anouma
Available online at http://ajol.info/index.php/ijbcs Int. J. Biol. Chem. Sci. 8(6): 2478-2493, December 2014 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print) Original Paper http://indexmedicus.afro.who.int Characterization and utilization of fermented cassava flour in breadmaking and placali preparation Casimir Anauma KOKO 1, 2, 3* , Benjamin Kan KOUAME 1, 2 , Emmanuel ASSIDJO 2 3 and Georges AMANI 1UFR Agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guedé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire. 2Laboratoire des Procédés Industriels, de Synthèse et Environnement, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, BP 1313 Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 3Laboratoire de Biochimie Alimentaire et de Technologie des Produits Tropicaux, UFR/STA, Université d’Abobo-Adjamé, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d’Ivoire. *Corresponding author, E-mail: [email protected]; Tel: (225) 07 36 40 95; Fax: 32 78 75 70 ABSTRACT Freshly harvested cassava roots from yace cultivar were collected in five regions of Ivory Coast and characterized. These roots were processed into fermented flour. The physicochemical characteristics of flours were evaluated following standard methods and, the ability to be valorised in placali preparation and breadmaking were assessed by sensory analysis of products obtained. Both roots and fermented flours were energizing foods. Moisture (6.09-10.49%), protein (1.12-1.57%), ash (0.87-1.39%), fat (0.20-0.51%), total sugars (1.43-1.80%) and cyanide contents (3.33-10.00 mg HCN/kg) of fermented flours were low, while starch (72.79-84.23%), total carbohydrate (93.67-96.45%) and energy (384.53-393.50 kcal/100 g) contents were high. -
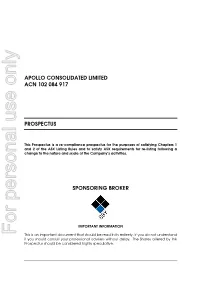
For Personal Use Only Use Personal for This Is an Important Document That Should Be Read in Its Entirety
APOLLO CONSOLIDATED LIMITED ACN 102 084 917 PROSPECTUS This Prospectus is a re-compliance prospectus for the purposes of satisfying Chapters 1 and 2 of the ASX Listing Rules and to satisfy ASX requirements for re-listing following a change to the nature and scale of the Company’s activities. SPONSORING BROKER IMPORTANT INFORMATION For personal use only This is an important document that should be read in its entirety. If you do not understand it you should consult your professional advisers without delay. The Shares offered by this Prospectus should be considered highly speculative. CONTENTS 1. CORPORATE DIRECTORY .............................................................................................. 2 2. IMPORTANT NOTICE ..................................................................................................... 3 3. KEY INFORMATION ....................................................................................................... 4 4. DETAILS OF THE OFFER ................................................................................................ 29 5. DIRECTORS AND CORPORATE GOVERNANCE .......................................................... 32 6. INDEPENDENT GEOLOGISTS REPORTS ........................................................................ 41 7. INVESTIGATING ACCOUNTANT’S REPORT ............................................................... 108 8. SOLICITORS’ REPORTS ON TENEMENTS .................................................................... 134 9. ADDITIONAL INFORMATION ................................................................................... -

The Earth's Lithosphere-Documentary
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/310021377 The Earth's Lithosphere-Documentary Presentation · November 2011 CITATIONS READS 0 1,973 1 author: A. Balasubramanian University of Mysore 348 PUBLICATIONS 315 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Indian Social Sceince Congress-Trends in Earth Science Research View project Numerical Modelling for Prediction and Control of Saltwater Encroachment in the Coastal Aquifers of Tuticorin, Tamil Nadu View project All content following this page was uploaded by A. Balasubramanian on 13 November 2016. The user has requested enhancement of the downloaded file. THE EARTH’S LITHOSPHERE- Documentary By Prof. A. Balasubramanian University of Mysore 19-11-2011 Introduction Earth’s environmental segments include Atmosphere, Hydrosphere, lithosphere, and biosphere. Lithosphere is the basic solid sphere of the planet earth. It is the sphere of hard rock masses. The land we live in is on this lithosphere only. All other spheres are attached to this lithosphere due to earth’s gravity. Lithosphere is a massive and hard solid substratum holding the semisolid, liquid, biotic and gaseous molecules and masses surrounding it. All geomorphic processes happen on this sphere. It is the sphere where all natural resources are existing. It links the cyclic processes of atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Lithosphere also acts as the basic route for all biogeochemical activities. For all geographic studies, a basic understanding of the lithosphere is needed. In this lesson, the following aspects are included: 1. The Earth’s Interior. 2. -

Mikropaläontologie (Foraminiferen, Ostrakoden), Biostratigraphie Und
abhandlungen Band 1 - Teil 1 Mikropaläontologie (Foraminiferen, Ostrakoden), Biostratigraphie und fazielle Entwicklung der Kreide von Nordsomalia mit einem Beitrag zur geodynamischen Entwicklung des östlichen Gondwana im Mesozoikum und frühen Känozoikum Micropalaeontology (Foraminiferida, Ostracoda), biostratigraphy and facies development of the Cretaceous of Northern Somalia including a contribution concerning the geodynamic development of eastern Gondwana during the Cretaceous to basal Paleocene Peter LUGER (†) TEXTBAND Landshut, 06. Dezember 2018 ISSN 2626-4161 (Print) ISSN 2626-9864 (Online) ISBN 978-3-947953-00-4 (Gesamtausgabe) ISBN 978-3-947953-01-1 (Band 1 - Teil 1) ISBN 978-3-947953-02-8 (Band 1 - Teil 2) Die Zeitschrift "documenta naturae abhandlungen" ist die Fortsetzung der Sonderband-Reihe der "Zeitschrift Documenta naturae", begründet 1976 in Landshut. Copyright © 2018 amh-Geo Geowissenschaftlicher Dienst, Aham bei Landshut Alle Rechte vorbehalten. - All rights reserved. Der/die Autor(en) sind verantwortlich für den Inhalt der Beiträge, für die Gesamtgestaltung Herausgeber und Verlag. Das vorliegende Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, insbesondere Übersetzungen, Nachdrucke, Vervielfältigungen jeder Art, Mikroverfilmungen, Einspeicherungen in elektronische Systeme, bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verlages. ISSN 2626-4161 (Print) ISSN 2626-9864 (Online) ISBN 978-3-947953-00-4 (Gesamtausgabe) ISBN 978-3-947953-01-1 (Band 1 - Teil 1) ISBN 978-3-947953-02-8 -

Grown in Ivory Coast
International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (Online) http://www.innspub.net Vol. 5, No. 1, p. 14-22, 2014 Int. J. Agron. Agri. R. International Journal of Agronomy and Agricultural Research (IJAAR) ISSN: 2223-7054 (Print) 2225-3610 (Online) http://www.innspub.net Vol. 9, No. 5, p. 14-20, 2016 RESEARCH PAPER OPEN ACCESS Characterization Agromorphological of five cultivars of eggplant (Solanum aethiopicum) grown in Ivory coast Ayolié Koutoua*3, Séka Chapauh Landry Vgile2, Kobénan Kouman1, Kouakou Tanoh Hilaire2 1Department of Entomology and Plant Pathology, Station of Bimbresso, CNRA, Côte d’Ivoire 2Department of Biology and Improving Plant Production, Faculty of Natural Sciences, University d'Abobo-Adjamé, Côte d’Ivoire 3Department of Agro-Physiology and Culture In-vitro Plant, UFR-Agroforestry, University Jean Lorougnon Guede, Côte d’Ivoire Article published on November 8, 2016 Key words: Eggplant, Cultivars, Agro-morphological characters, Côte d’Ivoire Solanum aethiopicum. Abstract To select eggplant high yielding cultivars and adapted to ecological conditions of Côte d’Ivoire, a trial was carried out at Anguededou Station of CNRA, between June and December 2008. It consisted to assess the agronomic performances of 5 eggplant cultivars (Solanum aethiopicum) collected from diverse ecological areas of the country. The experimental design was a Randomised Block Completed Design with 4 replications. Observations and measures were recorded on cultivars vegetative behaviour at field, dates of phenologic stages, fructification rate and yield components. Results showed that cultivars were vegetative well developed at the all observations dates. Concerning the days to flowering, all the cultivars flowered between 90 (Aub1N/06Dk) and 108 Days after sowing (Aub42K/06Ti).