Madagascar-Report.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
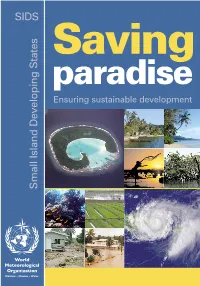
Small Island Developing States SIDS Saving Paradise Ensuring Sustainable Development Small Island Developing States
SIDS Saving paradise Ensuring sustainable development Small Island Developing States SIDS Saving paradise Ensuring sustainable development Small Island Developing States WMO-No. 973 WMO-No. 973 © 2005, World Meteorological Organization ISBN 92-63-10973-7 NOTE The designations employed and the presentation of mate- rial in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the World Meteorological Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitations of its frontiers or boundaries. Saving paradise Contents Foreword iv Introduction 1 Climate change and sea-level rise 5 Natural and environmental hazards 7 Coastal zone management 12 Freshwater 16 Energy 18 Tourism 20 National Meteorological and Hydrological Services and regional cooperation 21 paradise Conclusion 24 Saving iii Ensuring sustainable development Foreword Since the adoption of the Barbados Foreword Programme of Action (BPoA) for the Small Island Developing States (SIDS) in 1994, consid- erable efforts have been deployed to implement the high-priority programme areas defined therein. Today, the achievements may seem meagre when compared to the objectives of the BPoA and the increasing challenges faced by SIDS in areas of trade, security and environment. This is true for most developing countries, but particularly so for SIDS. The impediments are daunting, whether they be natural, indigenous or originate from global conditions. While the responsibility for meeting their socio-economic aspirations should rest primarily with the SIDS themselves, the world community, including strategic part- ners, UN system organizations and the private as well as in climate variability and change and sector, have the duty to commit resources and their impacts on sea-level rise. -

Madagascar Systematic Country Diagnostic
Public Disclosure Authorized Madagascar Systematic Country Diagnostic August 25, 2015 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized The World Bank Group Acknowledgements This Systematic Country Diagnostic was led by Keiko Kubota (Lead Economist, IBRD) with a core team comprising of Satyam Ramnauth (IFC), Southwest Indian Ocean Program Leaders (Julio Revilla, Cristina Santos and Mark Austin), Coralie Gevers (Country Manager for Madagascar). The table below lists those who made written contributions by GP/CCSA. Others have played an important role in providing expert input throughout the SCD process. Global Practice/ CCSA/Unit Contributors IFC Magdi Amin and Frank Douamba Energy Isabel Neto and Vonjy Rakotondramanana Extractives Remi Pelon Environment and Natural Resources Giovanni Ruta and Maminiaina Rasamoelina Disaster Risk Management and Climate Doekle Geert Wielinga Change Transport Noro Rabefaniraka ICT Charles Hurpy Urban Salim Rouhana Agriculture Jan Nijhoff, Ziva Razafintsalama and David Treguer Land André Teyssier Fisheries Xavier Vincent and Benjamin Garnaud PPP Jeffrey Delmon Gender Daniel Kirkwood Education Harisoa Rasolonjatovo Health, Nutrition, and Population Jumana Qamruddin and Voahirana Rajoela Social Protection and Labor Andrea Vermehren Fragility Catalina Quintero and Radhika Srinivasan Macro-Fiscal Enrique Blanco Armas, Faniry Razafimanantsoa, Abdoulaye Sy and Quentin Gouzien Poverty Theresa Osborne and Patrick Randriankolona Governance Anne-Lucie Lefevbre, Hugues Agossou, Sarah Lavin, Joel Turkewitz, Hajarivony Andriamarofara and Rado Razafimandimby Finance and Markets Francesco Strobbe and Noro Andriamihaja Trade and Competitiveness Michael Engman, Johanne Buba, Mombert Hoppe, Eneida Fernandes and Clive Harris The team is grateful to the peer reviewers Raju Singh (Program Leader, LCC8C) and Lars Sondergaard (Program Leader, EACTF) for their insightful and constructive comments, and to Rondro Rajaobelison and Madeleine Chungkong who ably assisted the team. -

Interagency Strategic Research Plan for Tropical Cyclones: the Way Ahead
INTERAGENCY STRATEGIC RESEARCH PLAN FOR TROPICAL CYCLONES THE WAY AHEAD FCM-P36-2007 February 2007 Office of the Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research THE FEDERAL COMMITTEE FOR METEOROLOGICAL SERVICES AND SUPPORTING RESEARCH (FCMSSR) VADM CONRAD C. LAUTENBACHER, JR., USN (RET.) MR. RANDOLPH LYON Chairman, Department of Commerce Office of Management and Budget DR. SHARON L. HAYS MS. VICTORIA COX Office of Science and Technology Policy Department of Transportation DR. RAYMOND MOTHA MR. DAVID MAURSTAD Department of Agriculture Federal Emergency Management Agency Department of Homeland Security BRIG GEN DAVID L. JOHNSON, USAF (RET.) Department of Commerce DR. MARY L. CLEAVE National Aeronautics and Space MR. ALAN SHAFFER Administration Department of Defense DR. MARGARET S. LEINEN DR. JERRY ELWOOD National Science Foundation Department of Energy MR. PAUL MISENCIK MR. KEVIN “SPANKY” KIRSCH National Transportation Safety Board Science and Technology Directorate Department of Homeland Security MR. JAMES WIGGINS U.S. Nuclear Regulatory Commission DR. MICHAEL SOUKUP Department of the Interior DR. LAWRENCE REITER Environmental Protection Agency MR. RALPH BRAIBANTI Department of State MR. SAMUEL P. WILLIAMSON Federal Coordinator MR. JAMES B. HARRISON, Executive Secretary Office of the Federal Coordinator for Meteorological Services and Supporting Research THE INTERDEPARTMENTAL COMMITTEE FOR METEOROLOGICAL SERVICES AND SUPPORTING RESEARCH (ICMSSR) MR. SAMUEL P. WILLIAMSON, Chairman MR. JAMES H. WILLIAMS Federal Coordinator Federal Aviation Administration Department of Transportation MR. THOMAS PUTERBAUGH Department of Agriculture DR. JONATHAN M. BERKSON United States Coast Guard MR. JOHN E. JONES, JR. Department of Homeland Security Department of Commerce MR. JEFFREY MACLURE RADM FRED BYUS, USN Department of State United States Navy Department of Defense DR. -

Programme Update No.1
EASTERN AFRICA 20 July 2004 REGIONAL PROGRAMMES The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people by mobilizing the power of humanity. It is the world’s largest humanitarian organization and its millions of volunteers are active in over 181 countries. For more information: www.ifrc.org In Brief Appeal No. 01.10/2004; Programme Update no. 1; Period covered: January to May 2004; Appeal coverage: 50.0%; Outstanding needs: CHF 1,706,823 (USD 1,335,000 or EUR 1,107,600). Click here to go directly to the attached Contributions List, also available on the website. Appeal target: CHF 3,412,740 (USD 2,563,078 or EUR 2,196,807) Related Emergency or Annual Appeals: · Eritrea: Drought, Emergency Appeal 04/2004 1 · Madagascar: Cyclone Gafilo, Emergency Appeal 08/2004 2 Programme summary: The regional delegation continued implementing the Strategy for Change notwithstanding the postponement of the decentralization process at Geneva level. Besides maintain ing focus on health activities in line with ARCHI 2010 3, scaling up HIV/AIDS activities, food security, and strengthening the capacity of national societies and volunteers’ management systems, emphasis is increasingly shifting to activities directly linked to organizational development and the coordination role of the Federation. A prudent start was made with the establishment of the External Relations Unit. The financial situation of the regional delegation is tight, given the level of coverage (see above). For further information specifically related to this operation please contact: · In Kenya: Reidar Schaanning, Easten Africa Regional Programme Coordinator, Nairobi; Email [email protected]; Phone 254.20.283.50.00; Fax 254.20.271.84.15 · In Geneva: Josse Gillijns, Federation Regional Officer for Eastern Africa, Africa Dept.; Email [email protected]; Phone 41.22.730.42.24; Fax 41.22.733.03.95 This Programme Update reflects activities to be implemented over a one-year period. -

MASARYK UNIVERSITY BRNO Diploma Thesis
MASARYK UNIVERSITY BRNO FACULTY OF EDUCATION Diploma thesis Brno 2018 Supervisor: Author: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. Bc. Lukáš Opavský MASARYK UNIVERSITY BRNO FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE Presentation Sentences in Wikipedia: FSP Analysis Diploma thesis Brno 2018 Supervisor: Author: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. Bc. Lukáš Opavský Declaration I declare that I have worked on this thesis independently, using only the primary and secondary sources listed in the bibliography. I agree with the placing of this thesis in the library of the Faculty of Education at the Masaryk University and with the access for academic purposes. Brno, 30th March 2018 …………………………………………. Bc. Lukáš Opavský Acknowledgements I would like to thank my supervisor, doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. for his kind help and constant guidance throughout my work. Bc. Lukáš Opavský OPAVSKÝ, Lukáš. Presentation Sentences in Wikipedia: FSP Analysis; Diploma Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2018. XX p. Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D. Annotation The purpose of this thesis is an analysis of a corpus comprising of opening sentences of articles collected from the online encyclopaedia Wikipedia. Four different quality categories from Wikipedia were chosen, from the total amount of eight, to ensure gathering of a representative sample, for each category there are fifty sentences, the total amount of the sentences altogether is, therefore, two hundred. The sentences will be analysed according to the Firabsian theory of functional sentence perspective in order to discriminate differences both between the quality categories and also within the categories. -

University of Southampton Research Repository
University of Southampton Research Repository Copyright © and Moral Rights for this thesis and, where applicable, any accompanying data are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis and the accompanying data cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content of the thesis and accompanying research data (where applicable) must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holder/s. When referring to this thesis and any accompanying data, full bibliographic details must be given, e.g. Thesis: Radhika Dave. (2016). Forest ecosystem services for agricultural risk reduction: examining interactions within socio-ecological systems in Madagascar, University of Southampton, Faculty of Social, Human and Mathematical Sciences, Geography and Environment, PhD Thesis, 218p. Data: Dave, R. (2016). Forest ecosystem services for agricultural risk reduction: examining interactions within socio-ecological systems in Madagascar. UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF SOCIAL, HUMAN AND MATHEMATICAL SCIENCES Geography and Environment Volume 1 of 1 Forest ecosystem services for agricultural risk reduction: examining interactions within socio-ecological systems in Madagascar by Radhika Dave Thesis for the degree of Doctor of Philosophy September 2016 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF SOCIAL, HUMAN AND MATHEMATICAL SCIENCES Geography and Environment Thesis for the degree of Doctor of Philosophy FOREST ECOSYSTEM SERVICES FOR AGRICULTURAL RISK REDUCTION: EXAMINING INTERACTIONS WITHIN SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS IN MADAGASCAR Radhika Dave ABSTRACT Natural ecosystems like forests, wetlands and coastal habitats are hypothesized to support disaster risk reduction by decreasing the exposure of communities to hazards such as floods, landslides and storm surge. -

10-Day Rainfall & Agromet Bulletin
10-Day Rainfall & Agromet Bulletin Department of Meteorological Services Period: 21 – 31 January 2004 Season: 2003/2004 Issue No.12 Release date: 4 February 2004 HIGHLIGHTS • Moderate to heavy rains continued over Malawi… • Continuous rains disrupted farming operations … • Cumulative rainfall performance improves… • Rainfall distribution likely to decrease within 1 – 10 February 2004… All inquiries should be addressed to: The Director of Meteorological Services, P.O. Box 2, Chileka, MALAWI Tel: (265) 1 692 312/333/320 Fax: (265) 1 692 329 E-mail: [email protected] Homepage: www.metmalawi.com 10-Day Rainfall and Agrometeorological Bulletin 21 to 31 January 2004 1. WEATHER SUMMARY experienced over Malawi. Most areas reported an average of less than four hours of bright sunshine. This resulted in low 1.1 RAINFALL solar radiation (less than 8 Cal/ cm-²/day) to be received over most parts of Malawi. Malawi experienced fairly continuous widespread rains with moderate to heavy amounts during the period 21 – 31 January 2004. Most areas in the 2. AGROMETEOROLOGICAL south reported above normal 10-day rainfall totals ASSESSMENT with at least seven rainy days. Some parts particularly the western sectors of southern Widespread rainfall received during the Malawi and Mzimba in the north registered very period under discussion supported crop high rainfall intensities and total rainfall for the growth and development. However, period was in excess of 120mm. High rainfall intensities experienced were caused by Congo air continuous rains hampered some farming mass which was enhanced by tropical cyclone operations such as weeding and fertilizer “Elita” in the Mozambique Channel. application particularly over some parts of the south. -

Madagascar: Cyclone Elita; Information Bulletin No
MADAGASCAR: 3 March 2004 CYCLONE ELITA Information Bulletin N° 1/04 Disaster Relief Emergency Fund (DREF) allocated: N/A The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people by mobilizing the power of humanity. It is the world’s largest humanitarian organization and its millions of volunteers are active in over 180 countries. For more information: www.ifrc.org In Brief This Information Bulletin no. 01/2004 is being issued for information only. The Federation is not seeking funding or other assistance from donors for this operation at this time. For further information specifically related to this operation please contact: In Nairobi, Kenya: Steve Penney, Regional Disaster Preparedness Coordinator, Regional Delegation Nairobi In Geneva: Regional Department, Josse Gillijns, Regional Officer; [email protected] All International Federation assistance seeks to adhere to the Code of Conduct and is committed to the Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response in delivering assistance to the most vulnerable. For support to or for further information concerning Federation programmes or operations in this or other countries, or for a full description of the national society profile, please access the Federation’s website at http://www.ifrc.org The Situation Tropical Cyclone Elita hit the Indian Ocean island of Madagascar three times between 26 January and 4 February 2004, causing loss of life and extensive damage. Local authorities in Madagascar later reported on 13 February 29 dead, 100 wounded, and 44,190 homeless. In addition 12,408 houses were partially or totally destroyed while 510 schools and hospitals suffered major damages. -

Madagascar: Cyclone Gafilo; Appeal No
MADAGASCAR: Date 26 March, 2004 CYCLONE GAFILO The Federation’s mission is to improve the lives of vulnerable people by mobilizing the power of humanity. It is the world’s largest humanitarian organization and its millions of volunteers are active in over 181 countries. In Brief Appeal No. 08/04; Operations Update no. 01; Period covered: 17 March to 25 March, 2004; Appeal coverage: 27.4%; (click here to go directly to the attached Contributions List, also available on the website). Appeal history: • Launched on 17 March 2004 for CHF 427,000 (USD 334,211 or EUR 272,606) for 3 months to assist 25,000 beneficiaries. • Disaster Relief Emergency Funds (DREF) allocated: CHF 50,000. Outstanding needs: CHF 309,990 Related Emergency or Annual Appeals: 2004 Annual Appeal for Indian Ocean sub-regional programmes (01.09/2004) Operational Summary: with timely and generous donor support, the delivery of the planned assistance has started, and the Malagasy Red Cross, supported by the Federation, is well on its way to meeting the planned objectives of this appeal. While the attached contributions list reflects an appeal coverage of 27%, pledged support is being recorded in the Federations pledge management system, and this will be reflected shortly. In addition to the contributions from the Finnish and Swedish Red Cross, the Canadian, Danish, and French Red Cross in particular have provided significant support to this operation, effectively bringing the actual coverage close to 80%. For further information specifically related to this operation please -

Regional Inter-Agency Standing Committee (RIASCO), Southern Africa
Humanitarian Trends in Southern Africa: Challenges and Opportunities Regional Inter-Agency Standing Committeei (RIASCO), Southern Africa Humanitarian Trends in Southern Africa: Challenges and Opportunities FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT Disaster Mitigation for Sustainable Livelihoods Programme Stellenbosch University Private Bag x1 Matieland, 7602 South Africa [email protected] PLEASE CITE AS: Holloway A., Chasi V., de Waal J., Drimie S., Fortune G., Mafuleka G., Morojele M., Penicela Nhambiu B., Randrianalijaona M., Vogel C. and Zweig P. 2013. Humanitarian Trends in Southern Africa: Challenges and Opportunities. Regional Interagency Standing Committee, Southern Africa. Rome, FAO. COVER IMAGE CAPTION “PRECIOUS BUNDLE: An as-yet-unnamed baby who was born on the back of a bakkie (pick- up truck) just days ago during the deluge is carried gently across the water by a farmworker” – courtesy of Antione de Ras, The Star, January 25, 2013. i The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO. -

PPCR Investment Plan for Madagascar
PPCR/SC.21/8 November 13, 2017 Meeting of the PPCR Sub-Committee Washington D.C. Tuesday, December 12 – Wednesday, December 13, 2017 Agenda Item 8 PPCR STRATEGIC PROGRAM FOR CLIMATE RESILIENCE FOR MADAGASCAR PROPOSED DECISION The PPCR Sub-Committee, having reviewed the document PPCR/SC.21/8, Strategic Program for Climate Resilience (SPCR) for Madagascar [endorses] the SPCR. The Sub-Committee encourages the Government of Madagascar and the MDBs to actively seek resources from other bilateral or multilateral sources to fund further development and implementation of the projects foreseen in the strategic plan. STRATEGIC PROGRAM FOR CLIMATE RESILIENCE: MADAGASCAR PILOT PROGRAM FOR CLIMATE RESILIENCE CELLULE DE PREVENTION ET GESTION BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES DES URGENCES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CPGU) (BNCCC) Template for Summary of SPCR1 Pilot Program for Climate Resilience Summary of Strategic Program for Climate Resilience (1) Country/Region: MADAGASCAR (2) PPCR Funding Request (in USD Grant: 165 Million USD Loan: million): (3 National PPCR Focal Point: Mamy Nirina RAZAKANAIVO (4) National Implementing Agency CPGU (Cellule de Prévention et Gestions des Urgences) (Coordination of Strategic Program): (5) Involved MDB World Bank and African Development Bank (6) MDB PPCR Focal Point and Project/ Headquarters-PPCR Focal Point: TTL: Program Task Team Leader (TTL): Kanta Kumari RIGAUD (World Bank) Michel MATERA (World Bank) Leandro Azevedo (African development Zinso BOUE (African Development Bank) Bank) (7) Description of SPCR: (a) Key challenges related to vulnerability to climate change/variability: Madagascar faces significant risks imposed by an increasingly variable and changing climate. Cyclones, droughts and floods are all recurrent occurrences in the country, affecting food security, drinking water supply and irrigation, public health systems, environmental management and development prospects overall. -

Acp-Eu Joint Parliamentary Assembly
ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ACP-EU 3669/04/fin. RESOLUTION1 on the damage caused by cyclones in the Pacific, the Indian Ocean and the Caribbean and the need for a rapid response to natural disasters The ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, - meeting in Addis Ababa (Ethiopia) from 16 to 19 February 2004, - having regard to its previous resolutions on the Pacific, Indian Ocean and Caribbean regions, - having regard to the United Nations Framework Convention on Climate Change, signed at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in June 1992, A. whereas tropical cyclone Heta recently ravaged the South Pacific islands of the Cook Islands, Niue, Samoa and Tonga, and cyclone Elita ravaged the west coast of Madagascar resulting in fatalities, leaving several people injured and hundreds homeless, and causing extensive damage to housing, infrastructure and agricultural crops, on which the local population heavily depends for its subsistence, B. recalling the 1994 Declaration of Barbados and the Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States (SIDSs), and mindful of the convening in Mauritius in September 2004 of the UN Barbados +10 Conference on SIDSs, C. taking into account the Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development (WSSD), which took place in Johannesburg, South Africa, in August 2002, and in particular the international strategy defined to address the particular vulnerability of Small Island Developing States, D. having regard to the growing number of natural hazards and disasters and the increase in the devastating violence thereof, the origin of which may be found in climate change, demographic pressure and the impact human beings have on nature throughout the world, 1 Adopted by the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly on 19 February 2004 in Addis Ababa (Ethiopia).