Sensibilisation Et Participation“ Rapport Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De
Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -
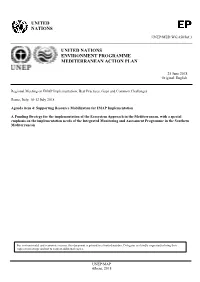
Introduction to Eu External Action
UNITED NATIONS UNEP/MED WG.450/Inf.3 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME MEDITERRANEAN ACTION PLAN 25 June 2018 Original: English Regional Meeting on IMAP Implementation: Best Practices, Gaps and Common Challenges Rome, Italy, 10-12 July 2018 Agenda item 4: Supporting Resource Mobilization for IMAP Implementation A Funding Strategy for the implementation of the Ecosystem Approach in the Mediterranean, with a special emphasis on the implementation needs of the Integrated Monitoring and Assessment Programme in the Southern Mediterranean For environmental and economic reasons, this document is printed in a limited number. Delegates are kindly requested to bring their copies to meetings and not to request additional copies. UNEP/MAP Athens, 2018 A FUNDING STRATEGY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ECOSYSTEM APPROACH IN THE MEDITERRANEAN, WITH A SPECIAL EMPHASIS ON THE IMPLEMENTATION NEEDS OF THE INTEGRATED MONITORING AND ASSESSMENT PROGRAMME IN THE SOUTHERN MEDITERRANEAN Table of Contents 1. Executive Summary 2. Introduction: The implementation needs of the Ecosystem Approach in the Mediterranean and the overall objective of the draft Ecosystem Approach Funding Strategy: 2.1. Overall policy framework for Ecosystem Approach in the Mediterranean 2.2. Ecosystem Approach Roadmap under the UN Environment/MAP-Barcelona Convention 2.3. Key implementation needs 3. Specific implementation needs of the Southern Mediterranean Countries: Capacity Assessment of IMAP implementation needs of Southern Mediterranean (EcAp-MEDII project beneficiaries) countries (Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia): 3.1. Algeria 3.2. Egypt 3.3. Israel 3.4. Lebanon 3.5. Libya 3.6. Morocco 3.7. Tunisia 4. Funding opportunities for the implementation of the Ecosystem Approach/IMAP in the Mediterranean under the EU MFF: 4.1. -

Arabic Kinship Terms Revisited: the Rural and Urban Context of North-Western Morocco
Sociolinguistic ISSN: 1750-8649 (print) Studies ISSN: 1750-8657 (online) Article Arabic kinship terms revisited: The rural and urban context of North-Western Morocco Amina Naciri-Azzouz Abstract This article reports on a study that focuses on the different kinship terms collected in several places in north-western Morocco, using elicitation and interviews conducted between March 2014 and June 2015 with several dozens of informants aged between 8 and 80. The analysed data include terms from the urban contexts of the city of Tetouan, but most of them were gathered in rural locations: the small village of Bni Ḥlu (Fahs-Anjra province) and different places throughout the coastal and inland regions of Ghomara (Chefchaouen province). The corpus consists of terms of address, terms of reference and some hypocoristic and affective terms. KEYWORDS: KINSHIP TERMS, TERMS OF ADDRESS, VARIATION, DIALECTOLOGY, MOROCCAN ARABIC (DARIJA) Affiliation University of Zaragoza, Spain email: [email protected] SOLS VOL 12.2 2018 185–208 https://doi.org/10.1558/sols.35639 © 2019, EQUINOX PUBLISHING 186 SOCIOLINGUISTIC STUDIES 1 Introduction The impact of migration ‒ attributable to multiple and diverse factors depending on the period ‒ is clearly noticeable in northern Morocco. Migratory movements from the east to the west, from rural areas to urban centres, as well as to Europe, has resulted in a shifting rural and urban population in this region. Furthermore, issues such as the increasing rate of urbanization and the drop in mortality have altered the social and spatial structure of cities such as Tetouan and Tangiers, where up to the present time some districts are known by the name of the origin of the population who settled down there: e.g. -

Liste Des Guichets Des Banques Marocaines Par Localite Et Par Region
Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 4 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 5 L’ORIENTAL 13 FÈS - MEKNÈS 21 RABAT - SALÉ- KÉNITRA 29 BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA 39 CASABLANCA- SETTAT 45 MARRAKECH - SAFI 65 DARÂA - TAFILALET 73 SOUSS - MASSA 77 GUELMIM - OUED NOUN 85 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA 87 DAKHLA-OUED EDDAHAB 89 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION 5 TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 6 RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA BANQUE LOCALITES GUICHET TELEPHONE AL BARID BANK AIT YOUSSEF OU ALI AIT YOUSSEF OU ALI CENTRE 0539802032 AJDIR CENTRE RURALE AJDIR 35052 TAZA 0535207082 AL AOUAMRA CENTRE AL AOUAMRA 92050 AL AOUAMRA 0539901881 AL HOCEIMA AVENUE MOULAY DRISS AL AKBAR AL HOCEIMA 0539982466 BV TARIK BNOU ZIAD AL HOCEIMA 0539982857 ARBAA TAOURIRT ARBAA TAOURIRT CENTRE 0539804716 ASILAH 1 PLACE DES NATIONS UNIES 90055 ASILAH 0539417314 ASMATEN CENTRE ASMATEN EN FACE EL KIADA AL HAMRA 93250 ASMATEN 0539707686 BAB BERRET CENTRE BAB BERRET 91100 BAB BERRET 0539892722 BAB TAZA CENTRE BAB TAZA 91002 BAB TAZA 0539896059 BENI BOUAYACHE BENI BOUAYACHE CENTRE 0539804020 BENI KARRICH FOUKI CENTRE BENI KARRICH FOUKI 93050 BENI KARRICH FOUKI 0539712787 BNI AHMED CENTRE BNI AHMED CHAMALIA 91100 BNI AHMED 0539881578 BNI AMMART -

L'entreprenariat Féminin A
1 Es para STEI Intersindical (Sindicato de trabajadoras y trabajadores de la Educación de las Islas Baleares) Intersindical y para la ONGD Ensenyants Solidaris una satisfacción el participar en el financiamiento de esta guía que permite identificar actividades económicas para la inserción de las mujeres en el ámbito laboral en la provincia de Chefchaouen. Con más de 20 años de colaboración conjunta compartimos con ATED el trabajo local de desarrollo humano en el norte de Marruecos. La solidaridad y la cooperación internacional, a nuestro entender, va más allá de la ejecución de proyectos y debe girar en torno al objetivo compartido de una trasformación social mundial, y en concreto en el eje mediterráneo, que se sustente en la ruptura de la dicotomía norte-sur. La necesidad de comprometerse con la igualdad de género, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres es uno de los elementos claves de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Somos conocedores de las dificultades que estos principios tienen en llegar a determinadas poblaciones debido a las miradas arcaicas machistas,sobre el rol de la mujer y sobre la igualdad de género,que predominan en diferentes sociedades; por tal motivo creemos que el trabajo que se presenta tiene una gran importancia para entender las posibilidades de abrir campos de inserción laboral de las mujeres en la provincia de Chefchaouen. Queremos felicitar a ATED por el estudio realizado y a todas las personas que trabajan de manera comprometida por la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en Centro de Escucha y Atención a las Familias (CEAF) de Chefchaouen que atiende a mujeres y niñas/os víctimas de violencia familiar. -

Leishmaniasis in Northern Morocco: Predominance of Leishmania Infantum Compared to Leishmania Tropica
Hindawi BioMed Research International Volume 2019, Article ID 5327287, 14 pages https://doi.org/10.1155/2019/5327287 Research Article Leishmaniasis in Northern Morocco: Predominance of Leishmania infantum Compared to Leishmania tropica Maryam Hakkour ,1,2,3 Mohamed Mahmoud El Alem ,1,2 Asmae Hmamouch,2,4 Abdelkebir Rhalem,3 Bouchra Delouane,2 Khalid Habbari,5 Hajiba Fellah ,1,2 Abderrahim Sadak ,1 and Faiza Sebti 2 1 Laboratory of Zoology and General Biology, Faculty of Sciences, Mohammed V University in Rabat, Rabat, Morocco 2National Reference Laboratory of Leishmaniasis, National Institute of Hygiene, Rabat, Morocco 3Agronomy and Veterinary Institute Hassan II, Rabat, Morocco 4Laboratory of Microbial Biotechnology, Sciences and Techniques Faculty, Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fez, Morocco 5Faculty of Sciences and Technics, University Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Morocco Correspondence should be addressed to Maryam Hakkour; [email protected] Received 24 April 2019; Revised 17 June 2019; Accepted 1 July 2019; Published 8 August 2019 Academic Editor: Elena Pariani Copyright © 2019 Maryam Hakkour et al. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In Morocco, Leishmania infantum species is the main causative agents of visceral leishmaniasis (VL). However, cutaneous leishmaniasis (CL) due to L. infantum has been reported sporadically. Moreover, the recent geographical expansion of L. infantum in the Mediterranean subregion leads us to suggest whether the nonsporadic cases of CL due to this species are present. In this context, this review is written to establish a retrospective study of cutaneous and visceral leishmaniasis in northern Morocco between 1997 and 2018 and also to conduct a molecular study to identify the circulating species responsible for the recent cases of leishmaniases in this region. -

Measure of Ground Deformations by SAR Interferometry in Tangier City (Northern Morocco)
International Journal of Engineering Research and Development e-ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, www.ijerd.com Volume 12, Issue 10 (October 2016), PP.40-48 Measure of ground deformations by SAR Interferometry in Tangier city (Northern Morocco) I. El medrai1, T. Mourabit2, A. Tahayt3 1Geology Department , Faculty Of Science And Technology, Abdelmalek Essaâdi University, Ziaten B.P. 416 Tangier, Morocco. 2Faculty Of Science And Technology, Mohammed I University, Ajdir B.P. 34 Al-Hoceima, Morocco. 3Department Of Earth Sciences, Scientific Institute, Mohammed V University Of Rabat. B.P. 703, Rabat, Marocco. Abstract: This study presents the deformations of earth's surface in Tangiers (Northern Morocco). The follow- up of these deformations was made by the Interferometric Synthetic Aperture Radar technique (InSAR). The application of InSAR in an urban environment allows to obtain a spatial distribution of the ground deformation within subcentimeter resolution. The InSAR time series analysis methods give an accurate estimation of the deformation rates. In this work we use ROI-PAC software to generate the interferograms from images acquired by Envisat between 2003 and 2010. In order to calculate the deformation rates (on the line of sight) by time series analysis we applied pi-rate software. The stacking map shows major uplift up to 20 mm/year in the coastal and southern zone of Tangier, and subsidence of the soil that can reach 15mm/year in some areas. To evaluate these results, we used the interferometric coherence as a measurement of the reliability of the interferometric phase. We calculated also the error map. All the deformation areas present a very high coherence and the associated error is almost negligible, also the atmospheric noise level is reduced during time series analysis. -

Rapport CHEFCHAOUEN & ASILAH
Rapport IVème REUNION INTERNATIONALE DU PROJET ‘’WADI’’ CHEFCHAOUEN & ASILAH 31 octobre - 4 novembre 2006 Soumia FAHD et Mohammed ATER Organisation Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences de Tétouan Laboratoire Diversité et Conservation des Systèmes Biologiques LDICOSYB & Université Mohamed V Agdal Institut Scientifique - Rabat Unité de Recherche OCEMAR Présentation des participants LES PARTENAIRES : UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI : Prof. Mohammed ATER Prof. Soumia FAHD Prof. Nard BENNAS Prof. Majida EL ALAMI Dr. Redouan AJBILOU Dr. Mohamed KADIRI Dr. Jamal STITOU Younès HMIMSA INSTITUT SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ MOHAMMED V : Dr. Oumnia HIMMI Prof. Abdellatif BAYED Dr. Abdellatif CHAOUTI Dr. Hocein BZAIRI IEI - INSTITUT INTERNATIONAL ENVIRONNEMENTAL, FONDATION INTERNATIONALE DES ETUDES UNIVERSITAIRTES. MALTE Prof. Louis Cassar Dr. Elisabeth Conrad UNIVERSITE D’ALICANTE, ESPAGNE Prof. Eduardo SEVA ROMAN UNIVERSITE EL MANAR, TUNISIE Prof. Faouzia CHARFI-CHEIKHROUHA Dr. Moufida AYADI Dr. Amina BOUATTOUR UNIVERSITE DE FLORENCE Prof. Felicita SCAPINI Prof. Lorenzo CHELAZZI Lucia FANINI Dr. Fatiha BOUSALAH (CONSULTANTE INTERNATIONALE, ALGÉRIE) IMAR – INSTITUTE OF MARINE RESEARCH, UNIVERSITY OF COIMBRA, PORTUGAL Dr. Joana PATRICIO CEDARE - CENTRE D’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS ARABES ET DE L’EUROPE. CAIRO, EGYPT Prof. Mohamed ABDRABO CONFERENCIERS INVITES AECI-APDN. AGENCE ESPAGNOLE DE COOPERATION INTERNATIONALE Mr. Roberto SOMLO Ing. Mohamed ELIAMANI DELEGATION DU TOURISME. TETOUAN, MAROC Mr. Abdelaziz KANNICHE DPA. DIRECTION PROVINCIALE D’AGRICULTURE. DIRECTION DU PARC NATIONAL DE TALASSEMTANE. CHEFCHAOUEN, MAROC Ing. Aissa MOKADEM DREF. DIRECTION REGIONALE DES EAUX & FORETS ET LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION. TETOUAN, MAROC Ing. Kamal MOUFADDAL INRA. INSTITUT NATIONALE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE. TANGER. MAROC Dr. Boughaleb FARAHAT LAROUSSI Dr. Mohamed ABDERABIHI INRA. INSTITUT NATIONALE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE. SETTAT. MAROC Dr. -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

M a Is O N C O M M U N a Le C a Ïd a T G E N D a Rm E Rie Ro Y a Le A
Nombre Existence Nombre d'équipements des équipements d'équipements et services administratifs socio-culturels sanitaires Commune rurale Caïdat Code Géographique Souk Souk hebdomadaire Pharmacie Foyer féminin Infirmier privé Bureau deBureau poste Maison de jeunes Dispensaire rural Maison communale Mécanicien dentiste Gendarmerie royale Agence de crédit agricole Centre de santé communal Centre de travaux agricoles 066. Aousserd Aghouinite 066.03.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aousserd 066.03.05 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bir Gandouz 066.05.03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tichla 066.03.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zoug 066.03.09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391. Oued Ed-Dahab Bir Anzarane 391.05.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El Argoub 391.09.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gleibat EL Foula 391.05.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imlili 391.09.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mijik 391.05.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oum Dreyga 391.05.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/160 La commune Nombre d'établissements est Réseaux d'enseignement et de accessible d'infrastructure formation par Commune rurale Train Lycée Collège Autocar de développement ? Grand taxi Autre moyen Réseau d'électricité Réseau d'eau potable Ecole primaire satellite Ecole primaire centrale professionnelle publique Ecole coranique ou Msid Réseau d'assainissement La commune dispose-t-elle d'un plan Ecole primaire autonome Etablissement de formation 066. -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

Pris En Application Du Dahir Portant Loi N° 1-74-338 Du 24 Joumada II 1394 (15 Juillet 1974) Relatif À L’Organisation Judiciaire (B.O
Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire (B.O. 17 juillet 1974) Décret n° 2-74-498 (25 joumada II 1394) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire Bulletin Officiel du 17 juillet 1974 Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume ; Après examen par le Conseil des ministres réuni le 11 joumada II 1394 (2 juillet et 1974). Article Premier : L’organisation judiciaire comporte un certain nombre de juridictions dont le siège et le ressort sont fixés conformément au tableau annexé (1). Cours d’appel et tribunaux de première instance Tableau annexé au décret 2-74-498 tel qu’abrog. et rempl. par le n° 2-96-467 20 nov. 1996- 8 rejeb 1417 : BO 2 janv. 1997, p 3 tel que mod. par le décret 2-99-832 du 28 septembre 1999-17 joumada II 1420 ; par le Décret n° 2-00-732 du 2 novembre 2000 – 5 chaabane 1421- B.O du 16 novembre 2000 et par le décret n° 2-02-6 du 17 juillet 2002-6 joumada I 1423 (B.O du 15 août 2002, décret n° 2-03-884 du 4 mai 2004 – 14 rabii I 1425 ; B.O.