Les Ignames Malgaches
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de janvier 2015 (2015-D01) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation éco-météorologique : page 1 Situation acridienne : page 3 Ministère de l’Agriculture Situation antiacridienne : page 8 Synthèse : page 10 Annexes : page 13 SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE Durant la 1ère décade de janvier 2015, un fort gradient pluviométrique Nord-Est/Sud-Ouest concernait Madagascar induisant une très forte pluviosité dans l’Aire d’invasion Nord, une pluviosité moyenne à forte dans l'Aire d’invasion Centre et une pluviosité souvent faible à moyenne dans l'Aire grégarigène. Les informations pluviométriques étaient contradictoires, selon les sources : x les estimations de FEWS-NET (figure 1) indiquaient que la pluviosité était supérieure à 125 mm au nord de la Grande-Île et qu’elle diminuait progressivement de 20 à 30 mm sur des bandes diagonales successives de 100 à 200 km de large à partir du nord et jusqu’au sud du pays ; x le peu de relevés transmis par le Centre National Antiacridien (annexe 1) indiquait que la pluviosité était très forte dans l’Aire grégarigène transitoire, moyenne à forte dans l’Aire de multiplication initiale ainsi que dans la majeure partie de l’Aire transitoire de multiplication et faible à moyenne dans l’Aire de densation, ce qui différait des estimations de FEWS-NET pour l’Aire grégarigène. Dans l’Aire grégarigène, compte tenu des relevés pluviométriques faits par le CNA, les conditions hydriques étaient fort erratiques : dans l’Aire grégarigène transitoire, elles étaient excédentaires par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache solitaire, dans l’Aire de multiplication initiale Centre, elles étaient favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito et dans les secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et de l’Aire de densation, les pluies restaient peu abondantes. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

MAHAJANGA BV Reçus: 246 Sur 246
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 4 MAHAJANGA BV reçus: 246 sur 246 INDEPE TIM MANAR AREMA MAPAR HVM NDANT ANARA : FANILO N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E ASSOCI REGION 41 BETSIBOKA BV reçus 39 sur 39 DISTRICT: 4101 KANDREHO BV reçus7 sur 7 01 AMBALIHA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 1 0 5 02 ANDASIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 03 ANTANIMBARIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 04 BEHAZOMATY 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 05 BETAIMBOAY 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 06 KANDREHO 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 07 MAHATSINJO SUD 0 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 5 TOTAL DISTRICT 0 0 42 40 0 40 0 11 0 1 1 27 DISTRICT: 4102 MAEVATANANA BV reçus19 sur 19 01 AMBALAJIA 0 0 6 5 0 5 0 2 0 0 2 1 02 AMBALANJANAKOMBY 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 03 ANDRIBA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 04 ANTANIMBARY 0 0 8 8 0 8 0 1 0 0 0 7 05 ANTSIAFABOSITRA 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 0 5 06 BEANANA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 07 BEMOKOTRA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 1 2 08 BERATSIMANINA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 6 09 BERIVOTRA 5/5 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 10 MADIROMIRAFY 0 0 6 6 0 6 0 1 0 0 1 4 11 MAEVATANANA I 0 0 10 9 0 9 0 3 0 0 2 4 12 MAEVATANANA II 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 0 6 13 MAHATSINJO 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 8 14 MAHAZOMA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 15 MANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 0 0 1 5 16 MARIA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 1 3 17 MAROKORO 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 18 MORAFENO 0 0 6 3 0 3 0 3 0 0 0 0 19 TSARARANO 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 2 3 TOTAL DISTRICT 0 0 134 125 0 125 0 33 0 0 15 77 DISTRICT: 4103 TSARATANANA BV reçus13 sur 13 01 AMBAKIRENY 0 0 8 8 0 8 0 4 0 0 0 4 02 AMPANDRANA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 03 ANDRIAMENA 0 0 8 7 0 7 0 4 0 0 0 3 04 -
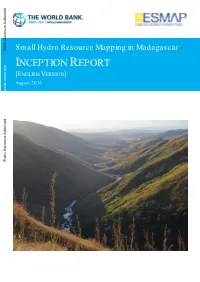
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin n° 25 Mars 2016 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Ministère de l’agriculture Situation acridienne : page 6 Situation antiacridienne : page 13 Synthèse : page 17 Annexes : page 19 SITUATION GÉNÉRALE Selon Fews-net, le mois de mars 2016 semble avoir été marqué par une forte pluviosité (supérieure à 150 mm) au nord du 18ème parallèle et une pluviosité moyenne, variant de 50 à 150 mm, au sud. Les relevés du Centre national antiacridien (CNA) indiquaient que la pluviosité était supérieure aux besoins du Criquet migrateur malgache dans l’Aire grégarigène transitoire Est et Centre, l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation du compartiment Nord. Elle était favorable pour son développement dans l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation des compartiments Centre et Sud. Les températures minimales et maximales moyennes restaient toujours favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito dans toute la Grande-Île. Aire grégarigène. Les compartiments Nord et Centre étaient colonisés par des populations groupées du Criquet migrateur malgache. Le compartiment Nord, où des pullulations larvaires, assorties d’une transformation phasaire, ont été observées sur deux principaux foyers (partie orientale du bassin de Manja et région de Befandriana-Sud), était moyennement infesté. Un phénomène similaire était en place dans le compartiment Centre mais, globalement, l’ampleur et l'étendue étaient moindres. Ce mois a été caractérisé par la fin du développement de la R2 du Criquet migrateur malgache et le début de celui de la R3. -

Résultats Détaillés Toliary
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de juin 2014 (2014-D16) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Conditions éco-météorologiques : page 1 Situation acridienne : page 2 Situation antiacridienne : page 6 Annexes : page 10 CONDITIONS CONDITIONS ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUES ECO-METEOROLOGIQUES DURANT DURANT LA LA PREMIÈRE DEUXIEME DÉCADE DECADE DEDE JUIN JANVIER 2014 2014 Durant la 1ère décade, la pluviosité était nulle à très faible et donc hyper-déficitaire par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache dans toute la Grande-Île (figure 1). Les relevés (CNA) effectués dans l’Aire grégarigène montraient cependant que la plage optimale pluviométrique (annexe 1) était atteinte dans certaines localités des compartiments Centre et Sud de l’Aire de densation (11,5 mm à Efoetse, 38,0 mm à Beloha et 28,0 mm à Lavanono). Dans les zones à faible pluviosité, à l’exception de l’Aire d’invasion Est, les réserves hydriques des sols devenaient de plus en plus difficilement utilisables, le point de flétrissement permanent pouvant être atteint dans les biotopes les plus arides. Les strates herbeuses dans les différentes régions naturelles se desséchaient rapidement. En général, la hauteur des strates herbeuses variait de 10 à 80 cm selon les régions naturelles, les biotopes et les espèces graminéennes. Le taux de verdissement variait de 20 à 40 % dans l’Aire grégarigène et de 30 à 50 % dans l’Aire d’invasion. Les biotopes favorables au développement des acridiens se limitaient progressivement aux bas-fonds. Dans l’Aire grégarigène, le vent était de secteur Est tandis que, dans l’Aire d’invasion, les vents dominants soufflaient du Sud-Est vers le Nord- Ouest. -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance
1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -

REQUÊTES FONDEES 126/13-L 30.12.13 Soatra Catherine
REQUÊTES FONDEES N°dossier Nom & qualité du requérant O b j e t District DECISION Date réception 126/13-L Soatra Catherine, candidate, district Annulation résultats BV Ambanja -jonction 30.12.13 d’Ambanja. Marotolana (des électeurs sans 126,127,128,129,130,600, carte d’identité ont voté, 601,602-fondée : annulation partialité des membres du BV). totale opérations électorales district Ambanja. 128/13-L Soatra Catherine, candidate, district Annulation résultats BV Begavo Ambanja -jonction 30.12.13 d’Ambanja. II (des électeurs sans carte 126,127,128,129,130,600, d’identité ont voté, partialité 601,602-fondée : annulation des membres du BV). totale opérations électorales district Ambanja. 129/13-L Soatra Catherine, candidate, district Annulation résultats BV Ambanja -jonction 30.12.13 d’Ambanja. Antsahampano (des électeurs 126,127,128,129,130,600, sans carte d’identité ont voté, 601,602-fondée : annulation partialité des membres du BV). totale opérations électorales district Ambanja. 130/13-L Soatra Catherine, candidate, district Annulation résultats BV Djangoa Ambanja -jonction 30.12.13 d’Ambanja. (des électeurs sans carte 126,127,128,129,130,600, d’identité ont voté, partialité 601,602-fondée : annulation des membres du BV). totale opérations électorales district Ambanja. 600/13-L Houssen, délégué de candidat, Disqualification du candidat Ambanja -jonction Ambanja. Solaimana Mahamodo et 126,127,128,129,130,600, annulation résultats BV EPP 601,602-fondée : annulation Ambohimena. totale opérations électorales district Ambanja. 1 127/13-L Soatra Catherine, candidate, district Annulation résultats BV Ambanja -jonction 30.12.13 d’Ambanja. Ambohimena (des électeurs 126,127,128,129,130,600, sans carte d’identité ont voté, 601,602-fondée : annulation partialité des membres du BV). -

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana-Fahafahana
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ----------o°o---------- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ----------o°o---------- UNIVERSITE DE MAHAJANGA -----------o°o---------- FACULTE DES SCIENCES LE SAVOIR FAIRE AU SERVICE DE L’ECONOMIE Unité de Formation Professionnalisante (UFP) Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention de Diplôme de Licence es-Sciences. Option : AQUACULTURE Année : 2009 N° :049/AQ/UM/SN/UFP/09 RESULTATS DES COLLECTES DES CRABES Scylla serrata EN FONCTION DES PHASES LUNAIRES au sein de la société PECHEXPORT S.A Présenté et soutenu publiquement le 14/08/2009 par Monsieur RAKOTONANDRASANA Fredson PROMOTION : RAITRA Tel : +261320445701 E-mail : [email protected] REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------------- MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ---------------------- UNIVERSITE DE MAHAJANGA ----------------------- FACULTE DES SCIENCES LE SAVOIR FAIRE AU SERVICE DE L’ECONOMIE Unité de Formation Professionnalisante (UFP) Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention de Diplôme de Licence es-Sciences. Option : AQUACULTURE Année : 2009 N° : 049/AQ/UM/SN/UFP/09 RESULTATS DES COLLECTES DES CRABES Scylla serrata EN FONCTION DES PHASES LUNAIRES au sein de la société PECHEXPORT S.A Présenté et soutenu publiquement le 14/08/2009 par Monsieur RAKOTONANDRASANA Fredson Membres du jury Président : Professeur RAFOMANANA Georges Juge : Monsieur RAMANANTONIAINA Jonah Rapporteur : Monsieur ANDRIAMIHAJA Herimalala DEDICACE A toute ma famille, Qui a été toujours là pour moi et de m’encourager jusqu’au bout de mes études. i REMERCIEMENTREMERCIEMENTSSSS C’est un grand honneur pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire de fin d’études, année 2009. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

District Commune Nombre Candidats
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RAKOTONANDRASANA Jean Victor INDEPENDANT LEMARIJY MATOKAN_DIA AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 RAKOTOZAFY Ravalomande Wilibald André (INDEPENDANT LEMARIJY MATOKAN_DIA) INDEPENDANT RAKOTOVAO RAPHAEL AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 RAKOTOVAO Raphael (INDEPENDANT RAKOTOVAO RAPHAEL) AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 MMM (Malagasy Miara-miainga) RAKOTONDRASOA Tahina Tsiresy INDEPENDANT (Independant Rakotoarimahafaka AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 RAKOTOARIMAHAFAKA Jean Louis Jean Louis) INDEPENDANT AMBONDROMAMY MIRAY AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 RAKOTOARISON Samuel (Independant Ambondromamy Miray) AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) ANDONIAINAMALALA Sylvie Raphaelie AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANDRIAMBOLOLONA Njakaharivelonirina Hervé AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 INDEPENDANT WILLIAM (Independant William) RAMAROSON William AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RAZAFIMAHAFALY Solofotiana Emma INDEPENDANT ADIDIKO NO MANASOA NY AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 TANANAN_TSIKA (INDEPENDANT ADIDIKO NO RAMANANJANAHARY Auguste MANASOA NY TANANAN_TSIKA) INDEPENDANT ANDRIAMAHOLY JOCELYN GOD AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 FRED DIT MAHOSY (Independant Andriamaholy ANDRIAMAHOLY Hasinimalala Jocelyn God Fred Jocelyn God Fred Dit Mahosy) AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RATAHIANJANAHARY Jean Claudin INDEPENDANT