Télécharger Le Document
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deliberation Du Comite Syndical
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL C’est le Mercredi 11 Décembre 2019 à 19h00 Salle de Conférence de la STAD, 240 Boulevard Pasteur à Guesnain que se sont réunis les délégués désignés par la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent et la communauté d’agglomération Douaisis Agglo adhérentes au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis. Il est rappelé qu’une convocation a été régulièrement adressée à chacun des membres désignés par les conseils communautaires. Nombre total de délégués : 46 Présents : (titulaires et suppléants) 36 Absents : 5 Procuration : 5 Etaient présents (délégués titulaires) : 32 Pour la CCCO : Christian VITU - Pascal JONIAUX - Marc HEMEZ - Frédéric DELANNOY - Alain PAKOSZ - Alain BRUNEEL - Pascal PRUVOST - Rémy VANANDREWELT - Dany HALLANT - Jean- Michel SIECZAREK. Pour DOUAISIS AGGLO : Joël THOREZ - Henri DERASSE - Damien FRENOY - Marylise FENAIN - Claude HEGO - Michel LEBLOND - Jean Claude DHALLUIN - Nadia BONY - Frédéric CHEREAU - Henri COQUELLE - Robert STRZELECKI - Denis LAMY - Maryline LUCAS - Romuald SAENEN - Arnaud PIESSET - Caroline BIENCOURT - Colette CAPA - Jacques LECLERCQ - Christophe DUMONT - Véronique LEGRAND - Claudine PARNETZKI - Dominique RICHARD. Etaient présents (délégués suppléants) : 4 Pour la CCCO : Christian TOSOLINI suppléant de Marc DELECLUSE - Bernard CIERZNIAK suppléant de Edith BESTIAN - Fabien BOURIEZ suppléant de Eric MOREAU. Pour DOUAISIS AGGLO : Claudine HOUDET suppléante de Jean Michel SZATNY. Etaient présents par procuration : 5 Pour la CCCO : Julien QUENESSON donne pouvoir à Romuald SAENEN. Pour DOUAISIS AGGLO : Thierry FAIDHERBE donne pouvoir à Robert STRZELECKI - Christian POIRET donne pouvoir à Claude HEGO - Jean Luc DEVRESSE donne pouvoir à Nadia BONY - Jacques ELIAS donne pouvoir à Maryline LUCAS. Etaient absents et excusés : 5 Pour la CCCO : Jocelyne MALFIGAN. Pour DOUAISIS AGGLO : Didier TASSEL - Francis FUSTIN - Alain KLEE - Didier CARREZ. -

Le Raquet Un Écoquartier Où Il Fait Bon Vivre
DOUAISIS NOV. - DÉC. 2019 - N°61 AGGLO LE RAQUET UN ÉCOQUARTIER OÙ IL FAIT BON VIVRE Versements aux communes : zoom sur 35 projets Collecte des déchets : ce qui va changer Ecoquartier du Raquet - 2 octobre 2019 - 2 octobre du Raquet Ecoquartier Des paniers bio accessibles à tous 1 1 DOUAISIS AGGLO - NOV. / DÉC. 2019 - N°61 Arrêt sur image 07>16 SEPT. FOIRE-EXPO Plus de 70 000 visiteurs ont parcouru les allées de Gayant-Expo pendant les 10 jours de la Foire-Expo Régionale de Douai ! Vous avez été nombreux à vous arrêter sur le stand de DOUAISIS AGGLO et à vous informer sur les compétences de l’Agglo, grâce à des animations et à des vidéos. Vous avez raté cet événement ? Pas de panique, rendez-vous sur les comptes Facebook, Instagram ou YouTube de DOUAISIS AGGLO pour visionner nos vidéos ! 01 OCT. AIDES AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES 13 porteurs de projet viennent de bénéficier d’un coup de pouce de DOUAISIS AGGLO lors du lancement de leur activité. Parmi eux, Michel Leporc vient d’installer sa brasserie bio à Râches. Depuis 2008, environ 700 000 € ont été versés à plus de 210 Très Petites Entreprises et 320 emplois ont ainsi été créés. 06 OCT. MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX La 9e édition de ce rendez-vous annuel, organisé par DOUAISIS AGGLO, s’est tenue à Lallaing. Plus de 1 100 visiteurs ont pu découvrir des produits de saison, du miel, des gaufres, de l’ail fumé d’Arleux, des produits laitiers... Cet événement, c’est du concret pour vous accompagner vers une alimentation saine, local et durable. -

FICHE SIGNALETIQUE CA Du Douaisis
FICHE SIGNALETIQUE CA du Douaisis Consultable sur www.sigale.nordpasdecalais.fr L’EPCI a été créé le 31 décembre 2001 et comporte 35 communes au 1er janvier 2010. L’EPCI appartient au Scot du Douaisis qui comprend également la CC Cœur d’Ostrevent, la CC du Cœur de Pévèle et la CC Espace en Pévèle. 1. Profil Territoire emplois sont présents. Conséquence de cette Un territoire urbain et dense. offre d'emplois plus importante que les Avec 647 habitants par km², la densité de la CA personnes travaillant et habitant le territoire, du Douaisis est deux fois plus importante que de nombreux emplois sont occupés par des la densité régionale. Du fait de cette forte personnes habitant en dehors de l'EPCI, densité, l'espace artificialisé est plus notamment dans le reste de la zone d'emploi. important qu'en moyenne régionale (29,2% La CA du Douaisis a une position de pôle contre 15,9%). En rapportant l'espace d'emplois mais également de pôle de services artificialisé au nombre d'habitants, supérieurs : pour les commerces et les l'artificialisation apparaît proportionnellement services au particulier, la densité moins importante qu'en moyenne régionale d’équipements supérieurs est plus élevée avec 451 m² artificialisé par habitant contre qu'en région (16 équipements pour 10 000 490 m² en région. habitants contre 14). L'EPCI s'inscrit dans une Graphique : Occupation du sol en 2005 agglomération plus large. Milieux humides 3,5 Parmi les 35 communes qui forment l'EPCI, 17 et surface en eau 1,2 appartiennent au pôle urbain de Douai – Lens Forêts et milieux 7,4 et 18 sont des communes périurbaines. -

Communes Par Taille
Liste des communes éligibles au volet "voirie communale" de l'ADVB Pop municipale Arrondisseme Nom commune au 1er janvier EPCI nt 2019 ABANCOURT Cambrai 461 CAC - CA de Cambrai AIX-LEZ-ORCHIES Douai 1 185 CCPC - CC Pévèle- Carembault AMFROIPRET Avesnes 228 CCPM - CC du Pays de Mormal ANHIERS Douai 904 DA - Douaisis Agglo ANNEUX Cambrai 279 CAC - CA de Cambrai ARTRES Valenciennes 1 053 CAVM - CA Valenciennes Métropole AUBENCHEUL-AU-BAC Cambrai 530 CAC - CA de Cambrai AUBIGNY-AU-BAC Douai 1 184 DA - Douaisis Agglo AUBRY-DU-HAINAUT Valenciennes 1 651 CAVM - CA Valenciennes Métropole AUCHY-LEZ-ORCHIES Douai 1 532 CCPC - CC Pévèle- Carembault AUDIGNIES Avesnes 357 CCPM - CC du Pays de Mormal AVESNES-LE-SEC Valenciennes 1 470 CAPH - CA de la Porte du Hainaut AWOINGT Cambrai 844 CAC - CA de Cambrai BACHY Lille 1 690 CCPC - CC Pévèle- Carembault BAIVES Avesnes 165 CCSA - CC du Sud Avesnois BANTEUX Cambrai 341 CAC - CA de Cambrai BANTIGNY Cambrai 507 CAC - CA de Cambrai BANTOUZELLE Cambrai 420 CAC - CA de Cambrai BAS-LIEU Avesnes 353 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BAZUEL Cambrai 533 CA2C - CA du Caudrésis et du Catésis BEAUDIGNIES Avesnes 563 CCPM - CC du Pays de Mormal BEAUMONT-EN-CAMBRESIS Cambrai 448 CA2C - CA du Caudrésis et du Catésis BEAURAIN Cambrai 231 CCPS - CC du Pays Solesmois BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE Avesnes 257 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BEAURIEUX Avesnes 165 CCCA - CC Coeur de l'Avesnois BELLAING Valenciennes 1 225 CAPH - CA de la Porte du Hainaut BELLIGNIES Avesnes 833 CCPM - CC du Pays de Mormal BERELLES Avesnes 149 CCCA - CC Coeur -

Rapport De Visite De L'hôtel De Police De Douai
Hôtel de police de Douai (Nord) Le 30 août 2011 RAPPORT DE VISITE: Hôtel de police de Douai (59) (59) Douai police de de Hôtel DEVISITE: RAPPORT Contrôleurs : - Jacques Gombert , chef de mission ; - Betty Brahmy, - Michel Jouannot. 2 1 CONDITIONS DE LA VISITE En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue de l’hôtel de police de Douai (Nord). Les contrôleurs sont arrivés à l’hôtel de police, situé 150 rue Saint-Sulpice à Douai, le mardi 30 août 2011 à 9h20. Ils en sont repartis le jour même à 17h45. Ils ont été accueillis par le commissaire de police, commissaire central, chef de la circonscription de sécurité publique de Douai agglomération. Une présentation du service a été faite par le commissaire central et par le commandant à l’échelon fonctionnel, adjoint au chef de service de sécurité de proximité. La visite et les entretiens se sont déroulés dans un climat de confiance, avec une réelle volonté de transparence. La qualité de l’accueil doit être soulignée. Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire central. Les contrôleurs ont visité l’ensemble des locaux de privation de liberté de l’hôtel de police : • neuf cellules de garde à vue, dont l’une est plus spécifiquement réservée aux mineurs ; • trois cellules de dégrisement ; • un local servant à la fois aux consultations des médecins et aux entretiens avec les avocats ; • un local de signalisation situé dans la zone des geôles; • les bureaux servant de locaux d’audition. -

Living with the Enemy in First World War France
i The experience of occupation in the Nord, 1914– 18 ii Cultural History of Modern War Series editors Ana Carden- Coyne, Peter Gatrell, Max Jones, Penny Summerfield and Bertrand Taithe Already published Carol Acton and Jane Potter Working in a World of Hurt: Trauma and Resilience in the Narratives of Medical Personnel in Warzones Julie Anderson War, Disability and Rehabilitation in Britain: Soul of a Nation Lindsey Dodd French Children under the Allied Bombs, 1940– 45: An Oral History Rachel Duffett The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the First World War Peter Gatrell and Lyubov Zhvanko (eds) Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War Christine E. Hallett Containing Trauma: Nursing Work in the First World War Jo Laycock Imagining Armenia: Orientalism, Ambiguity and Intervention Chris Millington From Victory to Vichy: Veterans in Inter- War France Juliette Pattinson Behind Enemy Lines: Gender, Passing and the Special Operations Executive in the Second World War Chris Pearson Mobilizing Nature: the Environmental History of War and Militarization in Modern France Jeffrey S. Reznick Healing the Nation: Soldiers and the Culture of Caregiving in Britain during the Great War Jeffrey S. Reznick John Galsworthy and Disabled Soldiers of the Great War: With an Illustrated Selection of His Writings Michael Roper The Secret Battle: Emotional Survival in the Great War Penny Summerfield and Corinna Peniston- Bird Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in the Second World War Trudi Tate and Kate Kennedy (eds) -

The Human Comedy. Philosophical Studies II
The Human Comedy Philosophical Studies II By Honore de Balzac THE ALKAHEST (THE HOUSE OF CLAES) CHAPTER I There is a house at Douai in the rue de Paris, whose aspect, interior arrangements, and details have preserved, to a greater degree than those of other domiciles, the characteristics of the old Flemish buildings, so naively adapted to the patriarchal manners and customs of that excellent land. Before describing this house it may be well, in the interest of other writers, to explain the necessity for such didactic preliminaries,—since they have roused a protest from certain ignorant and voracious readers who want emotions without undergoing the generating process, the flower without the seed, the child without gestation. Is Art supposed to have higher powers than Nature? The events of human existence, whether public or private, are so closely allied to architecture that the majority of observers can reconstruct nations and individuals, in their habits and ways of life, from the remains of public monuments or the relics of a home. Archaeology is to social nature what comparative anatomy is to organized nature. A mosaic tells the tale of a society, as the skeleton of an ichthyosaurus opens up a creative epoch. All things are linked together, and all are therefore deducible. Causes suggest effects, effects lead back to causes. Science resuscitates even the warts of the past ages. Hence the keen interest inspired by an architectural description, provided the imagination of the writer does not distort essential facts. The mind is enabled by rigid deduction to link it with the past; and to man, the past is singularly like the future; tell him what has been, and you seldom fail to show him what will be. -

IME Les ROUISSOIRS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE Institut Médico-Educatif SITUATION GÉOGRAPHIQUE IME Les ROUISSOIRS I.M.E DE SOMAIN Rue Roger Salengro 04 59490 Somain - USA - S Site internet : - 03 Version01 www.apeidouai.asso.fr 20 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION NOUS CONTACTER VALEURS DE L’APEI DU DOUAISIS I.M.E DE SOMAIN LES DROITS ET LES COMPENSATIONS : L’accès à tout pour tous. Rue Roger Salengro LA SOLIDARITE : Entreprendre ensemble. 59490 Somain L’UNICITE de la personne handicapée : Chaque personne Tel : 03.27.86.63.92 est unique et son projet est individualisé LA CITOYENNETE : Etre soi dans la société LA VIE ASSOCIATIVE : Faire vivre le mouvement parental Mail : secré[email protected] OBJET DE L’APEI DU DOUAISIS : Directrice : Madame DELPORTE Apporter aux personnes présentant un handicap intellectuel et à leurs fa- Chef de service : Madame DOLCI milles, l’appui moral et matériel dont elles ont besoin, Éducateur référent : Favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux parents, Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au meilleur développement moral, physique et intellectuel des personnes présentant un handicap intel- lectuel, Concourir à l’insertion sociale et professionnelle des personnes présentant un handicap intellectuel, Promouvoir la citoyenneté. PROJET DE L’APEI DU DOUAISIS L’association s’engage à apporter : Aux parents, Aux personnes en situation de handicap intellectuel présentant ou non des troubles associés, Aux personnes en situation de polyhandicap, Aux personnes présentant des Troubles Envahissants du Développement dont l’autisme, Les services dont ils ont besoin, le soutien, le conseil et l’accompagnement dans leur projet de vie. 2 19 COORDONNÉES DE LA MDPH Adresse mail : [email protected] HISTORIQUE DE L’APEI DU DOUAISIS MDPH 59 : Le 27 octobre 1962, une dizaine de parents se rassemblent et créent une asso- 21 rue de la Toison d’Or ciation sous la présidence de Monsieur Gabriel COUPLET, ingénieur des Mines BP 20372 et papa d’un enfant trisomique. -

IER Pour Une Résidence-Mission Dans 3 Quartiers De La Communauté D
La Communauté d'Agglomération du Douaisis (CAD) La Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France (DRAC) Le Commissariat Général à l'Égalité Des Territoires (CGET) La Préfecture du Nord En partenariat avec Le Rectorat de l'Académie de Lille La Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale du Nord La ville d’Auby La ville de Douai La ville de Flers-en-Escrebieux Et en lien avec Le Conseil Régional des Hauts de France Le Conseil Départemental du Nord Dans le cadre du programme de résidences-mission d'artistes à des fins d'action culturelle intitulé QU(ART)IER Lance un appel à candidatures en direction d’un duo d’artistes de tout domaine d’expression artistique dont la production interroge la notion de « pépites d’ici et d’ailleurs », Pour une résidence-mission dans 3 quartiers de la Communauté d’Agglomération du Douaisis I. CONTEXTE ET CADRE DE LA RÉSIDENCE MISSION La résidence mission est organisée en faveur des habitants de la Communauté d’Agglomération du Douaisis (35 communes pour près de 158 000 habitants), située dans le Nord, et plus particulièrement à destination des quartiers politique de la ville des communes de Auby, Flers-en-Escrebieux et Douai : - Quartier Pont de la Deûle à Flers-en-Escrebieux - Quartier des Asturies et Auby Centre - Quartier de Dorignies à Douai Afin de faire plus ample connaissance avec l’agglomération d'accueil de la résidence-mission, vous pouvez consulter le site web et la page Facebook de Communauté d’agglomération du Douaisis : http://www.douaisis-agglo.com/ https://www.facebook.com/cad.agglo/ Il est à noter que le programme de résidences-mission QU(ART)IER s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France (DRAC), la Préfecture du Nord, la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) et les communes associées au projet (Auby, Douai, Flers-en-Escrebieux). -

The Experience of Occupation in the Nord, 1914–18
67 v 2 v General misconduct and popular reprisals Three main forms of misconduct involving both men and women can be identified: denunciations, working for the Germans and espi- onage. As with sexual misconduct, there was a strong belief among locals that compatriots engaged in such activities, but the line between perceptions and reality is and was often blurred. Nevertheless, as will be demonstrated, the strength of belief in misconduct and disdain for perceived traitors was so great that the latter were the victims of popular reprisals and revenge during and after the war. Such extreme expressions of the occupied culture, whereby those who breached its norms deserved punishment, suggesting that it was adhered to by more than just the middle classes. Denunciations On 10 June 1915, M. Blin described the ‘sensational’ events taking place at Roubaix’s hôtel de ville. The Germans had installed a ‘locked window display’ accompanied by the following sign: ‘Documents available to the public. Anonymous letters in which the French slander [Blin’s wording] their compatriots.’ Blin was disgusted but perversely hopeful on seeing this, noting, ‘This shameful wound, displayed in broad daylight, this public ridicule of the cowardly accusations expressed in a revolting crudeness, may stop, henceforth, the pens of the villainous individuals who have the shamelessness to employ this procedure unworthy of real French people.’1 The following day, many people came to read the anonymous letters,2 and on 12 June Blin himself took a closer look, remarking: Many curious people stop in front of the display. I note in particular two new letters: the 1st is signed: ‘A soul devoted to your soldiers’ (Is it actually v 67 v James E. -

Rapport D'activite Associatif 2011
Rapport d’activité 2013 EDITO L’année 2013 a été une année particulièrement dense et stratégique pour notre association. Alors que les besoins sociaux n’ont jamais été aussi prégnants, la crise économique et sociale du pays impactant lourdement la situation personnelle et professionnelle d’un nombre croissant de nos concitoyens, ce dans un contexte de contraction des moyens publics, la Sauvegarde du Nord amplifie son action avec : - L’intégration de l’AREAS en janvier 2013. 50 professionnels accompagnant les Gens du Voyage et les Roms migrants ont ainsi rejoint nos équipes et ont été particulièrement impliqués cette dernière année suite à la mise en œuvre de la circulaire du XX août 2012. Lourde tâche ainsi dévolue à nos professionnels, sur un sujet très clivant dans les territoires où les digues peuvent rompre à chaque instant ; - La création du GCMS POLYCAP, inauguré le 5 février 2013 en présence du Directeur Général de l’ARS et du Vice-Président du Conseil Général en charge du Handicap. Ce groupement de coopération fondé avec l’ANAJI et le CCAS de Roubaix vise à renforcer les échanges professionnels, développer les bonnes pratiques et surtout permettre à terme une plus grande synergie des prises en charge de plus de 150 enfants et jeunes souffrant de poly ou pluri handicap accompagnés par POLYCAP. Ce champ d’intervention est clairement appelé à se renforcer ces prochaines années ; - La signature le 28 janvier 2013 d’une convention de coopération renforcée avec l’ADSSEAD en vue d’un rapprochement de nos deux associations : 700 professionnels se trouvent ainsi mobilisés dans une réflexion proposant un renouvellement de l’offre en matière de protection de l’enfance sur l’ensemble du département. -
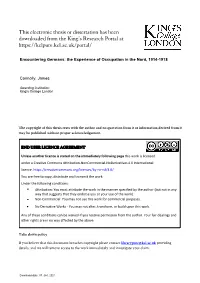
The Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Connolly, James Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Encountering Germans: the Experience of Occupation in the Nord, 1914-1918 Title: Author: James Connolly The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement.