L'heure Du Choix
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INFLUENCERS on BREXIT Who Is Most Influential on Brexit?
INFLUENCERS ON BREXIT Who is most influential on Brexit? 1= 1= 3 4 5 Theresa MAY Angela MERKEL Nicola STURGEON Michel BARNIER Donald TUSK Chief Negotiator for the Prime Minister Federal Chancellor First Minister Commission Taskforce on Brexit President Negotiations UK Government German Government Scottish Government European Commission European Council 6 7 8 9 10 François HOLLANDE Philip HAMMOND David DAVIS Jean-Claude JUNCKER Guy VERHOFSTADT Secretary of State for Exiting the President Chancellor of the Exchequer President MEP & Lead rapporteur on Brexit European Union French Government UK Government UK Government European Commission European Parliament 11 12 13 14 15 Didier SEEUWS Enda KENNY Hilary BENN Mark RUTTE Martin SELMAYR Head of the General Secretariat of Chair, Committee on Exiting the Head of Cabinet of the President the Council Special Taskforce on Taoiseach European Union & Member of Prime Minister of the European Commission the UK Parliament, Labour Council of the EU Irish Government UK Parliament Dutch Government European Commission 16 17 18 19 20 Keir STARMER Donald TRUMP Wolfgang SCHÄUBLE Liam FOX Frans TIMMERMANS Secretary of State for Shadow Brexit Secretary US President-Elect Finance Minister First Vice-President Member of Parliament, Labour International Trade UK Parliament US Goverment German Government UK Government European Commission 21 22 23 24 25 Boris JOHNSON Nigel FARAGE Nick TIMOTHY Uwe CORSEPIUS Paul DACRE Joint Number 10 Special Adviser on Europe to Foreign Secretary MEP, Interim Leader of UKIP Chief-of-Staff, -

Biography of Didier Seeuws
DIDIER SEEUWS' BIOGRAPHY Didier Seeuws (55) was until February 2021 the Head of the Task Force on the UK of the General Secretariat of the Council of the European union. He was nominated by the Secretary General immediately after the UK Brexit referendum in June 2016. In this capacity, he provided advice to the Secretary General and to the President of the European Council in all matters related to EU-UK relations and was in charge of coordinating the EU Member States' positions and developing the negotiating mandates of the Council and the guidelines of the European Council for negotiations with the United Kingdom. During the Art. 50 negotiations, he chaired the ad hoc Working Party on Article 50 and, between 1 February 2020 and 31 December 2020, the Working Party on the United Kingdom. Between December 2014 and June 2016, he was the director for Transport, Telecom and Energy at the General Secretariat of the Council of the EU. In this position, he advised the EU rotating presidency mainly on legislative files related to transport, telecom and energy and provided policy advice to the President of the European Council on these matters, in particular with respect to energy files. Before becoming a EU civil servant, Didier Seeuws was a Belgian career diplomat, posted in Washington and with the EU Institutions. He did a number of ministerial cabinets and was Spokesperson of the Belgian Foreign Affairs Ministry and the Belgian Prime Minister. In his postings with the EU, he was the Belgian Deputy Permanent Representative, dealing with a wide number of files related to the EU Single Market, and was the chair of COREPER I during the Belgian Council Presidency in July-December 2010. -

Brexit Round Up
This report will collate all key activity from the last week in Westminster, Whitehall, the European Commission, European Parliament and leading stakeholders as it relates to the energy sector and Brexit. TABLE OF CONTENT EU: Brexit task force takes shape EU: Junker makes State of the Union speech EU: EP President says “no negotiation without notification” UK: Chairman of Global Warming Policy Foundation gives evidence to peers UK: Written answer on impact of Brexit on renewables sector UK: Opportunities for UK energy market raised in House of Commons UK: Chancellor holds round table with business UK: Scottish Government hold summit with energy sector UK: Government response to report on EU/UK environmental policy UK: MP blog on impact of Brexit on the environment UK: Speech: UK-India partnership is strong in the energy sector UK: International Trade secretary speech in Dubai EU: Brexit’s impact on EU budget EU: Leaders reflect on future of union EU: Central European countries threaten to veto Brexit deal Lookahead – September/October October Members Area by using: EU: Brexit task force takes shape On September 14, the European Commission confirmed its decision to set up a Task Force for the preparation and conduct of the Brexit negotiations under Article 50 of the Treaty of the European Union. Former French Commissioner Michel Barnier, appointed as the Commission’s Chief Negotiator on Brexit in July, will lead this Task Force which will be responsible for coordinating all strategic, operational, legal and financial issues related to the negotiations. In setting up the Task Force, the Commission also appointed Sabine Weyand, currently Deputy Director-General in the Commission's Trade Department (DG Trade), as Deputy Chief Negotiator. -

CER Bulletin Issue 129 | December 2019/January 2020
CER Bulletin Issue 129 | December 2019/January 2020 How should the EU ‘get Brexit done’? By Agata Gostyńska-Jakubowska How economically damaging will Brexit be? By John Springford Defence without direction By Sophia Besch How should the EU ‘get Brexit done’? by Agata Gostyńska-Jakubowska The EU and the UK might have only 11 months to conclude negotiations on their future partnership. The EU would find it easier to achieve its objectives if its negotiating structures were similar to those for the Article 50 talks. ‘Get Brexit done’ is the mantra of Boris Johnson’s The legal basis for the next phase of election campaign. If he secures a parliamentary negotiations will be Articles 207 and 218 of the majority in the December election, the UK will Treaty on the Functioning of the EU (TFEU), probably leave the EU by January 31st – the which set out the procedures for opening, Brexit deadline set by European leaders. But conducting and finalising negotiations with contrary to Johnson’s claims, leaving the EU third countries. As a first step, the European will not be the end of the Brexit story. The UK Commission will formally recommend that the will have to reach agreement with the EU on Council authorises the opening of talks with the their future relationship, or face another cliff- UK and signs off the EU negotiator’s mandate. edge when the transition period comes to an end on December 31st 2020. According to the The Commission president, Ursula von der withdrawal agreement, that is the deadline, Leyen, has decided to keep Michel Barnier as unless the EU and the UK agree by July 2020 to the EU’s chief negotiator for the second phase extend it (for up to one or two years). -

Wnsdecisionpoint.Com 1 BREXIT OVERALL COMMENTARY
Brexit Overall Commentary BREXIT OVERALL COMMENTARY Table of Contents Politics and Brexit: The Road Ahead for U.K. - EU 01 Negotiations How did the U.K. Vote? 02 Timeline of Main Steps Taken in the EU and U.K. Post-referendum, 03 2016 and Early 2017 Government after the Referendum 04 Article 50: What does it Mean? 04 Possible Content of a Withdrawal Agreement 05 The Great Repeal Bill: Why is it Important? 06 Possible Future Framework of the U.K. - EU Relationship 07 . Scenario I: Full EU Membership An Extremely Soft Brexit 08 . Scenario II: Full Internal Market Participation, European Economic Area 08 (EEA) and Norway Model Moderately Soft Brexit . Scenario III: Limited Movement of Services, Switzerland Model Basic 08 Soft Brexit . Scenario IV: Free Trade Agreement, Canada Model Basic Hard Brexit 08 . Scenario V: Membership of the Customs Union Moderately Hard 08 Brexit . Scenario VI: No Deal with EU An Extremely Hard Brexit 08 What does the June 2017 Election Mean For Brexit? 09 Brexit Timeline: Events from March 29, 2017 Till April 2019 11 BREXIT OVERALL COMMENTARY POLITICS AND BREXIT: THE ROAD AHEAD FOR U.K. - EU NEGOTIATIONS The referendum held on June 23, 51.9 percent to 48.1 percent. The 2016 to decide the U.K.'s referendum turnout was 71.8 membership of the European Union percent, with more than 30 million (EU) saw the Leave vote win by people voting.1 1. Article by BBC, Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU, June 2017. wnsdecisionpoint.com 1 BREXIT OVERALL COMMENTARY Wales voted for Brexit, with Leave Remain by 62 percent to 38 HOW DID THE U.K. -

On the Road to Brexit
On the Road to Brexit Phinnemore, D. (2016). On the Road to Brexit. Political Insight, 7(3), 8-11. https://doi.org/10.1177/2041905816680412 Published in: Political Insight Document Version: Peer reviewed version Queen's University Belfast - Research Portal: Link to publication record in Queen's University Belfast Research Portal Publisher rights © 2016 The Authors. This work is made available online in accordance with the publisher’s policies. General rights Copyright for the publications made accessible via the Queen's University Belfast Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The Research Portal is Queen's institutional repository that provides access to Queen's research output. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact [email protected]. Download date:24. Sep. 2021 On the road to Brexit David Phinnemore, Professor of European Politics, Queen’s University Belfast The United Kingdom (UK) has never been at ease with either its membership of the European Union (EU) or the broader idea of European integration. The EU referendum on 23 June 2016 was supposed to settle the issue. It is unclear when and how it will. For the then Prime Minister, David Cameron, the plan was for the referendum to bring closure on the question of whether the UK should remain in or leave the EU. -

Brexit: the Timeline
Global - Europe Practice Alert July 2016 Brexit: The Timeline This note addresses the timeline for the UK's exit from the EU. It is one of a series of GTM Alerts designed to assist businesses in identifying the legal issues to consider and address in response to the UK's referendum vote of 23 June 2016 to withdraw from the European Union. The UK has not left the EU. It will remain a member of the EU, and EU law will continue to apply in its territory, until it formally exits. Exit is likely to take some time. Nearly two weeks after the UK referendum vote, a number of practical, political, and legal issues are emerging that may affect the start and timing of the procedure leading up to exit. This exit procedure is set out in Article 50 of one of the two main EU Treaties, the Treaty on European Union. It involves three main steps before exit – notification, negotiation, and approval. These steps are illustrated in a notional timeline at the end of this note and are described in more detail below, together with the issues that may affect the UK's exit date. 1. Notification: Under Article 50, the UK is required to notify the European Council of its decision to withdraw from the EU, but there is no deadline for the notification. • Referendum vote is not a decision: The outcome of the 23 June referendum does not constitute a decision to leave the EU, as it is not binding – its purpose is to advise government of the will of the British people. -

The UK Gave Formal Notice of Its Intention to Leave the EU on 29 March 2017, Setting 29 March 2019 As the Possible Date of Exit
A timeline of Brexit negotiations and associated actions March 2017 The UK gave formal notice of its intention to leave the EU on 29 March 2017, setting 29 March 2019 as the possible date of exit. Negotiations on the form of Brexit between the UK and EU will be framed and conducted according to Article 50 of the Treaty on European Union. The UK Government has assured the UK Parliament that it will This publication provides a visual overview of the key steps, be provided with “at least as much” information as the European people and institutions that will be involved in the UK’s process Parliament and will have a “take it or leave it” vote on the final of withdrawal from the EU. This process will involve different draft of the withdrawal agreement before it is concluded. contributors and stakeholders at a UK and EU level, but will also The European Parliament will closely follow the negotiations impact third countries. The process will include negotiations as and provide consent for the withdrawal agreement before it to some or all of: is concluded. > the UK’s withdrawal arrangement with the EU At the same time as negotiating the UK’s withdrawal, both the > the future EU-UK relationship EU and UK will also be thinking about their trading positions with > transitional arrangements third countries with whom the EU has existing agreements. > trade relationships of both the UK and the EU with third countries. The UK will also be considering trade arrangements with other third countries and will be facing the task of ensuring that the existing EU laws are adapted and adopted into UK law on exit day via the Great Repeal Bill. -

Brexit, Les Leçons De La Négociation Pour L'union Européenne
POLICY POLICY PAPERPAPER Question d'Europe n°494 Brexit, les leçons de la négociation 26 novembre 2018 pour l’Union européenne Eric MAURICE Le 25 novembre, les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont approuvé le projet d’accord sur la sortie du Royaume-Uni conclu le 14 novembre, ainsi que la déclaration politique qui définit les grandes lignes de la future relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. La formalisation de l’accord par les dirigeants européens Et surtout, à l’exception de la tension des derniers suit l’approbation donnée par le gouvernement jours autour de Gibraltar, les 27 ont mené jusqu’au britannique le 15 novembre et confirmée le 22 bout la négociation en maintenant leur unité, placée novembre. dès le 24 juin 2016 au rang de priorité absolue face au défi existentiel posé par le Brexit. Pour entrer en vigueur et garantir un Brexit ordonné, l’accord doit désormais être ratifié par le Parlement Quelle que soit l’issue du processus de ratification à européen – ce qui devrait être une formalité après un Londres, ou la manière dont se déroule effectivement débat entre groupes politiques -, et par le Parlement le Brexit au printemps 2019, la négociation sur britannique. l’accord de retrait constitue une phase particulière de l’histoire de l’Union qu’il convient d’examiner La faible majorité du gouvernement de Theresa May et d’évaluer, afin de déterminer si des leçons, et à la Chambre des Communes, ainsi que la complexité lesquelles, peuvent être tirées pour le développement des intérêts politiques vis-à-vis du Brexit – au sein du futur de l’Union. -

Delivering Empowered Welfare Societies
Delivering Empowered Welfare Societies With foreword by: Alfred GUSENBAUER Edited by: Ernst STETTER Karl DUFFEK Ania SKRZYPEK TAKING THE LEAD: SEIZING THE INDEX MOMENT, TAKING RESPONSIBILITY AND DEVISING A NEW SOCIAL COMPACT FRAMING A NEW PROGRESSIVE 145 Rethinking the European Social NARRATIVE Model 6 Introduction Dimitris TSAROUHAS Ernst STETTER, Karl DUFFEK 166 A Social Compact for a Social & Ania SKRZYPEK Union: A Political and Legal 15 How the Things Unfold... Window of Opportunity? Alfred GUSENBAUER Steven VAN HECKE, Johan LIEVENS & Gilles PITTOORS FOCUSING THE AGENDA: EQUALITY, QUALITY EMPLOYMENT 184 Socio-Economic Policy AND DECENT LIVING STANDARDS Making and the Contemporary Prospects for a ‘Social Europe’ 28 Wage, Employment, Working Alternative Conditions and Productivity: David J. BAILEY A New Focus on Quality Rémi BAZILLIER 202 Delivering Public Welfare Services in the Europe of 52 The Economic and Austerity. Responsibility vs Social Consequences Responsiveness? of the Obsession with Amandine CRESPY Competitiveness in the EMU Ronny MAZOCCHI 228 “Daring More Democracy” – Refl ections on the Future 72 Public Investments… To Do Foundation of Welfare Society What? Beyond ‘Bread and Pascal ZWICKY Butter’ Social Democracy Carlo D’IPPOLITI ACTING THROUGH EUROPE: SOLIDARITY, POLITICIZATION AND 90 The Politics of Productivity: COMMUNITARIAN METHOD Big Data Management and the Meaning of Work in the Post 258 External and Internal Crisis EU Challenges to Social Michael WEATHERBURN Democratic Leadership in Europe 110 Gender Equality: judicial -
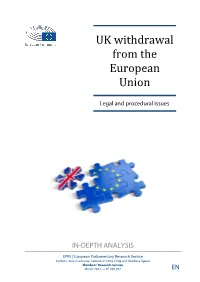
UK Withdrawal from the European Union: Legal and Procedural Issues
UK withdrawal from the European Legal andUnion procedural issues IN-DEPTH ANALYSIS EPRS | European Parliamentary Research Service Authors: Jesús Carmona, Carmen-Cristina Cîrlig and Gianluca Sgueo Members' Research Service March 2017 — PE 599.352 EN This paper considers some of the legal and procedural issues surrounding the United Kingdom’s planned withdrawal from the European Union. It looks in particular at the formal exit process under Article 50 TEU and the EU institutions' preparations for negotiations. It also sets out some possible templates for future EU-UK relations, as well as the details of existing frameworks for cooperation between the EU and third countries. PE 599.352 ISBN 978-92-846-0818-8 doi:10.2861/244741 QA-04-17-319-EN-N Original manuscript, in English, completed in March 2017. Graphics by Giulio Sabbati and Christian Dietrich. Disclaimer and Copyright This document is prepared for, and addressed to, the Members and staff of the European Parliament as background material to assist them in their parliamentary work. The content of the document is the sole responsibility of its author(s) and any opinions expressed herein should not be taken to represent an official position of the Parliament. Reproduction and translation for non-commercial purposes are authorised, provided the source is acknowledged and the European Parliament is given prior notice and sent a copy. © European Union, 2017. Photo credits: © Sashkin / Shutterstock.com. [email protected] http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog) UK withdrawal from the European Union – Legal and procedural issues Page 1 of 36 EXECUTIVE SUMMARY On 29 March 2017, the United Kingdom (UK) is expected to give formal notification of its intention to leave the European Union (EU), following the recent adoption of an Act of Parliament authorising the British government to take this important step. -

Article 50 Has Been Triggered; What Happens Next?
Article 50 has been triggered; what happens next? View this post in Welsh | Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg 29/03/17 The UK Prime Minister, Theresa May, has sent notification to the European Council of the UK Government’s intention to trigger Article 50 of the Treaty on European Union. The notification signals the beginning of the two-year period within which a withdrawal agreement has to be negotiated between the UK and the European Union. This two-year period can only be extended by unanimous agreement of all Member States. Under the process outlined in Article 50 the European Council have to approve any agreement by a qualified majority and the European Parliament has to vote in favour of a deal by a simple majority. A qualified majority in the European Council means at least 72% of Member States representing at least 65% of the population of the 27 must vote in favour. This equates to 20 Member States. The EU’s total estimated population in 2015 was 508 million inhabitants. The 2015 figure for the EU minus the UK would be 442 million inhabitants (65% of which would be approximately 287 million inhabitants). The most populous of the 27 Member States are Germany, France, Italy, Spain and Poland and the least Malta, Luxembourg, Cyprus, Estonia and Latvia. The UK will be treated as a non-EU State for the purposes of any Article 50 discussions and will therefore not participate in discussions in the European Council on the withdrawal negotiations. The EU will conduct the negotiations in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union.