Dans Les Meandres Du Quartier Europeen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Brussels for Kids Thematickit
brussels for kids thematic kit SPEND QUALITY TIME WITH YOUR FAMILY IN A QUALITY DESTINATION. BRUSSELS’ MUSEUMS AND ATTRACTIONS BOAST A WHOLE HOST OF CHILD-FRIENDLY ACTIVITIES THAT MAKE CULTURE FUN. THE SIGHTS AND SOUNDS OF BRUSSELS ARE ACCESSIBLE TO ALL THANKS TO DISCOVERY TRAILS, STORYTELLING, WORKSHOPS, AND MUCH MORE. THROUGHOUT THE YEAR, THE REGION PUTS ON EVENTS DEVISED ESPECIALLY FOR CHILDREN. BORED IN BRUSSELS? IT’S JUST NOT POSSIBLE! 1. CALENDAR OF EVENTS 03 2. CULTURE 10 3. CINEMA OUTINGS WITH CHILDREN 19 4. EDUCATIONAL FARMS 20 5. PLAYGROUNDS 21 6. BOOKSHOPS 22 7. FAMILY-FRIENDLY RESTAURANTS AND BARS 24 8. PUBLICATIONS 28 9. USEFUL LINKS 29 10. SHOPPING 30 11. CONTACTS 32 WWW.VISITBRUSSELS.BE 1. CALENDAR OF EVENTS THERE IS ALWAYS SOMETHING GOING ON FOR YOU AND YOUR KIDS... JANUARY LA NUIT DU CONTE Brussels’ Nuit du Conte is a series of more than 15 storytelling events on themes ranging from the Oriental to the slightly cheeky, from the traditional to the wacky. Some are told to a musical background and others in sign language... a night that invites you to enter the realm of dreams and to treat yourself to the wonderment of stories, shows and music that will see you alright until next winter. Storytelling events are in French only. www.conteursenbalade.be FEBRUARY ANIMA FESTIVAL A highlight of Belgium’s annual animated film scene since 1982, Anima is an enchanted universe where one colourful discovery follows the next in quick succession. Anima not only organises projections but also exhibitions, concerts and workshops for children. -

Sales Guide 2019 English Version © M
EN Sales Guide 2019 English version © M. Vanhulst The visit.brussels online sales guide is accessible to all, but is first and foremost aimed at professionals from the travel industry, namely tour operators, travel agents, coach companies and group organisers. It provides a complete overview of all activities and attractions in our city. These are then divided into specific themes which best represent Brussels, e.g. Art Nouveau, comics, heritage, etc. Each activity or attraction is explained in a file containing valuable information such as rates, contact details, languages in which the activity or attraction is provided, and much more. These files will allow travel professionals to take immediate action, should they wish to suggest an activity or attraction to their clients. The entire purpose of the sales guide is to advertise the tremendous potential of Brussels and boost creativity with travel professionals in order for them to perk up, enhance or change their offer whilst making them and their clients eager to discover and get a better idea of the city. Equally important, the sales guide limits research and hence lightens the workload considerably. In addition, the visit.brussels online sales guide obviously contains information on upcoming events, accommodation providers, coach parking details, visit.brussels contact information and other relevant data. We trust this unique tool will benefit all travel professionals worldwide and encourage them to choose Brussels as their preferred destination. Rest assured that we will keep on -

The Brussels Da Vinci Code
The Brussels Da Vinci Code The Rediscovery of Ancient Knowledge in the Capital of Europe The Brussels Da Vinci Code The Rediscovery of Ancient Knowledge in the Capital of Europe Ronald de Bruin Author: Ronald de Bruin Cover design: Ronald de Bruin — City map, courtesy of the Institut National Géographique – Nationaal Geografisch Instituut; — Vitruvian Man, Derivative work by Dario Crespi (alias Yiyi) of a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. Picture retrieved from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portale_Leonardo_da_Vinci.png ISBN: 9789464058338 © Ronald de Bruin 'People like us, who believe in physics, know that the distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.' — Albert Einstein TABLE OF CONTENTS PREFACE .............................................................................................................................. iii CHAPTER ONE ....................................................................................................................... 1 SCRATCHING THE SURFACE CHAPTER TWO .................................................................................................................... 15 HIDDEN RECORDS OF ANCIENT CIVILISATIONS CHAPTER THREE ................................................................................................................. 23 THE BRUSSELS STAR MAP Orion’s Belt ................................................................................................................... 23 -

Dossier De Presse
PRESS KIT Brussels, 17th April 2013 Fête de l'Iris 2013 “See you on 4th and 5th May next for the Fête de l’Iris ! This key occasion in Brussels life reminds us how proud we can be of our identity and reveals the wonderful treasures and joie de vivre of our Region. » Charles Picqué Minister-President of the Government of the Brussels-Capital Region The Brussels-Capital Region celebrates Europe and unveils a new image to the general public On 4th and 5th May 2013, the Brussels-Capital Region celebrates its 24 summers. The perfect opportunity to reaffirm its identity, hopes and ambitions. This key occasion in Brussels life reminds the people of Brussels how proud they can be of belonging here and shows visitors the wonderful treasures and joie de vivre of our Region. « be.brussels » The new «be.brussels» brand, chosen by the Region for its communication purposes, emphasises the role of the federal capital of the Brussels Region by adding the «be» of Belgium, thus symbolising the coming- together, coexistence and ongoing cooperation of the three national communities throughout the region. But «be» also reminds us of the opening-up of Brussels onto Europe and the rest of the world. From summer 2014, this new brand will also become the Internet address of the Region. Therefore, the Web extension «.brussels» will, gradually, towards the middle of next year, replace «.be» for all the key regional players as well as for all those who, whether business enterprises or individuals, wish to associate their name with that of their region. -
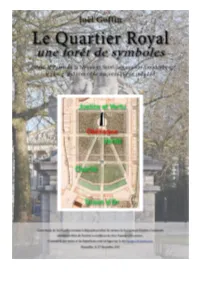
Brussels: a Forest of Symbols the Largest Masonic Complex in the World?
The Quartier Royal of Brussels: a forest of symbols The largest masonic complex in the world? This study is dedicated to Pascal Pirotte Strength for the undertaking, Wisdom for the execution and Beauty for the ornament. All it takes is for the crowd to enjoy in the vision of the show : to the initiated will not escape, at the same time, its high significance. Goethe about Mozart's The Magic Flute "What are the duties of a Freemason?" - Fleeing vice and practising virtue - How should he practice virtue? - By preferring justice and truth to everything else". Masonic catechism Real secrets are those that continue to be secrets even when they are revealed. I do this in memory of those who were and those who are no longer. Masonry of the Templars (18th century) The Brussels Park or the Perfect Plan? (english version to be continued – 2021.02.23) F ull F rench version Brief presentation In his Bruxelles, Mille ans de mystères, Paul de Saint-Hilaire seems to be the first contemporary author to have considered the layout of the Royal Park of Brussels from a Masonic point of view1. He saw in it a desire to inscribe the Lodge's main tools in the plan of the Park itself. The following tools would thus be discovered: the compass, the square, the chisel, the mallet, the hammer, the perpendicular (or plumb line), the level, the ruler or lever, and the trowel (illustration above). Thirty years later, in his work Bruxelles maçonnique: faux mystères et vrais symboles2, the masonologist Jean van Win categorically rejected this thesis as phantasmagorical. -

Brussels, the Capital City of Comic Strip Thematic Kit 1
Brussels, the capital city of comic strip thematic kit 1. BRUSSELS AND COMIC STRIP a. Birth of comic strip in Brussels b. From comic strip hero to film star c. The new generation of the Brussels comic strip scene 2. COMIC STRIP, PART OF BRUSSELS’ HERITAGE a. Brochures on Comics b. Comic Strip frescoes c. Buildings and monuments not to be missed d. Museums, exhibitions and galleries 3. COMIC STRIP ACTIVITIES AND EVENTS a. The various comic strip events b. Guided tours 4. COMIC STRIP SHOPPING 5. COMIC STRIP RESTAURANTS & BARS 6. USEFUL CONTACTS www.visit.brussels/comics BRUSSELS IS THE CAPITAL CITY OF COMIC STRIP! IN EACH CITY DISTRICT, AS YOU WEND YOUR WAY ALONG THE STREETS AND ALLEYWAYS OF BRUSSELS, COMIC STRIP IS EVERY- WHERE. IT’S A SOURCE OF NATIONAL PRIDE, AND THAT CAN BE FELT PARTICULARLY STRONGLY IN OUR CAPITAL CITY. BECAUSE SO MANY AUTHORS FROM BRUSSELS HAVE CONTRIBUTED TO THE RAPID GROWTH IN POPULARITY OF THE 9TH ART. YOU’LL FIND OUT ALL ABOUT IT WHEN YOU VISIT A MUSEUM, ENTIRELY DEDICATED TO COMIC STRIP, WANDER AROUND AMONG THE COMIC FRESCOES OR COME ACROSS MONUMENTAL SCULP- TURES OF BELGIAN COMIC BOOK CHARACTERS. COMIC STRIP IS AN ART IN ITS OWN RIGHT AND THE PEOPLE OF BRUSSELS ARE PARTICULARLY FOND OF IT. www.visit.brussels/comics 1. BRUSSELS AND COMIC STRIP A. BIRTH OF COMIC STRIP IN BRUSSELS Telling stories through a series of images is something that’s always been done all over the world. However, specialists agree that Belgium holds great sway in the sphere of what we now call comic strip. -

NATO HQ-INS-New Staff Member Welcome Booklet
NATO HQ - IMS - New Staff Member Welcome Booklet - Edition 1 - Oct 13 NATO HQ International Military Staff New Staff Member Welcome Booklet Edition 1 - Oct 13 1 NATO HQ - IMS - New Staff Member Welcome Booklet - Edition 1 - Oct 13 Table of Contents Section Title Page 1 Introduction 3 2 Who We Are and What We Do 4 3 A Message from DGIMS 6 4 Key Administrative Formalities for Consideration 8 5 Privileges and Immunities for the Military 11 6 A Little Bit About Life at NATO HQ 13 7 Achieving Domestic Happiness! 15 8 Your Leisure Time 21 9 Survivor’s Guide to Driving in Belgium 30 10 Useful Contacts 37 Disclaimer This Welcome Booklet is designed to answer some of the questions that may arise when you first arrive here, particularly if it is your first posting to Belgium. We make every effort to ensure that our information is current and correct. Your help is invaluable in keeping our records up to date by informing me (EXCO) of any changes to it, by sharing any additional information, which may be of interest to others. However, the content of this Welcome Booklet does not necessarily reflect the policies or opinions of NATO. The accuracy of the Welcome Booklet is not guaranteed but I have done my best! 2 NATO HQ - IMS - New Staff Member Welcome Booklet - Edition 1 - Oct 13 General Knud Bartels – Chairman of the NATO Military Committee 1 - Introduction 1. Welcome to NATO HQ and to the International Military Staff (IMS). We are looking forward to you joining our team. -

A Correspondent's Guide To
BRUSSELS 2018-2019 A CORRESPONDENT’SGUIDETO n 1 A CORRESPONDENT’S GUIDE INDEX n n WELCOME n n l Media contacts & Press officers 68 l Belgian minister of Foreign Affairs Didier Reynders 4 l Spokespersons of permanent representations in Brussels 73 l API-IPA president Tom Weingärtner 5 n EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 76 n GENERAL ADVICE l Getting started 8 n OTHER EU INSTITUTIONS & AGENCIES 78 l Accreditation 10 ................................................................................................................................ n n NATO n n n BRUSSELS MEDIA l Overview 88 l Media associations 16 l Spokespersions of NATO member states’ delegations 90 l European media organisations 20 l A short Guide to Lazy EU Journalism 22 n OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS 92 l Basic media ground rules 24 ................................................................................................................................ n LOBBY GROUPS 94 n n EUROPEAN UNION n n l Overview 26 n THINK TANKS 98 ................................................................................................................................ n THE EUROPEAN COMMISSION n n BELGIUM n n l Overview 30 l Overview 100 l Spokespersons’ service 34 l The federal government – ministers and their spokespersons 104 l Commission representations in member states 48 l Regional governments 108 n THE EUROPEAN PARLIAMENT n HOW TO GET THERE – ARRIVING IN BRUSSELS 110 l Overview 54 l Media contacts & Press Officers 56 n LIFE IN BRUSSELS 112 l Parliament’s representations -

WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: City Center- Bruxelles-Ville Galerie Ravenstein Was Built in 1958 As a Shopping Center
WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: City Center- Bruxelles-Ville Galerie Ravenstein was built in 1958 as a shopping center. Its original aim was to give a new boost to the neighbourhood, which was heavily affected by the destructive works for the Nord-Midi (north-south) junction. Designed as a shopping gallery which could house 81 shops, it was built between 1954 and 1958 in the International style, according to Alexis and Philippe plans by the architects Alexis and Philippe Dumont, who designed the *** Galerie Ravenstein Rue Ravenstein 18 Dumont nearby building which houses Shell’s offices. From rue Ravenstein, a huge porch gives access to a staircase under a cupola which compensates for the ten-metre height difference that exists between the two streets. When it opened, it accommodated over 80 shops. The innovative skylight and stellar artwork incorporated into the design of the arcade are striking features to be admired. A cinema documentation centre has recently opened with thousands of books, magazines and more than a million photographs, which can be perused in the reading room. Forty displays trace the early days of Victor Horta cinema i.e. the main inventions that led to the discovery of *** CINEMATIC and Robbrecht & Rue Baron Horta 9 cinematography by the Lumière brothers. For the renovation and Daem (renovation) refurbishment of the Film Museum, located in the Centre for Fine Arts in Brussels, the architects used new and old means. The light and the visual angles in Victor Horta's building were used to let Cinematek connect with the rest of the structure. -

260-ADPCSDMFDGBV-Coudenberg
COUDENBERG PALACE BRUSSELS From Medieval Castle to Archaeological Site SCIENTIFIC DIRECTION: Vincent Heymans COORDINATION: Laetitia Cnockaert and Frédérique Honoré AUTHORS: P. Anagnostopoulos, A. Buyle, P. Charruadas, L. Cnockaert, M. de Waha, S. Demeter, Y. Devos, C. Dickstein-Bernard, A. Dierkens, M. Fourny, C. Gaier, M. Galand, D. Guilardian, S. Guri, V. Heymans, J. Houssiau, J.-P. Huys, C. Loir, P. Lombaerde, M. Meganck, S. Modrie, C. Paredes, P. Sosnowska, S. van Sprang, B. Vannieuwenhuyze, A. Vanrie This publication has been produced by the Palais de Charles Quint ASBL, a non profit-making organisation, on the initiative of the Brussels Capital Region and the City of Brussels Scientific direction: Vincent Heymans Coordination: Laetitia Cnockaert and Frédérique Honoré Authors: Pierre Anagnostopoulos, Anne Buyle, Paulo Charruadas, Laetitia Cnockaert, Michel de Waha, Stéphane Demeter, Yannick Devos, Claire Dickstein-Bernard, Alain Dierkens, Michel Fourny, Claude Gaier, Michèle Galand, David Guilardian, Shipé Guri, Vincent Heymans, Jean Houssiau, Jean-Philippe Huys, Christophe Loir, Piet Lombaerde, Marc Meganck, Sylvianne Modrie, Cecilia Paredes, Philippe Sosnowska, Sabine van Sprang, Bram Vannieuwenhuyze, André Vanrie Their titles and institutions are given at the end of the book Scientific committee: Vincent Heymans (President), Pierre-Paul Bonenfant †, Marcel Celis, Stéphane Demeter, Alain Dierkens, Michel Fourny, Sylvianne Modrie, Anne Vandenbulcke, André Vanrie The scientific committee very much regrets that one of its members passed -

Dossier De Presse Carolus Festival EN
PRESS RELEASE Brussels, 9 March 2017 Charles V Festival Brussels in Renaissance times Once again this year from May through September during the Charles V Festival, Brussels brings back the Renaissance spirit with its artistic and scientific innovations. On this occasion fifteenth century European history and heritage will be in the spotlight thanks to a full schedule of festive, cultural, and family activities planned for different locations throughout the Brussels-Capital Region. The festive and historical Charles programme is incorporated into the "European routes of Emperor Charles V" network. This historical and tourist route is recognised by the Council of Europe's European Institute of Cultural Routes. It combines the places that marked the reign of Charles V and the cities through which he travelled. This year we are commemorating the 150 th anniversary of Charles de Coster's Ulenspiegel, a masterful work of Brussels literature set in the old Netherlands at the time of Charles V and his son. Now here is a preview of the must-see events of this edition: Exhibition/route: Remigio Cantagallina, an Italian traveller in the Southern Netherlands More than 400 years ago, a Florentine artist named Remigio Cantagallina journeyed across Europe to present himself at the court of Archduke Albert and Archduchess Isabelle in Brussels. His reasons for making this trip have been the subject of meticulous research straddling history and art history. During his 1612-1613 stay in the old Southern Netherlands, he produced a number of drawings which constitute a unique record to this very day. These small drawings have been enlarged and staged in the underground ruins of the old Coudenberg Palace. -

Brussels in Collaboration with Visit.Brussels Photo: Brussels, a City That Continues to Surprise and Move You
Brussels in collaboration with visit.brussels Photo: Brussels, a city that continues to surprise and move you. This city-region-capital of 500 million Europeans is waiting to share its treasures with you. It’s a fair bet that its stormy history is the reason for its open-mindedness, warmth and friendliness. You’ll feel right at home in Brussels! As well as its historic monuments, Brussels has so much to share with you: its comic strip speech bubbles, its Art Nouveau façades, the talent of its stylists and designers, its delicacies and its surrealism, which can be found on every street corner. Featured Top 5 Belgian Beer Weekend in Br... The Atomium - Monument Finally it's happening! Take part and... in beer and brewing-related The Atomium is the symbol of events at the ... Brussels and Belgium, a unique Fête de la Musique Mini-Europe,monument and the an EU's... most... This famed event, perfect for At the foot of the Atomium, celebrating the summer solstice Mini-Europe allows you to have with hundreds ... a whistle-stop to... Visit the Laeken Royal Gre... Train World, discover the ... Designed by architect Balat Opened in September 2015, a (Victor Horta's teacher) these new attraction awaits you in greenhouses are s... Brussels: Train Wor... The Brussels Flower Carpet... Parlamentarium, the Europe... This creation is a genuine Come and discover the challenge: 1800m², 1 million Parlamentarium, the European flowers and artisans... Parliament's Visitors Cen... Bruxelles Les Bains - A be... Royal Belgian Institute of... 6000m² of fine sand, palm trees, The Museum of Natural sports pitches, straw food huts, Sciences in Brussels houses the games and ..