Le Savoir Commun
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

What We Can Learn from Wikipedia: Why We Should Jump on Board
Collaborative Librarianship Volume 10 Issue 1 Article 2 6-15-2018 What we can learn from Wikipedia: Why we should jump on board Lori Bowen Ayre Galecia Group, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship Part of the Library and Information Science Commons Recommended Citation Ayre, Lori Bowen (2018) "What we can learn from Wikipedia: Why we should jump on board," Collaborative Librarianship: Vol. 10 : Iss. 1 , Article 2. Available at: https://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship/vol10/iss1/2 This Columns is brought to you for free and open access by Digital Commons @ DU. It has been accepted for inclusion in Collaborative Librarianship by an authorized editor of Digital Commons @ DU. For more information, please contact [email protected],[email protected]. Ayre: What We Can Learn from Wikipedia Technology Matters What We Can Learn from Wikipedia: Why We Should Jump Onboard Lori Bowen Ayre ([email protected]) The Galecia Group In an effort to fight conspiracy theories from 4. Wikipedia’s editors should treat each propagating uncontested on YouTube, Susan other with respect and civility Wojcicki, YouTube CEO, announced that con- 5. Wikipedia has no firm rules spiracy videos would be accompanied by “infor- mation cues” to provide an alternate viewpoint. Wikipedia content is a product of the effort of The announcement came during a panel at “hundreds of thousands of people” who write, South by Southwest on March 20th, 2018. improve, and update articles in an effort to keep it “neutral and supported by reliable re- The authoritative resource that would be called sources.”3 It is overwhelmingly made up of vol- upon to both define conspiracy theories and unteer editors with a smaller cadre of volunteers provide the alternative viewpoint on those theo- who have some additional editorial authority. -

Wikimedia Movement Strategy Process
Wikimedia Movement Strategy Process Gereon Kalkuhl, Nicole Ebber Pre-Wikimania meeting Berlin, June 10, 2017 Stephan Kunz, CC Zero, Unsplash The most notable source of knowledge in the world Beko, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons 10 thousands of volunteers Martin Kraft, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons st Data is the oil of the 21 century Addshore, CC Zero, Wikimedia Commons Conserving the past: Wiki loves monuments Shreemilabaj, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons Shaping copyright Sebastiaan Ter-Burg, CC BY 2.0, Wikimedia Commons Changing society Together with GLAMs Romaine, CC Zero, Wikimedia Commons We’ve come a long way. But where do we go from here? What do we want to build or achieve together over the next 15 years? Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons Wikimania 2016 in Esino Lario Katherine Maher new WMF ED Wikimedia Movement Strategy Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons Timeline Before Wikimania Develop Wikimedia’s global strategic direction; “Which mountain do we want to climb?” After Wikimania How can we fill this direction with life? (roles, responsibilities, resources, goals); “How do we climb this mountain?” Andrew Neel, CC Zero, Unsplash Goals for this process As a movement, identify a cohesive direction that aligns and inspires us all on our path to 2030. Build trust within our movement through participation in an open process based on shared power. Better understand the people and institutions that form our movement, those we are not yet reaching, and how their needs may change over the next 13 years. -

The Future of Wikimedia and Why New Zealand Museums Should Pay Attention
The Future of Wikimedia and Why New Zealand Museums Should Pay Attention Susan Tolich On the 21st of May it was announced that Mike Dickison will be assuming the position as Aotearoa’s frst Wikipedia-at-large. Tis new role will entail several placements at GLAM institutions around the country where Dickison will act as a ‘Wikipedian in Residence.’ Tis position does not involve editing Wikipedia on behalf of the organisations but focuses on training staf in how to contribute and engage with all parts of Wikimedia and its editing community. Wikipedia is just one of the projects run by the non-proft Wikimedia Foundation; others include Wikimedia Commons and Wikidata. Troughout his career Dickison has had years of experience advocating for Wikipedia to be used in the GLAM sector and has hosted various events to improve the representation of New Zealand endemic species and female scientists on the site.1 While Dickson is the frst Wikipedian-at-large in New Zealand he is part of a much larger global movement which works towards creating a freely accessed ‘sum of all knowledge.’ Wikimedians have partnered with GLAM institutions around the world since 2010 with the mission of ‘connecting audiences to open knowledge, ideas and creativity on a global scale.’2 Other Wikipedian-in-residence projects have ranged from creating documentary photography of Carpathian folk lore, to upskilling librarians in the Ivory Coast to be able to promote their heritage using Wikimedia platforms. It was eforts such as these that also delivered Te Metropolitan Museum 1 Mike Dickison, “New Zealand Wikimedian at large,” Giant Flightless Bird (Blog), 21 May 2018, http://www.giantfightlessbirds.com/2018/05/new-zealand-wikipedian-at-large/ 2 Katherine Maher and Loic Tallon, “Wikimedia and the Met: a shared digital vision,” Medium, 20 April 2018, https://medium.com/freely-sharing-the-sum-of-all-knowledge/wikimedia-and -the-met-a-shared-digital-vision-f91b59eab2e9. -

Introduction: Connections
Wikipedia @ 20 • ::Wikipedia @ 20 Introduction: Connections Joseph Reagle, Jackie Koerner Published on: Oct 15, 2020 License: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) Wikipedia @ 20 • ::Wikipedia @ 20 Introduction: Connections Twenty years ago, Wikipedia set out on its path to provide humanity with free access to the sum of all knowledge. Even if this is a mission that can’t be finished, Wikipedia has made remarkable progress toward the impossible. How so? Wikipedia is an encyclopedia built on a wiki. And never has an application (gathering the sum of human knowledge) been so suited to its medium (easily interconnected web pages). Encyclopedias have long been reliant on interconnections. In 1755, the Encyclopédie’s Denis Diderot wrote that the use of cross-references (or renvois) was “the most important part of our encyclopedia scheme.”1 This feature allowed the Encyclopédie’s editors to depict the connective tissue of Enlightenment knowledge and to dodge state and church authorities by way of facetious and satirical references. For example, they linked to articles on the Christian rite of communion, wherein “the body and blood of Christ” is consumed, from the article on “Cannibals.” At the onset of each new informational medium—from paper, to microfilm, to silicon—connectivity was the impetus. Among the documentalists of the early twentieth century, there was Wilhelm Ostwald’s Brücke, a bridge, and Suzanne Briet’s indice, an indicator. Such documentalists advanced indexing and classification schemes to improve interconnections between information. Then, on the cusp of the digital age, Vannevar Bush famously wrote of the power of an electromechanical memex laced with “associative trails.”2 This inspired the hyperlinks of the 1960s and the URLs of the 1990s. -

Contributors
Wikipedia @ 20 • ::Wikipedia @ 20 Contributors Published on: Oct 15, 2020 License: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) Wikipedia @ 20 • ::Wikipedia @ 20 Contributors Phoebe Ayers is the librarian for electrical engineering and computer science at the Massachusetts Institute of Technology Libraries. She has been a Wikipedian since 2003, is a former member of the Wikimedia Foundation Board of Trustees, and is the coauthor of How Wikipedia Works: And How You Can Be a Part of It (No Starch Press, 2008). Omer Benjakob is a journalist and researcher based in Israel. He was born in New York and raised in Tel Aviv. His work focuses on Wikipedia and the politics of knowledge in the digital age. He covers the online encyclopedia for Haaretz—Israel’s sole paper of record—in English and Hebrew. His work has also appeared in Wired UK. His academic research focuses on Wikipedia’s ties to science, and he works with scientists from the Weizmann Institute of Science and the Centre de recherches interdisciplinaires to map the growth of knowledge online. He’s pursuing an MA from Tel Aviv University’s Cohn Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas. Yochai Benkler is the Berkman Professor of Entrepreneurial Legal Studies at Harvard Law School and codirector of the Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University. He has been a leading scholar on the impact of the internet on the networked economy and society since the 1990s, with a particular focus on commons, cooperation, and decentralization. His books include Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics (Oxford University Press, 2018) and The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (Yale University Press, 2006). -
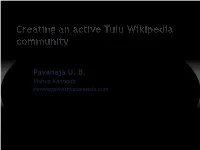
IT Skills in Demand
Pavanaja U. B. Vishva Kannada [email protected] *Tulu belongs to Dravidian family of languages. *Geographically and politically it belongs to Karnataka and to northern Kerala. *There are about 30 lakh Tulu speakers including those who are staying outside Tulunadu. *Tulu has its own distinct identity. Images from Wikipedia (CC-BY-SA) *No of speakers ~30 lakh *Tulu had its own script, but not in use recently *Kannada script is used by Tulu nowadays *Tulu has less Sanskrit words compared to Kannada *Use of Kannada script has brought in many Kannada and Sanskrit words to Tulu *No science writing in Tulu *There is no encyclopaedia in Tulu *Tulu has been introduced as a language at Mangaluru & Udupi district schools *Students have no encyclopaedic books, websites to read other than the text books *Bringing world knowledge in your language helps to preserve and grow the language *Most of Tulu culture, literature, heritage is still in oral tradition. It needs to be documented *Started as an incubator project in 2008 *Some activity in 2008-09, dormant afterwards *Meeting held in Jan 2014 to instil new life *Many meetings workshops, editathons held at Mangaluru & Udupi *Presentation done during World Tulu Festival at Mangaluru, Dec 2014 *All these brought in a new set of dedicated editors *Lot of media mentions brought in awareness In incubator January November August 2016 2014 2014 Articles 135 747 1079 Editors 8 68 102 (>10 edits) 19-01-2014, Mangaluru 05-04-2014, Mangaluru 19-04-2014, Mangaluru 25-05-2014, Udupi 26-28-11-2014, Sahyadri -

Online Meddlers Can't Run and Can't Hide from Wikiwash
metronews.ca 18 NEWS Thursday, October 9, 2014 Online meddlers can’t run and can’t hide from WikiWash In March 2014, Metro’s digital team headed to Toronto’s inaugural edition of Techraking, a data journalism crash course sponsored by Google, the Center for Investigative Reporting and The Working Group. The prize at the end was a sizeable chunk of TWG’s time to develop a data journalism tool pitched by an attending team. Metro’s team won over the judges, and WikiWash is the result. What is WikiWash? Ʉ `'Ċÿ`ÑĨþÿĨÑĨåÑĤÝþ åĒûÿĒåĮþÑĮĤåĺåÑČĨĮþå åáÿĮþÿĨĮėĤĽėîÑ`ÿĊÿġåáÿÑ åĒĮĤĽȩSėČåÑĤĒĻþÿÝþ ıĨåĤĨþÑĺåÜååĒåáÿĮÿĒû ÑġÑûåȦĨÿđġČĽġÑĨĮåĮþå ČÿĒĊėĤĮĽġåĮþåĮÿĮČåÿĒĮė `ÿĊÿ`ÑĨþȱĨĨåÑĤÝþóåČáȩ Ʉ `ÿĊÿ`ÑĨþĻÿČČĮþåĒġĤė- ĺÿáåĽėıĻÿĮþÑÝþĤėĒė- ČėûÿÝÑČČÿĨĮėîåáÿĮĨđÑáå ĮėĮþÑĮġÑûåȦÿĒÝČıáÿĒûĮþå þÑĒáČåėĤ'GÑááĤåĨĨėîĮþå ġåĤĨėĒÜåþÿĒáÿĮȩČÿÝĊÿĒû ėĒåÑÝþåáÿĮȱĨĨıđđÑĤĽ ĻÿČČþÿûþČÿûþĮĮþåĨġåÝÿóÝ ÝþÑĒûåĨĮþÑĮĻåĤåđÑáåȦ ÜåÿĮĨÿđġČĽÝėĤĤåÝĮÿĒûÑ ĮĽġėȦėĤĨėđåĮþÿĒûÑČÿĮĮČå ĨþÑáÿåĤȩ Ʉ NėĻþÑĮĮėáėĻÿĮþÑČČ ĮþåĨååáÿĮþÿĨĮėĤÿåĨȤ`åČČȦ ĮþÑĮȱĨıġĮėĽėıȩ Metro digital reporter Luke Simcoe demonstrates the WikiWash program in Toronto Wednesday. DAVID VAN DYKE/METRO LUKE Wikipedia editors to the organ- Background start giving people open tools SIMCOE izations from which the chan- to create and share knowledge Metro Online ges were made. Griffith’s tool and participate in democracy, revealed edits made from IP ad- The seeds tions would worm their way corrected could go a long way then the sky’s the limit on what According to itself, Wikipedia is dresses connected to numerous into our notorious incum- to taming the more damaging they’ll actually do with them.” the fifth-most popular website governments, businesses and of an idea bent’s entry? If somebody aspects of Wikipedia’s crowd- Ed Summers, creator of on Earth. agencies, including the CIA, the was spotted sowing confusion sourcing model. -

Wikihbcudio Launch Event at Washington National Cathedral
WikiHBCUDIO Launch Event at Washington National Cathedral (draft blurb) List under category “Special Event” Admission: free for congregation and public Date and time: Sunday, January 19, 2020, 1–4 p.m. Location: Perry Auditorium and Pilgrim Observation Gallery Wikipedia, as a free encyclopedia that everyone can edit, inevitably incorporates biases that mirror society’s own; improving Wikipedia means confronting real world inequalities, and vice versa. WikiHBCUDIO is a coalition of Historically Black Colleges and Universities, along with other Departments, Institutions and Organizations representing people of color, leveraging their unique resources to address the under-representation of minorities on and off Wikipedia. Join us for this first ever WikiHBCUDIO offline event, where technology, academia and activism intersect at Washington National Cathedral. A 30-minute panel kicks off the discussion on how people of faith can lead the fight for equality in today’s digital world, followed by two parallel sessions stretching into the afternoon: Unconference (just outside Perry Auditorium): Focusing on WikiHBCUDIO’s role outside Wikipedia, attendees chat and mingle with each of the panelists/guests in an informal setting, generate ideas, and learn about the work of their respective organizations. Edit-a-thon (inside Perry Auditorium): Led by seasoned Wikipedia editors, attendees gather in groups of three to five; each group edit/create a specific page/topic of interest to the Cathedral community. Coffee and snacks are served. First-timers welcome, no special skills required! If you wish to participate in active editing, please bring your own laptop. Welcome speaker: The Rev. Dr. Leonard Hamlin, Canon Missioner of Washington National Cathedral Panelists: Jim Hayes, Board Member, Wikimedia District of Columbia Dr. -

Katherine Maher Lydia Pintscher Alessandro Barbero Jimmy Wales
La itWikiCon 2020 è il convegno della comunità dei progetti Wikimedia in lingua italiana e nelle lingue minori del territorio italiano e si svolgerà online il 24 e 25 ottobre in contemporanea e in collaborazione con il Linux Day. Ospiti speciali Katherine Maher Alessandro Barbero Direttrice esecutiva della Wikimedia Foundation Storico, accademico e scrittore Lydia Pintscher Jimmy Wales Product Manager di Wikidata Cofondatore del progetto Wikipedia Programma Wikimedia 2030: cosa cambierà e come partecipare Introduzione a Wikidata Sabato 24 dalle 11:00 alle 13:00 Caccia al tesoro sulla storia dell'informatica Tavola rotonda sui progetti fratelli Wikidata per WLM Certificare le conoscenze Wikimedia: un framework Come collaborare con i piccoli musei nei progetti Wikimedia? Openedu SPARQL: milleuno domande che non vi siete mai fatti ma di cui daremo risposta Vikidia, Wikiversità e Wikivoyage nella scuola primaria e secondaria di primo Introduzione a OpenStreetMap grado Mappare il passato: OHM Edutainment ai tempi del Covid - Wikipedia & OSM al servizio del mondo ludico Perché non posso fotografare la piazza del mio paese? Il Daty Pywikibot - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare il La data visualization sui progetti Wikimedia web semantico Voci semi-protette all'infinito Corso accelerato sui Template e moduli Lua Domenica 25 dalle 13:15 alle 14:15 Esplorando Busto Arsizio – tour virtuale interattivo La gestione dei conflitti nei progetti Wikimedia, modalità a confronto Accessibilità e usabilità dei progetti Wikimedia Qual è il nostro nome? Wikipedia, Wikimedia e il rebranding WikiBase, partendo da zero Wikisource - Gli strumenti per facilitarsi la vita itWikicon nei prossimi anni Wikinotizie non è triste come pensate Community Health Metrics: presentazione del progetto Iniziativa per la Sostenibilità – che c'è di nuovo? Wikiproxy: come Wikipedia può sopravvivere alle censure dei governi 24 e 25 ottobre, online 2020.itwikicon.org. -

12722-23087-1-SM (3) Rev AL 14
WikiCon 2020 Susanna Giaccai Wikipedia è prodotta da una comunità di volontari con regole editoriali condivise e moltissimi spazi virtuali per scambio di idee, di confronto e di progettazione di nuove attività. La stessa modalità operativa è presente in tutti gli altri progetti della comunità Wikimedia: Commons (raccolta di file multimediali), Wikisource (biblioteca digitale), Wikidata (archivio di dati strutturati aperti e liberi) ecc. I componenti di queste comunità colloquiano moltissimo per progettare attività, scambiarsi opinioni su singole voci e altro; un formicaio in continuo movimento sta sotto alle 1,6 milioni di voci di Wikipedia così come in tutte le altre piattaforme Wikimedia. I volontari, oltre a parlarsi nelle piattaforme virtuali Wikimedia, ogni tanto si incontrano anche dal vivo. Ogni anno in un paese diverso si tiene Wikimania, una conferenza che riunisce la Wikimedia Foundation e tutti i soci delle associazioni nazionali Wikimedia. Nel 2016 questa conferenza si è tenuta a Esino Lario, vicino Como 1, e successivamente a Montreal, Città del Capo e nel 2019 a Stoccolma. Si tratta di raduni cui partecipano diverse centinaia di “wikimediani” seguendo decine di sessioni. Quest’anno la Wikimania è saltata a causa della pandemia, ma la comunità sta discutendo se puntare a una sua organizzazione online adesso e mantenere una versione online anche quando la pandemia sarà passata, allo scopo di ridurne l’impatto energetico; una Wikimania organizzata in una città ove arrivano centinaia di volontari con viaggi in aereo di andata e ritorno produce molto CO2. La comunità pone tra i suoi obiettivi 2030 anche la sostenibilità del progetto: è stato calcolato che nel 2019 i voli aerei della comunità legati alle attività del progetto hanno causato la 1 Un mio resoconto in Wikimania2016 a Esino Lario: Wikipediani di tutto il mondo in un paesino sul lago di Como , in "Vedi Anche", n. -

The Talent We Need. the Talent We Need
The talent we need. We are growing the free knowledge movement. We are looking for Board members to join us. The future of free knowledge The Wikimedia movement is based on a radical vision: a world in which every single person can freely share in all knowledge. We believe that world is within reach. Over the past 15 years, Wikipedia has become one of the world’s most beloved resources, reaching hundreds of millions of people each month with reliable, free information, written by a community of critical thinkers. There are opportunities and challenges all around us. There is information everywhere you turn. Populations are changing around the world. Literacy levels are rising. Internet penetration continues to grow. Meanwhile, the web is less open and more commercial. Privacy is increasingly illusory. The window of discourse is narrowing. The quality of our civilization’s infosphere may be at stake. We are serious about our vision. We must face the future with our communities, as a movement. 02 This photo lives on Wikimedia Commons, a repository of stunning images that are freely licensed for all to use. Where we came from. It began in 2001 as a radical idea: an open and free encyclopedia that anyone could edit.1 Let go of traditional notions of experts and peer review and allow anyone to create, edit, and discuss articles. Build an open platform, add reasonable rules of engagement,2 and see what happens. Lo and behold, contributors from all over the world arrived in waves. In the Spring of 2006, Wikipedia celebrated its 1 millionth article in over 100 languages.3 And they were only getting started. -

The Talent We Need
TheThe talenttalent we need. we need. We are growing the free knowledge movement. We are looking for board members to join us. The future of free knowledge The Wikimedia movement is based on a radical vision: a world in which every single person can freely share in all knowledge. We believe that world is within reach. Over the past 15 years, Wikipedia has become one of the world’s most beloved resources, reaching hundreds of millions of people each month with reliable, free information, written by a community of critical thinkers. There are opportunities and challenges all around us. There is information everywhere you turn. Populations are changing around the world. Literacy levels are rising. Internet penetration continues to grow. Meanwhile, the web is less open and more commercial. Privacy is increasingly illusory. The window of discourse is narrowing. The quality of our civilization’s infosphere may be at stake. We are serious about our vision. We must face the future with our communities, as a movement. 02 This photo lives on Wikimedia Commons, a repository of stunning images that are freely licensed for all to use. Where we came from. It began in 2001 as a radical idea: an open and free encyclopedia that anyone could edit.1 Let go of traditional notions of experts and peer review and allow anyone to create, edit, and discuss articles. Build an open platform, add reasonable rules of engagement,2 and see what happens. Lo and behold, contributors from all over the world arrived in waves. In the Spring of 2006, Wikipedia celebrated its 1 millionth article in over 100 languages.3 And they were only getting started.