Mémoire Soumis À La Commission Des Institutions
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
An Analysis of Geography Educa.Tion in the · Protestant High Schooi.S of Montreal
. AN ANALYSIS OF GEOGRAPHY EDUCA.TION IN THE · PROTESTANT HIGH SCHOOI.S OF MONTREAL by Russell Andrew McNeilly1 :B.Sc., A.C.P. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts. Department of Education, August 1963 McGill University, Montreal. ACKNOWLEDGEMENT This study1 which was carried out in the Division of Graduate Studies in Education, examines the learning and teaching processes of geography in the high schools of the Montreal area, and more particularly the high schools controlled by the Protestant School Board of Greater Montreal. To gain information for the thesis, the writer needed the assistance of members of various school boards, the principals of the high schools, the geography teachers in the high schools, and the committee of the newly formed geography teacherst association. To all of these, the writer acknowledges his indebtedness. Appreciation is expressed also to Prof. Harry Clinch, head of the Department of Geography, Sir George Williams University, to Prof. Trevor Lloyd, Chairman of the Department of Geography, McGill University, and to Prof. Reginald Edwards, Chairman of the Division of Graduate Studies in Education, McGill University. The writer wishes to offer thanks for their kind assistance. Finally, the author owes a debt of gratitude to his director of studies, Prof. R.L.R. Overing1 of the Institute of Education, for his guidance, assistance and encouragement in the preparation of the thesis. TABLE OF CONTENTS :Page No. Acknowledgement List of Tables Introduction :PART 1 - :PRINCIPLES 1 Ch.l. A FRAMEVORK FOR GEOGRA:PHY EDUCATION 1 1 Introduction 1 11 The Nature and scope of geography 6 III The Existing dichotomy 9 IV The vital role of geograpby in present day society and in high school 12 v Two schools of thought in geography 18 VI The subdivision of geography 19 VII Electic view for high school geography in Montreal 24 Ch.2. -

POUR APP Liste Tournée 2014 Rev3 Cindy
OPUS PHOTO ID TOUR RENEWAL IN SCHOOLS Schedule subject to change Please check this list again to confirm the photo session date in your school. School Tour Date A Academie Dunton 15-sept Académie Michèle-Provost 08-oct Académie Roberval 07-oct B Beaconsfield High School 09-sept Beurling Academy 25-sept Bialik High School 14-oct C CAE d’Outremont (prise de photo à l'école Saint-Laurent édifice Cardinal) 15-oct Cégep André-Laurendeau 19-sept Cégep de Saint-Laurent 17-sept Cégep du Vieux Montréal 11-12 sept Cégep Gérald-Godin 08-sept Cégep Marie-Victorin 10-sept Centennial Academy 08-oct Centennial College (prise de photo à Centennial Academy) 08-oct Centre Champagnat 07-oct Centre d'éducation des adultes de LaSalle (prise de photo à l'édifice Clément) 24-sept Centre d'éducation aux adultes Ferland 26-sept Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé 18-sept Centre François-Michelle (prise de photo au Collège Français) 15-oct Centre Gédéon-Ouimet 10-oct Centre Mountainview (prise de photo à John Grant High School) 29-sept Collège Stanislas 26-août Collège Ahuntsic 05-sept Collège André-Grasset 10-sept Collège Beaubois 18-sept Collège Bois-de-Boulogne 04-sept Collège Charlemagne 09-sept Collège d’Anjou 22-août Collège de Maisonneuve 28-29 août Collège de Montréal 03-sept Collège de Rosemont 07-oct Collège Français 15-oct Collège international des Marcellines (prise de photo à Villa Sainte-Marcelline) 30-sept Collège international Marie de France 14-oct Collège Jean-de-Brébeuf (Collégial) 15-sept Collège Jean-de-Brébeuf (Secondaire) 15-sept -

Strategic Plan 2015 2020.Pdf
t is with honour and pride that I present to you, the members of our community, the Lester B. Pearson School Board 2015-2020 IStrategic Plan. This plan is the result of the extraordinary efforts of a dedicated, experienced group of administrators from our schools, centers and head office, with valuable input garnered from our consultative partners. All involved were clearly focused on providing a well-rounded framework that ensures the success of our students. The three main directions within recognize the evolving environment within our schools and centers - student-led learning using the tools and technologies that will be necessary for their future, in a safe and caring space. It allows for diversity in learning styles as well as teaching styles. The plan also recognizes that mental and physical well-being are essential factors in learning. Lester B. Pearson School Board continues to lead in recognizing students’ needs for today and tomorrow. This Strategic Plan allows all staff to focus on the next five years, to plan for and build an infrastructure that supports the needs of both students and teachers and to guide the students to achieving their goals, not the least of which, as the title of this plan suggests, is life-long learning. Each of the three directions in the plan has well-articulated objectives with measurable results. The bar has been set high, but we have no doubt that as has been the case in past, we will achieve these results. On behalf of the Council of Commissioners I would like to thank Mr. Thomas Rhymes for leading the effort to create this plan and the many staff members who contributed to it. -

(CQSB) 2046 Chemin St. Louis Sillery Quebec G1T 1P4
CENTRAL QUEBEC SCHOOL BOARD (CQSB) 2046 Chemin St. Louis Sillery Quebec G1T 1P4 CLC School Board Representative: Mark Sutherland - [email protected] - 1-418-688-8730 CLC CLC Schools Principal CLC Community Development Agent Quebec High School Warren Thomson Ed Sweeney 945 Belevedere, Quebec G1S 3G2 [email protected] [email protected] IP: 206.167.67.72 418-683-1953 418-683-1953 #223 / 418-575-1414 Susan Faguy Sylvie Piché Eastern Quebec Learning Centre (Adult Ed) Quebec CLC [email protected] [email protected] 3005 William Stuart, Quebec G1W 1V4 418-654-0537#2810 418-654-0537 # 2852 Gary Kenler Ed Sweeney Everest Elementary School [email protected] [email protected] 2280 rue Laverdière, Quebec G1P 2T3 418 -688-8229, #1110 418-683-1953 #223 / 418-575-1414 La Tuque High School (K – Sec. V) Jason Barwise Jeff Reed La Tuque CLC 531 rue St-Maurice, La Tuque G9X 3E9 [email protected] [email protected] IP: 206.167.67.77 819-523-2515 819-523-2515 #1750 / Cell: 819-676-6838 Portneuf Elementary School Linda Beaulieu Christian Trepanier Portneuf CLC 35, rue Richard, Cap Santé G0A 1L0 [email protected] [email protected] IP: 206.167.67.81 418-285-2313, #8910 418-285-2313 - #8922 (office) / #8923 (VC room) Stephen Renaud Michelle Mathieu Thetford A.S. Johnson Memorial/St-Patrick Elementary [email protected] [email protected] Mines CLC 919, rue Mooney Ouest, Thetford Mines G5G 6E3 418-335-5366 / 418-331-0744 Cell: 418-333-3012 Valcartier Elementary Julie Carpentier Jayne Doddridge Valcartier CLC 1748 boul. -

EMSB EXPRESS | Vol
Commission scolaire English-Montréal ~ English Montreal School Board EMSB www.emsb.qc.ca volume 16 | number 2 | Spring 2014 Find us on: TheThe Arts Arts Are Are Alive Alive Spreading positivity, one post-it at a time @@EMSBEMSB Laurier Macdonald student Stefania Restagno becomes a media sensation Like all International Baccalaureate students, Stefania Restagno was required to undertake a personal project. Yet, for this Grade 11 student at St. Leonard’s Laurier Macdonald High School, her project has become anything but personal. Carrying a backpack full of post-it notes and pens, Stefania’s goal was to mirror the “Operation Beautiful” project, a viral initiative created by American parent Caitlin Boyle, in which she began posting positive messages in public bathrooms, hoping it would catch on. “If I could help at least one person, that would be amazing,” said Stefania. “Just the thought of having someone write a positive Stefania Restagno’s project has attracted national media attention. Rock star Jonas and actress/radio show host/James Lyng High School grad Marina Orsini meet some members of the Coronation Elementary School Steel Pan Band at the Arts Are Alive@EMSB press conference. On the eve of the annual various opportunities for students incorporated Urban Arts into Kindergarten Registration Week, to share their talents on a larger its Extra-Curricular Activity English Montreal School Board scale through vernis sages, programming. One of its feeder Chairman Angela Mancini festivals, poetry slams, shows and elementary schools, St. Gabriel hosted a press conference at concerts,” stated Ms. Mancini. in Pointe St. Charles, is doing which time she introduced a new “The arts bring out empathy, the same thing. -

Qfhsa News Spring 2015
THE VOICE OF THE PARENT IN EDUCATION VOLUME 53 ISSUE 1 SPRING 2015 The Quebec Federation of Home and School Associations will be having its Annual General Meeting on May 2, 2015. Why is this important to you, the average Home and School member? It is at the AGM that policy and direction for your provincial organization is determined. Why should the direction of the provincial organization be of interest to you? It should be of interest because delegates from each member association will be gathering In This Issue together to hear about the work of the QFHSA and hear from their sister organizations. They will vote on changes to the QFHSA Constitution and Bylaws and get advice on their own President’s Message... p. 2 governing Constitution and By-laws . They will debate resolutions that, once passed, will Executive Director… p. 3 become policy for ALL Home and School Associations. They will share ideas, concerns and find solutions. Membership Services..p. 4-5 The AGM is where delegates get a chance to see the “Big Picture”, where local concerns E-books pros and cons … p. 5 are brought to the provincial level and provincial concerns are brought to the national level, Resolutions….p. 6-7 through our membership with the Canadian Home and School Federation. Last year QFHSA passed a resolution supporting the teaching of Financial Literacy in Elementary and High History Corner … p. 10 schools. This year, the Canadian Home and School Federation will be proposing the members EPCA Note … p. 12 of the national organization pass a similar resolution. -

Rapport Annuel-08-09 Francais.Pdf
Le mot des coprésidents À la veille de ses quinze années d’existence, La Fondation de la tolérance poursuit sa croissance et nous sommes très fiers d’y être associés. En effet, ses principales activités continuent à susciter un intérêt unique auprès des élèves des écoles secondaires à travers le Québec. Tout comme nous, nos partenaires scolaires sont convaincus que la tolérance est un combat au quotidien qui passe par la connaissance de l’autre ; aussi, croyons-nous que l’éducation à la différence est l’une des solu- tions pour combattre toute forme de discrimination. Nous sommes persuadés que notre message d’ouverture amène nos jeunes à être plus solidaires et plus soucieux des libertés publiques et à per- cevoir les avantages dont ils pourraient eux-mêmes bénéficier à vivre dans une société plus ouverte et fière des ses différences. L’année financière 2008-20091 a été marquée par trois faits notables. Le premier est la création du Prix de la Tolérance Paul Gérin-Lajoie. Décerné annuellement, ce prix honorera une personnalité qué- bécoise pour sa contribution exceptionnelle à la promotion des valeurs humanistes de tolérance, de lutte contre toute forme de discrimination et de rapprochement entre les Québécois et Québécoi- ses de toutes origines et de toutes conditions. Le second est la mise sur pied d’un conseil des Gou- verneurs composé de personnalités réputées qui ont accepté de souscrire publiquement à la mission de l’organisme. Le troisième est la mise sur pied de la première campagne majeure de financement pour l’année financière 2009-2010. Finalement, nous tenons à remercier nos donateurs pour leur générosité, les membres du conseil d’administration pour leur implication ainsi que les employés de La Fondation de la tolérance pour leur professionnalisme et leur dévouement au quotidien. -

Home and Schools 1945-2019
HOME AND SCHOOLS 1945-2019 QUEBEC Home and schools may come and go over the years, but their contributions to their schools have not been forgotten. Here is a list of all the historic Home and School Associations. Those in blue ink are still active. A.B.C. 1956-1970 Bourlamarque see Val d’Or Abitibi Area 1973-1974 Briarwood 1958-1970 Adath Israel 1956-1962 Bronx Park 1956-1975 Ahuntsic 1956-1974 Brownsburg High 1956-1968 Alexander Galt 1977-1978 Buckingham Elementary 1999- Alexander Wolf (Camp 1956-1969 Valcartier) Buckingham High 1956-1971 Algonquin 1956-1980 Bury High 1956-1963 Allancroft 1961-1977 Butler 2017- Allion 1998- Butler (Bedford) 1956-1970 Camp Valcartier see Amherst 1956-1963 Alexander Wolf Arundel 1999- Campbell’s Bay 1959-1971 Asbestos Danville Shipton 1956-1984 Candiac Champlain 1960-1968 Ayers Cliff 1956- Elementary Aylmer Eardley Elementary 1968-1973 Carlyle 1956-1995 Aylmer High 1956-1965 Cartierville 1956-1971 Bagotville Corbet Memorial 1956-1967 Cecil Newman 1958-1970 1961-1971, Baie Comeau 1970- Cedar Crest 2019- Bancroft 1956-1958 Cedar Park 1956-1979 Bancroft 1968-1969 Cedar Street – Beloeil 1969 Bannantyne 1956-1969 Centennial Park 1967-1972 Barclay 1956-1966 Central Park 1956-1968 Baron Bing High 1956-1967 Champlain 1979 Beacon Hill 1967- Champlain Street 1978 Beaconsfield – Briarwood 1958-1980 Chelsea 1961- Beaconsfield Ecole Cherrier see St-Paul 1980- Primaire L’Ermite Beaconsfield Elementary 1966-1979 Chibougamau 1959-1968 Beaconsfield High 1956- Children’s World 2018- Beauharnois Intermediate 1956-1961 Chomedey -
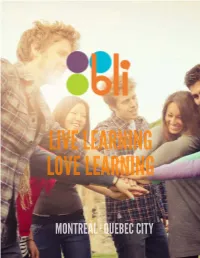
French, We Have a Program for You
LIVE LEARNING LOVE LEARNING MONTREAL · QUEBEC CITY BLI.... "A learning experience that goes beyond the classroom and your expectations" A UNIQUE LEARNING STUDYING AT BLI EXPERIENCE Wide variety of program options BLI offers a vast variety of programs to suit your needs. At BLI you will find the program you are looking for. Two different locations · Two different Languages Whether you want to learn English or French, we have a program for you. Social Program Live the language you are learning by participating in our social program that offers great activities every day. Counselling We make sure you receive all the support you need while you live this learning experience. Housing services Our housing department offers different housing options for you to choose from. Transfers We pick you up and drop you off at the airport to make your travel experience to Canada as easy and safe as possible. Visa and CAQ assistance If you need a visa or study permit to come to Canada, we can help you with the process. Health Insurance We can take care of your medical insurance, which is mandatory for all international students coming to Canada. BLI offers all you need to live an amazing learning experience abroad. For more than 39 years, BLI has offered quality language programs paying close attention to your needs and learning styles. Ca na d a ....is one of the best places in the world to live ....offers a very high standard of living ....warmly welcomes students from all over the world ....is a beautiful place and has a great environment ....is a very safe country for you to live in ....is a high tech country ....is a bilingual country Montreal is a city full of contrasts. -

CRC Robotics 2014 Winners V2
821 Ste-Croix, St-Laurent QC H4L 3X9 Tel: 514.744.7500 Fax: For514.744.7505 Immedia te Release [email protected] www.vaniercollege.qc.ca VANIER NEWS RELEASE CÉGEP / COLLEGE 821 Ste-Croix, Montréal QC H4L 3X9 Tel: 514.744.7500 Fax: 514.744.7505 [email protected] www.vaniercollege.qc.ca Robots lift, push, pile and build their way to the top at the 13th Annual CRC Robotics Competition Montreal, February 28, 2014. It was noisy, chaotic, riveting and fun as 700 keen and driven students and their robots pushed, lifted and rolled their way to success at the 13th Annual CRC Robotics Competition, February 20 to 22, 2014. Thirty-one teams from twenty-eight high schools and Cegeps participated in a roof-raising competition that is one of the liveliest and most entertaining high tech contests around. "The Robotics Competition is a great event,” said Vanier organizer Stephen Newbigging. “It’s always amazing to see what the teams come up with in terms of their robots and their kiosks. The sky is the limit, or in the case of MacDonald High School, which always has an imaginative approach to the competition, the roof of the Sports Complex was the limit with a kiosk that was almost twenty feet high!” Organizers were thrilled with this year’s entries and impressed with the kind of cooperation demonstrated between the competing schools and the teamwork among the participants. Everywhere you looked there was a flurry of activity: teams were assembling and hosting their kiosks, groups of students huddled over their robots, going back and forth between their creation and a tool box, making final adjustments before the heats; others were carrying their prize robot onto the playing field. -

The Loyola News
The Loyola News Loyola High School’s Official Student Newspaper Visit us online at news.loyola.ca December 14, 2010 Christmas Season Consumerism Volume VIII, Issue III largely apocryphal, Christmas the hands of callous, capitalistic And the angel answered her, shopping does account for a rela- marketing executives, repeated “The Holy Spirit will come tively large portion of today even by preco- upon you, and the power of the retailers' annual reve- cious young children. Most High will overshadow nues, namely, an aver- you; therefore the child to be At risk of age of 20%. born will be called holy–the appearing arrogant, I Son of God. Luke 1:35 Yes, money can vouch for the does drive the world's overwhelming likeli- economic engine, and hood that such argu- retailers will always ments have been re- Inside this issue: be intent on ensuring peated by generation the presence of par- after generation of ents purchasing gifts to avoid the exasperated parents seeking an Current News 1-3 sight of Dickensian hatred in entity on which they could lay their children's eyes come Christ- blame for their plight. $34.5 bil- mas Day, but the puritanical reac- lion is a surprisingly small Arts and Culture 4-9, By Chris Scarvelis tion of many at the perceived amount of gross national expen- 12-13 blight of consumerism is over- diture on a holiday that many $34.5 billion: the amount of done at best, and fanatical at now associate with unrestrained Christmas Puzzles 10-11 money spent by Canadians in worst. -

October 29.2010.Pub
LOYOLA HIGH SCHOOL’S OFFICIAL STUDENT NEWSPAPER October 29, 2010 Volume VIII, Issue II The Loyola News THE HALLOWE’EN EDITIEDITIONON “Hold on, man. We don't go anywhere with "scary," When Video Games Control You "spooky," "haunted," or "forbidden" in the title. “ ~From Scooby-Doo By Kevin Khoury many of the behaviours we feel are being performed excessively. With the increasing popularity of As humans, we tend to look for- Inside this issue: video games among teenagers, ward to and repeat activities that the Loyola News decided to go give us pleasure, and avoid those one-on-one with Mr. which cause us displeasure. I Current News 1-3 Greczkowski in order to gather know many students for whom more information on the serious certain activities take up a lot or topic. According to the NPD , a too much time, but cannot be New Teacher 3 market research group, 63% of called addictions, at least not by a Feature Americans play videogames. It counsellor or psychologist. In has come to the point where fact, we speak of internet and Arts and Culture 4 some teens and adults are being gaming "addicts", yet our health controlled by video games. So system has yet to officially name State of the Nation 4 this begs the question: are you this as a disorder (though there is talk of it). controlling the video game, or is Fun Pages 6-7 the video game controlling you? Such an addiction, as How would you say video game might be defined by health and In short, the person's life would On the Road 8 addiction affects relationships? mental health professionals, revolve around gaming, like the would mean the person plays the life of a gambling or substance Let me begin by asserting that the game compulsively, despite abuse addict.