Route Départementale 7
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Festival D'aix
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2017 69th edition 3 – 22 JULY 2017 PRESS RELEASE www.festival-aix.com PRESS OFFICE Valérie Weill | [email protected] +33 (0)1 44 88 59 66 | +33 (0)6 85 22 74 66 Christine Delterme | [email protected] CONTENTS THE INSTITUTION PAGES 4 - 5 CALENDAR PAGES 6 - 8 OPERA PAGES 9 - 15 CONCERTS PAGES 16-17 AIX EN JUIN PAGES 18 - 21 ACADEMIE DU FESTIVAL PAGES 22-30 PASSERELLES PAGES 31-34 TALKS AND EVENTS PAGE 35 TOURS IN 2017 PAGE 36 ESTIMATED BUDGET 2017 PAGE 37 SUSTAINABLE DEVELOPMENT PAGES 38-39 SPONSORS AND PARTNERSHIPS PAGES 40-47 PRICES PAGE 48 PRACTICAL INFORMATION PAGE 49 3 FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2017 THE FESTIVAL D’AIX KEY FIGURES 2016 | by 31 December 2016 | | ATTENDANCE | | PASSERELLES | 75,526 SPECTATORS 3,200 STUDENTS FROM 133 CLASSES of 87 educational institutions (schools, secondary 40% OF TICKETS SOLD FOR LESS THAN 55 ¤ schools, highschools, music schools, universities, 534 YOUNG PEOPLE ENJOYED THE conservatoires) « CHILDREN DISCOVERY » RATE including 1,170 students from Aix-Marseille 39,972 TICKETS FOR OPERAS AND CONCERTS Université (370 through the Opera ON programme) ( not including the Académie ) 2,250 YOUNG ADULTS AND ADULTS 35,554 SPECTATORS FOR AIX EN JUIN, THE BENEFITED FROM THE RAISING AWARENESS ACADEMIE, THEIR PUBLIC REHEARSAL AND OF OPERA PROGRAMME THEIR LIVE BROADCASTING as well as 110 associations and social partners 220 AMATEUR ARTISTS | AIX EN JUIN | 1 450 SPECTATORS 17 004 SPECTATORS or the opening performance Ouverture[s] including 12,736 for free performances 3 000 -
Ligne 180 (Gardanne-Meyreuil-Aix)
GARDANNE 180 AIX-EN-PROVENCE HORAIRES Valables à partir du 29 août 2016 FFRE O R E N F O R C É E OUVEA Gardanne N U P+R KRYPTON T Meyreuil E R MIN U S Aix-en-Provence CAR Toutes les infos sur www.paysdaix.fr / www.lepilote.com GARDANNE 180 AIX-EN-PROVENCE 2 LE PILOTE.COM - N°AZUR 0 810 00 13 26 LE PILOTE.COM - N°AZUR 0 810 00 13 26 3 180 GARDANNE AIX-EN-PROVENCE Toulon Le Stade La Croix PuskaricLe Canet 8 mai 1945 Beausoleil MEYREUIL Bel Ormeau GARDANNE Saint-Joseph Hôtel de Ville Saint-Benoit Coton RougeP+R Krypton Lycée Fourcade Plan de Meyreuil CollineAvenue des Frères des ÉcolesCôteaux de Veline École Saint-Joseph AIX-EN-PROVENCE Gare Routière SNCF Anciens Combattants Les Côteaux Rouges LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN AU AU TLJ TLJ AU AU AU TLJ AU AU SAM SAM SAM SAM SAM SAM SAM GARDANNE Gare Routière SNCF 06:50 07:45 08:45 11:10 12:50 14:15 16:25 17:35 18:35 19:20 Avenue des Écoles 06:52 07:47 08:47 11:12 12:52 14:17 16:27 17:37 18:37 19:22 Lycée Fourcade 06:54 07:49 08:49 11:14 12:54 14:19 16:29 17:39 18:39 19:24 École Saint-Joseph 06:57 07:52 08:52 11:17 12:57 14:22 16:32 17:42 18:42 19:27 MEYREUIL Plan de Meyreuil 07:00 07:55 08:55 11:20 13:00 14:25 16:35 17:45 18:45 19:30 La Croix 07:02 07:57 08:57 11:22 13:02 14:27 16:37 17:47 18:47 19:32 Hôtel de Ville 07:07 08:02 09:02 11:27 13:07 14:32 16:42 17:52 18:52 19:37 Le Canet 07:15 08:10 09:10 11:35 13:15 14:40 16:50 18:00 19:00 19:45 Pont de Bayeux – – 09:12 11:37 13:30 14:42 – – – – LE THOLONET Maison Pezet – – 09:16 11:41 13:32 14:46 – – – – AIX-EN-PROVENCE Beausoleil 07:30 08:30 09:30 11:50 13:30 14:55 17:05 18:15 19:15 19:55 Coton Rouge 07:32 08:32 09:32 11:52 13:32 14:57 17:07 18:17 19:17 19:57 P+R Krypton 07:35 08:35 09:35 11:55 13:35 15:00 17:10 18:20 19:20 20:00 Les horaires sont calculés pour des conditions normales de circulation. -

Lambesc Maintient Le
2 INFOS PRATIQUES Lambesc Magazine n°13 mars/avril/mai 2017 ÉTAT CIVIL Simone Préau Ils sont nés Née le 14 février 1920, Simone PRÉAU, AUDIER de son TAFTAF Malak le 04/10/2016 nom de jeune fille, aurait eu 97 ans cette année. Lambescaine BOTA Maximilien le 06/10/2016 de naissance et maman de quatre garçons, Simone Préau VENDEMBILQUE Anissa le 25/10/2016 savait gérer son temps entre une vie professionnelle durant JEBARI Noé le 1er/11/2016 laquelle elle a beaucoup apporté aux autres, une vie familiale EL MEJJATI Léa le 1er/11/2016 bien remplie et la passion d’élue au service de sa commune. RAMOND Juliette le 02/11/2016 VILAPELLEJA Thomas le 21/11/2016 Simone Préau a marqué la vie politique de Lambesc : élue pour la première fois en MAZOCKY Alessio le 11/12/2016 1965, elle remporte à chaque fois tous les suffrages. Elle assure ainsi 5 mandats en PEQUIGNOT Angèle le 20/12/2016 tant que deuxième Adjointe et reste 30 ans au service de notre municipalité. Dès 1983, elle se consacre aux Affaires Sociales, domaine où son écoute, son sens Ils se sont mariés du détail, son dévouement n’avaient pas de limite. ALONSO Clément avec MAZZUCCO Audrey le 29/10/2016 Elle maîtrisait parfaitement sa fonction avec beaucoup de discrétion, de générosité, MAS Philippe avec COMBY Mélinda le 29/10/2016 luttant contre l’injustice et toujours présente sur le terrain. BENYAHYA Hamza avec MOUISSAT Myriam le Elle a contribué à réaliser le Service d’Aide à Domicile, le Foyer Restaurant 17/12/2016 l’Oustalet, la Maison de retraite l’Ensouleïado, l’aide aux personnes âgées, handicapées ou dans le besoin. -

Beaurecueil, Châteauneuf Le Rouge, Fuveau, Peynier, Pourcieux, Pourrières, Puyloubier, Rousset, St Antonin Sur Bayon & Trets
Beaurecueil, Châteauneuf le Rouge, Fuveau, Peynier, Pourcieux, Pourrières, Puyloubier, Rousset, St Antonin sur Bayon & Trets Activités au programme des Multi-Sports suivant les thèmes : Athlétisme, Basket, Base-ball, Course d’orientation, Flag, Foot, Gym sportive, Hand, Rugby, Sports d’opposition, Tchoukball, Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Volley, Vélo. MULTI-SPORTS - 4/6 ans et 7/13 ans Les 20 & 21/10 ou 31/10 & 02/11 - Du 24 au 28/10 1/2 40 ! les 2 jours - 100 ! les 5 jours - 60 ! les 5 journées LES MULTI-SPORTS A THEMES - Du 24 au 28/10 MULTI-SPORTS & ARTISTIQUE - 140 ! 4/6 ans : Mobile fleurs et oiseaux - 7/13 ans : Montgolfières colorées (Réalisation avec matériaux de récupérations) MULTI-SPORTS MULTI-SPORTS & ESCALADE & BMX 7/13 ans - 160 ! 7/13 ans - 135 ! MULTI-SPORTS MULTI-SPORTS & ÉQUITATION & JEUX CRÉATIFS 7/13 ans - 190 ! 7/13 ans - 110 ! MULTI-SPORTS MULTI-SPORTS & EVEIL MUSICAL & PETITS GEEK 4/6 ans - 130 ! 7/11 ans - 155 ! MULTI-SPORTS MULTI-SPORTS & TENNIS & TIR A L’ARC 7/13 ans - 130 ! - Débutant 105 ! - 7/13 ans Selon les thèmes : - Horaire de 9 h à 17 h 45 - Garderie de 8 h à 9 h et/ou de 17 h 45 à 18 h 45 - Transport possible au départ de TRETS - Lieu : FUVEAU - Gymnase du Collège Font d’Aurumy - Repas : 22,50 !/semaine - Garderie/Transport : 20 ! / semaine ARTISTIQUES ENFANTS - A Rousset - 9 h/12 h et/ou 14 h/17 h - 7/14 ans 1/2 1/2 20 ! les 2 journées - 50 ! les 5 journées - 40 ! les 2 jours - 100 ! les 5 jours Du 20 et 21/10 : Matin / Après-midi : Modelage sur le thème d’ Halloween (terre) Du 24 au 28/10 : Matin : Tournage / Après-midi : Découpage, peinture. -

Regroupement De Communes Entre Lesquelles Les Frais De Deplacements Lies Aux Actions De Formation Continue Ne Sont Pas Rembourses
IA13/DP2/FC REGROUPEMENT DE COMMUNES ENTRE LESQUELLES LES FRAIS DE DEPLACEMENTS LIES AUX ACTIONS DE FORMATION CONTINUE NE SONT PAS REMBOURSES En gras souligné: commune de référence = lieu de stage En italique : communes n'ouvrant pas droit à des frais de déplacement vers la commune de référence * Communes non rattachées à une commune de référence AIX-EN-PROVENCE CASSIS GEMENOS MARSEILLE ROGNES TARASCON BOUC-BEL-AIR AUBAGNE AUBAGNE ALLAUCH AIX-EN-PROVENCE ARLES CABRIES CARNOUX-EN-PROVENCE AURIOL AUBAGNE GARDANNE BOULBON EGUILLES CEYRESTE CASSIS CASSIS LA ROQUE-D'ANTHERON GRAVESON FUVEAU GEMENOS CUGES-LES-PINS GARDANNE LE PUY-SAINTE-REPARADE SAINT-ETIENNE-DU-GRES GARDANNE LA CIOTAT MARSEILLE GEMENOS SAINT-ESTEVE-JANSON SAINT-MARTIN-DE-CRAU LE PUY-SAINTE-REPARADE LES PENNES MIRABEAU ROQUEVAIRE LA CIOTAT VITROLLES TRETS LE THOLONET MARSEILLE ISTRES LA PENNE-SUR-HUVEAUNE SAINT-MARTIN-DE-CRAU PEYNIER LES PENNES MIRABEAU ROQUEFORT-LA-BEDOULE FOS-SUR-MER LE ROVE ARLES ROUSSET MARIGNANE SIMIANE-COLLONGUE MIRAMAS LES PENNES-MIRABEAU EYGUIERES VITROLLES MEYREUIL CHATEAUNEUF LES MARTIGUES PORT-DE-BOUC PLAN-DE-CUQUES ISTRES AIX-EN-PROVENCE ROGNAC GIGNAC-LA-NERTHE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE SEPTEMES-LES-VALLONS MIRAMAS CABRIES ROGNES MARIGNANE SAINT-MARTIN-DE-CRAU SIMIANE-COLLONGUE SALON-DE-PROVENCE GARDANNE SAINT-CANNAT MARTIGUES SAINT-MITRE-LES-REMPARTS VITROLLES SAINT-REMY-DE-PROVENCE LES PENNES-MIRABEAU SAINT-MARC-JAUMEGARDE PORT-DE-BOUC LA CIOTAT MARTIGUES EYGALIERES MARSEILLE SIMIANE COLLONGUE VITROLLES AUBAGNE CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES EYRAGUES -
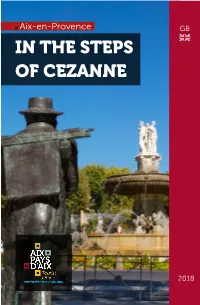
In the Steps of Cezanne
Aix-en-Provence GB IN THE STEPS OF CEZANNE 2018 IN CEZANNE'S COUNTRY (1839 - 1906) Paul Cezanne was passionately attached to Aix and his Provence, and summed his love up in a single sentence when he was away: ”When you’re born there, it’s hopeless, nothing else is good enough”. It was while walking in the Aix countryside as a teena- ger with Émile Zola that he realised he was an artist. The particular light of Provence guided him on his creative path to the threshold of abstraction. And it is in Aix-en-Provence and the surrounding area that you can share Cezanne's experience intensely today, as you visit the streets, places and landscapes that marked the life, the outlook and the work of the father of modern painting… ”the father of us all!” Picasso said. 2 | | 3 IN THE HEART OF AIX-EN-PROVENCE The town is home to several precious historical sites which embody the mysteries surrounding Cezanne. For today’s visitor, forays into this emblematic painter’s universe include discove- ring the Cezanne's Studio on the old Lauves hill or exploring the open-air Bibémus quarries. Walk in the steps of Cezanne and visit the city as he expe- rienced it… A pedestrian route marked by studs stamped with a “C” allows you to discover the landmarks of his early years (the houses where he lived as a child, his schools, etc), the places that marked him, the addresses of his family and ac- quaintances, the cafés where he met his friends and other artists… From classical elegance to Baroque opulence, Aix’s architectural heritage is the setting for your walk in the old town and its surroundings. -

Vacances D'hiver Pour Chacun Les Dangers Du
Meilleurs Vœux 2019 ! JANVIER 2019 • N° 149 Les Dangers du Monoxyde de Carbone Vacances d’hiver pour chacun évènement Don de sang, Rencontre d’un chef étoilé & dégustation ! La prochaine collecte de sang organisée par Recherche de bénévoles l’Etablissement Français du Sang (EFS) se déroulera le mercredi 30 janvier 2019 de 15h à 19h30 à la salle L’association des donneurs de sang de Meyreuil a Jean Monnet. besoin de vous ! Pourquoi ne pas venir renforcer l’équipe ? L’association a besoin d’aide pour effectuer de A cette occasion, la Municipalité vous propose, l’affichage, informer les Meyreuillais des jours de collecte gratuitement, une animation culinaire par Jean-Marie et de présence lors des opérations de don du sang. Aucun MERLY, Chef étoilé, Compagnon du Tour de France besoin de connaissances médicales pour les aider et Des Devoirs Unis. adhérer ! De la volonté et un peu de temps suffisent ! A la suite de votre don, vous pourrez rencontrer Renseignement : Service Social Jean-Marie Merly et déguster ses délicieux mets préparés Christine ANTON - [email protected] tout au long de l’après-midi. 04 42 65 90 62 Dès 19h, un apéritif sera offert par la Municipalité, avec Entrée libre. la participation du Chef, et clôturera la journée. Association des Donneurs de Sang Meyreuil : Venez nombreux pour la bonne cause ! 06 07 70 21 09 sports et loisirs Des vacances d’hiver pour chacun ! UN STAGE À LA DÉCOUVERTE DES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR ADOS/SENIORS UN STAGE SPORTIF MULTI-SPORTS POUR ADO L’OMSC vous propose, mercredi 20 et jeudi 21 février de 10h à 12h - 14h à 16h et 16h à 18h salle Mistral, la pratique de jeux de société. -

Publication of an Application for Registration of a Name Pursuant to Article 50(2)(A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of The
C 26/8 EN Offi cial Jour nal of the European Union 27.1.2020 Publication of an application for registration of a name pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 26/05) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months of the date of this publication. SINGLE DOCUMENT ‘BROUSSE DU ROVE’ EU No: PDO-FR-02424 – 28.6.2018 PDO (X) PGI () 1. Name(s) ‘Brousse du Rove’ 2. Member State or third country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product [as in Annex XI] Class 1.3: Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Brousse du Rove’ is a goat’s cheese presented in its original cornet used for moulding. The cornet is a truncated cone mould measuring 32 mm (diameter at the top) x 22 mm (diameter at the bottom) x 85 mm (height), with three holes pierced in the base. The cheese is produced using the milk flocculation method after heating and adding white alcohol vinegar as an acidifier. It contains a maximum of 30 grams of dry matter per 100 grams of cheese, and a minimum of 45 grams of fat per 100 grams of cheese when completely dry. Its weight is 45 to 55 grams at the end of the moulding process. -
Ligne 161 2017.Pdf
TRETS PÔLE D’ACTIVITÉS 161 D’AIX-EN-PROVENCE HORAIRES Valables au 1er septembre 2017 A OR IRE H S VACANCES Trets SCOLAIRES A D Peynier A P T É S Rousset Fuveau Meyreuil Gardanne Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence CABUSR Toutes les infos sur www.paysdaix.fr / www.lepilote.com TRETS PÔLE D’ACTIVITÉS 161 D’AIX-EN-PROVENCE 2 LE PILOTE.COM - N° 0800 713 137 LE PILOTE.COM - N° 0800 713 137 3 TRETS PÔLE D’ACTIVITÉS 161 D’AIX-EN-PROVENCE Eiffel TRETS VacherImbertPerroy Arago La Croix AmpèreBerthier Fresnel Le VallatPEYNIER Le Lavoir La PlaineFUVEAU Pichaury Foucault Magellan Philibert La LecqueLe Village ROUSSET Rampelin Bessemer La Robole De Broglie Descartes MEYREUILGARDANNESaint-André Les Grottes Archimède Halte RoutièreCassin quai 3 La Corneirelle Luynes LycéeTrois Pigeons Maison d’arrêt Le Vieux Moulin Hameau de Turin Parc Club du Golf Ecole de la Barque CimetièrePÔLE Militaire D’ACTIVITÉS HameauAIX-EN-PROVENCE de Valabre Europôle de l’Arbois D’AIX-EN-PROVENCE Rond Point des Phocéens PÉRIODE HORS VACANCES SCOLAIRES PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN AU AU AU AU AU AU AU AU VEN VEN VEN VEN VEN VEN VEN VEN TRETS TRETS Halte Routière 7:00 7:20 7:50 8:20 Halte Routière 7:00 7:20 7:50 8:20 Le Vallat 7:01 7:21 7:51 8:21 Le Vallat 7:01 7:21 7:51 8:21 PEYNIER PEYNIER Le Village 7:06 7:26 7:56 8:26 Le Village 7:05 7:25 7:55 8:25 La Corneirelle 7:11 7:31 8:01 8:31 La Corneirelle 7:09 7:29 7:59 8:29 ROUSSET ROUSSET Perroy 7:13 7:33 8:03 8:33 Perroy 7:11 7:31 8:01 8:31 FUVEAU FUVEAU Ecole de La Barque 7:20 7:40 8:10 8:40 Ecole -

Recueil Des Actes Administratifs N°13-2019-004
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°13-2019-004 BOUCHES-DU-RHÔNE PUBLIÉ LE 8 JANVIER 2019 1 Sommaire Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 13-2018-12-27-011 - DS N°405 - Mme SABATIER CH SALON DE PROVENCE (2 pages) Page 4 13-2018-12-27-012 - DS N°406 - M. VIOUJAS CH SALON DE PROVENCE (2 pages) Page 7 13-2018-12-27-013 - DS N°407 - M. VEUILLET CENTRE GERONT DEPART (2 pages) Page 10 13-2018-12-27-014 - DS N°408 - M. GREGOIRE CENTRE GERONT DEPART (2 pages) Page 13 13-2018-12-27-015 - DS N°409 - M. TURZO CH EDOUARD TOULOUSE (2 pages) Page 16 13-2018-12-27-016 - DS N°410 - M. STASSI CH EDOUARD TOULOUSE (2 pages) Page 19 13-2018-12-27-017 - DS N°411 - M. GELIN CH MARTIGUES (2 pages) Page 22 13-2018-12-27-018 - DS N°412 - Mme RIBES CH MARTIGUES (2 pages) Page 25 13-2018-12-27-019 - DS N°413 - Mme ROBIN CH ALLAUCH (2 pages) Page 28 13-2018-12-27-020 - DS N°414 - Mme DI MATTEA CH ALLAUCH (2 pages) Page 31 13-2018-12-27-021 - DS N°415 - Mme SABOT CH AIX (2 pages) Page 34 13-2018-12-27-022 - DS N°416 - Mme AILLOUD CH AIX (2 pages) Page 37 13-2018-12-27-023 - DS N°417 - Mme BONTOUX CH LA CIOTAT (2 pages) Page 40 13-2018-12-27-024 - DS N°418 - M. BARESTE CH LA CIOTAT (2 pages) Page 43 13-2018-12-27-025 - DS N°419 - M. -
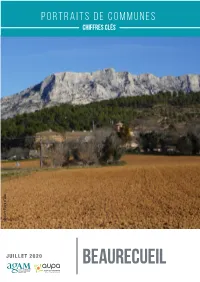
Beaurecueil La Commune
PORTRAITS DE COMMUNES CHIFFRES CLÉS photo : Pays d’Aix JUILLET 2020 BEAURECUEIL LA COMMUNE CARTE D’IDENTITÉ u Canton de Trets, arrondissement d’Aix-en-Provence u Maire : Eglantine ROCCHIA u Habitant : Beaurecueines, Beaurecueins u Population (2016) : 578 habitants dont moins de 20 ans : 14 % de 20 à 39 ans : 16 % de 40 à 65 ans : 33 % plus de 65 ans : 37 % u Superficie : 9,9 km² u Densité de population : 58 habitants/km² u Altitude mini : 200 m - maxi : 669 m PLUS D’INFOS : www.mairie-beaurecueil.fr HOTEL DE VILLE ACCESSIBILITÉ u Accès autoroute (A8) : 20 à 25 minutes u Gare TER de Aix-Ville : 20 à 30 minutes u Gare de Aix-TGV : 20 à 30 minutes u Aéroport de Marseille-Provence : 30 à 40 minutes RÉPARTITION DE L’ESPACE SAINT-MARC-JAUMEGARDE LE THOLONET BEAURECUEIL MEYREUIL CHATEUNEUF-LE-ROUGE 0 1 km 2 km Source : OCSOL 2014 CRIGE Paca SUPERFICIE TOTALE VAUVENARGUES 986 hectares ESPACES NATURELS % 79 SOIT 769 ha dont zones humides : 0 ha ESPACES AGRICOLES % 13 SOIT 133 ha ESPACES URBANISÉS HABITAT % 7 SOIT 70 ha SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON ESPACES URBANISÉS ACTIVITÉS % 1 SOIT 14 ha Cette carte a été conçue à partir de la base de données BD-OCSOL PACA. Elle doit être considérée comme une carte de connaissance du territoire permettant de visualiser aisément les zones urbaines, naturelles et agricoles. La nomenclature se base sur l’occupation CHATEUNEUF-LE-ROUGE de l’espace et non pas sur le zonage réglementaire. Elle peut donc présenter quelques différences avec les cartes du zonage du PLU en vigueur dans la commune. -

Sainte Victoire
RéseauRéseau SAINTE SAinte-Victoire VICTOIRE Joucas Villars St-Michel-l'Observatoire Réseau SAINTE VICTOIRE Etablissements publics dans le réseau St-Maime Autres réseaux Maternelle (87) Dauphin Gargas Roussillon Elémentaire (117) Viens CLG (24) Routes principales Lycée (6) Caseneuve Autoroute Reillanne LP (3) Nationale Apt Départementale Afin que les points ne se chevauchentSt-Martin-de-Castillon pas sur 0 5 Saignon Goult la carte, les établissements ont pu être Céreste déplacés par rapport à leur emplacement réel. Réseau GIONO kilomètres Montfuron Réseau LE LUBERON Manosque Lacoste Bonnieux Pierrevert Peypin-d'Aigues 196 Ste-Tulle Cabrières-d'Aigues 151 Vaugines La Bastide-des-Jourdans 102 La Motte-d'Aigues 229 117 153 Cucuron 214 Corbières Lourmarin St-Martin-de-la-Brasque 145 169 Grambois Puyvert Puget 203 200 162 161 90 Lauris 89 Beaumont-de-Pertuis 112 Ansouis 160 110 111 158 159 Cadenet La Tour-d'Aigues 154 157 Villelaure Charleval 155 156 236 189 178 La Roque- 237 La Bastidonne d'Anthéron Pertuis 188 Mirabeau 187 152 179 à 182 183 à 186 215 St-Paul-lès-Durance Réseau SALON 166 Rognes 163 205 164 204 Le Puy-Ste-Réparade 198 206 199 197 Lambesc Jouques Peyrolles-en-Pce 150 170 149 171 Meyrargues 165 St-Cannat 212 210 211 Venelles 235 231 4 232 39 233 234 8 43 6 Académie de Nice 119 41 121 Éguilles 118 120 2 230 38 47 Vauvenargues Coudoux 213 80 St-Marc-Jaumegarde 7 79 Ventabren 42 75 84 76 85 Puyloubier 201 202 77 88 168 10 à 36 78 87 Le Tholonet Velaux 48 à 73 91 Aix-en-Pce 83 74 167 Beaurecueil 1 37 3 86 44 45 Châteauneuf-le-Rouge