Autour Des Fortifications De Rodemack
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
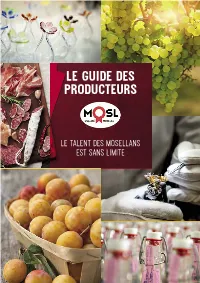
Le Guide Des Producteurs
LE GUIDE DES PRODUCTEURS LE TALENT DES MOSELLANS EST SANS LIMITE Carte d’identité THIONVILLE de la Moselle FORBACH SAINT-AVOLD SARREGUEMINES METZ BITCHE CHÂTEAU-SALINS SARREBOURG Qualité MOSL : 2 un repère pour vous guider 3 1,047 MILLIONS Qualité MOSL vous permet de reconnaître les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et privilégient les productions locales et les savoir-faire propres au territoire. Vous pourrez le D’HABITANTS retrouver sur les produits alimentaires, les lieux de restauration, les sites ou activités touristiques. Le talent des mosellans est sans limite, profitez-en ! 2 6 216 KM DE Le logo Qualité MOSL apposé sur les produits agréés vous garantit une production locale SUPERFICIE de qualité. Chaque produit agréé Qualité MOSL répond à un cahier des charges strict. Il a fait DONT 50% DE l’objet d’un audit par un comité d’agrément constitué de professionnels et d’une procédure 2 400 encadrée par une charte dans laquelle le producteur s’engage à une transparence totale et une SURFACES AGRICOLES EXPLOITATIONS information claire sur l’origine des matières premières et les méthodes de production. Facilement AGRICOLES reconnaissable par les consommateurs, son logo permet une identification rapide des produits. ET 8 100 EMPLOIS En 2018 : près de 200 producteurs et artisans sont engagés dans cette démarche et près de 1000 DIRECTS produits portent l’agrément Qualité MOSL. 19 000 ENTREPRISES L’agrément Qualité MOSL est piloté par : ARTISANALES ET 100 000 SALARIÉS 70 HECTARES DE VIGNES AOC MOSELLE ET 250 000 BOUTEILLES PAR AN L’agriculture et l’artisanat mosellans L’agriculture mosellane, majoritairement quotidiens des populations. -

Tourisme De Mémoire En Moselle 1
TOURISME DE MÉMOIRE EN MOSELLE 1 MOSELLE DÉRACINÉE LA MOSELLE VOUS INVITE À UNE DÉCOUVERTE OU UNE REDÉCOUVERTE ORIGINALE DE SON TERRITOIRE ET DE SON HISTOIRE EDITORIAL Technicité, art militaire, architecture, histoire, patrimoine : les sites mémoriels de Moselle évoquent tout cela à la fois, à des degrés divers selon les lieux. Notre Département a connu des heures de gloire et des moments douloureux ; de nombreux sites en témoignent, qui méritent d’être explorés et commentés. Du génie de Vauban au Père de l’Europe, Robert Schuman, en passant par Maginot, de grands noms ont laissé leur empreinte en Moselle. C’est donc à une découverte ou une redécouverte originale de son territoire et de son histoire que le Département de la Moselle vous invite, en partenariat avec les nombreux animateurs de ces « lieux de mémoire », le plus souvent bénévoles et toujours passionnés. 2020 constituera une année particulière pour notre Département puisqu’elle commémorera, au travers de « Moselle Déracinée », l’un des épisodes les plus marquant et méconnu de la 2nde Guerre Mondiale. Entre 1939 et 1940, plus de 400 000 Mosellans ont été contraints de quitter leur terre natale pour être accueillis dans de nombreux départements français, soit pour être éloignés des combats, soit expulsés par les nazis. Cet exil forcé et douloureux a créé, néanmoins, des liens indéfectibles avec ces territoires d’accueil auxquels nous rendrons hommage tout au long de cette année. Je souhaite que chacun puisse contribuer à la transmission de ces pages de notre histoire à travers -

Guénange À La Canner
1 THI 13 Vendredi 11 Mai 2012 Guénange à la Canner URGENCES STUCKANGE NÉCROLOGIE Mme Henriette Samu 57 Metzervisse : rue des Romains (tél. 03 82 56 80 70). Schivre Tous secteurs : aide médicale Une union dorée à l’or fin urgente (tél. 15). Ambulances METZERESCHE. — Nous Pharmacie Guénange : Guénange ambu- Les époux Hoffbeck se sont rencontrés lors d’un bal. Ils se sont plu et se sont épousés. Le couple a longtemps vécu apprenons le décès de Mme lances (tél. 03 82 50 21 29 Tous secteurs : composer Henriette Schivre survenu le ou 06 84 71 55 82) ; Klein à à Stuckange avant de s’installer à Menskirch, dans le canton de Bouzonville. le 3237. 9 mai à Metz à l’âge de 87 ans. Illange (tél. 03 82 86 66 00) ; ela fait un demi-siècle ment ne se quittent plus. Ils Née Wenner le 8 octobre Sapeurs-pompiers Sérafino à Uckange que les époux Hoffbeck décident de se marier le 1924 à Metzeresche, la défunte (tél. 03 82 86 36 10). Tous secteurs : tél. 18. Cont célébré leur union à 24 avril 1962. avait perdu son époux M. Julien Kédange-sur-Canner : Volmunster dans le Bitcher- Antoinette, née Roth, a vu le Schivre en 1993. De leur union Gendarmeries 57-Assistance land. Des vœux renouvelés en jour le 13 juin 1937. Elle a aidé sont nés neuf enfants dont (tél. 03 87 77 98 18). l’église de Metzervisse à ses parents propriétaires au deux sont décédés. Mme Hen- Guénange : boulevard du Pont Metzervisse : Moselle Ambu- (tél. 03 82 82 64 27). -

(Re)Découvrant Le Territoire De CATTENOM Et ENVIRONS !
Communiqué de presse – Saison estivale Office de Tourisme de Cattenom et Environs – Place des Baillis F-57570 RODEMACK Cet été, on s’amuse en (re)découvrant le territoire de CATTENOM et ENVIRONS ! Depuis 2019, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs offre régulièrement des expériences ludiques et interactives aux visiteurs de son territoire, afin de les transformer en explorateurs du patrimoine local. Cet été, l’expérience immersive se poursuit et de nouvelles aventures interactives et en pleine nature viennent enrichir cette offre. Contact et informations : Office de Tourisme – Place des Baillis 57570 RODEMACK Ouvert tous les jours (week-end et fériés inclus) de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. Tel : 03 82 56 00 02 – Courriel : [email protected] Site web : www.tourisme-ccce.fr - Page Facebook www.facebook.com/TourismeCCCE Communiqué de presse – Saison estivale Office de Tourisme de Cattenom et Environs – Place des Baillis F-57570 RODEMACK Une offre Baludik renouvelée ! Passez un bon moment en famille, entre amis ou en solo, et découvrez les trésors cachés de Cattenom et Environs grâce à l’application Baludik. Armé de votre smartphone, vous pourrez réaliser des missions et débloquer du contenu multimédia : anecdotes et souvenirs, photo ou contenus audio. Après le succès du premier parcours intercommunal, sur les traces du chevalier Arnould 1er, trois nouveaux parcours vous plongent dans l’histoire, la nature et le patrimoine local. De nouvelles aventures s’offrent à vous cet été, et vous permettront de découvrir un aspect différent et inattendu du territoire de Cattenom et Environs. Alors cher visiteur, vous reprendrez bien un peu de balade ? Comment faire ? Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité. -

Communauté De Communes De Cattenom Et Environs
Communauté de Communes de Cattenom et Environs RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS • 2017 2 Le mot du président. Je vous invite à découvrir le rapport d’activités 2017 de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs. Il répond aux obligations légales prévues par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale demandant au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale d’adresser, annuellement au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de la Communauté de Communes. C’est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les actions menées par notre Communauté de Communes aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu’à travers les grands investissements communautaires. L’année 2017 a notamment été marquée par : ▪ la prise de compétences dans le cadre de la loi NOTRe (aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,..) ; ▪ un nouvel accord local et un renouvellement partiel des instances ; ▪ la mise en place du dispositif SOLIDACAR. En plus de ces projets, la Communauté de Communes a poursuivi son engagement au quotidien dans le service et l’action pour le territoire : ▪ poursuite des actions de développement économique pour favoriser la création d’emplois ; ▪ poursuite de son programme pluriannuel de travaux ; ▪ poursuite de sa politique « petite enfance » ; ▪ poursuite de son soutien aux associations sportives d’intérêt communautaire. Ce rapport sera envoyé à toutes les communes membres de notre EPCI afin d’être présenté à l’ensemble des Conseils municipaux. Bonne lecture à toutes et à tous. -

RODEMACK Moselle
PHIL@POSTE Communiqué de presse Mai 2020 RODEMACK Moselle Le 29 juin 2020, La Poste émet un timbre de la série touristique consacré à Rodemack « La petite Carcassonne de Lorraine ». Réf. : 11 20 042 Visuels d’après maquettes - Couleurs non contractuelles/disponibles sur demande Un peu d’histoire … Communément appelée « la petite Carcassonne lorraine », Rodemack, cité médiévale, se trouve au cœur du Pays des Trois Frontières, à proximité du Luxembourg et de l’Allemagne. 3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69 La Poste - Société anonyme au capital de 5 364 851 364 euros - 356 000 000 RCS PARIS Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00 Au XIIe siècle, les seigneurs de Rodemack, vassaux du comte de Luxembourg, en firent une place forte. En 1492, Bernard, le dernier seigneur de Rodemack, fut dépossédé de toutes ses terres pour cause de félonie – on lui reprochait de s’être allié aux Français – au profit des margraves de Bade. Les Français occupent définitivement Rodemack en 1678. Par sa situation, Rodemack est au carrefour des conflits jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Au pied de l’imposante citadelle se blottit le bourg entouré de 700 mètres de remparts du XIVe siècle, percés de meurtrières et ponctués de tours rondes. C’est par la magnifique porte de Sierck que l’on pénètre dans le village. Cette porte, défendue par deux tours rondes, était nommée autrefois « porte de la Franchise ». -

Gazette Décembre 2019.Cdr
Décembre 2019 - N° 91 Gavissoise Mot du maire Au fil des délibérations Les délibérations sont téléchargeables dans leur intégralité sur le site de la commune : www.gavisse.fr Chère Gavissoise, Cher Gavissois, Réunion ordinaire du 31 janvier 2019 Au moment où je vais quitter prochainement, après une décision mûrement Bilan de la concertation et arrêt du projet du P.L.U. rééchie, mes fonctions électives : élu au conseil municipal le 1er mars 1971, deuxième adjoint au maire le 17 octobre 1997, premier adjoint au Maire le 25 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Ÿ les raisons qui ont conduit la commune à engager la Municipal : mars 2001 et Maire depuis janvier 2004 ; je tiens par la présente à vous procédure de révision du POS valant transformation Ÿ clôture la concertation avec le public ; témoigner tout à la fois ma profonde estime, mais aussi toute ma en PLU ; Ÿ tire le bilan de la concertation annexé à la présente reconnaissance. Ÿ les modalités selon lesquelles la concertation avec la délibération ; A chaque étape de notre vie se présentent ou s'imposent d'autres réalités, mais population a été mise en œuvre et le bilan qu'il Ÿ approuve le bilan de concertation présenté par aussi et encore les mêmes vérités. convient d'en tirer ; Monsieur le Maire ; Merci pour votre bienveillante amitié témoignée au cours de ces 49 années Ÿ le débat qui s'est tenu au sein du conseil municipal dans Ÿ arrête le projet du plan local d'urbanisme de la renouvelées pour offrir les mêmes valeurs. -

Le' Truier' 10RR",'" Bulletin De Recherches Régionales Publié Avec Le Concours De L'académie Nationale De Metz Et De L'université De Metz
Trimestriel N° NOVEMBRE 1979 - 4 lE' tRUIER' 10RR",'" Bulletin de recherches régionales publié avec le concours de l'Académie Nationale de Metz et de l'Université de Metz RODEMACK SON CHATEAU ET Le site de Rodemack date probablement de l'époque gallo-ro maine. Toponymiquement Rodemack (Rodenmacher) se range parmi les noms en maceries (murs): Klein-, Greven-, Kônigs-, Rodenmacher (Macre-le-Petit,-« » = -le-Comte, -le-Roi, -le-Sart ?), à moins qu'il ne s'agisse d'un hydronyme «< Rotenbach Rouge-Eau ?), » = comme le ferait croire sa première mention connue «< Rotinpach ) dans une charte d'échange entre les abbayes de Fulda et d'Echter» nach (907). La seconde citation, en tant que paroisse (915), fait supposer une agglomération déjà considérable. Régulièrement confirmé par les bulles papales en faveur d'Echternach, Rodemack demeura jusqu'à la fin du XII" siècle sous la seigneurie bénédictine. Le premier château, construit vers 1190 à l'emplacement du château actuel, résulte d'une usurpation de biens abbatiaux d'Ech ternach par le voué Arnould qui cependant eut gain de cause devant l'empereur (1191) et prit le titre de sire de Rodemack. Vassal égale ment des comtes de Bar, il prêta en 1216 foi et hommage pour Tincry. Ses descendants prirent rapidement rang parmi les premiers châtelains du Luxembourg et du Barrois. Gilles (1220-45) guer roya en Lorraine pour le comte de Bar Hugues1er (1245-64), dota richement l'abbaye de Bonnevoie, Gilles II (1264-1303),justicier des nobles, puis sénéchal du Luxembourg, réussit en 1303 à faire investir son fils d'un fief rodemackois fort agrandi (Rodemack, Faulbach, Simming, Uckange, Boust, Gavisse, Berg ainsi qu'une partie de Garche et Manom). -

Parcours De Rodemack Dernière Mise À Jour 25/06/2020
Parcours de Rodemack Dernière mise à jour 25/06/2020 Rodemack (12,175 Km D+ 140m D- 140m mini 178m maxi 251m Convient à la marche nordique et jogging I K J Points D’intérêt Voir page 6 et 7 X Vous avez fait le choix de ce parcours exceptionnel pour la beauté de son village médiéval et de ses Jardins Botaniques, vous allez aussi traverser des espaces naturels protégés, soyez respectueux de la nature elle vous le rendra. N’oubliez jamais ce que vous souillez ou dégradez vos enfants et petits-enfants ne pourront pas en profiter. 1) Rendez-vous sur le parking à l’entrée de Rodemack route de Mondorff sur la D57. 2) Prenez le passage sous la porte de Sierck et remontez la rue des Margraves de Bade. 3) A environ 100m descendre à gauche vers les jardins botaniques le long des remparts Ouest. 4) Au bout des jardins montez sur la droite l’Impasse Gilles IV. 5) Suivre la rue du Luxembourg jusqu’au rond-point et prenez à votre droite la rue du Château. 6) Prenez la rue de Halling. Arrivée à la sortie du (S) empruntez le petit chemin qui se situe à droite avant le 2éme Km et suivez-le sur 1,5 Km jusqu’à la route de la Fontaine. 7) Suivez la route de la Fontaine jusqu’au lieu-dit Schoesserie, prenez le chemin à votre gauche qui rentre dans le bois juste avant la première maison (au passage vous pourrez voir la grotte dans le bois). Dans cette direction vous arriverez sur la route de la Grotte. -

Livret D'accueil Garde D'enfant Malade
Les Catt’Mômes Centre socio-éducatif Siège : 5 rue St Exupery, 57570 CATTENOM tél: 03.82.83.08.01 fax: 03.82.55.49.79 e-mail: [email protected] LIVRET D’ACCUEIL GARDE D’ENFANT MALADE SOMMAIRE PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION...................................................................... 3 NOTRE SECTEUR D’INTERVENTION...................................................................... 4 NOTRE PROJET........................................................................................................ 5 L’ACCOMPAGNEMENT DE CONFIANCE................................................................. 6 NOS PRESTATIONS DE SERVICE........................................................................... 7 VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS................................................................... 8 MODALITES – TARIFICATION - EXONERATION..................................................... 9 VOS ENGAGEMENTS ............................................................................................. 10 INFORMATIONS PRATIQUES ................................................................................ 11 ANNEXES ................................................................................................................ 12 Antennes : Breistroff-la-grande, Fixem, Gavisse, Mondorff, Puttelange-les-Thionville, Rodemack Association inscrite au registre des associations du tribunal de Thionville sous le n° RA 27/99 Code APE 9499Z - Siret 423329309 00011 – Agrément jeunesse et éducation populaire n° JEP 08-121 Agrément DIRECCTE -

Listes Def 25 02 Nom De La Commune Ou Subd
Listes_Def_25_02 Nom_de_la_Commune_ou_Subd. Libellé_abrégé Conduite_par Nbre_cand._saisis Abreschviller ABRESCH VIVRE ENSEMBLE M. RIEHL Emmanuel 15 Abreschviller ABRESCHVILLER 2020 M. JANSON Thierry 15 Achen POUR ACHEN, AGISSONS M. SCHRUB Laurent 17 Algrange ALGRANGE ENSEMBLE M. CERBAI Jean-Pierre 31 Algrange ALGRANGE AVENIR M. ADIAMINI Maximilien 29 Alsting CONTINUONS D'OEUVRER M. HEHN Jean-Claude 25 Alsting UNE ALTERNATIVE M. BUHR Jean-Claude 23 Amanvillers AMANVILLERS RENOUVEAU Mme LOGIN Frédérique 21 Amnéville ERIC MUNIER M. MUNIER Eric 35 Amnéville AMNEVILLE MALANCOURT DEBO M. DIEUDONNÉ Xavier 35 Amnéville AMNEVILLE-MALANCOURT M. SUDROW Cédric 35 Ancy-Dornot ANCY-DORNOT, VILLAGE VIVA M. SOULIER Gilles 25 Angevillers VILLAGE DE COEUR M. COLIN Jean-Marie 17 Apach APACH VILLAGE AU COEUR Mme FELTZ-VILLAIN Emilie 17 Apach APACH, AUTREMENT ? M. GUTIERES Patrick 17 Argancy EN ROUTE VERS 2026 Mme EMMENDOERFFER Jocelyne 17 Audun-le-Tiche AUDUN-LE-TICHE M. DJEBAR Bouzid 29 Audun-le-Tiche VERS DE NOUVEAUX HORIZONS M. JACQUIN Éric 31 Augny AUGNY AVEC VOUS M. KUNTZ Hervé 21 Augny AUGNY A VENIR M. HENRION François 19 Aumetz ENSEMBLE VERS L'AVENIR M. DESTREMONT Gilles 19 Ay-sur-Moselle ENSEMBLE VERS DEMAIN Mme LAPOIRIE Catherine 17 Bambiderstroff ENSEMBLE POUR BAMBI M. MAILLOT Gilles 15 Bambiderstroff TOUS UNIS POUR BAMBI M. FRANCOIS Jean-Luc 15 Le Ban-Saint-Martin UNION ET ACTION M. HASSER Henri 29 Béning-lès-Saint-Avold ALLONS DE L'AVANT Mme RAMSAIER Simone 15 Bertrange BERTRANGER VERS AVENIR M. PERRIN Jean-Luc 23 Bertrange BERTRANGE ENSEMBLE Mme ZIEGLER Marielle 23 Bining NOUVEL ELAN A BINING M. KREBS Jean Luc 15 Bining VIVRE ENSEMBLE BINING Mme RUFF Monique 17 Bining ENS POUR L'AVENIR Mme MULLER Blandine 17 Bitche RÉUSSIR BITCHE M. -

Air Package Cycle Along Europe’S Most Scenic River and Experience Three Very Different Cultures—Luxembourg, France, and Germany—On One Exhilarating Journey
VBT Itinerary by VBT www.vbt.com France, Luxembourg & Germany Bike & Boat: Mosel River Valley Bike Vacation + Air Package Cycle along Europe’s most scenic river and experience three very different cultures—Luxembourg, France, and Germany—on one exhilarating journey. You won’t just bike Europe. You’ll also drift along the waterway aboard a luxurious barge, admiring shifting landscapes from the comfort of a deck chair and enjoying sumptuous meals and a spirit of camaraderie all along the way. On our carefully curated routes, you’ll pedal past vineyards and forests, castles, and half-timbered villages … explore cosmopolitan Luxembourg City, the picturesque French village of Rodemack, the Roman ruins of Trier, the dual city of Bernkastel-Kues, and the beautiful Eifel Valley … and enjoy exclusive events like a private wine tasting at a family-owned estate. Don’t miss this chance to explore this charming pocket of Europe! Cultural Highlights 1 / 11 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Experience three countries—Luxembourg, France, and Germany—up close, by bike View quaint villages, lush vineyards and forests, and fairytale castles as you roll along a scenic river Discover the art of bell forging Explore the ancient Roman and medieval treasures of Trier Enjoy a private wine tasting in a century-old cellar Embark on an exhilarating ride through tunnels, over bridges, and past small lakes in the Eifel Valley Savor lunch in a cozy café, idyllically located in an old barn Relax on your barge and sip Germany’s finest Rieslings and beers What to Expect This tour offers easy terrain on bike paths and roads through both urban and rural areas.