Dossier 127 Text 7/22/04 10:27 AM Page I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Apiculture Au Sud Mali
TG01 / 2008 Transfert et de la gestion décentralisée Rapport d’étude : Problématique de l’immatriculation, du trans- fert et de la gestion dé- centralisée des équipe- ments et infrastructures productives Intercooperation Jèkasy –www.dicsahel.org Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Jèkasy Sikasso J Problématique de l’immatriculation, du transfert et de la gestion décentralisée des équipements et infrastructures productives Rapport d’étude Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Avril 2008 2 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION........................................................................................................................................... 6 II. ANALYSE CRITIQUE DU CADRE SOCIO-JURIDIQUE .......................................................................7 2.1 CONTEXTE................................................................................................................................................ 7 2.2 POUVOIRS DE L’ETAT SUR LES INFRASTRUCTURES .................................................................................. 7 2.3 PREROGATIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SUR LES INFRASTRUCTURES....................................8 2.3.1 Appropriation communale des équipements ....................................................................................... 9 2.3.2 Gestion communale des équipements................................................................................................ 10 2.3 LES PRETENTIONS DES POPULATIONS SUR LES INFRASTRUCTURES.........................................................10 -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Memoire Du Diplome D'etude Approfondie (Dea)
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT REPUBLIQUE DU MALI SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE Un Peuple-Un But-Une Foi SCIENTIFIQUE INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE (ISFRA) MEMOIRE DU DIPLOME D’ETUDE APPROFONDIE (DEA) Option : Population-Environnement, Gestion des Zones Humides et Développement Durable THEME : Analyse de l’évolution des pratiques de pêche dans la commune rurale de Zangasso, cercle de Koutiala au Mali Présenté par : Ousmane CISSE Président du Jury : Directeur de mémoire Pr Moussa KAREMBE, Pr Mahamane H. MAIGA, Professeur Professeur Titulaire à l’USTTB Titulaire à l’ISFRA Membres : Co-encadreur de mémoire Dr Hady DIALLO, Maître Dr Edmond TOTIN, Chercheur à Assistant L’ICRISAT Mahamane H. MAIGA, Professeur à l’ISFRA Date et Lieu de soutenance : Année universitaire 2016-2017 10/08/ 2017 à L’ISFRA Avant-propos ............................................................................................................................. V DEDICACE .............................................................................................................................. VI REMERCIEMENTS ............................................................................................................... VII LISTE DES TABLEAUX, DES CARTES, DES PHOTOS, ET DES FIGURES ................ VIII RESUME .................................................................................................................................. IX INTRODUCTION ..................................................................................................................... -

Programme National De Developpement Des Plateformes Multifonctionnelles Pour La Lutte Contre La Pauvrete 2017 - 2021
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME RÉPUBLIQUE DU MALI DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SECRETARIAT GENERAL PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 2017 - 2021 Durée : 5 ans (2017 - 2021) Couverture géographique : Territoire National Coût de réalisation: 55 497 925 000 FCFA • Contribution du gouvernement : 8 558 525 000 FCFA • Contribution des bénéficiaires : 2 500 000 000 FCFA • Financements et Partenariats à rechercher : 44 439 400 000 FCFA Novembre 2016 Table des matières Sigles et Abréviations .......................................................................................................................................... 4 RESUME DU PROGRAMME ................................................................................................................... 6 Résumé exécutif .................................................................................................................................................. 7 1.2. Problématiques et enjeux ......................................................................................................................... 13 1.3. Objectifs de développement et cadrage politique .................................................................................... 14 II. STRATEGIES ET POLITIQUES NATIONALES ET SECTORIELLES ........................................................................... 15 2.1. Stratégies et Politiques nationales ............................................................................................................ -

M600kv1905mlia1l-Mliadm22303-Sikasso.Pdf (Français)
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RÉGION DE SIKASSO - MALI ! ! Map No: MLIADM22303 N'Ga!ssola Yang!asso ! ! ! ! 8°0'W Keninkou 7°0'W Diaforongo 6°0'W 5°0'W Koulala Sourountouna Sanékuy Torodo Baraouéli Diéna ! ! ! Kazangasso ! Niamana Sobala Diéli ! N N ' Mandiakuy ' 0 0 ° ° 3 3 1 Bossofola Yéelekebougou ! 1 ! Kal!aké ! Tiémena Kéme!ni ! Sanando Niala Bla Kalifabougou ! ! Nafadie ! ! Dougouolo ! Karaba Kagoua ! Konobougou Falo Dioundiou Baoulé Diakourouna Nerissso ! ! ! Konkankan ! Diora Koulikoro Gouni S É G O U Somasso Samabogo ! RÉGINOég!ueNla DE SIKASSO P ! Waki 1 ! ! ! Negala Guinina Diaramana Kimparana Begu! ené ^ National Capital Route Pr!incipale ! ! Kambila Dio Gare Gouendo ! M!afouné ! Fana ! Diago ! Safo Talikourou P Chef-lieu Région Rou!te Secondaire Tingolé ! Nianaso! ! Koloni Dombila Kati Kérela Toko!unko ! ! Tienfala ! ! Debéla Baramana Chef-lieu Cercle Tertiary ! ! ! Toura-Kalanga Dialakorodji ! ! Marka-Coungo Kia ! ! ! Chef-lieu Commune FrDoonutibèarbeo Iungteorunationale ! ! ! Tyenfala Sountiani M'Pebougou Pegu!éna Fonfona ! ! Nangola ! ! Kore ! ! ! ! ! ! ! B!ongosso Moribila-Kagoua Kinikai Village Limite Région ! ! ! Toukoro M'Pessoba Zoumanabougou ^ Miéna Dogodouma ! ! Limite Cercle ! M'Pedougou Kenyebaoulé Aéroport ! ! Zan!soni 7 Gouala!bougou ! Wacoro N'Tagonasso ! ! ! M’Pessoba Ou!la ! Faya ! Tasso Fleuve Bamako Baramba ! Koumbia ! ! Sirababougou ! Zone Marécageuse ! Karagouana Mallé! Daboni ! Dandougou N'Tongo!losso ! Kouniana N'Pa!nafa Nien!esso Forêts Classées ! Ouenzzindougou ! K O U L I K O R O ! Bobola-Zangasso ! Lac Kolomosso ! Dorokouma ! Torosogoba Sinde ! 7 ! Bamana N'Tossoni Sorob!asso Djigo!uala Sirake!lé Mountougoula ! ! Ko!un Bele!koro ! Kiffosso 1 Beleko Soba Togobabougou Zangorola Cette carte a été réalisée selon le découpage adminisMtraotnift sd uM Maanldi iàn pgauretisr des ! ! Kon!ina ! Hamidou Goita Dioila ! Gouama Sogotila Famessasso Beledo!ugou ! données de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

PROGRAMME ATPC Cartographie Des Interventions
PROGRAMME ATPC Cartographie des interventions Agouni !( Banikane !( TOMBOUCTOU Rharous ! Ber . !( Essakane Tin AÎcha !( Tombouctou !( Minkiri Madiakoye H! !( !( Tou!(cabangou !( Bintagoungou M'bouna Bourem-inaly !( !( Adarmalane Toya !( !( Aglal Raz-el-ma !( !( Hangabera !( Douekire GOUNDAM !( Garbakoira !( Gargando Dangha !( !( G!(ou!(ndam Sonima Doukouria Kaneye Tinguereguif Gari !( .! !( !( !( !( Kirchamba TOMBOUCTOU !( MAURITANIE Dire .! !( HaÏbongo DIRE !( Tonka Tindirma !( !( Sareyamou !( Daka Fifo Salakoira !( GOURMA-RHAROUS Kel Malha Banikane !( !( !( NIAFOUNKE Niafunke .! Soumpi Bambara Maoude !( !( Sarafere !( KoumaÏra !( Dianke I Lere !( Gogui !( !( Kormou-maraka !( N'gorkou !( N'gouma Inadiatafane Sah !( !( !( Ambiri !( Gathi-loumo !( Kirane !( Korientze Bafarara Youwarou !( Teichibe !( # YOUWAROU !( Kremis Guidi-sare !( Balle Koronga .! !( Diarra !( !( Diona !( !( Nioro Tougoune Rang Gueneibe Nampala !( Yerere Troungoumbe !( !( Ourosendegue !( !( !( !( Nioro Allahina !( Kikara .! Baniere !( Diaye Coura !( # !( Nara Dogo Diabigue !( Gavinane Guedebin!(e Korera Kore .! Bore Yelimane !( Kadiaba KadielGuetema!( !( !( !( Go!(ry Youri !( !( Fassoudebe Debere DOUENTZA !( .! !( !( !(Dallah Diongaga YELIMANE Boulal Boni !( !(Tambacara !( !( Takaba Bema # # NIORO !( # Kerena Dogofiry !( Dialloube !( !( Fanga # Dilly !( !( Kersignane !( Goumbou # KoubewelDouentza !( !( Aourou !( ## !( .! !( # K#onna Borko # # #!( !( Simbi Toguere-coumbe !( NARA !( Dogani Bere Koussane # !( !( # Dianwely-maounde # NIONO # Tongo To !( Groumera Dioura -

Decision-Concour-IFM-2020 – SPECIALISTE-BAC
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Un peuple-Un But-Une Foi SECRETARIAT GENERAL °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° DECISION N°2021-____000068 ___/MEN–SG Portant admission au concours direct d'entrée dans les Instituts de Formation de Maîtres. Session de Décembre 2020. Filières: SPECIALISTES-BAC LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, Vu la Constitution ; Vu la charte de la transition ; Vu la Loi n°99-046/ du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d’Orientation sur l’Éducation ; Vu l’Ordonnance n°01-043/P-RM du 19 septembre 2001 portant création du Centre national des examens et concours de l’Éducation (CNECE) ; Vu le Décret n°09-692/P-RM du 29 décembre 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national des examens et concours de l’Éducation (CNECE) ; Vu le Décret n°2013-529/P-RM du 21 juin 2013 portant allocation d’indemnités au personnel chargé des examens scolaires et concours professionnels ; Vu Le Décret n°2020-00068/PT-M du 27 Septembre 2020, portant nomination du Premier ministre ; Vu Le Décret n°2020-0074/PT du 05 Septembre 2020, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la Décision n°2020-003224/MEN-SG du 16 novembre 2020 portant ouverture d’un concours direct d’entrée dans les Instituts de Formation des Maîtres-filière Spécialistes, session de décembre 2020, SPECIALISTES-BAC 1/91 Sur proposition du Directeur du Centre National des Examens et Concours de l’Éducation, DECIDE : Article 1 :: Les candidats dont les noms suivent sont -

Enhancing the Utility and Efficacy of USAID/Mali's 2003–2012 Country
Enhancing the Utility and Efficacy of USAID/Mali’s 2003–2012 Country Strategic Plan through Gender Analyses and an Action Plan A project funded by the Office of Women in Development, Bureau for Global Programs, Field Support and Research, U.S. Agency for International Development under contract number FAO-0100-C-00-6005-00 with Development Alternatives, Inc. February 2002 TECH 1717 Massachusetts Ave. NW, Suite 302, Washington, DC 20036 USA Tel.: 202-332-2853 FAX: 202-332-8257 Internet: [email protected] A Women in Development Technical Assistance Project Development Alternatives, Inc. International Center for Research on Women Academy for Educational Development Development Associates, Inc. This publication was made possible through support provided by the Office of Women in Development, Bureau for Global Programs Field Support and Research, U.S. Agency for International Development, under the terms of Contract No. FAO-0100-C-00-6005-00. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development. Enhancing the Utility and Efficacy of USAID/Mali’s 2003–2012 Country Strategic Plan through Gender Analyses and an Action Plan by Marcia E. Greenberg and Marieme Lo Development Alternatives, Inc. February 2002 TECH A Women in Development A project funded by the Office of Women in Development, Bureau for Global Programs, Field Support and Research, U.S. Agency for International Development under contract number FAO –0100-C-00-6005-00 Technical Assistance Project i PREFACE For more than five years now, USAID missions have asked the Women in Development Technical Assistance (WIDTECH) Project1 for technical assistance to conduct gender assessments and make recommendations for actions addressing gender-based obstacles and opportunities as a means of improving results. -
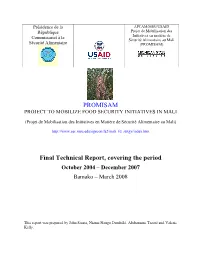
PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period
Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ............................................................................................... -

S2mv1905mlia0l-Mliadm223-Mali.Pdf
CARTE ADMINISTRATIVE - MALI Map No: MLIADM223 12°0'W 10°0'W 8°0'W 6°0'W 4°0'W 2°0'W 0°0' 2°0'E 4°0'E !! El Mzereb RÉPUBLIQUE DU MALI CARTE DE RÉFÉRENCE !^ Capitale Nationale Route Principale Ts!alabia Plateau N N ' ' 0 0 ° ° 4 ! 4 2 .! Chef-lieu Région Route Secondaire 2 ! ! Chef-lieu Cercle Frontière Internationale ! Dâyet Boû el Athem ! Chef-lieu Commune Limite Région ! Teghaza 7 Aéroport Fleuve Réserve/Forêts Classées Lac Zone Marécageuse ! A L G É R I E ! Bir Chali Cette carte a été réalisée selon le découpage administratif du Mali à partir des données de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT). ! Taoudenni ! Sources: Agorgot - Direction Nationale des Collectivités Territroriales (DNCT), Mali - Esri, USGS, NOAA - Open Street Map !In Dagouber Coordinate System: Geographic N N ' ! ' 0 Datum : WGS 1984 El Ghetara 0 ° ° 2 2 2 2 1:2,200,000 0 100 200 Tazouikert ! ! Kilometres ! ! Bir Ouane Tamanieret Oumm El Jeyem ! ! ! In-Afarak http://mali.humanitarianresponse.info El Ksaib Tagnout Chagueret ! In Techerene ! Foum El Alba ! ! Amachach Kal Tessalit ! ! Tessalit Taounnant In Echai ! ! N N ' Boughessa! ' 0 0 ° ° 0 ! ! 0 2 ! 2 ! Tanezrouft pist Tinzawatène Kal Tadhak Telakak ! T O M B O U C T O U Taghlit ! Bezzeg Tin Tersi ! K I D A L ! Iradjanatene Tassendjit! ! Tin Ezeman ! Tin Karr ! Aguel-Hoc Ouan Madroin! ! ! Adrar Tin Oulli Inabag ! ! Tafainak ! El M! raiti ! Inabag Kal Relle Tadjmart Avertissement: Les limites, les noms et les désignations utilisés sur cette carte n’impliquent pas une reconnaissance ! Abeïbara Elb Techerit ! ou acceptation officielle des Nations Unies.