Memoire Du Diplome D'etude Approfondie (Dea)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Sur Les Moustiques De La République Du Mali
'. ORGANISATION DE· COORDINATION . ET DE' COOPERATION POUR· LA LUTTE CONTRE LES GRAlID:BiS ENn~UES',' ~=-=- . 'CENmE MURAZ'. ~.~~-" SECTION DI EàlTQrIIOLOGIE . JJ)APPORTSUR LES'I'lOU'JTIQUESDE LA'REPlTBLIQU8DU lmr ".. ( -=-=-:;;"=--:;-=-=-c:~~~=-r-.>::::>-=--=-::..~~=-=-- parHANONJacques, DIALLO Bellon, EYRAun Hà.rceli ~]YEI~OillîA AugÙstinetOUA110U Sylla "':'-"'000-':"'''' ., Les premières, observations concernant' les moustiques duBoudan sont: , .celles de IEMOAL en 1906 et de: BüUFFABD, en I908~ Depuis 'ces études diverses' pu.... blications .ont augmenté nos connaissances sur ce. sujet, .mais jUsqu 1 en I950 le nombre total des nouatLuesccnnus du:.:cll . était de-treize: sept Anopheles; ·un Aëdes, et cinq Culex, 'et les données existantes, concernaâenti-pi-esque unique- ment sur la répartition des' anophèles le long èLela vallée du Niger, avec quel.ques '' '. indications sur leurs gîtes larvaires et les lieux de repos des edul.tess. , 'Les enquêtes d tHOLSTEIN, 'menées pour 'leconipte du SeryiceGénéral . d"Hygiène ~Ifobile et. de Prophylaxie bu de l'Office du Niger ont' considérablement ,. augmenté nos connai'ssanoea .sur' la répartition des anophèles au Soudan~.enappo~ .tant également des indications préci.euses 'sur leUTS variatiClns saisonnières et . Leurs indices sporozoïtiques' danaTa régi,on de SEGOU. Les au:t~es moustiques ciui . · ont pu ~tre récoltés Lo'rsdes enquêtes d'HOLSTEIN sur .Les 'and'phèles n ' ont pas encore été .é'tu:diés. .' .. Des niises au point ont réceillIrlent ,été faites, gén6ralemen,t à' l'échelle de l'Afrique Occidentale, sur Laplupart des autres groupes d' àrthr,oPQdesd':tm-: portance médicale ouvétérânarre : tiques;.phlébotomes, tabanidés~ simlllies, et à .. · l 'heure où 1lOrganisationMondütle de la Santé :envisage l 'êradication du paludisme, dans toute l'Afrique, et où lès Instituts Pasteur; se préoccupent de pl\l.s en p.lus ". -

Agricultural Diversification in Mali: the Case of the Cotton Zone of Koutiala
AGRICULTURAL DIVERSIFICATION IN MALI: THE CASE OF THE COTTON ZONE OF KOUTIALA By Mariam Sako Thiam A THESIS Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Agricultural, Food, and Resource Economics – Master of Science 2014 ABSTRACT AGRICULTURAL DIVERSIFICATION IN MALI: THE CASE OF THE COTTON ZONE OF KOUTIALA By Mariam Sako Thiam Cotton production plays a central role in the economy and the livelihood of cotton growers in the Koutiala area of Mali. Despite all the investment made in the cotton zones, the cotton farmers in Koutiala suffer substantially from uncertainties in the cotton subsector linked to prices, timely payment, and to the future structure of the industry. This study analyzes empirically how cotton growers with different agricultural characteristics coped with these uncertainties over the period 2006-2010. The data used in this study were collected during the survey that covered 150 households in the Koutiala area during three cropping seasons: 2006-07, 2008-09 and 2009- 10.The results show that despite income diversification among the households surveyed in Koutiala, agricultural production remains the main source of income. The findings also show that the farmers who continued to grow cotton during the three years of the survey and those who started producing cotton after year one diversified within the agricultural sector by producing more peanuts and cowpeas while the farmers who dropped out of cotton production after year one of the survey diversified toward non-farm activities such as commerce and self. We also found that the non-cotton growers are the poorest group of farmers, with less agricultural equipment and labor as well as less overall wealth, limiting their potential to invest in farm activities and start an off-farm business. -

Annual Report October 1, 2019 to September 30, 2020
USAID MALI SELECTIVE INTEGRATED READING ACTIVITY (SIRA) Annual Report October 1, 2019 to September 30, 2020 Submission Date: October 30, 2020 Contract Number: AID-688-TO-16-0005 under IDIQC No. AID-OAA-I-14-00053 Activity Start Date and End Date: 02/08/2016 to 02/07/2021 COR: Binta Bocoum Submitted by: Suzanne Reier, Chief of Party Adwoa Atta-Krah, Project Director Emails: [email protected]/ [email protected] Education Development Center Rue 209, Porte 45 Hamdallaye ACI 2000, Bamako Tel: (223) 2029 0018 Disclaimer: This report is made possible by the support of the American People jointly through the United States Agency for International Development (USAID) andJuly the 2008Government of Mali. The contents of this report are the sole responsibility of Education Development Center, Inc. (EDC) and 1its subcontractors and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. 1. PROGRAM OVERVIEW/SUMMARY USAID Mali/SIRA (Selective Integrated Reading Activity) Program Name: Activity Start Date and End February 8, 2016 to July 30, 2021 Date: Name of Prime Education Development Center Implementing Partner: [Contract/Agreement] AID-688-TO-16-0005 under IDIQC No. AID-OAA-I-14-00053 Number: Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel (OMAES), Save the Children, Name of Subcontractors School to School International, Cowater Sogema Total Estimated Cost $50,238,568 Major Counterpart Ministry of National Education (MEN) Organizations Mali: Administrative regions of Koulikoro, Ségou, Sikasso and the District Geographic Coverage of Bamako (cities and or countries) October 1, 2019 through September 30, 2020 Reporting Period: October 30, 2020 2 1.1. -

Apiculture Au Sud Mali
TG01 / 2008 Transfert et de la gestion décentralisée Rapport d’étude : Problématique de l’immatriculation, du trans- fert et de la gestion dé- centralisée des équipe- ments et infrastructures productives Intercooperation Jèkasy –www.dicsahel.org Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Jèkasy Sikasso J Problématique de l’immatriculation, du transfert et de la gestion décentralisée des équipements et infrastructures productives Rapport d’étude Maître Oumar Cissé Maître Tignougou Sanogo Avril 2008 2 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION........................................................................................................................................... 6 II. ANALYSE CRITIQUE DU CADRE SOCIO-JURIDIQUE .......................................................................7 2.1 CONTEXTE................................................................................................................................................ 7 2.2 POUVOIRS DE L’ETAT SUR LES INFRASTRUCTURES .................................................................................. 7 2.3 PREROGATIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SUR LES INFRASTRUCTURES....................................8 2.3.1 Appropriation communale des équipements ....................................................................................... 9 2.3.2 Gestion communale des équipements................................................................................................ 10 2.3 LES PRETENTIONS DES POPULATIONS SUR LES INFRASTRUCTURES.........................................................10 -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

VEGETALE : Semences De Riz
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ********* UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI DIRECTION NATIONALE DE L’AGRICULTURE APRAO/MALI DNA BULLETIN N°1 D’INFORMATION SUR LES SEMENCES D’ORIGINE VEGETALE : Semences de riz JANVIER 2012 1 LISTE DES ABREVIATIONS ACF : Action Contre la Faim APRAO : Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest CAPROSET : Centre Agro écologique de Production de Semences Tropicales CMDT : Compagnie Malienne de Développement de textile CRRA : Centre Régional de Recherche Agronomique DNA : Direction Nationale de l’Agriculture DRA : Direction Régionale de l’Agriculture ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics IER : Institut d’Economie Rurale IRD : International Recherche Développement MPDL : Mouvement pour le Développement Local ON : Office du Niger ONG : Organisation Non Gouvernementale OP : Organisation Paysanne PAFISEM : Projet d’Appui à la Filière Semencière du Mali PDRN : Projet de Diffusion du Riz Nérica RHK : Réseau des Horticulteurs de Kayes SSN : Service Semencier National WASA: West African Seeds Alliancy 2 INTRODUCTION Le Mali est un pays à vocation essentiellement agro pastorale. Depuis un certain temps, le Gouvernement a opté de faire du Mali une puissance agricole et faire de l’agriculture le moteur de la croissance économique. La réalisation de cette ambition passe par la combinaison de plusieurs facteurs dont la production et l’utilisation des semences certifiées. On note que la semence contribue à hauteur de 30-40% dans l’augmentation de la production agricole. En effet, les semences G4, R1 et R2 sont produites aussi bien par les structures techniques de l’Etat (Service Semencier National et l’IER) que par les sociétés et Coopératives semencières (FASO KABA, Cigogne, Comptoir 2000, etc.) ainsi que par les producteurs individuels à travers le pays. -
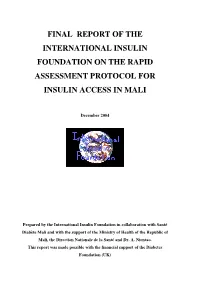
Final Report of the International Insulin Foundation on the Rapid Assessment Protocol for Insulin Access in Mali
FINAL REPORT OF THE INTERNATIONAL INSULIN FOUNDATION ON THE RAPID ASSESSMENT PROTOCOL FOR INSULIN ACCESS IN MALI December 2004 Prepared by the International Insulin Foundation in collaboration with Santé Diabète Mali and with the support of the Ministry of Health of the Republic of Mali, the Direction Nationale de la Santé and Dr. A. Nientao. This report was made possible with the financial support of the Diabetes Foundation (UK) Table of Contents Pages List of Tables 3 List of Figures 3 List of Appendices 3 1. Executive Summary 4 1.1. Key Findings 4 1.2. Recommendations 4-5 2. Background Information 2.1. Diabetes 6 2.2. International Insulin Foundation 6 2.3. Rapid Assessment Protocol for Insulin Access - method of assessment 6 2.4. Mali 7 2.5. Mali’s healthcare system 8-11 2.6. Implementation of RAPIA in Mali 11 3. Type 1 Diabetes in Mali 11-14 4. Mali’s medecine supply 14-16 4.1. Mali's insulin supply and quantification 16-18 4.2. Price of Insulin 18-19 5. Access to Syringes 19 6. Access to Diabetes Care 6.1. Overview 19-20 6.2. Bamako 20 6.3. Sikasso and Kadiolo 21 6.4. Timbuktu and Douentza 21 7. Diagnostic issues 21-22 8. Training 22 9. Diabetes Association of Mali 22-23 10. Policy Framework 23 11. Registers 23 12. Traditional Healers 23-24 13. Other Issues 24 14. Some positive points 24 15. Discussion 24-25 16. Recommendations 26-30 17. Presentation of Results 31-36 18 Acknowledgements 37-38 19. -

Evaluation De L'état Nutritionnel Des Enfants De 6 À 59 Mois Dans Le Cercle De Koutiala
REPUBLIQUE DU MALI Ministère de l’Enseignement Un Peuple-Un But-Une Foi Supérieur et de La Recherche Scientifique FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO STOMATOLOGIE ANNEE UNIVERSITAIRE: 2012-2013 N°………/ Evaluation de l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois dans le cercle de Koutiala (Région de Sikasso) en 2012 THÈSE Présentée et soutenue publiquement le 28 Mai 2013 Devant la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie PAR Mr : Bakary Moulaye KONE Pour obtenir le Grade de Docteur en Médecine (DIPLOME D’ETAT) Jury Président : Pr Samba DIOP Membre : Dr Fatou DIAWARA Co-directeur : Dr Kadiatou KAMIAN Directeur : Pr Akory AG IKNANE Cette Etude a été financée et commanditée par MSF (Médecins Sans Frontières France) FACULTE DE MEDECINE ET D’ODONTO-STOMATOLOGIE ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013 ADMINISTRATION DOYEN : FEU ANATOLE TOUNKARA - PROFESSEUR 1er ASSESSEUR : BOUBACAR TRAORE - MAITRE DE CONFERENCES 2ème ASSESSEUR : IBRAHIM I. MAIGA - PROFESSEUR SECRETAIRE PRINCIPAL : IDRISSA AHMADOU CISSE - MAITRE DE CONFERENCES AGENT COMPTABLE : MADAME COULIBALY FATOUMATA TALL - CONTROLEUR DES FINANCES LES PROFESSEURS HONORAIRES Mr Alou BA Ophtalmologie † Mr Bocar SALL Orthopédie Traumatologie - Secourisme Mr Yaya FOFANA Hématologie Mr Mamadou L. TRAORE Chirurgie Générale Mr Balla COULIBALY Pédiatrie Mr Mamadou DEMBELE Chirurgie Générale Mr Mamadou KOUMARE Pharmacognosie Mr Ali Nouhoum DIALLO Médecine interne Mr Aly GUINDO Gastro-Entérologie Mr Mamadou M. KEITA Pédiatrie Mr Siné BAYO Anatomie-Pathologie-Histoembryologie Mr Sidi Yaya SIMAGA Santé Publique Mr Abdoulaye Ag RHALY Médecine Interne Mr Boulkassoum HAIDARA Législation Mr Boubacar Sidiki CISSE Toxicologie Mr Massa SANOGO Chimie Analytique Mr Sambou SOUMARE Chirurgie Générale Mr Sanoussi KONATE Santé Publique Mr Abdou Alassane TOURE Orthopédie - Traumatologie Mr Daouda DIALLO Chimie Générale & Minérale Mr Issa TRAORE Radiologie Mr Mamadou K. -

Jumpstarting Agribusiness Markets
MONTHLY FEED THE FUTURE REPORT USAID CEREAL VALUE CHAIN PROJECT (AID-688-C-13-00002) JUNE 2015 REPORT JUNE 20, 2015 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by the USAID CVC project team. MONTHLY FEED THE FUTURE REPORT USAID CEREAL VALUE CHAIN PROJECT (AID-688-C-13-00002) JUNE 2015 REPORT DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. INTRODUCTION This report covers the period from May 20 to June 20, 2015. The main activities carried out during this period are: Training of irrigation management committees in the Sikasso region Organization of the rice value chain workshop in the Sikasso region Monitoring of the marketing contracts between the wholesalers and World Food Programme (WFP) Follow-up of the recommendations of the millet value chain workshop in Bankass and Koro Preparation and submission of inputs loan applications of the Producer Organizations (POs) in the Sikasso region Identification of vulnerable groups within partner POs Sell More For More (SMFM) training Monitoring and Evaluation (M&E) workshops Participation in the WFP annual review IR 1: AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN IRRIGATED AND DRYLAND SYSTEMS INCREASED Training of irrigation management committees in Sikasso A total of 200 water management committee members (rice producers) were trained in the district of Kadiolo on wa- ter requirements for rice production and the water level control in rice fields to avoid total submersion of the plants. The objective of the training was strengthen the capacity of the water management committees. -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Perceptions and Adaptations to Climate Change in Southern Mali
Preprints (www.preprints.org) | NOT PEER-REVIEWED | Posted: 12 March 2021 doi:10.20944/preprints202103.0353.v1 Perceptions and adaptations to climate change in Southern Mali Tiémoko SOUMAORO PhD student at the UFR of Economics and Management, Gaston Berger University (UGB) of Saint-Louis, Senegal. [email protected] ABSTRACT This study aims to determine the impact of climate change on market garden production in the extreme south of Mali through the perception and adaptation of market gardeners to climatic phenomena. The study used two models, namely the probit selection and Heckman results models and multinomial logistic regression, based on data collected from producers. A total of 194 producers were surveyed. The results of Heckman's probit model indicate that experience in agriculture and the educational level of the producers are the two main determinants of producers' perception and simultaneous adaptation to climate change. Among these variables agricultural experience is both positively and negatively correlated with perception. Keywords: Adaptation, climate change, southern Mali, Heckman probit, vegetable production 1. INTRODUCTION Climate change and its impacts have now become one of the greatest challenges for humanity, its environment and its economies (IPCC, 2013). At the global level, climate change is reflected in the rise in the average temperature of the planet, the melting of glaciers, the rise in sea level and the increase in the frequency of extreme events, the disappearance of species of animal origin, changes in rainfall patterns, etc. The average temperature in the world will increase by 1.8°C to 4°C, and in the worst case 6.4°C by the end of this century (IPCC, 2007). -

Meteorological Assistance to the Rural Community in Mali
Agence Nationale de la Météorologie (MALI METEO) Meteorological assistance to the rural Community in Mali Mr. D Z Diarra, Chef du Service Agrométéorologie, Agence Nationale de la Mmétéorologie (MALI METEO), Bamako, Mali Antalya , April 2014 PLAN Introduction Priorities of rural producers Hitory Weather assistance to rural world Other carried out action Some results Some Constraints Perspectives Conclusion INTRODUCTIONINTRODUCTION Mali: Sahelian country – 14,5 Millions people (census of 1st at April 14, 2009) Economy: Largely dominated by Agriculture: 40% of the P.I.B Nearly 70% of the population live in rural environment including 80% directly or indirectly of rain fed agriculture Agricultural production subjected to the annual and interannual variability of rainfall like to its space-time distribution. Rainfall mode: Great dryness of 1972 and successive drynesses Reduction of the average annual rainfall of more than 20% over the successive periods 1951 – 1970 and 1971 - 2000. PRIORITIES OF RURAL PRODUCERS • When will the rainy season begin in different localities? • What quantity of rain will fall throughout the rainy season? • How long will the season last? • Can we predict the weather and the climate for each zone of the country (e.g. on the sub-national or village scale)? HISTORY To face the challenge of drynesses the authorities of the touched countries shared their efforts within the framework of the strategies of parade by the creation of the CILSS with its Specialized agencies (CRA, INSAH). On the level of the countries there was a reinforcement of capacities of the weather and hydrological services (equipment, formation). The concretization of this political good-will resulted in the setting into?uvre pilot project of agrometeorologic assistance in Mali in 1982 to attenuate the impacts of the drynesses.