Association Pour La Sauvegarde Du Site De Villevieille
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
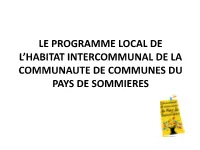
Le Programme Local De L'habitat INTERCOMMUNAL DE LA
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC - juillet 2008 QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Le dynamisme démographique de la Communauté de communes – 18 675 habitants en 2007 (18 981 habitants au 1er janvier 2010) – Près de 500 habitants supplémentaires par an depuis 1999 – Un taux de croissance annuel de l’ordre de + 2,9% sur la période 1999-2007 – 250 logements construits en moyenne entre 2000 et 2007 (soit le double de la période précédente) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • La faiblesse et la concentration du parc locatif social – Un taux d’équipement global inférieur à 6% – Un parc social essentiellement concentré sur Sommières (83% du parc hors foyers) – 5 communes ne disposent à ce jour d’aucun logement social – 290 demandeurs enregistrés en 2005 (taux de satisfaction très faible et délai d’attente pour une attribution d’environ 8 mois) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Quelques chiffres/indicateurs de précarité – 42% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% du plafond HLM (55% à Sommières) – 10,4% de la population est couverte par des minimas sociaux (20,3% à Sommières) – Le parc de logements potentiellement indignes est estimé à 13% des résidences principales de la Communauté de communes (25% à Sommières), soit environ 1 000 logements – 72 % de la population gardoise sont éligibles à un logement social QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Des valeurs foncières et immobilières en forte hausse -

24 Septembre 2020
PROCES VERBAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sommières Du Jeudi 24 Septembre 2020 L’an deux mille vingt, le 24 Septembre, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni à 18h30, en session ordinaire, à la Salle Polyvalente de Sommières, sous la présidence de Monsieur Pierre MARTINEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières. - Date de convocation : 18 Septembre 2020 - Date d’affichage de la convocation : 18 Septembre 2020 - Nombre de conseillers : 36 (et 13 suppléants) - En exercice : 36 titulaires (et 13 suppléants) - Présents : 26 titulaires 1 suppléant (avec voix délibérative) Votants : 27 Etaient présents : - Membres titulaires : Bernard CHLUDA ; André SAUZEDE ; Véronique MARTIN ; Alex DUMAS ; Christiane EXBRAYAT ; Alain HERAUD ; Julie JOUVE ; Sonia AUBRY ; Michel DEBOUVERIE ; Fabienne DHUISME ; Loïc LEPHAY, Pascale CAVALIER ; Alain THEROND ; Marie-José PELLET ; Bernadette POHER ; François GRANIER ; Jean-Michel ANDRIUZZI ; Sylvain RENNER ; Marc LARROQUE ; Pierre MARTINEZ ; Sandrine GUY ; Patrick CAMPABADAL ; Josette COMPAN-PASQUET ; Sylvie ROYO ; Catherine LECERF, Cécile MARQUIER - Membres suppléants : Jean-Louis NICOLAS (avec voix délibérative) - Etaient excusés : Jean-Louis RIVIERE, Jean-Pierre BONDOR, Ombeline MERCEREAU, Bétrice LECCIA, Carole NARDINI Présidente de Séance : André SAUZEDE Procès Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 24 septembre 2020 Page 2 sur 44 ADMINISTRATION GENERALE : 1- Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 23 juillet 2020 Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sommières que : Les délibérations du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 ont été transmises et rendues exécutoires par visa de la Préfecture du 29 juillet 2020. -

Cours Du Vidourle De Salinelles À Gallargues (Identifiant National : 910030361)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues (Identifiant national : 910030361) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 30142097) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030361, Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon Centroïde calculé : 746617°-1858660° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon
ZNIEFF de type I n° 3014-2097 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues Identifiant national : 910030361 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Hérault et Gard Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues n° 3014-2097 Identifiant national : 910030361 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département du Gard Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 30321 SOMMIERES 35 ha 23 % 30019 AUBAIS 20 ha 13 % 30123 GALLARGUES-LE-MONTUEUX 16 ha 11 % 30352 VILLEVIEILLE 10 ha 7 % 30136 JUNAS 8 ha 5 % 30306 SALINELLES 5 ha 3 % Département de l'Hérault Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 34340 VILLETELLE 25 ha 16 % 34033 BOISSERON 15 ha 9 % 34288 SAINT-SERIES 11 ha 7 % 34145 LUNEL 8 ha 5 % La ZNIEFF « Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues » est située sur la frontière entre les départements du Gard et de l'Hérault. Elle englobe la rivière du Vidourle sur un linéaire de plus de 16 kilomètres. Elle couvre une superficie de presque 154 hectares, pour une altitude variant peu, entre 10 et 30 mètres. -

Villevieille Antique, Un Projet De Médiation Numérique Pour Valoriser Le Site Archéologique Des Terriers À Villevieille
DOSSIER DE PRESSE Villevieille Antique, un projet de médiation numérique pour valoriser le site archéologique des Terriers à Villevieille villevieilleantique.fr Présentation du projet de valorisation Villevieille antique Pour valoriser la restitution de la domus gallo-romaine de Villevieille (Gard, Occitanie), la Communauté de Communes du Pays de Sommières a fédéré des partenaires régionaux et nationaux pour produire une expérience narrative transmédia qui adapte la mise en récit du site archéologique des Terriers pour différents publics, usages et outils numériques. Le site archéologique des Terriers Suite à la réalisation de fouilles archéologiques sur le site des Terriers à Villevieille, la Commune de Villevieille a décidé de préserver certains vestiges datant de l'Antiquité romaine. La Communauté de Communes du Pays de Sommières a, par la suite, commandé la reconstitution du plan archéologique en élévation d'une des domus gallo romaines fouillées, qui montre son l’emprise au sol et la nature des différentes pièces. Pour prolonger cette mise en valeur patrimoniale et permettre au public de comprendre cette restitution du passé Antique de Villevieille, la Communauté de Communes du Pays de Sommières a lancé un appel à projets de conception et la réalisation d’un outil numérique de valorisation de ce site archéologique. 2 Objectifs de valorisation et de médiation L’objet de ce dispositif est de restituer ce qui n’existe plus pour raconter aux visiteurs, sur place et à distance, à quoi ressemblait le site de Villevieille à l’époque romaine, le mettre en contexte territorial en lien avec d’autres sites patrimoniaux et imaginer la vie quotidienne et sociale des habitants de la domus reconstituée, en se basant de manière rigoureuse sur les données scientifiques, archéologiques et historiques. -

Vacancesfin En !
2021 Guide d’accueil Welcome booklet Welkom gids envacancesfin en ! F I Y T Office de Tourisme du Pays de Sommières www.ot-sommieres.com 2 3 PAYS DE SOMMIÈRES ÉDITO prenez le temps de vivre D’un confinement à l’autre, un besoin impératif de liberté, de dépaysement et de divertissement nous envahit chaque jour un peu plus ! Nous osons penser que nous serons soulagés très bientôt et dans l’espoir de votre venue, nous adaptons nos actions à vos attentes. Dans ce guide, nous nous sommes attachés à ce que vous vous sentiez déjà en vacances. Vous y trouverez une foule de bons plans : manifestations sportives et culturelles, coins secrets à découvrir, fêtes locales et traditions… A pied, à vélo ou à VTT, mais aussi à cheval ou avec un âne, le Pays de Sommières vous propose de découvrir ses différentes facettes et nos partenaires ont, eux aussi, rivalisé d’imagination pour vous proposer des vacances « idéales ». Adultes, jeunes et enfants, chacun trouvera ici, l’activité qui lui convient … Et bien sûr, nos équipes restent plus que jamais mobilisées (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur) pour vous aider à organiser votre séjour et partager leurs coups de cœur. Alors, prenez le temps de vivre… Venez souffler, respirer et vous ressourcer en Pays de Sommières ! Pierre Martinez Président de la Communauté de communes du Pays de Sommières Suzanne Hérisson Présidente de l’Office de Tourisme intercommunal T You will find many informations in this guide : sporting and cultural events, secret places, local festivals and traditions... Our teams is happy to welcome you (in accordance with the sanitary rules), to help you to organize your stay and to share their favourites. -

Arrêté D'extension CCPS + Cannes-Et-Clairan
Préfecture Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales Nîmes, le 16 juillet 2012 Bureau du Contrôle de Légalité et de l’Intercommunalité Affaire suivie par Gisèle MARIN 04 66 36 42 64 04 66 36 42 55 Mél [email protected] ARRETE N° 2012-198-0002 portant extension de la Communauté de Communes du Pays de Sommières à la commune de Cannes-et-Clairan Le Préfet du Gard, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5210-1-1, L.5211-6-1, L.5211-18 et L.5214-7 ; VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, notamment les articles 60 (II) et 83 ; VU l’arrêté préfectoral n° 2011357-0007 du 23 décembre 2011 portant approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Gard ; VU l’arrêté préfectoral n° 2012-025-006 du 25 janvier 2012 relatif au projet de modification de périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Sommières étendue à la commune de Cannes-et-Clairan ; VU les délibérations des conseils municipaux des communes concernées se prononçant en faveur de l’extension du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Sommières à la commune de Cannes-et-Clairan ; AUJARGUES, par délibération du 13 avril 2012, CALVISSON, par délibération du 27 février 2012, COMBAS, par délibération du 2 avril 2012, CRESPIAN, par délibération -

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public D’Élimination Des Déchets - 2019 1 1 2 2020 Un Bilan Et Une Nouvelle Ère
s r e g Rapport a n é m s t e h annuel c é d s e d n o ti a in s 2019 u m r li le ’é p d ri lic x e ub t la ce p qualité du servi 00 i 20 C ma onfo u 11 rmém 04 d ent au décret n° 2000-4 www.ccpaysdesommieres.fr Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets - 2019 1 1 2 2020 un bilan et une nouvelle ère Ce rapport 2019 est le reflet du travail accompli. En effet les objectifs que nous avions fixés en 2014 sont largement atteints. Quatre objectifs majeurs étaient ciblés : 1 - Infrastructure : comme nous l’avions planifié, la déchetterie de Calvisson a été livrée au premier semestre 2019 malgré les difficultés rencontrées > Engagement tenu 2 - Organisation : même si quelques détails doivent être améliorés, l’organisation des services administratif et technique sur les déchetteries a été modifié rial et optimisé > Engagement tenu 3 - Réduction déchets : réduire nos déchets est un objectif permanent et sur ce point nos résultats démontrent une réduction constante du volume par habitant > Engagement tenu 4 - Finances : le ratio positif recettes / dépenses est depuis 5 ans en perpétuelle augmentation, ce qui nous a permis de maintenir la TEOM à 15,2 % > Engagement tenu édito Concernant ce dernier point finance, il faut savoir que les dépenses de fonctionnement du service déchets s’articulent autour de trois grands postes : la collecte et le traitement des ordures ménagères (44,36 % des dépenses), l’activité de nos déchetteries (31,90 % des dépenses) et la collecte sélective et la valorisation (23,74 % des dépenses). -

Arrêté Préfectoral N°DDTM-SEF-2020-0071
PRÉFET DU GARD Direction Départementale des Territoires et de la Mer Fait à Nîmes, le 15 juin 2020 Service Environnement Forêt Unité Forêt - DFCI Courriel : [email protected] Arrêté préfectoral n°DDTM-SEF-2020-0071 réglementant l’usage de certains matériels et de l’activité de bivouac ou camping sauvage dans le cadre de la prévention des incendies de forêt Le préfet du Gard chevalier de la Légion d’honneur Vu le code forestier et notamment ses articles L.131-6, R.163-2 et R.163-6, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1, L.2212-2, L.2215-1 et L.2215-3, Vu le code de l’environnement et notamment son article L.362-1, Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Didier Lauga en qualité de préfet du Gard, Vu le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (Pdpfci) approuvé par l’arrêté préfectoral n°2013186-0006 le 05 juillet 2013 et prorogé par l’arrêté préfectoral n°DDTM-SEF-20180364 du 24 octobre 2018, Vu l’arrêté préfectoral permanent n°2012244-0013 du 31 août 2012 relatif à la prévention des incendies de forêt et notamment l’emploi du feu, Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, sollicitée par écrit du 18 mai au 04 juin 2020, Vu l’avis favorable de la commission départementale des espaces sites et itinéraires du Gard, Vu la participation du public réalisée du 19 mai au 08 juin 2020 ; Considérant la nécessité de renforcer les mesures de prévention des -

Ccoommmmuunnaauuttéé Ddee Ccoommmmuunneess Dduu Ppaayyss Ddee Ssoommmmiièèrreess DD Ii Aa Gg Nn Oo Ss Tt Ii Cc
CCoommmmuunnaauutttéé ddee CCoommmmuunneess dduu PPaayyss ddee SSoommmmiiièèrrreess Élaboration du Programme Local de l’Habitat DDiiiaaggnnoosstttiiicc Septembre 2008 Contact 866 avenue Maréchal Juin 30900 Nîmes tél. 04 66 29 97 03 fax 04 66 38 09 78 [email protected] www.urbanis.fr Conseil en habitat, urbanisme et réhabilitations Equipe URBANIS Chef de projet : François Moulonguet [email protected] Chargés de mission : Corinne Snabre [email protected] Marie Olivier [email protected] Cartographe : Marie Mélétopoulos [email protected] www.urbanis.fr Conseil en habitat, urbanisme et réhabilitations 2 Elaboration du PLH de la Communauté de Communes du Pays de Sommières IIInntttrrroodduucctttiiioonn La Communauté de Communes du Pays de Sommières a décidé l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. L’objectif est de définir la future politique communautaire en matière de logement sur l’ensemble du territoire du Pays. Le présent rapport concerne la première phase d’élaboration du P.L.H.I. Cette dernière repose sur : - l’analyse du fonctionnement du marché immobilier local à travers ses diverses composantes foncières et immobilières (accession/location, privé/social), - l’approche urbaine des différentes communes constitutives de l’E.P.C.I. reposant sur des entretiens conduits directement auprès des communes : identification des besoins prioritaires en logements, pratiques communales en matière d’urbanisme opérationnel et réglementaires, inventaire foncier et des principaux projets immobiliers…, - le -

ALLEZ-Y AVEC Lio ! Lignes Touristiques
ALLEZ-Y AVEC liO ! Lignes touristiques Du 4 avril au 30 septembre 2020 Copiright - Rodriguez Aurélio - Site du Pont du Gard du Pont du Site - Aurélio Rodriguez - Copiright lio.laregion.fr Allez-y avec liO ! Consciente de l’impact des transports sur l’émission de gaz à effet de serre, la Région Occitanie souhaite promouvoir l’usage de son réseau liO, trains ou cars, pour les déplacements du quotidien. Elle investit ainsi de façon très importante sur les infrastructures et le matériel roulant ferroviaire, et développe fortement l’offre routière pour faciliter les trajets domicile – travail ou domicile – études. Mais la Région va plus loin, puisqu’elle propose une offre saisonnière liO adaptée aux besoins de déplacements de loisirs, au plus près des atouts touristiques des terri - toires qui la composent. Ainsi, dans le Gard, pour seulement 1€50, vous pourrez aller de Pont-Saint-Esprit à Nîmes en passant par le Pont du Gard, ou vous rendre à Aigues-Mortes pour découvrir la cité médiévale. C’est pourquoi je vous invite à découvrir —ou redécou- vrir— le patrimoine et les paysages du Gard en em- pruntant les lignes liO, mises en place pour répondre aux besoins et attentes des touristes venus de toute l’Occitanie ou d’ailleurs. Alors, venez dans le Gard, mais allez-y avec liO ! Ce document a été réalisé par liO, Service Public Occitanie Transports Carole DELGA et la Région Occitanie. Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Sommaire Les destinations Alès Le Cirque de Navacelles Ligne 115 Ligne 105 Avignon Uzès Alès ...................................................08 Le Vigan Cirque de Navacelles Vissec. -

Pleins Feux Sur L'ancien Phare Rénové
Le N°178 ● Septembre, octobre, novembre 2019 Pleins feux sur l’ancien phare rénové Page 18 Canicule : le CCAS mobilisé Page 11 18 juillet : le Grau du Roi est libre Page 19 Port Camargue : bilan 2018 Page 32 Dossier spécial 4 Rénovation urbaine : une nouvelle respiration pour la Ville p 4 Protéger 8 Vive la rentrée p 8 Deux nouvelles directrices pour les écoles p 9 Une restauration scolaire de qualité p 10 Canicule : le CCAS mobilisé p 11 Un projet d’extension chez les pompiers p 12 Des gendarmes en renfort pendant la saison p 13 Santé : un enjeu majeur p 14 Le Pavillon Bleu flotte sur la ville p 15 La Ville a accueilli le bureau du Parlement de la mer p 16 Une convention de végétalisation pour embellir le centre-ville p 17 Réunir 18 L’ancien phare bientôt mis en lumière p 18 18 juillet : le Grau du Roi est autonome p 19 Saison théâtrale : une programmation de choix p.20 et 21 Andutz Mendi : passeurs de mémoire p.22 Conseils de quartier : bilan et perspectives p. 24 CMJ : 20 ans et plein de projets p.25 Deux grandes courses aux arènes p.26 Construire 28 Le président du Conservatoire du Littoral sur le terrain p.28 Site de l’ancien hôpital : rendez-vous à l’automne p.29 L’office de tourisme classé catégorie 1 p.30 Toutes les missions du Seaquarium p.31 Régie de Port Camargue : le bilan 2018 p.32 Karim Kadri vise l’Univers et au-delà p. 33 Cette Fabrique à pâtes qui épate p.