1-1 Diag Salinelles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
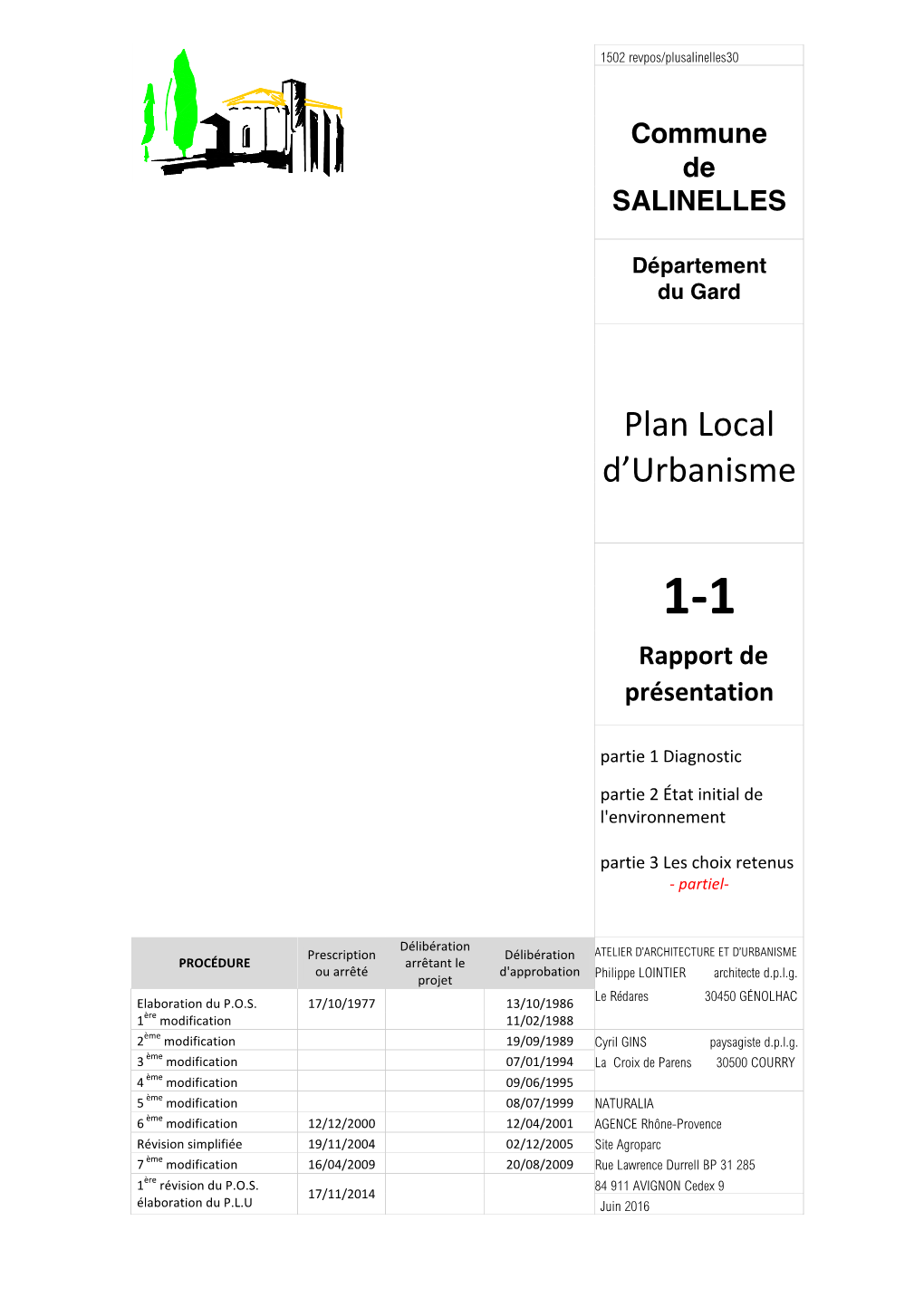
Load more
Recommended publications
-
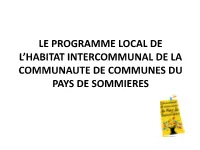
Le Programme Local De L'habitat INTERCOMMUNAL DE LA
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC - juillet 2008 QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Le dynamisme démographique de la Communauté de communes – 18 675 habitants en 2007 (18 981 habitants au 1er janvier 2010) – Près de 500 habitants supplémentaires par an depuis 1999 – Un taux de croissance annuel de l’ordre de + 2,9% sur la période 1999-2007 – 250 logements construits en moyenne entre 2000 et 2007 (soit le double de la période précédente) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • La faiblesse et la concentration du parc locatif social – Un taux d’équipement global inférieur à 6% – Un parc social essentiellement concentré sur Sommières (83% du parc hors foyers) – 5 communes ne disposent à ce jour d’aucun logement social – 290 demandeurs enregistrés en 2005 (taux de satisfaction très faible et délai d’attente pour une attribution d’environ 8 mois) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Quelques chiffres/indicateurs de précarité – 42% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% du plafond HLM (55% à Sommières) – 10,4% de la population est couverte par des minimas sociaux (20,3% à Sommières) – Le parc de logements potentiellement indignes est estimé à 13% des résidences principales de la Communauté de communes (25% à Sommières), soit environ 1 000 logements – 72 % de la population gardoise sont éligibles à un logement social QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Des valeurs foncières et immobilières en forte hausse -

Administration Generale : Personnel : Tourisme : Affaires Scolaires Et Periscolaires
Sommières, le 17 septembre 2020 Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières Objet : Convocation conseil communautaire Aux membres du conseil communautaire Affaire suivie par : Pierre LERASLE Direction Générale des Services Madame, Monsieur, J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sommières, le : JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 A 18H30 A LA SALLE POLYVALENTE DE SOMMIERES ADMINISTRATION GENERALE : 1- Approbation du procès-verbal du Conseil du 23 juillet 2020 2- Création et constitution des Commissions Thématiques 3- Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et du plan d’action 4- Désignation d’un référent « Egalité entre les femmes et les hommes » 5- Désignation des délégués au Comité de Programmation LEADER 6- Election du membre titulaire à la Commission Locale de l’Eau Sage Vistre Vistrenque Costières 7- Délibération modificative de la délibération n°10 du 23 juillet 2020 concernant la désignation des délégués pour le SIVOM Leins Gardonnenque 8- Délibération modificative de la délibération n°11 du 23 juillet 2020 concernant la désignation des délégués pour le SIEM 9- Délibération modificative de la délibération n°16 du 23 juillet 2020 relative à la composition de la CAO 10- Délibération modificative de la délibération n°22 du 23 juillet 2020 relative à l’élection des délégués pour l’Office de Tourisme PERSONNEL : 11- Indemnités aux instituteurs et professeurs des écoles pour les études surveillées 12- Ajustement de postes dans les services communautaires 13- Réflexion sur la mise en place du télétravail TOURISME : 14- Tarifs 2021 de la taxe de séjour AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : 15- Renouvellement de la convention annuelle de mise à disposition des locaux scolaires entre la C.C.P.S. -

24 Septembre 2020
PROCES VERBAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sommières Du Jeudi 24 Septembre 2020 L’an deux mille vingt, le 24 Septembre, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni à 18h30, en session ordinaire, à la Salle Polyvalente de Sommières, sous la présidence de Monsieur Pierre MARTINEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières. - Date de convocation : 18 Septembre 2020 - Date d’affichage de la convocation : 18 Septembre 2020 - Nombre de conseillers : 36 (et 13 suppléants) - En exercice : 36 titulaires (et 13 suppléants) - Présents : 26 titulaires 1 suppléant (avec voix délibérative) Votants : 27 Etaient présents : - Membres titulaires : Bernard CHLUDA ; André SAUZEDE ; Véronique MARTIN ; Alex DUMAS ; Christiane EXBRAYAT ; Alain HERAUD ; Julie JOUVE ; Sonia AUBRY ; Michel DEBOUVERIE ; Fabienne DHUISME ; Loïc LEPHAY, Pascale CAVALIER ; Alain THEROND ; Marie-José PELLET ; Bernadette POHER ; François GRANIER ; Jean-Michel ANDRIUZZI ; Sylvain RENNER ; Marc LARROQUE ; Pierre MARTINEZ ; Sandrine GUY ; Patrick CAMPABADAL ; Josette COMPAN-PASQUET ; Sylvie ROYO ; Catherine LECERF, Cécile MARQUIER - Membres suppléants : Jean-Louis NICOLAS (avec voix délibérative) - Etaient excusés : Jean-Louis RIVIERE, Jean-Pierre BONDOR, Ombeline MERCEREAU, Bétrice LECCIA, Carole NARDINI Présidente de Séance : André SAUZEDE Procès Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 24 septembre 2020 Page 2 sur 44 ADMINISTRATION GENERALE : 1- Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 23 juillet 2020 Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sommières que : Les délibérations du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 ont été transmises et rendues exécutoires par visa de la Préfecture du 29 juillet 2020. -

Direction Départementale Des Territoires Et De La Mer
Direction départementale des territoires et de la mer Service eau et risques Unité milieux aquatiques et ressource en eau Tél : 04-66-62-63-61 Mai l : [email protected] ARRÊTÉ N° 30-2021-07-16-00003 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l'eau dans le Gard La préfète du Gard Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite VU La directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; VU La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; VU Le code de l’environnement, notamment les articles L211-3, L216-4 et R211-66 à R211-70 ; VU Le code des collectivités territoriales, notamment les articles L2212 et L2215 ; VU Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; VU Le décret du 17 février 2021 nommant Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; VU L'arrêté cadre départemental n° 30-2019-07-02-006 du 2 juillet 2018, définissant les seuils de vigilance et les mesures exceptionnelles de limitation des usages de l'eau en cas de sécheresse dans le Gard ; VU L'arrêté inter-préfectoral du 17 décembre 1984 portant règlement d'eau du barrage écrêteur de crues de Sénéchas, sur la Cèze ; VU L'arrêté inter-préfectoral n° 2003-87-10 du 28 mars 2003 autorisant la rénovation du barrage des Cambous, et décrivant notamment les conditions de gestion de soutien d'étiage -

Cours Du Vidourle De Salinelles À Gallargues (Identifiant National : 910030361)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues (Identifiant national : 910030361) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 30142097) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030361, Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon Centroïde calculé : 746617°-1858660° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon
ZNIEFF de type I n° 3014-2097 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues Identifiant national : 910030361 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Hérault et Gard Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues n° 3014-2097 Identifiant national : 910030361 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département du Gard Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 30321 SOMMIERES 35 ha 23 % 30019 AUBAIS 20 ha 13 % 30123 GALLARGUES-LE-MONTUEUX 16 ha 11 % 30352 VILLEVIEILLE 10 ha 7 % 30136 JUNAS 8 ha 5 % 30306 SALINELLES 5 ha 3 % Département de l'Hérault Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 34340 VILLETELLE 25 ha 16 % 34033 BOISSERON 15 ha 9 % 34288 SAINT-SERIES 11 ha 7 % 34145 LUNEL 8 ha 5 % La ZNIEFF « Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues » est située sur la frontière entre les départements du Gard et de l'Hérault. Elle englobe la rivière du Vidourle sur un linéaire de plus de 16 kilomètres. Elle couvre une superficie de presque 154 hectares, pour une altitude variant peu, entre 10 et 30 mètres. -

Rivière Du Vidourle Entre Sardan Et Lecques (Identifiant National : 910030359)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030359 Rivière du Vidourle entre Sardan et Lecques (Identifiant national : 910030359) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 30142088) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030359, Rivière du Vidourle entre Sardan et Lecques. - INPN, SPN-MNHN Paris, 6P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030359.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon Centroïde calculé : 737577°-1876924° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

SOMMIÈRES Notre Combat Les Prix Bas Du Lundi Au Samedi De 8H30 À
GUIDE D’ACCUEIL 2014 LE PAYS DE SOMMIÈRES DES VACANCES AUTHENTIQUES www.ot-sommieres.fr 2 PAYS DE 3 SOMMIÈRES GUIDE D’ACCUEIL 2014 Cher visiteur, Vous avez envie de prendre le temps, de savourer l’instant présent ? D'entendre le bel accent du Sud, de visiter des vignobles de qualité Dear visitor, whaT are et des villages hors du temps, de flâner you looking for? A quieT sur des marchés du terroir ensoleillés ? place, far from The over - De faire de vraies découvertes en crowded TourisT spoTs? Do dehors des sentiers battus, d'apprécier you like The old TradiTional villages, farmers’ markeTs, la douceur d'une soirée d'été village fesTivals? Are you ou d'écouter le chant des cigales ? inTeresTed in ancienT hisTo - ry, archiTecTure? If This is Alors posez vos valises, ce que vous so, dear visiTor, look no cherchez est ici, en Pays de Sommières. furTher. You can find whaT you Ce guide vous aidera à profiter de are looking for here in The “Pays de Sommières”. votre séjour chez nous. We will welcome you for Vous y trouverez l’histoire du Pays one day, one weekend de Sommières, les bonnes adresses or for a longer sTay. pour vos activités sportives, de loisirs ou culturelles et beaucoup d’autres Laat u ontroeren Houdt u van de sfeer op de informations utiles. streekmarkten, de sfeer van de avonden in het zuiden? Le Pays de Sommières est heureux Wilt u 2000 jaar teruggaan de vous offrir toutes ces émotions. in architectuur, avonturen en Vous repartirez reposé et ressourcé, menselijke levens? Wilt u ou peut-être ne repartirez-vous plus .. -

Villevieille Antique, Un Projet De Médiation Numérique Pour Valoriser Le Site Archéologique Des Terriers À Villevieille
DOSSIER DE PRESSE Villevieille Antique, un projet de médiation numérique pour valoriser le site archéologique des Terriers à Villevieille villevieilleantique.fr Présentation du projet de valorisation Villevieille antique Pour valoriser la restitution de la domus gallo-romaine de Villevieille (Gard, Occitanie), la Communauté de Communes du Pays de Sommières a fédéré des partenaires régionaux et nationaux pour produire une expérience narrative transmédia qui adapte la mise en récit du site archéologique des Terriers pour différents publics, usages et outils numériques. Le site archéologique des Terriers Suite à la réalisation de fouilles archéologiques sur le site des Terriers à Villevieille, la Commune de Villevieille a décidé de préserver certains vestiges datant de l'Antiquité romaine. La Communauté de Communes du Pays de Sommières a, par la suite, commandé la reconstitution du plan archéologique en élévation d'une des domus gallo romaines fouillées, qui montre son l’emprise au sol et la nature des différentes pièces. Pour prolonger cette mise en valeur patrimoniale et permettre au public de comprendre cette restitution du passé Antique de Villevieille, la Communauté de Communes du Pays de Sommières a lancé un appel à projets de conception et la réalisation d’un outil numérique de valorisation de ce site archéologique. 2 Objectifs de valorisation et de médiation L’objet de ce dispositif est de restituer ce qui n’existe plus pour raconter aux visiteurs, sur place et à distance, à quoi ressemblait le site de Villevieille à l’époque romaine, le mettre en contexte territorial en lien avec d’autres sites patrimoniaux et imaginer la vie quotidienne et sociale des habitants de la domus reconstituée, en se basant de manière rigoureuse sur les données scientifiques, archéologiques et historiques. -

Republique Francaise
COMMUNE DE SOUVIGNARGUES (Gard) COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Membres afférents : 15 Date convocation : 08/01/2015 Membres en exercice : 15 Date d'affichage : 08/01/2015 Membres présents : 11 L’an deux mil quinze, le douze du mois de janvier, à dix-neuf heures le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Serge PATTUS, Maire. Présents : Mmes et MM Serge PATTUS, Olivier GRAU, Danielle DUMAS-GUILLOUX, François LEPICIER, Jacques GABRIEL, Eric GUIDO, Eric VIDAL, Gwenola LE TALLEC, Muriel DESIRA, Catherine LECERF, Martial POLGE. Excusés : MM Sébastien VIDAL, Jérôme LECONTE, Fabrice BOURNIER. Procuration : Mme Gwenola LE TALLEC à Mme Danielle DUMAS-GUILLOUX. Secrétaire de Séance : M. Eric VIDAL. ********** Le compte-rendu de la séance du 12 janvier 2015 affiché en Mairie le 21 janvier 2015 est approuvé sans remarques ni réserves. ********* DELIBERATION N° 03 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES (CCPS) MODIFICATIONS STATUTAIRES : RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE MANDAT 2014 - 2020 Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération n° 2 du 4 février 2015, la CCPS a approuvé la recomposition du Conseil Communautaire, suite au décès de son Président, Monsieur Jean-Claude HERZOG : - Article 2 : Selon l'arrêté préfectoral n° 2015-015-001 du 15 janvier 2015, et afin de se mettre en conformité avec la loi en vigueur, le nombre de conseillers communautaires composant -
Mise En Page 1 03/09/13 10:58 Page1
DECOUVERTE WEB anglais_Mise en page 1 03/09/13 10:58 Page1 TOURISME .com DISCOVERING NÎMES nimes-tourisme DECOUVERTE WEB anglais_Mise en page 1 03/09/13 10:58 Page2 Welcome to Nîmes Nîmes is 2000 years old and still young. Two thousand years of history and passions. Roman masterpieces, contemporary architecture, gardens laid out in an ancient sanctuary and celebrated by George Sand and Jean-Jacques Rousseau. Everything here goes through time with strength and lightness. The city is mysterious. Its soul is made up of sun and water, pride and reserve, joyfulness and secrecy. Wander through streets and squares and look around. There will always be surprises: here, crocodiles emerge from the paving stones, there a historic conservation area spreads its lace and over there Roman columns are reflected in sheets of glass. The riches in Nîmes can be seen-forming the stuff that dreams are made of. Leafing through this document takes you into our history. Let yourself be charmed. Nîmes will give you its most precious stones! The Tourist Office TOURISME is also .com www.facebook.com/nimes.tourisme Tape guide Guided visits An online boutique nimes-tourisme Information +33 (0) 4 66 58 38 00 DECOUVERTE WEB anglais_Mise en page 1 03/09/13 10:58 Page3 The Beginnings: The founding of Nîmes goes back to the sixth century BC. The Volcae Arecomici, a Celtic tribe, settled around a spring, made it a deity and built a sanctuary. In 120 BC, the Volcae, who had a vast territory, accepted the Roman legions without resistance. The Gallo-Romans: Nîmes became a colony under Latin Law and was ornamented with sumptuous monuments. -

Vacancesfin En !
2021 Guide d’accueil Welcome booklet Welkom gids envacancesfin en ! F I Y T Office de Tourisme du Pays de Sommières www.ot-sommieres.com 2 3 PAYS DE SOMMIÈRES ÉDITO prenez le temps de vivre D’un confinement à l’autre, un besoin impératif de liberté, de dépaysement et de divertissement nous envahit chaque jour un peu plus ! Nous osons penser que nous serons soulagés très bientôt et dans l’espoir de votre venue, nous adaptons nos actions à vos attentes. Dans ce guide, nous nous sommes attachés à ce que vous vous sentiez déjà en vacances. Vous y trouverez une foule de bons plans : manifestations sportives et culturelles, coins secrets à découvrir, fêtes locales et traditions… A pied, à vélo ou à VTT, mais aussi à cheval ou avec un âne, le Pays de Sommières vous propose de découvrir ses différentes facettes et nos partenaires ont, eux aussi, rivalisé d’imagination pour vous proposer des vacances « idéales ». Adultes, jeunes et enfants, chacun trouvera ici, l’activité qui lui convient … Et bien sûr, nos équipes restent plus que jamais mobilisées (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur) pour vous aider à organiser votre séjour et partager leurs coups de cœur. Alors, prenez le temps de vivre… Venez souffler, respirer et vous ressourcer en Pays de Sommières ! Pierre Martinez Président de la Communauté de communes du Pays de Sommières Suzanne Hérisson Présidente de l’Office de Tourisme intercommunal T You will find many informations in this guide : sporting and cultural events, secret places, local festivals and traditions... Our teams is happy to welcome you (in accordance with the sanitary rules), to help you to organize your stay and to share their favourites.