Charles Pasqua
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
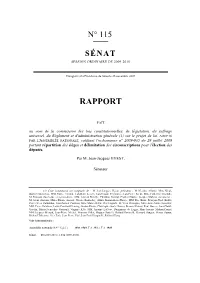
Format Acrobat
N° 115 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 novembre 2009 RAPPORT FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, Par M. Jean-Jacques HYEST, Sénateur (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. Voir le(s) numéro(s) : Assemblée nationale (13ème législ.) : 1893, 1949, T.A. 353 et T.A. 1949 Sénat : 48 (2009-2010) et 116 (2009-2010) - 2 - - 3 - SOMMAIRE Pages LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS......................................................... -

DECISION 91-290 DC of 9 MAY 1991 Act on the Statute of the Territorial Unit of Corsica
DECISION 91-290 DC OF 9 MAY 1991 Act on the statute of the territorial unit of Corsica The Constitutional Council received a referral on 12 April 1991 from Mr Pierre MAZEAUD, Mr Jacques CHIRAC, Mr Bernard PONS, Mr Robert PANDRAUD, Mr Franck BOROTRA, Mr Henri CUQ, Mr Alain JONEMANN, Mr Jean-Louis GOASDUFF, Mr Lucien GUICHON, Mr Michel TERROT, Mr Roland VUILLAUME, Mr Bernard DEBRE, Mr Emmanuel AUBERT, Mr René COUVEINHES, Mr Etienne PINTE, Mr Georges GORSE, Mr Philippe SEGUIN, Mr Edouard BALLADUR, Mr Claude BARATE, Mr Nicolas SARKOZY, Mr Michel GIRAUD, Mr Jean FALALA, Ms Françoise de PANAFIEU, Mr Robert POUJADE, Mr Dominique PERBEN, Mr Charles PACCOU, Mr Gabriel KASPEREIT, Ms Martine DAUGREILH, Mr Eric RAOULT, Mr Richard CAZENAVE, Mr Jean-Louis MASSON, Ms Lucette MICHAUX-CHEVRY, Mr Michel PERICARD, Mr Antoine RUFENACHT, Mr Jean-Louis DEBRE, Mr Gérard LEONARD, Mr Jacques TOUBON, Mr Jean-Michel COUVE, Mr Patrick OLLIER, Mr Jean VALLEIX, Mr Claude DHINNIN, Mr François FILLON, Mr Patrick DEVEDJIAN, Mr Alain COUSIN, Mr Jean KIFFER, Mr Christian ESTROSI, Mr Jean-Pierre DELALANDE, Mr Pierre- Rémy HOUSSIN, Mr Roland NUNGESSER, Mr Jean-Yves CHAMARD, Mr Jean TIBERI, Mr Georges TRANCHANT, Mr Jean-Paul de ROCCA-SERRA, Mr Jacques MASDEU-ARUS, Mr Jean-Claude MIGNON, Mr Olivier DASSAULT, Mr Guy DRUT, Mr Olivier GUICHARD, Mr Pierre PASQUINI, Mr Arthur DEHAINE, Mr Robert-André VIVIEN, Mr Robert GALLEY, Mr Arnaud LEPERCQ, Mr François GRUSSENMEYER, Mr Henri de GASTINES, Mr René GALY-DEJEAN, Mr Serge CHARLES, Mr Didier JULIA, Mr Charles MILLON, Ms Louise MOREAU, -

The French Presidential Election: an Assessment by Thierry Leterre, Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Versailles, St
The French Presidential Election: An Assessment By Thierry Leterre, Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Versailles, St. Quentin In the Constitution of the Fifth Republic (founded by General Charles de Gaulle in 1958), the presidency is the key-stone of French institutions. Presidential elections are dramatic moments in the country’s democratic life: the people of the Republic choses by direct universal suffrage the incarnation of its sovereignty for five years. (The term was seven years until the 2001 constitutional revision: see US-France Analysis by Olivier Duhamel, “France's New Five-Year Presiential Term, http://www.brookings.edu/fp/cusf/analysis/quinquennat.htm). The President of the Republic is elected by an absolute majority of votes cast. If no candidate obtains a majority on the first ballot, a second ballot is organized with the two candidates who have won the greatest number of votes in the first ballot. This two-round system avoids an election with only a relative majority and prevents third party candidates-such as Ross Perot or Ralph Nader in recent American elections-from distorting the outcome. The French believe this would weaken the bond between the nation and its supreme representative. Any French citizen who meets certain eligibility criteria can run for president. These criteria include paying a deposit of €153,000 and getting “500 signatures”-the patronage of at least 500 elected officials (from a list of about 45,000) from 30 départements. There are some 15 official candidates in the 2002 election (see table). The final contest, however, will be a showdown between two, and only two, competitors. -

1 DIRECTION DE LA COMMUNICATION. Les
Archives départementales des Hauts-de-Seine DIRECTION DE LA COMMUNICATION. Les versements présentés ici permettent d'appréhender le développement de la stratégie de communication mise en place par le Département depuis les années 1980. Il est ainsi possible de saisir les priorités données par ce dernier et ce qu'il a voulu faire connaître aux habitants des Hauts-de-Seine. Cela permet aussi de voir comment s'est organisé un service dédié à la communication externe au sein d'une collectivité territoriale qui a vu ses responsabilités et ses compétences augmenter. Les fonds de la Direction de la communication apportent aussi une connaissance globale des services du Département par le biais de leurs actions en communication. La place de la Direction de la communication est en effet centrale au sein du Département puis qu'elle est en relation avec tous les autres services et avec les partenaires du Département. Une étude plus approfondie sur le rôle du directeur de la communication et ses liens étroits avec les présidents du Conseil général peut être suggérée. [1972] - 2015 Histoire administrative : Le département des Hauts-de-Seine a été créé en 1964, suite à la réforme territoriale et administrative de la région parisienne. Il compte 36 communes. La collectivité se dote d'une administration entre 1967 et 1968. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 transfèrent aux collectivités territoriales des compétences auparavant réservées à l'État. La communication devient pour le Département un outil indispensable pour faire connaître ses actions sur le territoire des Hauts-de-Seine. Entre 1982 et 2006, se sont succédés à la tête du Conseil général des Hauts-de- Seine : - Paul Graziani (1982-1988) - Charles Pasqua (1988-2004) - Nicolas Sarkozy (2004-2007) - Patrick Devedjian (2007-2020) La Direction de la communication a été créée en 1989. -

French Foreign Policy in Africa: Between Pré Carré and Multilateralism
FRENCH FOREIGN POLICY IN AFRICA: BETWEEN PRÉ CARRÉ AND MULTILATERALISM Sylvain Touati An Africa Programme Briefing Note February 2007 Chatham House (The Royal Institute of International Affairs) is an independent body which promotes the rigorous study of international questions and does not express opinions of its own. The opinions expressed in this publication are the responsibility of the author. © The Royal Institute of International Affairs, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright holder. Please direct all enquiries to the publishers. 2 Contents 1 Introduction 1 2 Historical Context 2 3 Public Aid for Development 5 4 Political Trends 9 5 International Competition 14 6 France in Europe 16 7 2007 Elections 18 8 Conclusions 21 3 1 INTRODUCTION “Africa is a real opportunity for France. It broadens both our horizon and our ambition on the international scene. It is true in the diplomatic, economic and cultural context.” Dominique de Villepin, 18 June 20031 France’s monopoly of Africa is under threat. The last 50 years have seen the French battling to hold on to the ‘privileged relationship’ with their former colonial empire, and a number of factors have forced the once imperial power into redefining its affiliation with ex-colonies, such as new laws on aid distribution, the integration of the EU and modern economic reforms. In the post-Cold War era, ‘multilateralism’ has become the latest political buzzword, and in its wake a notable shift in French policy in Africa has emerged. -

The French Party System Forms a Benchmark Study of the State of Party Politics in France
evans cover 5/2/03 2:37 PM Page 1 THE FRENCH PARTY SYSTEM THE FRENCHPARTY This book provides a complete overview of political parties in France. The social and ideological profiles of all the major parties are analysed chapter by chapter, highlighting their principal functions and dynamics within the system. This examination is THE complemented by analyses of bloc and system features, including the pluralist left, Europe, and the ideological space in which the parties operate. In particular, the book addresses the impressive FRENCH capacity of French parties and their leaders to adapt themselves to the changing concerns of their electorates and to a shifting PARTY institutional context. Contrary to the apparently fragmentary system and increasingly hostile clashes between political personalities, the continuities in the French political system seem SYSTEM destined to persist. Drawing on the expertise of its French and British contributors, The French party system forms a benchmark study of the state of party politics in France. It will be an essential text for all students of Edited by French politics and parties, and of interest to students of European Evans Jocelyn Evans politics more generally. ed. Jocelyn Evans is Lecturer in Politics at the University of Salford The French party system The French party system edited by Jocelyn A. J. Evans Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Copyright © Manchester University Press 2003 While copyright in the volume as a whole is vested in Manchester University Press, copyright in individual chapters belongs to their respective authors. This electronic version has been made freely available under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND) licence, which permits non-commercial use, distribution and reproduction provided the author(s) and Manchester University Press are fully cited and no modifications or adaptations are made. -

Implications of the Conseil Constitutionnel's Immigration and Asylum Decision of August 1993 Susan Soltesz
Boston College International and Comparative Law Review Volume 18 | Issue 1 Article 7 12-1-1995 Implications of the Conseil Constitutionnel's Immigration and Asylum Decision of August 1993 Susan Soltesz Follow this and additional works at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr Part of the Immigration Law Commons Recommended Citation Susan Soltesz, Implications of the Conseil Constitutionnel's Immigration and Asylum Decision of August 1993, 18 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 265 (1995), http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol18/iss1/7 This Notes is brought to you for free and open access by the Law Journals at Digital Commons @ Boston College Law School. It has been accepted for inclusion in Boston College International and Comparative Law Review by an authorized editor of Digital Commons @ Boston College Law School. For more information, please contact [email protected]. Implications of the Conseil Constitutionnel's Immigration and Asylum Decision of August 1993t INTRODUCTION During its 1993 spring session and additional extraordinary ses sion in July, the French Parliament adopted several new laws relating to immigration.l These laws were introduced by Charles Pasqua, the Interior Secretary for France's right wing political party, Rally for the Republic (RPR) , a politician who has stated that his "aim is zero immigration."2 Specifically, the legislation encompassed three areas of law: one relating to the entry, reception, and stay of foreigners in France; another reforming the nationality code regarding marriages of convenience; and -

Lionel Jospin
LeMonde Job: WMQ2609--0001-0 WAS LMQ2609-1 Op.: XX Rev.: 25-09-00 T.: 10:23 S.: 111,06-Cmp.:25,10, Base : LMQPAG 55Fap: 100 No: 0713 Lcp: 700 CMYK LE MONDE ÉCONOMIE a Les cartels et la mondialisation a Emploi : 19 pages d’annonces classées Demandez notre supplément www.lemonde.fr 56e ANNÉE – No 17315 – 7,50 F - 1,14 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE MARDI 26 SEPTEMBRE 2000 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Quinquennat : abstentions, record battu Le triomphe b L’instauration du quinquennat a été approuvée par 73,15 % des suffrages b Mais un niveau d’abstention sans précédent (69,68 %) a marqué le scrutin b Jacques Chirac a justifié le choix du référendum, exprimant son « refus du vélo de la démocratie confisquée » b Lionel Jospin promet d’autres réformes b Dans notre cahier spécial, les résultats complets LE RÉFÉRENDUM visant à ré- très élevé signifie qu’il n’y a « pas a duire à cinq ans la durée du man- assez » de démocratie. Il a assuré En VTT, dat présidentiel a été marqué, di- qu’il faut donc « recourir au réfé- Inachevé manche 24 septembre, par une rendum plus souvent ». De son cô- Miguel Martinez large victoire du oui, mais aussi par té, le premier ministre a pris acte, À PREMIÈRE VUE, le bilan n’est un niveau sans précédent d’abs- dans un communiqué, de la « très pas fameux : le spectacle que donne apporte tention. Proposée par Lionel Jos- faible participation ». Il a redit son la démocratie française est en effet pin et engagée par Jacques Chirac, souhait que le quinquennat « pré- de nature à inquiéter. -

From the Gaullist Movement to the President's Party
8 From the Gaullist movement to the president’s party Andrew Knapp The right From the Gaullist movement to the president’s party Introduction Most major European countries are content with just one major party of the centre-right: Britain’s Conservatives, Spain’s PPE, Germany’s CDU–CSU. France has always had at least two. The electoral cycle of April–June 2002, however, held out the prospect of change by transform- ing the fortunes of France’s centre-right in two ways. A double victory at the presidential and parliamentary elections kept Jacques Chirac in the Elysée and put a large centre-right majority into the National Assembly. Second, most of the hitherto dispersed centre-right family merged into a single formation, the UMP. Why did this merger happen in 2002, and not sooner? The first part of this chapter will consider what kept the mainstream right apart before 2002. The second section will show why the parties had less reason to stay apart by 2002 than they had had five, ten or twenty years earlier. The third will show how a more favourable context was used to advance a concrete merger project, in the approach to and aftermath of the 2002 elections. The conclusion will assess both the UMP’s longer-term prospects, and its more general impact on the French party system. France’s divided right For most of the Fifth Republic, three things have divided the French right: real differences of ideology and policy; opposed organisational cultures; and the logic of presidential competition. On the other hand, although the right-wing electorate is far from homogeneous, divisions among voters had rather little impact on divisions between the parties – and voter demand was eventually to be important in the genesis of a merged party. -

Ce Terrible Monsieur Pasqua Ouvrages D'alain Rollat
CE TERRIBLE MONSIEUR PASQUA OUVRAGES D'ALAIN ROLLAT Guide des Médecines parallèles (Calmann-Levy, 1973) Les Hommes de l'extrême droite (Calmann-Levy, 1985) Avec Edwy Plenel : L'effet Le Pen (La Découverte-Le Monde, 1984) Philippe BOGGIO - Alain ROLLAT CE TERRIBLE MONSIEUR PASQUA Olivier Orban Ouvrage publié sous la direction de Gilles Hertzog @ Olivier Orban, 1988 ISBN 2-85565^*2 Flânerie... C'était un des derniers beaux jours de la fin de l'automne. Une de ces matinées lumineuses comme la Côte d'Azur en réserve, en novembre, entre deux averses. Les parfums de l'été restaient entêtants. Charles Pasqua, en visite à Nice, n'avait pas su y résister. Il flânait sur la Promenade des Anglais. Un flic devant, un flic derrière. Il allait incognito, croyait-il, mains dans les poches, les yeux dissimulés par de grosses lunettes noires. Caricature de lui-même. Un vrai ministre de l'Intérieur en enquête dans un décor de feuilleton US sur façades trom- peuses de fausse Floride... Ceux qui le reconnaissaient en le croisant s'effaçaient avec courtoisie, après un sourire ou un bonjour. A sa démarche, son dos voûté, sa tête légèrement penchée en avant, sa fatigue était perceptible. Nantes, l'avant-veille, avait frôlé la catastrophe. Il avait appelé Jacques Chirac en urgence sur la ligne directe. « Jacques... - Charles, rappelle-moi, je suis avec Monseigneur Lusti- ger. - Au contraire, passe-le-moi... « Monseigneur, priez pour nous! Un nuage toxique menace Nantes. » Le cardinal de Paris n'avait pas marchandé sa bénédic- tion... La campagne présidentielle allait commencer. Il nous parlait de François Mitterrand avec la précision et la passion d'un biographe. -

For a History of Militant Violence in France. the Case of Gaullist Order Services
Journal of Liberal Arts and Humanities (JLAH) Issue: Vol. 1; No. 4; April 2020 pp. 92-100 ISSN 2690-070X (Print) 2690-0718 (Online) Website: www.jlahnet.com E-mail: [email protected] For a History of Militant Violence in France. The case of Gaullist Order Services Bryan Muller, PhD University of Lorraine Laboratory CRULH, Metz (France) Abstract This article examines the History of Order Services in France after the Second World War, focusing on the Gaullist Order Service. It shows that the RPF is set up at the end of 1947-beginning of 1948, in order to respond to the aggressiveness of the Communist Party, a very professional order service. Its model is paramilitary in terms of its number of staff, a residual presence of weapons, the existence of a clandestine parallel organisation, the over-representation of the military, including active soldiers, and an authoritarian structure and operation. From the early 1960s onwards, there was a paradigm shift in the relationship to militant violence. The Gaullist Order Service adopts a model similar to Police forces’, making it more peaceful. There is demilitarization in terms of manpower, circulation of weapons and clandestinity, even if the operation remains verticalized and political surveillance practices persist here and there. The change in context is decisive: the police services have moved from the oppositional framework of the Cold War to a less tense configuration, that of the ruling party's police services, in a calmer international environment. From the end of 1959, the quick decline in militant violence (with the exception of the Algerian Affair) allow to the SAC to confine itself into a dissuasive stance. -
French Political Parties and Russia: the Politics of Power and Influence
French Political Parties and Russia: The Politics of Power and Influence Jean-Yves Camus In 2018, what relationship do French political parties have with the Russian Federation, its government, and its political parties, including but not limited to its most prominent party, United Russia? In recent years, this issue has often been discussed in relation to two preconceived notions. The first is that financial relationships are the primary—if not the only— explanation: anything “funded by Russia” is supposed to support Russia’s positions, specifically the ideology of President Putin and United Russia. The second is that the goal of Russia’s financial relationships with political personalities or entities is to meddle in France’s internal affairs, either by influencing the electoral process or by spreading fake news and thereby shifting public opinion. In this study, we propose a different approach. We begin from the standpoint that both Russia and France are major political, economic, and military powers. Both pursue strategies to secure power and influence. As such, they are obliged to have trade relations, to cooperate, and to engage in dialogue, even in the current strained international context. Despite the war in South Ossetia and Abkhazia in 2008, then the annexation of Crimea and the Donbas war in 2014, followed by then-President François Hollande’s decision not to deliver Mistral warships to Russia, and finally President Macron’s “cold shoulder” due to Russia’s supposed interference in the French presidential campaign, the relationship has never broken down. The two states have an objective interest in forecasting the political situation in their countries, and—while cooperating with the current administrations—diversifying their political contacts as much as possible to ensure that any turnover or change in the government does not risk the loss of their contacts.