L'autre Siècle De Messer Gaster? Physiologies De L'estomac Au Xixe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fighting for France's Political Future in the Long Wake of the Commune, 1871-1880
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2013 Long Live the Revolutions: Fighting for France's Political Future in the Long Wake of the Commune, 1871-1880 Heather Marlene Bennett University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the European History Commons Recommended Citation Bennett, Heather Marlene, "Long Live the Revolutions: Fighting for France's Political Future in the Long Wake of the Commune, 1871-1880" (2013). Publicly Accessible Penn Dissertations. 734. https://repository.upenn.edu/edissertations/734 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/734 For more information, please contact [email protected]. Long Live the Revolutions: Fighting for France's Political Future in the Long Wake of the Commune, 1871-1880 Abstract The traumatic legacies of the Paris Commune and its harsh suppression in 1871 had a significant impact on the identities and voter outreach efforts of each of the chief political blocs of the 1870s. The political and cultural developments of this phenomenal decade, which is frequently mislabeled as calm and stable, established the Republic's longevity and set its character. Yet the Commune's legacies have never been comprehensively examined in a way that synthesizes their political and cultural effects. This dissertation offers a compelling perspective of the 1870s through qualitative and quantitative analyses of the influence of these legacies, using sources as diverse as parliamentary debates, visual media, and scribbled sedition on city walls, to explicate the decade's most important political and cultural moments, their origins, and their impact. -
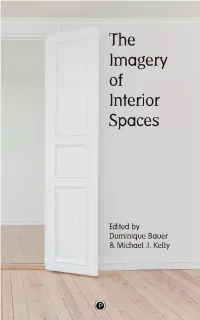
The Imagery of Interior Spaces
the imagery of interior spaces Before you start to read this book, take this moment to think about making a donation to punctum books, an independent non-profit press, @ https://punctumbooks.com/support/ If you’re reading the e-book, you can click on the image below to go directly to our donations site. Any amount, no matter the size, is appreciated and will help us to keep our ship of fools afloat. Contri- butions from dedicated readers will also help us to keep our commons open and to cultivate new work that can’t find a welcoming port elsewhere. Our ad- venture is not possible without your support. Vive la Open Access. Fig. 1. Hieronymus Bosch, Ship of Fools (1490–1500) the imagery of interior spaces. Copyright © 2019 by the editors and au- thors. This work carries a Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International li- cense, which means that you are free to copy and redistribute the material in any medium or format, and you may also remix, transform and build upon the material, as long as you clearly attribute the work to the authors (but not in a way that suggests the authors or punctum books endorses you and your work), you do not use this work for commercial gain in any form whatsoever, and that for any remixing and transformation, you distribute your rebuild under the same license. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ First published in 2019 by punctum books, Earth, Milky Way. https://punctumbooks.com ISBN-13: 978-1-950192-19-9 (print) ISBN-13: 978-1-950192-20-5 (ePDF) doi: 10.21983/P3.0248.1.00 lccn: 2019937173 Library of Congress Cataloging Data is available from the Library of Congress Book design: Vincent W.J. -

ÉCRITURE ARTISTE and the IDEA of PAINTERLY WRITING in NINETEENTH-CENTURY FRANCE by ALEXANDRA SLAVE a DISSERTATION Presented To
ÉCRITURE ARTISTE AND THE IDEA OF PAINTERLY WRITING IN NINETEENTH-CENTURY FRANCE by ALEXANDRA SLAVE A DISSERTATION Presented to the Department of Romance Languages and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy September 2017 DISSERTATION APPROVAL PAGE Student: Alexandra Slave Title: Écriture Artiste and the Idea of Painterly Writing in Nineteenth-Century France This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in the Department of Romance Languages by: Evlyn Gould Chairperson Nathalie Hester Core Member Alexandre Albert-Galtier Core Member George J. Sheridan Institutional Representative and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded September 2017 ii © 2017 Alexandra Slave iii DISSERTATION ABSTRACT Alexandra Slave Doctor of Philosophy Department of Romance Languages September 2017 Title: Écriture Artiste and the Idea of Painterly Writing in Nineteenth-Century France My interdisciplinary dissertation, Écriture Artiste and the Idea of Painterly Writing in Nineteenth-Century France, studies the notion of écriture artiste as an ideologically charged aesthetic doctrine that provides a better understanding of the rapports between art and the socio-historical context of mid nineteenth-century France. Specifically, using a case study approach, I examined four encounters between writers and painters, including Gustave Flaubert, Gustave Moreau, the Goncourt brothers, Eugène Delacroix, Émile Zola, Édouard Manet, J.-K. Huysmans and Odilon Redon. I analyzed how these pairings, each illustrative of a different facet of écriture artiste, highlight extratextual realities of the time through aesthetic embellishments. -

Balzac Entre 1856 Et 1858 Stéphane Vachon
Document généré le 29 sept. 2021 16:00 Études françaises Balzac entre 1856 et 1858 Stéphane Vachon 1857. Un état de l’imaginaire littéraire Résumé de l'article Volume 43, numéro 2, 2007 Entre mai 1856 et mars 1858, un foisonnement d’études inédites paraissent sur Honoré de Balzac qui s’écartent de la tradition des témoignages et des critiques URI : https://id.erudit.org/iderudit/016470ar biographiques — celle des contemporains qui ont côtoyé le grand homme DOI : https://doi.org/10.7202/016470ar disparu et se grandissent en disant qu’ils l’ont bien connu. Si l’on peut affirmer qu’une révolution s’est opérée en août 1850 sur la tombe de Balzac qui affecte Aller au sommaire du numéro les appropriations de son oeuvre autant que le discours global sur le genre romanesque et sur son ennoblissement, on peut ajouter que la mêlée des discours qui s’appliquent à l’auteur de La comédie humaine sept ans plus tard, tandis que Flaubert et Baudelaire sont poursuivis pour outrage à la morale Éditeur(s) publique et à la religion, permet de réarticuler les tensions entre romantisme, Les Presses de l'Université de Montréal réalisme et naturalisme, et entre romantisme et modernité. ISSN 0014-2085 (imprimé) 1492-1405 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Vachon, S. (2007). Balzac entre 1856 et 1858. Études françaises, 43(2), 13–29. https://doi.org/10.7202/016470ar Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 2007 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. -
Decadent Perfume: Under the Skin and Through the Page
Decadent Perfume: Under the Skin and through the Page Cheryl Krueger On 1 October 1912, the New York Times ran the provocative report ‘Perfume now Injected: Latest Fad in Paris. Skin Becomes Saturated with Aroma’. Similar articles had been circulating since at least 1896, when the L.A. Times called subcutaneous perfume injection a ‘Queer Fad of French Women’.1 Was it an urban myth? Were Americans overreacting to quirks of continental fashion? Or were French women in fact infusing themselves with perfume? Max Nordau had already deemed seekers of olfactory sensation degenerate (502), warning that pleasure in smell becomes a ‘malady of love […] from which only the degenerate suffer’ (501). Willful puncturing of the skin recalls an algophilic behaviour that one turn-of-the-century practitioner attributed to a ‘degener- ate’s fantasy’ frequently observed in hysterical women: sticking oneself with pins (Clérambault 29–30). The image of penetrating the body with scented liquid suggests fashionable drug fads of the period as well: ingestion and injec- tion of ether, opium eating, morphine shooting parties.2 At least one reporter emphasized the correlation between perfume injection and drug abuse: A Paris physician (says our correspondent) has nipped in the bud a habit which promised to be as dangerous as that of morphine. It appears that a well-known Parisienne had discovered that subcutaneous injections of certain perfumes gave their special fragrance to the skin, and that it was quite possible to exhale the lily, the rose, or any other floral scent. (‘Injec- tions of Perfumes’, New York Times, 1898) This attention to the biological intimacy of perfume injection, its perilous eccentricity and the physical alteration that results, bespeaks a suspicion of perfume abuse that seems to have intensified as fragrance products became more affordable, more available and more feminized in the nineteenth century. -

INFORMATION to USERS the Most Advanced Technology Has Been Used to Photo Graph and Reproduce This Manuscript from the Microfilm Master
INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. These are also available as one exposure on a standard 35mm slide17 or" x as 23" a black and white photographic print for an additional charge. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 8907270 Out from under the artists’ brush: Aesthetics and psychoanalysis in “Manette Salomon” and “L’OEuvre” Molnar, Julie Arlene, Ph.D. -

La Recepció D'alphonse Daudet En Llengua Catalana. Traduccions En
UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE LLETRES DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA LA RECEPCIÓ D’ALPHONSE DAUDET EN LLENGUA CATALANA. TRADUCCIONS EN VOLUM Àngels RIBES DE DIOS Tesi doctoral dirigida per la Dra Marta GINÉ JANER Any 2003 LA RECEPCIÓ D’ALPHONSE DAUDET EN LLENGUA CATALANA. TRADUCCIONS EN VOLUM 2 Fer la recerca de la recepció d’Alphonse Daudet en català ha estat un treball dur i difícil però apassionant, per tant, voldria agrair a totes les institucions i persones el seu ajut per dur a terme la realització d’aquesta tesi doctoral. He rebut, en general, tota mena de facilitats i un tracte afable. Recordo les hores passades als arxius, biblioteques i hemeroteques: l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, l’Institut del Teatre de Barcelona, la Universitat de Lleida, etc. També l’estada a les biblioteques de París: Bibliothèque Nationale de France, Centre Beaubourg, Sainte Geneviève i el Colegio de España, gràcies a l’ajut de l’Ajuntament de Lleida que financiava el grup de recerca de la Universitat de Lleida “La recepción de la literatura francesa desde la revolución y hasta nuestros días, en las letras hispánicas del siglo XX”. El meu agraïment a l’associació Amis d’Alphonse Daudet i a la revista Le Petit Chose - ambdues presidides per Roger Ripoll - per tota la informació rebuda i per tot el treball que fan per mantenir viva la memòria i l’obra de Daudet. La meva gratitud a Christian Chelebourg que em va invitar a participar al col·loqui "Alphonse Daudet, pluriel et singulier”, celebrat al Centre Culturel International de Cérisy-la-Salle (França) del 14 al 21 d’agost de 2002. -

Balzac, Honor
« Les romans mis en pièces»: étude sur la pratique de l’adaptation théâtrale à la fin du XIXe siècle. Le cas d’Émile Zola (1873-1902). by Geneviève De Viveiros A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Département d’Études Françaises University of Toronto © Copyright by Geneviève De Viveiros 2009 « Les romans mis en pièces »: étude sur la pratique de l’adaptation théâtrale à la fin du XIXe siècle. Le cas d’Émile Zola (1873-1902). Geneviève De Viveiros Doctor of Philosophy Degree Département d’études françaises University of Toronto 2009 Résumé Le XIXe siècle marque la consécration d’une nouvelle tendance au théâtre : la représentation de pièces tirées de romans. En France, cette pratique connaît, surtout dans la seconde moitié du siècle, une popularité sans précédent. La thèse est une étude historique de ce phénomène. La première partie situe la pratique de l’adaptation dans le contexte culturel de la deuxième moitié du XIXe siècle. La deuxième partie étudie les conditions qui entourent la production de ce type de pièce (lieux de représentation, auteurs, éditeurs). Nous nous intéressons aussi dans cette partie au discours critique et à la perception des adaptations théâtrales dans le milieu littéraire. Enfin, la troisième partie se concentre sur les adaptations théâtrales tirées des œuvres d’Émile Zola et représentées à Paris entre 1873 et 1902. Zola fut l’un des auteurs les plus adaptés sur scène au cours de cette période. En cherchant à situer l’œuvre et la participation du chef de file de l’école naturaliste dans ce phénomène théâtral, nous étudions d’abord les positions de Zola à l’égard de la pratique de l’adaptation telles qu’elles s’expriment à travers les chroniques dramatiques et les entrevues qu’il publia ii dans les journaux. -

Balzac Entre 1856 Et 1858 Stéphane Vachon
Document generated on 09/29/2021 2:45 p.m. Études françaises Balzac entre 1856 et 1858 Stéphane Vachon 1857. Un état de l’imaginaire littéraire Article abstract Volume 43, Number 2, 2007 Between may 1856 and March 1858, a profusion of previously unpublished studies on Honoré de Balzac appears, which set themselves apart from the URI: https://id.erudit.org/iderudit/016470ar personal accounts and the biographical critiques—those of contemporaries DOI: https://doi.org/10.7202/016470ar who were acquaintances of the great man and who aggrandize themselves after his disappearance by saying that they knew him well. If we can affirm See table of contents that a revolution occurred in August 1850 on Balzac’s tomb that affects the appropriations of his works as much as it affects the global discourse on the genre of the novel and its ennoblement, we can also add that the plurality of discourses that apply to the author of La comédie humaine seven years later Publisher(s) (while Flaubert and Baudelaire are charged for moral and religious offenses) Les Presses de l'Université de Montréal allows us to rearticulate the tensions between romanticism, realism, and naturalism, between romanticism and modernity. ISSN 0014-2085 (print) 1492-1405 (digital) Explore this journal Cite this article Vachon, S. (2007). Balzac entre 1856 et 1858. Études françaises, 43(2), 13–29. https://doi.org/10.7202/016470ar Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 2007 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. -
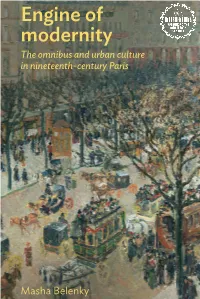
Modernity Engine Of
Engine of modernity Engine of Engine of Engine of modernity examines the connection between public modernity transportation and popular culture in nineteenth-century Paris by focussing on the omnibus – a horse-drawn vehicle for mass urban transport which enabled contact across lines of class and gender. A major The omnibus and urban culture advancement in urban locomotion, the omnibus generated innovations in social practices by compelling passengers of diverse backgrounds to in nineteenth-century Paris interact within the vehicle’s close confines. Although the omnibus itself did not actually have an engine, its arrival on the streets of Paris and in the pages of popular literature acted as a motor for a fundamental cultural shift in how people thought about the city, its social life, and its artistic representations. At the intersection of literary criticism and cultural history, Engine of modernity argues that for nineteenth-century French writers and artists, the omnibus was much more than a mode of transportation. It became a metaphor through which to explore evolving social dynamics of class Belenky and gender, meditate on the meaning of progress and change, and reflect on one’s own literary and artistic practices. Because of the book’s interdisciplinary approach and scope, Engine of modernity will appeal to scholars and students in a variety of academic fields, including French literature and culture, French and European history, urban studies, gender studies, and nineteenth-century visual culture. Masha Belenky is Associate Professor of French at the George Washington University Cover image: Camille Pissarro. Boulevard des Italiens, morning sunlight. 1897. Oil on canvas. -

Musical References in Proust
!Music in Marcel Proust’s ! À la recherche du temps perdu !A Playlist !Resource James Connelly !Proust Society of America, !Boston Chapter ! Orris Publishing Music in Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu A Playlist Resource <<Quand je ne suis pas trop triste pour en écouter, ma consolation est dans la musique.>> Music in Marcel Proust’s À la recherche du temps perdu A Playlist Resource James Connelly Orris Publishing Hingham, MA 2013 Compilation and Original Content (10 October 2013) Copyright © James Connelly, 2013! This publication is for nonprofit educational purposes within the meaning of 17 U.S.C. § 107. Notwithstanding such copyright protection as may apply, fair use of this publication and its contents is permitted for nonprofit educational and other recognized purposes in accordance with 17 U.S.C. § 107. Notes on the photographs of Marcel Proust (1871-1922): Front Cover : Proust kneels to “serenade” Jeanne Pouquet at the boulevard Bineau tennis court, 1891. This relationship, depicted in what Proust called his“court of love,” is described in William C. Carter, Marcel Proust, A Life (Yale University Press: 2000), p. 123. Frontispiece : Proust photographed by Paul Nadar, 21 December 1892. The quotation is from Proust’s letter of 5 January 1914 to Mme Émile Straus (Kolb, ed., Correspondance, t. XIII, p. 31). Introduction : Page vii : Proust stands, center rear, with the Brancovan family, the Prince and Princesse de Polignac, and guests at the Brancovan home, Villa Bassaraba, near Évian-les-Bains, 1899. Poet Anna de Noailles is seated , second row, at right. Pianist Léon Delafosse (1874-1951), standing far right, had earlier (1894-95) dedicated to Proust the song “Baisers,” one of Delafosse’s settings of verses from Robert de Montesquiou-Fézensac’s Les Chauves-souris: http://imslp.org/wiki/Les_Chauves-Souris_ %28Delafosse,_L%C3%A9on%29 . -

Making Love / Making Work the Sculpture Practice of Sarah Bernhardt
Making Love / Making Work The Sculpture Practice of Sarah Bernhardt Volume II Miranda Eve Mason Submitted in accordance with the requirements of the degree of Doctor of Philosophy The University of Leeds, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies May 2007 The candidate confirms that the work submitted is her own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. Table of Contents 3 Making Work: The Sculpture Practice of Sarah Bernhardt 242 3. 1 A Body of Work The Catalogue of Works Overview of Bernhardt's Oeuvre 3.2 The Labour and Love of Writing Art History 3. 3 Representing Works Apres la tempete (1876) Statuette de Sarah Bernhardt (c. 1880) Ophelie (1880) 3.4 Sculpture Training in Nineteenth-Century France: A Brief Synopsis 3.5 Becoming This Sculptor: Bernhardt's Training and Daily Studio Practice Bernhardt's Teachers: Roland Mathieu-Meusnier and Jules Franceschi Why Mathieu-Meusnier? What did Mathieu-Meusnier do? Why Franceschi? What did Franceschi do? How Did Bernhardt Not Learn Sculpture? Tall Tales, Silly Rumours, Misreadings 3.6 What Does a Sculptor Do? .An 'Aptitude for Sculpture' Drawing Anatomy Working from the Life Model Modelling Clay Casting Plaster Carving Marble ii Praticiens, Founders, Merchants, Transportation Domestic Labour, Studio Assistance, Taking Care of the Sculptor Reading about Sculpture, Thinking about Sculpture, Speaking about Sculpture 3. 7 A Sculptors' World: Bernhardt and her Peers 3.