1 Republique De Guinee Ministere De L'agriculture
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guinea : Reference Map of Kankan Region (As of 3 March 2015)
Guinea : Reference Map of Kankan Region (as of 3 March 2015) Bankolen Mambifagalena Niagassola Kry Tourelen Berlen Sokoromansa Magadiano Faraboloni Linkekoro KIGNEKOUROU CENTRE Bouyido Malsadou Seourou Konfara 2 Gnembou Tanssa Magnaka KOTE CENTRE Balenda SOUMBARAYA CENTRE Kourelen TALABE CENTRE Dialawassa II Kondoko Djanwely Itipony Dougounta Dora Kourakoda DIBIA CENTRE Djinko Ilimalo Naboun Kanimbakalako Kodougoulen KAKAMA CENTRE Tondo Komagron Kayaga Kignedi Sininko Kadabili Kignero Gnere Sininkoro Badamako Kounsounkoro Yirikelèma Kanikoumbaya SOKORO CENTRE DIATEA CENTRE Dita Salla Tondji1 Koda Kebesabaya Siguirini Sakounou Malea Bembéta Megnèkoma Silabado Diakan Toukönö BOULAN CENTRE Gbèdela MANKADIAN CENTRE Gbörökola Doko Tombani Maragbè Kana Sékela Mansadji Sidao Tonso Banankölö Tomba Doula Amina Amina Kinièba Franwalia Tinko Diatifere Fountou Soumbalakölen Iroda Kounkoun Koda Mainou SARAYA CENTRE Tomboni Sinimbaya KOBEDRA CENTRE MIGNADA CENTRE Bökökö Farani Banora Simbona Bida Tomba Boufe Bandioula FOULATA CENTRE Kintinian Yorola Tougnou Sanouna SEELA CENTRE Bankon MALI Tinkoba Kobada Beretela Sando Noumandiana Kandani Fodela Bèrèko Tabakoro BAMBALA Tabako Madila Moyafara Kourouni Banantamou Siguiri FALAMA BANFARA CENTRE Saint Alexis Dialakoro Nedekoroko Banantou Lansanaya Sakolado Manakoro Farabada Dounin Farabelen Bida Bantambaye Woléwoléya Koda Koda Kogne Tambabougou Gbongoroma Kigne Kokoudouninda Dinguiraye Gbilin Balandougouba KONKOYE CENTRE Waran-Fougou Kiniebakoura DIARRADOU CENTRE Sansani Faradjian Tassiliman Centre Kewoulé -

Région De Kankan 2018
REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice- Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE La région de Kankan en chiffres Edition 2020 GEOGRAPHIE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE Géographie 0rganisation administrative en 2018 5 préfectures ; 53 sous-préfectures ; 5 communes urbaines, Superficie = 72 145km2 920 districts/quartiers ; 2 117 secteurs 53 communes rurales Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) Préfectures Sous-préfectures Balandougou, Bate-Nafadji, Boula, Gberedou-Baranama, Karifamoriyah, Koumban, Kankan Mamouroudou, Missamana, Moribayah, Sabadou-Baranama, Tinti-Oulen, Tokounou Kérouané Banankoro, Damaro, Komodou, Kounsankoro, Linko, Sibiribaro, Soromaya Babila, Balato, Banfele, Baro, Cissela, Douako, Doura, Kiniero, Komola-Koura, Koumana, Kouroussa Sanguiana Balandougouba, Dialakoro, Faralako, Kantoumania, Kinieran, Kondianakoro, Koundian, Morodou, Mandiana Niantania, Saladou, Sansando Banko, Doko, Faranwalia, Kiniebakoura, Kintinian, Malea, Naboun, Niagossola, Niandankoro, Siguiri Norassoba, Nounkounkan, Siguirini Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES Population 1983 1996 2014 Population région de Kankan 640 432 1 011 644 1 972 537 Population de la principale préfecture : Siguiri 161 303 271 224 687 002 Part de la population nationale en 2014 : 18,7 % Rang régional en 2018 : 1/8 Sources : Institut national de la statistique/RGPH Population au 1er -
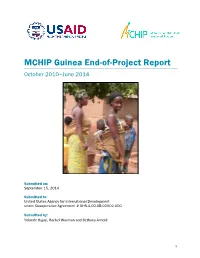
MCHIP Guinea End-Of-Project Report October 2010–June 2014
MCHIP Guinea End-of-Project Report October 2010–June 2014 Submitted on: September 15, 2014 Submitted to: United States Agency for International Development under Coooperative Agreement # GHS-A-00-08-00002-000 Submitted by: Yolande Hyjazi, Rachel Waxman and Bethany Arnold 1 The Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) is the USAID Bureau for Global Health’s flagship maternal, neonatal and child health (MNCH) program. MCHIP supports programming in maternal, newborn and child health, immunization, family planning, malaria, nutrition, and HIV/AIDS, and strongly encourages opportunities for integration. Cross-cutting technical areas include water, sanitation, hygiene, urban health and health systems strengthening. MCHIP brings together a partnership of organizations with demonstrated success in reducing maternal, newborn and child mortality rates and malnutrition. Each partner will take the lead in developing programs around specific technical areas: Jhpiego, as the Prime, will lead maternal health, family planning/reproductive health, and prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT); JSI—child health, immunization, and pediatric AIDS; Save the Children—newborn health, community interventions for MNCH, and community mobilization; PATH—nutrition and health technology; JHU/IIP—research and evaluation; Broad Branch—health financing; PSI—social marketing; and ICF International—continues support for the Child Survival and Health Grants Program (CSHGP) and the Malaria Communities Program (MCP). This report was made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID), under the terms of the Leader with Associates Cooperative Agreement GHS-A-00-08-00002-00. The contents are the responsibility of the Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Guinea - Number of Confirmed Ebola Cases and Population by Sous - Préfecture (As of 11 April 2015)
Guinea - Number of confirmed Ebola cases and population by Sous - préfecture (as of 11 April 2015) Sambailo SENEGAL Youkounkoun Sareboido Termesse Kamabi Lebekeren Balaki Touba Foulamory Guinguan Mali Niagassola Naboun Ctre Madina Gadha MALI GUINEA-BISSAU Wora Gayah Hidayatou Salambande Woundou Gagnakaly Fougou Kounsitel Telire Fello Koundoua Linsan Donghol Siguirini Matakaou Fafaya Diatifere Franwalia Saran Yimbering Sigon Koumbia Banora Malea Doko Kouratongo Koubia Tianguel Ctre Malanta Bori Lafou Pilimini Wendou Diontou Bankon Korbe Dalein Kintinian Mbour Kolet Siguiri Sansale Konah Balaya Sannou Tougue Dinguiraye Ctre Kakony Parawol Diari Lansanaya Dialokoro Dabiss Kaalan Dionfo Tangali Sagale Ctre Ctr Balandougouba Kiniebakoura Noussy Koin Kalinko Koba Timbi Hafia Mombeyah Fatako Herico Madina Kansangui Komola Koundianakoro Missira Norassoba Niandankoro Bantignel Kankalabe Selouma Khoura Sangaredi Santou Ninguelande Bourouwal Kolangui Teguereyah Sansando Kinieran Timbi Bodie Donghol Brouwal Dialakoro Tarihoye Touni Kebali Boke Ley Touma Tape Mafara Bissikrima Kanfarande Konsotami Morodou Niantanina Ctre Telemele Miro Maci Ditinn Kankama Cissela Ctre Mitty Nyagara Doura Koundian Kolaboui Kaala Bate Daramagnaky Thionthian Dabola Koumana Malapouya Gongoret Ctre Nafadji Dalaba Saramoussaya Sanguiana Balato Kamsar Sinta Ctre Banguigny Sangareah Faralako Poredaka Dogomet Ndema Banko Babila Mandiana Bintimodia Sogolon Timbo Kouroussa Baro Karifamoriah Ctre Kolia Konendou Ctre Balandougou Baguinet Tolo Dounet Kindoye Mankountan Lisso Fria -

GUINÉE - Kankan /Préfecture De Kouroussa - Sous Préfecture De Kouroussa Urbain - Cartographie De RECOS
GUINÉE - Kankan /Préfecture de Kouroussa - Sous Préfecture de Kouroussa Urbain - Cartographie de RECOS B ou nk a n Population 2019 Kouroussa Urbain : 45829 hab Wassabada 9177 DOURA Kouroussa-Koura 7898 Doula 7429 Sandö 6729 ± Diaragbèla 3986 MALI Saman 3129 GAMBIA Talikan Bamako Mènindji 756 !(G SENEGAL ")" Djonkö 706 Labé Frakoun 705 Boké Kankan Mamou Kanaoro 694 Faranah E R Kindia I O ")" Kiniédouba 610 V Conakry I ' SANGUIANA D Wouloukin 490 GUINEA E ")"Freetown T Bankan 489 SIERRA Nzérékoré Ô C LEONE Kinkini 468 LIBERIA ")" 447 Mali Safina Kankan Poste de MALI KOUMANA LABÉ Banankö 367 santé Bokoro Koubia Siguiri Tougué Dinguiraye Taféla 353 !(G Labé KANKAN Kouroussa Souloukoudö 320 Dalaba Dabola Mandiana E R Sökörö 319 GUINEA I Mamou O V I MAMOU FARANAH ' D Tambiko 279 Kindia Faranah Kankan E T Nènèfra 252 Ô SIERRA C Kènkèna 227 Kissidougou Kérouané LEONE Beyla Guéckédou Macenta LEGENDE !!(5 Safina !!(1 \\\ \\\ 24km R! Kanka [5] 25km ! R Kanaoro [1] \\Position de Reco Support MSF depuis l'année 2018 \!!(3 Limite de 5km autour de RECOS \ Zone Couverte par un centre de santé 1\4km ! Poste de R Djonko [3] santé de Structure de Santé Moussaya !!(6 H !(G \\\ Â Hopital Préfectoral 14km ! Kinkinin [6] R (!G Centre de Santé (2 \!! !(G Poste de Santé Poste de \\ ! 7km santé Konda R R! Village couvert par le RECO !(G Kenkena [2] Menendji [2] ! Banako [2] ¥¥ Village non couvert par le RECO R ! Soloukoudo R !(4 6km Estimation de la population \\! Wouloukin [4] [2] \ <= 650 1\1km R!!(GFrakounR! [4] R! 9km 6km 651 à 1000 Poste de santé Poste de -

Les Pôles De Développement Du PDLGII En Haute Guinée : Une Dynamique Socio -Économique Intercommunale Prometteuse, Un Atout Pour La Décentralisation En Guinée
Capitalisation des pôles de développement des préfectures de Kouroussa et Siguiri Les pôles de développement du PDLGII en Haute Guinée : une dynamique socio -économique intercommunale prometteuse, un atout pour la décentralisation en Guinée odile Balizet 2012 Capitalisation des pôles de développement des préfectures de Kouroussa et Siguiri Avant propos L’expérience en pôle de développement économique est une stratégie permettant le regroupement de plusieurs collectivités locales réunies par une solidarité naturelle et bénéficiant de potentialités communes pour la gestion de proximité en vue de promouvoir le développement socioéconomique durable. Monsieur Alhassane CONDE Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 2 Avertissement aux lecteurs Ce document est le fruit d’une réflexion collective avec les principaux acteurs impliqués dans les pôles de développement. : au niveau de l’état guinéen : Secrétaires généraux du ministère, 3 secrétaires généraux et receveurs des Communautés rurales. Maires, élus, techniciens des collectivités locales, représentants de la société civile en particulier des pôles de Kiniéro, Norassoba et Doko, au niveau de l’équipe technique du PDLG II, la cellule d’appui technique et les 9 secrétaires techniques de pôles ainsi que le partenaire stratégique du PDLGII le PACV2 et la cellule d’appui conseil des plates formes multifonctionnelles ATC. L’ensemble de ces acteurs a souhaité faire partager cette expérience aussi bien dans ses réussites que ses difficultés, sous forme d’un document à l’adresse de l’ensemble des acteurs impliqués de près ou de loin dans la décentralisation et le développement local. Par cette capitalisation de l’expérience pilote des pôles de développement, ils espèrent contribuer à la réflexion mais aussi à la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local en Guinée et plus largement de la sous région. -

Région De Kankan En Chiffres
REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice- Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE La région de Kankan en chiffres Edition 201 8 GEOGRAPHIE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE Géographie 0rganisation administrative en 2016 5 préfectures ; 53 sous-préfectures ; 878 districts ; 5 communes urbaines, Superficie = 72 145km 2 68 quartiers ; 1 864 secteurs 53 communes rurales Source : Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation Préfectures Sous-préfectures Balandougou, Bate-nafadji, Boula, Gberedou-Baranama, Kankan-Centre, Karifamoriyah, Koumban, Kankan Mamouroudou, Missamana, Moribayah, Sabadou-Baranama, Tinti-Oulen, Tokounou Kérouané Banankoro, Damaro, Kerouane-Centre, Komodou, Kounsankoro, Linko, Sibiribaro, Soromaya Babila, Balato, Banfele, Baro, Cissela, Douako, Doura, Kiniero, Komola-koura, Koumana, Kouroussa Kouroussa-Centre, Sanguiana Balandougouba, Dialakoro, Faralako, Kantoumania, Kinieran, Kondianakoro, Koundian, Mandian- Mandiana centre, Morodou, Niantania, Saladou, Sansando Banko, Doko, Faranwalia, Kiniebakoura, Kintinian, Malea, Naboun, Niagossola, Niandankoro, Siguiri Norassoba, Nounkounkan, Siguiri Centre, Siguirini Source : Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES Population 1983 1996 2014 Population région de Kankan 640 432 1 011 644 1 972 537 Population de la principale préfecture : Siguiri 161 303 271 224 687 002 Part de la population nationale en 2014 : 18,7 % Rang régional en 2016 : 1/8 Sources : Institut national de la statistique/RGPH -

Sous-Préfecture De Doura
GUINÉE - Région Kankan / Préfecture de KourLoeledua ssa - Sous-PréfectureBen ddoue Doura - Carte de Base Kewoulé Balanen Kobala (!G!! Leleda Centre Todakoudounkan Diabotésidi R É G I O N D E Tombonin Gbérèbbérèkolen K A N K A N Siko 68km!! Kérouané Danfako Doungbé Faranindjan SOUS-PREFECTURE 67km Faragbègba ± DE KOMOLA-KOURA Dalanikan Sounsounkoudoun Kolenkoun Centre Tonofida Poste de Centre ! !! ! 64km santé de Farakoba Lemourou Farakoba ! Kolensen !!G58km Dalakan ( Bohoulé 71km Kolendou Talininkoro Gbonko Kountoun Sébèfarani Talibonin Poste de Siladalakolen Bankoulenkoura Santé de Lemourou Soulougbalako Sagbakoro SOUS-PREFECTURE Tombo !! (!GSagbakoro DE KOUMANA Sédaninkoro Hérèmakono Damissakoro Kossokoba Bankoulenkoro Centre Centre !! ! Farada Centre ! PREFECTURE !! 48km Dambafée Signendala DE SIGUIRI Kada Faradian Kadabili Banfele Gbanimofara Koura Banfele Centre Koro Centre Gnamatombo !! !! Konkono Touloukouraba Taliyaran Manankourou Kossoko !! 42km Fadou Nounkounkan Boroto Nounkounkan Centre Sokoura I Centre de Sante ! ! ! ! !G eNige Centre !(! Fandia Centre L r Nounkounkan !! Paneau Scolaire Gbenkorokoro II Centre SOUS-PREFECTURE Château D'Eau 65 Böfilianin ! !! G! DE DOURA (!!G ! Balandou Gbenkorokoro( !!Landy Centre ! PREFECTURE DE ! Centre Korowagnako Centre Makon!o Centre Poste de KOUROUSSA santé !! Norakoro Hèrèmakono Heremakono Norassoba ! Centre ! Soulafinko Centre SOUS-PREFECTURE 31km (!G 26km de Sante DE SANGUIANA !! !! 36km Sifra (!G ! Kanké Bansounkélén Nenen Traoréla Kankésyllala 22km Traoré !! 22km Dénkada 34km!Karikarissa -

Sous-Préfecture De Komola Koura
GUINÉE - Région Kankan /H aPfia réfecture de Kouroussa - Sous-Préfecture de Komola Koura - Carte de Base !! Fifa Centre Thiankoun Lantadji Carrefour Ndiarendi Paradji Centre Bamabadala Ley Sere !! Senore Gadha Kouby Bhawo Bowal Ti R É G I O N D E nkisso Koubi Sinthouidji R É G I O N D E Kourekoun Linguere K A N K A N Koubi Ley Thiankounwoe Fatafing Kiniono K A N K A N !! Simpia Centre Sere Centre !! 49km Bantambaye ± PREFECTURE Woléwoléya Bilindou Madina Koura DE SIGUIRI Ndjambou Balandougou R É G I O N D E Banié Diboli Temenedougou F A R A N A H Hopital Hermakonon PREFECTURE DE Tinkiss !! o Prefectoral DINGUIRAYE Dinguiraye Souloukoufalan Â(!HG!!! Dinguiraye-Centre MGosquée (! 32km Secteur Kansaba 5 Villa Sylli Tinkisso Pelloye Centre 32km Faradjian Bhohere !! Kansakan 1 Parawol Kansakan 2 Diagui Kamabantan Centre ! Loukoun ! Nyakalen Leleda Safe Dioulabougou Balanen Poste de Leleda Centre(!G!! Dakamandji santé Kobala Sambaya Sambaya !! Diabotésidi (!G21km 20km SOUS-PREFECTURE Banankélén-Souaré Sambaya Saba DE KOMOLA-KOURA Kérouané Lenguere Konkèkan !! Danfako Koubikoura 19km Poste de Kounsigna Doungbé santé Balia Faragbègba SOUS-PREFECTURE 18km Konkèfing Dalamandji Doghol Poste de DE CISSÉLA Konkéfing Hérako Tonofida santé de (!G35km Dide Sambaya PREFECTURE Farakoba Farakoba !! 24km Koubihoun Limbon Kolensen (!!G DE DABOLA 27km 23km Koubi Kolendou Lory 16km Bohere 23km PREFECTURE Poste de Bélénkörö Koubaly 2 SOUS-PREFECTURE Hafia souty santé DE KOUROUSSA Poste de Bokodala 10km 10km Koubaly 1 Bissa DE DOURA 14km Heremakono Santé de Siladalakolen -

Guinea : Reference Map of Kankan Region (As of 02 Janv 2015)
Guinea : Reference Map of Kankan Region (as of 02 Janv 2015) Bankolen Mambifagalena Niagassola Kry Tourelen Berlen Sokoromansa Magadiano Faraboloni Linkekoro KIGNEKOUROU CENTRE Bouyido Malsadou Seourou Konfara 2 Gnembou Tanssa Magnaka KOTE CENTRE Balenda SOUMBARAYA CENTRE Kourelen TALABE CENTRE Dialawassa II Kondoko Djanwely Itipony Dougounta Dora Kourakoda DIBIA CENTRE Djinko Ilimalo Naboun Kanimbakalako Kodougoulen KAKAMA CENTRE Tondo Komagron Kayaga Kignedi Sininko Kadabili Kignero Gnere Sininkoro Badamako Kounsounkoro Yirikelèma Kanikoumbaya SOKORO CENTRE DIATEA CENTRE Dita Salla Tondji1 Koda Kebesabaya Siguirini Sakounou Malea Bembéta Megnèkoma Silabado Diakan Toukönö BOULAN CENTRE Gbèdela MANKADIAN CENTRE Gbörökola Doko Tombani Maragbè Kana Sékela Mansadji Sidao Tonso Banankölö Tomba Doula Amina Amina Kinièba Franwalia Tinko Diatifere Fountou Soumbalakölen Iroda Kounkoun Koda Mainou SARAYA CENTRE Tomboni Sinimbaya KOBEDRA CENTRE MIGNADA CENTRE Bökökö Farani Banora Simbona Bida Tomba Boufe Bandioula FOULATA CENTRE Kintinian Yorola Tougnou Sanouna SEELA CENTRE Bankon MALI Tinkoba Kobada Beretela Sando Noumandiana Kandani Fodela Bèrèko Tabakoro BAMBALA Tabako Madila Moyafara Kourouni Banantamou Siguiri FALAMA BANFARA CENTRE Saint Alexis Dialakoro Nedekoroko Banantou Lansanaya Sakolado Manakoro Farabada Dounin Farabelen Bida Bantambaye Woléwoléya Koda Koda Kogne Tambabougou Gbongoroma Kigne Kokoudouninda Dinguiraye Gbilin Balandougouba KONKOYE CENTRE Waran-Fougou Kiniebakoura DIARRADOU CENTRE Sansani Faradjian Tassiliman Centre Kewoulé -

Citizens' Involvement in Health Governance
CITIZENS’ INVOLVEMENT IN HEALTH GOVERNANCE (CIHG) Endline Data Collection Final Report September 2020 This report was prepared with funds provided by the U.S. Agency for International Development under Cooperative Agreement AID-675-LA-17-00001. The opinions expressed herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development. Contents Executive Summary ...................................................................................... 1 I. Introduction ............................................................................................... 5 Overview ...................................................................................................... 5 Background................................................................................................... 5 II. Methodology ............................................................................................ 6 Approach ...................................................................................................... 6 Data Collection ............................................................................................. 7 Analysis ....................................................................................................... 10 Limitations .................................................................................................. 10 Safety and Security ..................................................................................... 11 III. Findings ................................................................................................ -

Livelihood Zone Descriptions: Guinea
REVISION OF THE LIVELIHOODS ZONE MAP AND DESCRIPTIONS FOR THE REPUBLIC OF GUINEA A REPORT OF THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWROK (FEWS NET) November 2016 This report is based on the original livelihoods zoning report of 2013 and was produced by Julius Holt, Food Economy Group, consultant to FEWS NET GUINEA Livelihood Zone Map and Descriptions November 2016 2013 Table of Contents Acknowledgements ..................................................................................................................................................... 3 Introduction ................................................................................................................................................................. 4 Methodology ................................................................................................................................................................ 4 Changes to the Livelihood Zones Map ...................................................................................................................... 5 The National Context ................................................................................................................................................. 6 Livelihood Zone Descriptions .................................................................................................................................. 10 ZONE GN01 LITTORAL: RICE, FISHING, PALM OIL .................................................................................................................................................