5837-44Bd-9087-F404623634ee.Txt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2. Foreword by Cleveland Moffett, the Bulletin Magazine the Belgian
2. Foreword by Cleveland Moffett, The Bulletin Magazine The Belgian Revolution of 1830 has never been celebrated with the uproarious firework festivities that the national upheavals of the French, Americans, Mexicans or Russians inspire every year. One reason is that the Belgians never had any such colourful characters as Danton, Washington, Zapata or Lenin. They have their statues of Rogier, Gendebien and Merode, of course, and then there was that riot at the opera house in August – young men stirred by a romantic aria to throw their top hats in the air and cry ‘Liberty!’ – followed by the four days in September of valiant battle and around the Royal Park, all splendid events well worth commemorating. And yet the date chosen as Belgium’s national day is July 21, 1831, when an immigrant German prince agreed to be called Leopold I and to accept the role of the people’s king. Still, it was a peaceful compromise that ended a year of turmoil. A constitutional monarchy was what the upstart new nation’s powerful neighbours insisted upon. The only holdout, the one fierce opponent of this sensible solution, was journalist Louis de Potter (Bruges, 1786-1859). He, strangely enough, has no public statue or acknowledgement for his merits. Nothing more than a blue plate with his name in a short dusty side street in the pink district of Schaerbeek. And yet, without Louis de Potter it is hardly likely that there would have been any revolution at all. It was his eloquence, his pamphlets and proclamations, that led the people of Belgium, then under the thumb of William I of the Netherlands, to believe they could rise up against Dutch tyranny and go it alone. -

Redalyc.“Freemasonry As a Patriotic Society? the 1830 Belgian Revolution”
REHMLAC. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña E-ISSN: 1659-4223 [email protected] Universidad de Costa Rica Costa Rica Maes, Anaïs “Freemasonry as a Patriotic Society? The 1830 Belgian Revolution” REHMLAC. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, vol. 2, núm. 2, -diciembre, 2010, pp. 1-17 Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369537359001 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative “Freemasonry as a Patriotic Society? The 1830 Belgian Revolution” Anaïs Maes Consejo Científico: José Antonio Ferrer Benimeli (Universidad de Zaragoza), Miguel Guzmán-Stein (Universidad de Costa Rica), Eduardo Torres-Cuevas (Universidad de La Habana), Andreas Önnerfors (University of Leiden), María Eugenia Vázquez Semadeni (Universidad Nacional Autónoma de México), Roberto Valdés Valle (Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”), Carlos Martínez Moreno (Universidad Nacional Autónoma de México), Céline Sala (Université de Perpignan) Editor: Yván Pozuelo Andrés (IES Universidad Laboral de Gijón) Director: Ricardo Martínez Esquivel (Universidad de Costa Rica) Dirección web: http://rehmlac.com/main.html Correo electrónico: [email protected] Apartado postal: 243-2300 San José, Costa Rica REHMLAC ISSN 1659-4223 2 Vol. 2, Nº 2, Diciembre 2010-Abril 2011 Fecha de recibido: 12 junio 2010 – Fecha de aceptación: 3 agosto 2010 Palabras clave Masonería, patriotismo, nacionalismo, revolución, Bélgica Keywords Freemasonry, patriotism, nationalism, revolution, Belgium Resumen Al cuestionar la masonería y el patriotismo, tenemos que conceptualizar el análisis de la evolución de la identidad patriótica. -

Demain La Wallonie Avec La France Vers La Réunification Française
Paul-Henry Gendebien Demain la Wallonie avec la France Vers la réunification française Cet ouvrage est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 Belgique. Editeur responsable : Paul-Henry Gendebien, Jevigné 38 à 4990 Lierneux Illustration de couverture : coq wallon dans l'Hexagone et le drapeau français Texte achevé le 15 décembre 2013 (avant les élections du 25 mai 2014) Remerciements à Joël Goffin pour la relecture et la mise en page Table des matières CHAPITRE PREMIER.........................................................................................1 VERS LE DEMEMBREMENT DE LA BELGIQUE : LA FRANCE INTERPELLEE.................................................................................................1 Un gouvernement assis sur un baril de poudre..............................................4 Inévitable implication de la France...............................................................9 La nécessité et l’honneur.............................................................................10 Légitimité d’une assistance à peuple en danger..........................................16 Donner un objectif ambitieux à une nouvelle génération républicaine.......19 CHAPITRE II......................................................................................................21 COMMENT UNE CONSTRUCTION D’ABORD VOULUE PAR L’EUROPE EST ENSUITE DEVENUE INUTILE........................................21 Menaces contre l’ordre européen issu du -

National Sovereignty in the Belgian Constitution of 1831. on the Meaning(S) of Article 25
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Springer - Publisher Connector National Sovereignty in the Belgian Constitution of 1831. On the Meaning(s) of Article 25 Brecht Deseure Abstract Article 25 of the Belgian Constitution of 1831 specifi es that all powers emanate from the nation, but fails to defi ne who or what the nation is. This chapter aims at reconstructing the underdetermined meaning of national sovereignty by looking into a wide array of sources concerning the genesis and reception of the Belgian Constitution. It argues, fi rstly, that ‘nation’ and ‘King’ were conceptually differentiated notions, revealing a concern on the part of the Belgian National Congress to substitute the popular principle for the monarchical one. By vesting the origin of sovereignty exclusively in the nation, it relegated the monarch to the posi- tion of a constituted power. Secondly, it refutes the widely accepted defi nition of national sovereignty as the counterpart of popular sovereignty. The debates of the constituent assembly prove that the antithesis between the concepts ‘nation’ and ‘people’, supposedly originating in two rivalling political-theoretical traditions, is a false one. Not only were both terms used as synonyms, the Congress delegates themselves plainly proclaimed the sovereignty of the people. However, this did not imply the establishment of universal suffrage, since political participation was lim- ited to the propertied classes. The revolutionary press generally endorsed the popu- lar principle, too, without necessarily agreeing to the form it was given in practice. The legitimacy of the National Congress’s claim to speak in the name of the people was challenged both by the conservative press, which rejected the sovereignty of the people, and by the radical newspapers, which considered popular sovereignty inval- idated by the instatement of census suffrage. -

1914): Des Origines De L'etat Constitutionnel Bourgeois Aux Débuts De La Démocratie De Masse (Unpublished Doctoral Dissertation)
Dépôt Institutionnel de l’Université libre de Bruxelles / Université libre de Bruxelles Institutional Repository Thèse de doctorat/ PhD Thesis Citation APA: Van Den Dungen, P. (2003). Milieux de presse et journalistes en Belgique au XIXe siècle (1828-1914): des origines de l'Etat constitutionnel bourgeois aux débuts de la démocratie de masse (Unpublished doctoral dissertation). Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Bruxelles. Disponible à / Available at permalink : https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/211230/3/aadad0b9-db9a-4f0b-ad10-304437ec4d52.txt (English version below) Cette thèse de doctorat a été numérisée par l’Université libre de Bruxelles. L’auteur qui s’opposerait à sa mise en ligne dans DI-fusion est invité à prendre contact avec l’Université ([email protected]). Dans le cas où une version électronique native de la thèse existe, l’Université ne peut garantir que la présente version numérisée soit identique à la version électronique native, ni qu’elle soit la version officielle définitive de la thèse. DI-fusion, le Dépôt Institutionnel de l’Université libre de Bruxelles, recueille la production scientifique de l’Université, mise à disposition en libre accès autant que possible. Les œuvres accessibles dans DI-fusion sont protégées par la législation belge relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Toute personne peut, sans avoir à demander l’autorisation de l’auteur ou de l’ayant-droit, à des fins d’usage privé ou à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi, lire, télécharger ou reproduire sur papier ou sur tout autre support, les articles ou des fragments d’autres œuvres, disponibles dans DI-fusion, pour autant que : - Le nom des auteurs, le titre et la référence bibliographique complète soient cités; - L’identifiant unique attribué aux métadonnées dans DI-fusion (permalink) soit indiqué; - Le contenu ne soit pas modifié. -

Alexandre Gendebien, Membre Du Gouvernement Provisoire Et Du
Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automatisch zoeken. Verder vragen we u het volgende: + Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. -

ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC Considérations Générales Et Particularités Belges
ÉLÉMENTS DE DROIT PUBLIC Considérations générales et particularités belges Frédéric BOUHON Chargé de cours à l’Université de Liège et Xavier MINY Doctorant (Boursier FRESH) à l’Université de Liège Syllabus partiel et provisoire Université de Liège Version du 5 décembre 2018 TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS ..................................................................................................... 6 CHAPITRE 1ER – LE DROIT, LE DROIT PUBLIC ET L’ÉTAT .................................... 7 CHAPITRE 2 – LA CONSTITUTION ......................................................................... 8 A.- CONSIDERATIONS GENERALES ............................................................................................. 8 1) Définitions : constitutions formelle et matérielle .......................................................... 8 2) Adoption de la constitution formelle ............................................................................. 13 3) Modification de la constitution formelle ....................................................................... 16 B.- PARTICULARITES BELGES .................................................................................................. 20 1) Adoption de la constitution formelle en 1831 ............................................................... 20 2) Révision de la Constitution formelle............................................................................. 23 3) Contenu et structure actuels de la Constitution formelle ............................................ 28 4) -
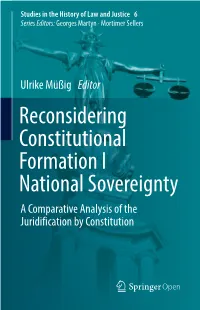
Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty a Comparative Analysis of the Juridification by Constitution Studies in the History of Law and Justice
Studies in the History of Law and Justice 6 Series Editors: Georges Martyn · Mortimer Sellers Ulrike Müßig Editor Reconsidering Constitutional Formation I National Sovereignty A Comparative Analysis of the Juridification by Constitution Studies in the History of Law and Justice Volume 6 Series editors Georges Martyn University of Ghent , Gent , Belgium Mortimer Sellers University of Baltimore , Baltimore , Maryland, USA Editorial Board António Pedro Barbas Homem, Universidade de Lisboa Emanuele Conte, Università degli Studi Roma Tre Gigliola di Renzo Villata, Università degli Studi di Milano Markus Dirk Dubber, University of Toronto William Ewald, University of Pennsylvania Law School Igor Filippov, Moscow State University Amalia Kessler, Stanford University Mia Korpiola, Helsinki Collegium for Advanced Studies Aniceto Masferrer, Universidad de Valencia Yasutomo Morigiwa, Nagoya University Graduate School of Law Ulrike Muessig, Universität Passau Sylvain Soleil, Université de Rennes James Q.Whitman, Yale Law School The purpose of this book series is to publish high quality volumes on the history of law and justice. Legal history can be a deeply provocative and infl uential fi eld, as illustrated by the growth of the European universities and the ius commune, the French Revolution, the American Revolution, and indeed all the great movements for national liberation through law. The study of history gives scholars and reformers the models and cour- age to question entrenched injustices, by demonstrating the contingency of law and other social arrangements. Yet legal history today fi nds itself diminished in the universities and legal academy. Too often scholarship betrays no knowledge of what went before, or why legal institutions took the shape they did. -

Le Rôle Des Milieux De Presse Dans La Fondation De L'etat Belge \(1830\) Et
@mnis Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale EUROPES / AMÉRIQUES http://www.univ-brest.fr/amnis/ Le rôle des milieux de presse dans la fondation de l’Etat belge et la création d’une « opinion publique » nationale (1830-1860) Pierre Van den Dungen Université libre de Bruxelles- ULB, Belgique E-mail : [email protected] Lors du Congrès de Vienne (1815), les puissances alliées souhaitent ériger une barrière territoriale contre les ambitions annexionnistes de la France. C’est ainsi qu’elles décident la réunion des provinces belges (sous régime français depuis 1795) aux Provinces-Unies de Guillaume 1er d’Orange. Dès les années 1820, des groupes bourgeois contestataires expriment en français leur opposition à un régime éclairé mais autoritaire qui, de surcroît, promeut le néerlandais et favorise ceux qui le parlent. Pour ce faire, ils fondent des quotidiens bientôt qualifiés d’opposition. A Liège d’abord, en mars 1824, où d’anciens étudiants de l’université de la ville fondent le Mathieu Laensberg. A Gand et à Bruxelles ensuite, en 1826, où paraissent respectivement Le Catholique des Pays-Bas et puis Le Courrier des Pays-Bas1. Ces petits milieux de gens de plumes, qui bénéficient de l’appui de notables acquis aux idées nouvelles, se revendiquent du courant libéral politique. Nous allons tenter de mesurer l’ampleur de leur contribution à la naissance de l’Etat belge entre 1830 et 1860 : en qualité d’acteurs de la révolution et de promoteurs d’une liberté de la presse perçue comme constitutive de ‘l’opinion nationale’2. 1 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (AGR), Papiers Charles Rogier, microfilms 2295, n°70, Liège, 10-03 1824, Acte fondateur du Mathieu Laensberg. -

Le Caractère Collegial Des Premières Formes De Gouvernement Dt D
LE CARACTERE COLLEGIAL DES PREMIERES FORMES DE GOUVERNEMENT ET D'ADMINISTRATION DE L'ETAT BELGE (1830-1831) (1) par John GILISSEN Professeur aux Universités de Bruxelles L'Etat belge est né le 4 octobre 1830, par une déclaration d'in- dépendance faite par un arrêté du Gouvernement provisoire. Cet arrêté précise que : "Les provinces de la Belgique, violemment déta- chées de la Hollande, constitueront un Etat indépendant"; il ajoute qu'un Congrès national sera convoqué pour adopter une constitution dont le projet sera rédigé à l'initiative du Comité central. Cette constitution fut promulguée quatre mois plus tard, le 7 février 1831. Devenue obligatoire le 24 février, elle est encore en vigueur; elle est restée presque inchangée, sauf sous l'angle du droit électoral, pendant 140 ans, jusqu'à la 3e révision en 1970. Elle a ser- vi de modèle à de nombreuses constitutions européennes, notamment celles de 1848 et plus spécialement celles des pays balcaniques des années 1865-1870; la constitution de Roumanie de 1866 reproduit à peu près textuellement la constitution belge de 1831 (2). (1) Rapport (largement remanié) présenté au groupe de travail "1830" organi- sé dans le cadre du Congrès international des Sciences historiques, à Bucarest, en août 1980. Certains aspects de la présente question sont aussi exposés dans le rapport présenté en 1978 à l'Institut belge des Sciences administratives sous le titre : De Tijdelijke Regering en de eerste administratieve organisatie van België 1830-1831. Sous presse. (2) J. GILISSEN, "La Constitution belge de 1831 : ses sources, son influen- ce", Res publica, X, 1968 et "Die belgische Verfassung von 1831 : ihr Ursprung und ihr Einfluss", Beiträge zur deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte in 19. -

NICOLAS DELVAUX TFE AOUT 2019.Pdf
http://lib.uliege.be https://matheo.uliege.be La France de Juillet dans la tourmente : l'action des factions vue par la presse périodique belge (1830-1835) Auteur : Delvaux, Nicolas Promoteur(s) : Lanneau, Catherine Faculté : Faculté de Philosophie et Lettres Diplôme : Master en histoire, à finalité approfondie Année académique : 2018-2019 URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/8390 Avertissement à l'attention des usagers : Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite. Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite l'autorisation préalable et expresse des auteurs ou de leurs ayants droit. -

Coucke En Goethals
Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Coucke en Goethals: Ware Martelaars van de Vlaamse zaak? Masterproef van de opleiding ‗Master in de rechten‘ Ingediend door Lieselot Van Herreweghe (Stamnummer: 2005 3794) (major: burgerlijk- en strafrecht) Promotor: Professor Dr. Dirk Heirbaut Commissaris: Professor Dr. Georges Martyn ‗De Goede Rechters‘ (1891) James Ensor De prent ―De goede rechters‖ wordt in verband gebracht met de ophefmakende rechtszaak Coucke en rechtszaak en Goethals. Coucke gebracht de ophefmakende wordt met rechters‖ prent in verband goede ―De De (Privéverzameling) 2 Voorwoord. In dit voorwoord wens ik ieder te bedanken die mij heeft geholpen om deze masterproef mogelijk te maken. Vooreerst mijn promotor professor dr. Dirk Heirbaut. Ook wil ik professor dr. Georges Martyn bedanken, die als commissaris mijn masterproef beoordeelt. Tevens wil ik mijn vader in de bloementjes zetten. Zonder zijn hulp zou de masterproef er niet gekomen zijn. Eveneens wil ik mijn mama en mijn vriend Laurens bedanken voor hun raad en steun tijdens mijn gehele rechtenopleiding. Ten slotte wil ik ook een bedankje richten aan al mijn medestudenten en vrienden voor de jarenlange vriendschap. Allen van harte bedankt !! Lieselot Van Herreweghe 11 mei 2010. 3 Inhoudstafel. Voorwoord. ...................................................................................................................................... 3 Inhoudstafel. ....................................................................................................................................