Le Sud-Ouest De Madagascar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de janvier 2015 (2015-D01) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation éco-météorologique : page 1 Situation acridienne : page 3 Ministère de l’Agriculture Situation antiacridienne : page 8 Synthèse : page 10 Annexes : page 13 SITUATION ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUE Durant la 1ère décade de janvier 2015, un fort gradient pluviométrique Nord-Est/Sud-Ouest concernait Madagascar induisant une très forte pluviosité dans l’Aire d’invasion Nord, une pluviosité moyenne à forte dans l'Aire d’invasion Centre et une pluviosité souvent faible à moyenne dans l'Aire grégarigène. Les informations pluviométriques étaient contradictoires, selon les sources : x les estimations de FEWS-NET (figure 1) indiquaient que la pluviosité était supérieure à 125 mm au nord de la Grande-Île et qu’elle diminuait progressivement de 20 à 30 mm sur des bandes diagonales successives de 100 à 200 km de large à partir du nord et jusqu’au sud du pays ; x le peu de relevés transmis par le Centre National Antiacridien (annexe 1) indiquait que la pluviosité était très forte dans l’Aire grégarigène transitoire, moyenne à forte dans l’Aire de multiplication initiale ainsi que dans la majeure partie de l’Aire transitoire de multiplication et faible à moyenne dans l’Aire de densation, ce qui différait des estimations de FEWS-NET pour l’Aire grégarigène. Dans l’Aire grégarigène, compte tenu des relevés pluviométriques faits par le CNA, les conditions hydriques étaient fort erratiques : dans l’Aire grégarigène transitoire, elles étaient excédentaires par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache solitaire, dans l’Aire de multiplication initiale Centre, elles étaient favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito et dans les secteurs Sud de l’Aire transitoire de multiplication et de l’Aire de densation, les pluies restaient peu abondantes. -

Identification Et Analyse D'activités Alternatives À La Fabrication De Charbon De Bois Dans Le District De Toliara II
Projet site de référence Toliara Q096 Identification et analyse d'activités alternatives à la fabrication de charbon de bois dans le District de Toliara II Haja N. MASEZAMANA Julien H. ANDRIANARISOA Léa I.B.RAOLIARIVELO Josoa R.RANDRIAMALALA Mars 2013 SOMMAIRE LISTE DES CARTES...........................................................................................................................i LISTE DES TABLEAUX......................................................................................................................i LISTE DES PHOTOGRAPHIES............................................................................................................ii LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................................ii LISTE DES ABBREVIATIONS ............................................................................................................3 1. INTRODUCTION ..........................................................................................................................1 2. SITE D’ETUDE.............................................................................................................................2 2.1. Climat.....................................................................................................................................3 2.2. Végétation..............................................................................................................................3 2.3. Société et Milieu humains......................................................................................................3 -
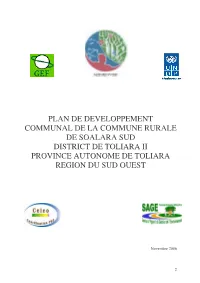
PCD Soalara Final CORRIGEDEC2006
PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE RURALE DE SOALARA SUD DISTRICT DE TOLIARA II PROVINCE AUTONOME DE TOLIARA REGION DU SUD OUEST Novembre 2006 2 SOMMAIRE 1 .INTRODUCTION........................................................................................................... 5 2 METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PCD ...................................................... 5 2.1.1 La phase d’information et de sensibilisation............................................................. 5 2.1.2 L’élaboration de la monographie communale .......................................................... 5 2.1.3 Le diagnostic participatif........................................................................................... 5 2.1.4 La détermination des axes stratégiques de développement et l’identification des actions de développement....................................................................................................... 6 2.1.5 La validation du PCD................................................................................................ 6 MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE ................................................................................. 7 1. LES CARACTERISTIQUES ET LES POTENTIALITES. .............................................. 8 1.1 Historique de la Commune ........................................................................................ 8 1.1.1 Origine de la Commune...................................................................................... 8 1.1.2 Toponymie.......................................................................................................... -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin n° 25 Mars 2016 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Ministère de l’agriculture Situation acridienne : page 6 Situation antiacridienne : page 13 Synthèse : page 17 Annexes : page 19 SITUATION GÉNÉRALE Selon Fews-net, le mois de mars 2016 semble avoir été marqué par une forte pluviosité (supérieure à 150 mm) au nord du 18ème parallèle et une pluviosité moyenne, variant de 50 à 150 mm, au sud. Les relevés du Centre national antiacridien (CNA) indiquaient que la pluviosité était supérieure aux besoins du Criquet migrateur malgache dans l’Aire grégarigène transitoire Est et Centre, l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation du compartiment Nord. Elle était favorable pour son développement dans l’Aire transitoire de multiplication et l’Aire de densation des compartiments Centre et Sud. Les températures minimales et maximales moyennes restaient toujours favorables au développement et à la reproduction du Locusta migratoria capito dans toute la Grande-Île. Aire grégarigène. Les compartiments Nord et Centre étaient colonisés par des populations groupées du Criquet migrateur malgache. Le compartiment Nord, où des pullulations larvaires, assorties d’une transformation phasaire, ont été observées sur deux principaux foyers (partie orientale du bassin de Manja et région de Befandriana-Sud), était moyennement infesté. Un phénomène similaire était en place dans le compartiment Centre mais, globalement, l’ampleur et l'étendue étaient moindres. Ce mois a été caractérisé par la fin du développement de la R2 du Criquet migrateur malgache et le début de celui de la R3. -
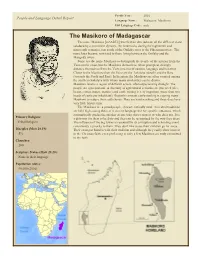
Expanded PDF Profile
Profile Year: 2001 People and Language Detail Report Language Name: Malagasy, Masikoro ISO Language Code: msh The Masikoro of Madagascar The name Masikoro [mASikUr] was first used to indicate all the different clans subdued by a prominent dynasty, the Andrevola, during the eighteenth and nineteenth centuries, just south of the Onilahy river to the Fiherenana river. The name later became restricted to those living between the Onilahy and the Mangoky rivers. Some use the name Masikoro to distinguish the people of the interior from the Vezo on the coast, but the Masikoro themselves, when prompted, strongly distance themselves from the Vezo in terms of custom, language and behavior. Closer to the Masikoro than the Vezo are the Tañalaña (South) and the Bara (towards the North and East). In literature the Masikoro are often counted among the southern Sakalava with whom many similarities can be drawn. Masikoro land is a region of difficult access, often experiencing drought. The people are agro-pastoral. A diversity of agricultural activities are practiced (rice, beans, cotton, maize, manioc) and cattle raising is very important (more than two heads of cattle per inhabitant). Recently rampant cattle-rustling is causing many Masikoro to reduce their cattle herds. They are hard-working and these days have very little leisure time. The Masikoro are a proud people, characteristically rural. Ancestral traditions are held high among them as is correct language use for specific situations, which automatically grades the speaker as one who shows respect or who does not. It is Primary Religion: a dishonor for them to be dirty and they can be recognized by the way they dress. -

6309 Toliary Ii
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 630901010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBIKY S.1 dfggfdgffhCommune: AMBOHIMAHAVELONA dfggfdgffhDistrict: TOLIARY II dfggfdgffhRegion: ATSIMO-ANDREFANA dfggfdgffhProvince: TOLIARY Inscrits : 473 Votants: 196 Blancs et Nuls: 3 Soit: 1,53% Suffrages exprimes: 193 Soit: 98,47% Taux de participation: 41,44% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 165 85,49% 25 RAVALOMANANA Marc 28 14,51% Total voix: 193 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 630901020102 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBOHIMAHAVELONA S.1 dfggfdgffhCommune: AMBOHIMAHAVELONA dfggfdgffhDistrict: TOLIARY II dfggfdgffhRegion: ATSIMO-ANDREFANA dfggfdgffhProvince: TOLIARY Inscrits : 499 Votants: 223 Blancs et Nuls: 2 Soit: 0,90% Suffrages exprimes: 221 Soit: 99,10% Taux de participation: 44,69% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 192 86,88% 25 RAVALOMANANA Marc 29 13,12% Total voix: 221 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I -

Fombandrazana Vezo: Ethnic Identity and Subsistence
FOMBANDRAZANA VEZO: ETHNIC IDENTITY AND SUBSISTENCE STRATEGIES AMONG COASTAL FISHERS OF WESTERN MADAGASCAR by EARL FURMAN SANDERS (Under the Direction of THEODORE GRAGSON) ABSTRACT The complex dynamic among coastal peoples of western Madagascar involves spread of cultural elements due to extensive seasonal migrations, tribes and ethnic groups merging into progressively broader ethnic groups, distinctions based on interethnic and intra-ethnic boundaries, and lumping of peoples with remotely similar subsistence patterns which has perpetuated ethnonym vagaries. This study analyzes the cultural bases of the Vezo, a group of marine fishers inhabiting the west coast of Madagascar, with the intent of presenting a clearer image of what is entailed within the ethnonym, Vezo, both with respect to subsistence strategies and cultural identity. Three broad areas of inquiry, ethnohistory, ecological niche as understood from the Eltonian definition, and geographical scope inform the field research. Access to these areas leans heavily on oral histories, which in turn is greatly facilitated by intensive participant observation and work in the native language. The analysis shows that the Vezo constitute a distinct ethnic group composed of diverse named patrilineal descent groups. This ethnic group is defined by common origins and a shared sense of common history, which along with the origins of the taboos are maintained within their oral histories. Within the ethnonym, Vezo, there are subsistence as well as other cultural distinctions, most notably the taboos. These distinctions are the bases of the ethnic boundaries separating those who belong to the Vezo cultural group and others who are referred to as Vezo (Vezom-potake and Vezo-loatse) due to geographical disposition. -
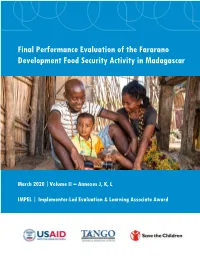
Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar
Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar March 2020 |Volume II – Annexes J, K, L IMPEL | Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award ABOUT IMPEL The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award works to improve the design and implementation of Food for Peace (FFP)-funded development food security activities (DFSAs) through implementer-led evaluations and knowledge sharing. Funded by the USAID Office of Food for Peace (FFP), the Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award will gather information and knowledge in order to measure performance of DFSAs, strengthen accountability, and improve guidance and policy. This information will help the food security community of practice and USAID to design projects and modify existing projects in ways that bolster performance, efficiency and effectiveness. The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award is a two-year activity (2019-2021) implemented by Save the Children (lead), TANGO International, and Tulane University in Haiti, the Democratic Republic of Congo, Madagascar, Malawi, Nepal, and Zimbabwe. RECOMMENDED CITATION IMPEL. (2020). Final Performance Evaluation of the Fararano Development Food Security Activity in Madagascar (Vol. 2). Washington, DC: The Implementer-Led Evaluation & Learning Associate Award PHOTO CREDITS Three-year-old child, at home in Mangily village (Toliara II District), after recovering from moderate acute malnutrition thanks to support from the Fararano Project. Photo by Heidi Yanulis for CRS. DISCLAIMER This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Implementer-Led Evaluation & Learning (IMPEL) award and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Summary Prepared for the IOTC 15Th
IOTC-2020-WPEB16-INF04 Summary prepared for the IOTC 15th Working Party on Ecosystems and Bycatch - Report of the IWC Workshop on Bycatch Mitigation Opportunities in the Western Indian Ocean and Arabian Sea. The International Whaling Commission (IWC) held a technical workshop on Bycatch Mitigation Opportunities in the Western Indian Ocean and Arabian Sea from 8-9 May 2019 in Nairobi, Kenya. The workshop was attended by 50 participants working in 17 different countries, with half of the participants coming from within the Indian Ocean region. Workshop participants included national government officials working in marine conservation and fisheries management, cetacean and fisheries researchers, fisheries technologists, socio-economists and representatives from Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs), inter- and non-governmental organisations. The focal region of the workshop extended from South Africa, north to the Arabian Sea and east to Sri Lanka, including coastal areas, national waters and high seas. The primary objectives of the workshop were to (i) develop a broad-scale picture of cetacean bycatch across the North and Western Indian Ocean region in both artisanal and commercial fisheries; (ii) explore the challenges and opportunities related to the monitoring and mitigation of cetacean bycatch in the western and northern Indian Ocean (Arabian Sea); (iii) identify key gaps in knowledge and capacity within the region and tools needed address these gaps; (iv) introduce the Bycatch Mitigation Initiative (BMI) to Indian Ocean stakeholders and assess how the initiative can be of use; (v) identify potential locations which could serve as BMI pilot projects; (vi) start building collaborations to tackle bycatch at national, regional and international level. -
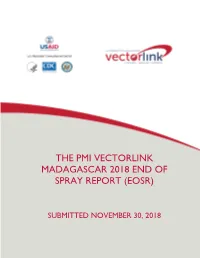
The Pmi Vectorlink Madagascar 2018 End of Spray Report (Eosr)
THE PMI VECTORLINK MADAGASCAR 2018 END OF SPRAY REPORT (EOSR) SUBMITTED NOVEMBER 30, 2018 Recommended Citation: The PMI VectorLink Project. November 2018. PMI VectorLink Madagascar 2018 End of Spray Report. Rockville, MD. The PMI VectorLink Project, Abt Associates Inc. Contract Number: AID-OAA-I-17-00008 Task Order Number: AID-OAA-TO-17-00027 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI The views expressed in this document do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. Abt Associates Inc. | 6130 Executive Boulevard | Rockville, MD 20852 | T. 301.347.5000 | F. 301.913.9061 | www.abtassociates.com THE PMI VECTORLINK MADAGASCAR 2018 END OF SPRAY REPORT (EOSR) Contents Acronyms…. ................................................................................................................................viii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction .......................................................................................................................... 11 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................................................. 11 1.2 2018 Campaign Objectives ............................................................................................................................. 12 2. Pre-Spray Activities ............................................................................................................ -

Untitled Private Land Ownership;
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et Cadre de Plan de Réinstallation (CPR) du Projet d’Appui à la zone de Transformation Agro-industrielle du Sud-Ouest (PATASO) de Madagascar_version mis à jour Contents LISTE DES FIGURES ................................................................................................................................ 3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE ........................................................................................................................... 7 EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................................... 24 INTRODUCTION ................................................................................................................................... 44 I. DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PROJET .......................................................................... 46 1.1 OBJECTIFS DU PATASO ....................................................................................................................................... 46 1.2 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DU PATASO ................................................................................................. 47 1.3 LOCALISATION ET DESCRIPTION DES SITES ......................................................................................................... 49 1.3.1 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE DU PAI DE TULÉAR ........................................................................... 50 1.3.2 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE