Modification Des Tracés Des Canalisations GSM1 Et GSM2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Révision Taxinomique Et Nomenclaturale Des Rhopalocera Et Des Zygaenidae De France Métropolitaine
Direction de la Recherche, de l’Expertise et de la Valorisation Direction Déléguée au Développement Durable, à la Conservation de la Nature et à l’Expertise Service du Patrimoine Naturel Dupont P, Luquet G. Chr., Demerges D., Drouet E. Révision taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport SPN 2013 - 19 (Septembre 2013) Dupont (Pascal), Demerges (David), Drouet (Eric) et Luquet (Gérard Chr.). 2013. Révision systématique, taxinomique et nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. Résumé : Les études de phylogénie moléculaire sur les Lépidoptères Rhopalocères et Zygènes sont de plus en plus nombreuses ces dernières années modifiant la systématique et la taxinomie de ces deux groupes. Une mise à jour complète est réalisée dans ce travail. Un cadre décisionnel a été élaboré pour les niveaux spécifiques et infra-spécifique avec une approche intégrative de la taxinomie. Ce cadre intégre notamment un aspect biogéographique en tenant compte des zones-refuges potentielles pour les espèces au cours du dernier maximum glaciaire. Cette démarche permet d’avoir une approche homogène pour le classement des taxa aux niveaux spécifiques et infra-spécifiques. Les conséquences pour l’acquisition des données dans le cadre d’un inventaire national sont développées. Summary : Studies on molecular phylogenies of Butterflies and Burnets have been increasingly frequent in the recent years, changing the systematics and taxonomy of these two groups. A full update has been performed in this work. -

Evaluation of Drought-Resistant Plants for Beneficial Insect Attraction
University of Connecticut OpenCommons@UConn Master's Theses University of Connecticut Graduate School 11-5-2019 Evaluation of Drought-Resistant Plants for Beneficial Insect Attraction Benjamin Gluck [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/gs_theses Recommended Citation Gluck, Benjamin, "Evaluation of Drought-Resistant Plants for Beneficial Insect ttrA action" (2019). Master's Theses. 1446. https://opencommons.uconn.edu/gs_theses/1446 This work is brought to you for free and open access by the University of Connecticut Graduate School at OpenCommons@UConn. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of OpenCommons@UConn. For more information, please contact [email protected]. Evaluation of Drought-Resistant Plants for Beneficial Insect Attraction Benjamin Levi Gluck B.A., University of Connecticut, 2010 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science At the University of Connecticut 2019 Copyright by Benjamin Levi Gluck 2019 ii APPROVAL PAGE Masters of Science Thesis Evaluation of Drought-Resistant Plants for Beneficial Insect Attraction Presented by Benjamin Levi Gluck, B.A. Major Advisor ___________________________________________ Dr. Ana Legrand Associate Advisor _________________________________________ Dr. Kim Stoner Associate Advisor_________________________________________ Julia Cartabiano University of Connecticut 2019 iii Acknowledgements I would first like to thank my thesis advisor, Dr. Ana Legrand. She provided invaluable advice on how to develop my research project, and also demonstrated endless patience during the editing process. I would also like to thank the members of my thesis committee, Dr. Kim Stoner and Julia Cartabiano, who helped me refine my study and provided valuable feedback. -

ISTA List of Stabilised Plant Names 7Th Edition
ISTA List of Stabilised Plant Names 7th Edition ISTA Nomenclature Committee Chair Dr. M. Schori Published by All rights reserved. No part of this publication may be The International Seed Testing Association (ISTA) reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in Richtiarkade 18, CH- 8304 Wallisellen, Switzerland any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior ©2021 International Seed Testing Association (ISTA) permission in writing from ISTA. ISBN 978-3-906549-77-4 Valid from: 16.06.2021 ISTA List of Stabilised Plant Names 1st Edition 1966 ISTA Nomenclature Committee Chair: Prof P. A. Linehan 2nd Edition 1983 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. H. Pirson 3rd Edition 1988 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. W. A. Brandenburg 4th Edition 2001 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 5th Edition 2007 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 6th Edition 2013 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 7th Edition 2019 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. M. Schori 7th Edition 2 ISTA List of Stabilised Plant Names Table of Contents A .............................................................................................................................................................. 7 B ............................................................................................................................................................ 21 C ........................................................................................................................................................... -

Bntomojauna ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomofauna Jahr/Year: 1985 Band/Volume: 0006 Autor(en)/Author(s): Naumann Clas M., Naumann Storai Artikel/Article: Zur morphologischen Differenzierung asiatischer Populationen des Zygaena purpuralis-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae). 265-358 © Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Bntomojauna ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE Band 6,Heft 20/1 ISSN 0250-4413 Linz,30.September 1985 Zur morphologischen Differenzierung asiatischer Populationen des Zygaena purpuralis-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae) Clas M. Naumann 8 Storai Naumann *) Abstract This paper continues previous studies on the Zygaena purpuralis-complex, which have dealt with the variabili- ty and consistency of morphological characters of euro- pean populations. The reproductive isolation of Zygaena purpuralis (BRÜNNICH, 1763) and Zygaena minos ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER] , 1775) is proved for the whole of Asia minor, and for Transcaucasia. In most parts of Asia mi- nor both species are sympatric, in certain areas even syntopic, but Zygaena minos has not been recorded in re- cent times from the most northwestern part of the coun- try. The southern coastal belt is only inhabited by Zy- gaena minos . Morphological differences are usually con- *) 37. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Zygaena FABRICIUS, 1775, und ihrer Vorstufen (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae) (36: Hitt.münchn. ent.Ges. : im Druck). 265 © Entomofauna Ansfelden/Austria; download unter www.biologiezentrum.at stant and will allow the determination of most specimens. But the geographical Variation of both species seems to overlap in the Lake Van area, so that a precise determi- nation of specimens from this district will only be pos- sible when the larval food-plant choice of a given popu- lation is known. -

Tribu Anthemideae Familia Asteraceae
FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Anthemideae Cardueae Hurrell, Julio Alberto Plantas cultivadas de la Argentina : asteráceas-compuestas / Julio Alberto Hurrell ; Néstor D. Bayón ; Gustavo Delucchi. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Hemisferio Sur, 2017. 576 p. ; 24 x 17 cm. ISBN 978-950-504-634-8 1. Cultivo. 2. Plantas. I. Bayón, Néstor D. II. Delucchi, Gustavo III. Título CDD 580 © Editorial Hemisferio Sur S.A. 1a. edición, 2017 Pasteur 743, C1028AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Telefax: (54-11) 4952-8454 e-mail: [email protected] http//www.hemisferiosur.com.ar Reservados todos los derechos de la presente edición para todos los países. Este libro no se podrá reproducir total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico, mecánico o cualquier otro, incluyendo los sistemas de fotocopia y fotoduplicación, registro magnetofónico o de alimentación de datos, sin expreso consentimiento de la Editorial. Hecho el depósito que prevé la ley 11.723 IMPRESO EN LA ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA ISBN 978-950-504-634-8 Fotografías de tapa (Pericallis hybrida) y contratapa (Cosmos bipinnatus) por Daniel H. Bazzano. Esta edición se terminó de imprimir en Gráfica Laf S.R.L., Monteagudo 741, Villa Lynch, San Martín, Provincia de Buenos Aires. Se utilizó para su interior papel ilustración de 115 gramos; para sus tapas, papel ilustración de 300 gramos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Septiembre de 2017. 24 Plantas cultivadas de la Argentina Plantas cultivadas de la Argentina Asteráceas (= Compuestas) Julio A. Hurrell Néstor D. Bayón Gustavo Delucchi Editores Editorial Hemisferio Sur Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2017 25 FamiliaFamilia Asteraceae Asteraceae - Tribu- Tribu Anthemideae StifftieaeCardueae Autores María B. -

Anthemideae Christoph Oberprieler, Sven Himmelreich, Mari Källersjö, Joan Vallès, Linda E
Chapter38 Anthemideae Christoph Oberprieler, Sven Himmelreich, Mari Källersjö, Joan Vallès, Linda E. Watson and Robert Vogt HISTORICAL OVERVIEW The circumscription of Anthemideae remained relatively unchanged since the early artifi cial classifi cation systems According to the most recent generic conspectus of Com- of Lessing (1832), Hoff mann (1890–1894), and Bentham pos itae tribe Anthemideae (Oberprieler et al. 2007a), the (1873), and also in more recent ones (e.g., Reitbrecht 1974; tribe consists of 111 genera and ca. 1800 species. The Heywood and Humphries 1977; Bremer and Humphries main concentrations of members of Anthemideae are in 1993), with Cotula and Ursinia being included in the tribe Central Asia, the Mediterranean region, and southern despite extensive debate (Bentham 1873; Robinson and Africa. Members of the tribe are well known as aromatic Brettell 1973; Heywood and Humphries 1977; Jeff rey plants, and some are utilized for their pharmaceutical 1978; Gadek et al. 1989; Bruhl and Quinn 1990, 1991; and/or pesticidal value (Fig. 38.1). Bremer and Humphries 1993; Kim and Jansen 1995). The tribe Anthemideae was fi rst described by Cassini Subtribal classifi cation, however, has created considerable (1819: 192) as his eleventh tribe of Compositae. In a diffi culties throughout the taxonomic history of the tribe. later publication (Cassini 1823) he divided the tribe into Owing to the artifi ciality of a subtribal classifi cation based two major groups: “Anthémidées-Chrysanthémées” and on the presence vs. absence of paleae, numerous attempts “An thé midées-Prototypes”, based on the absence vs. have been made to develop a more satisfactory taxonomy presence of paleae (receptacular scales). -

Red List of Vascular Plants of the Czech Republic: 3Rd Edition
Preslia 84: 631–645, 2012 631 Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání Dedicated to the centenary of the Czech Botanical Society (1912–2012) VítGrulich Department of Botany and Zoology, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: [email protected] Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645. The knowledge of the flora of the Czech Republic has substantially improved since the second ver- sion of the national Red List was published, mainly due to large-scale field recording during the last decade and the resulting large national databases. In this paper, an updated Red List is presented and compared with the previous editions of 1979 and 2000. The complete updated Red List consists of 1720 taxa (listed in Electronic Appendix 1), accounting for more then a half (59.2%) of the native flora of the Czech Republic. Of the Red-Listed taxa, 156 (9.1% of the total number on the list) are in the A categories, which include taxa that have vanished from the flora or are not known to occur at present, 471 (27.4%) are classified as critically threatened, 357 (20.8%) as threatened and 356 (20.7%) as endangered. From 1979 to 2000 to 2012, there has been an increase in the total number of taxa included in the Red List (from 1190 to 1627 to 1720) and in most categories, mainly for the following reasons: (i) The continuing human pressure on many natural and semi-natural habitats is reflected in the increased vulnerability or level of threat to many vascular plants; some vulnerable species therefore became endangered, those endangered critically threatened, while species until recently not classified may be included in the Red List as vulnerable or even endangered. -

Ecological Checklist of the Missouri Flora for Floristic Quality Assessment
Ladd, D. and J.R. Thomas. 2015. Ecological checklist of the Missouri flora for Floristic Quality Assessment. Phytoneuron 2015-12: 1–274. Published 12 February 2015. ISSN 2153 733X ECOLOGICAL CHECKLIST OF THE MISSOURI FLORA FOR FLORISTIC QUALITY ASSESSMENT DOUGLAS LADD The Nature Conservancy 2800 S. Brentwood Blvd. St. Louis, Missouri 63144 [email protected] JUSTIN R. THOMAS Institute of Botanical Training, LLC 111 County Road 3260 Salem, Missouri 65560 [email protected] ABSTRACT An annotated checklist of the 2,961 vascular taxa comprising the flora of Missouri is presented, with conservatism rankings for Floristic Quality Assessment. The list also provides standardized acronyms for each taxon and information on nativity, physiognomy, and wetness ratings. Annotated comments for selected taxa provide taxonomic, floristic, and ecological information, particularly for taxa not recognized in recent treatments of the Missouri flora. Synonymy crosswalks are provided for three references commonly used in Missouri. A discussion of the concept and application of Floristic Quality Assessment is presented. To accurately reflect ecological and taxonomic relationships, new combinations are validated for two distinct taxa, Dichanthelium ashei and D. werneri , and problems in application of infraspecific taxon names within Quercus shumardii are clarified. CONTENTS Introduction Species conservatism and floristic quality Application of Floristic Quality Assessment Checklist: Rationale and methods Nomenclature and taxonomic concepts Synonymy Acronyms Physiognomy, nativity, and wetness Summary of the Missouri flora Conclusion Annotated comments for checklist taxa Acknowledgements Literature Cited Ecological checklist of the Missouri flora Table 1. C values, physiognomy, and common names Table 2. Synonymy crosswalk Table 3. Wetness ratings and plant families INTRODUCTION This list was developed as part of a revised and expanded system for Floristic Quality Assessment (FQA) in Missouri. -

Spredning Av Fremmede Arter Med Planteimport Til Norge
1136 Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge Kristine Bakke Westergaard, Oddvar Hanssen, Anders Endrestøl, Anders Often, Odd Stabbetorp, Arnstein Staverløkk, Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding og NINA Project Report. Normalt er dette NINAs rapportering til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. I tillegg vil serien favne mye av instituttets øvrige rapportering, for eksempel fra seminarer og konferanser, resultater av eget forsk- nings- og utredningsarbeid og litteraturstudier. NINA Rapport kan også utgis på annet språk når det er hensiktsmessig. NINA Temahefte Som navnet angir behandler temaheftene spesielle emner. Heftene utarbeides etter behov og se- rien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstil- linger i samfunnet. NINA Temahefte gis vanligvis en populærvitenskapelig form med mer vekt på illustrasjoner enn NINA Rapport. NINA Fakta Faktaarkene har som mål å gjøre NINAs forskningsresultater raskt og enkelt tilgjengelig for et større publikum. De sendes til presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivå, politikere og andre spesielt interesserte. Faktaarkene gir en kort framstilling av noen av våre viktigste forsk- ningstema. Annen publisering I tillegg til rapporteringen i NINAs egne serier publiserer instituttets ansatte en stor del av sine viten- skapelige resultater i internasjonale journaler, populærfaglige bøker og tidsskrifter. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge Kristine Bakke Westergaard Oddvar Hanssen Anders Endrestøl Anders Often Odd Stabbetorp Arnstein Staverløkk Frode Ødegaard Norsk institutt for naturforskning NINA Rapport 1136 Westergaard, K.B., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbe- torp, O., Staverløkk, A. -

2019 Census of the Vascular Plants of Tasmania
A CENSUS OF THE VASCULAR PLANTS OF TASMANIA, INCLUDING MACQUARIE ISLAND MF de Salas & ML Baker 2019 edition Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery Department of State Growth Tasmanian Vascular Plant Census 2019 A Census of the Vascular Plants of Tasmania, including Macquarie Island. 2019 edition MF de Salas and ML Baker Postal address: Street address: Tasmanian Herbarium College Road PO Box 5058 Sandy Bay, Tasmania 7005 UTAS LPO Australia Sandy Bay, Tasmania 7005 Australia © Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery Published by the Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery GPO Box 1164 Hobart, Tasmania 7001 Australia https://www.tmag.tas.gov.au Cite as: de Salas, MF, Baker, ML (2019) A Census of the Vascular Plants of Tasmania, including Macquarie Island. (Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart) https://flora.tmag.tas.gov.au/resources/census/ 2 Tasmanian Vascular Plant Census 2019 Introduction The Census of the Vascular Plants of Tasmania is a checklist of every native and naturalised vascular plant taxon for which there is physical evidence of its presence in Tasmania. It includes the correct nomenclature and authorship of the taxon’s name, as well as the reference of its original publication. According to this Census, the Tasmanian flora contains 2726 vascular plants, of which 1920 (70%) are considered native and 808 (30%) have naturalised from elsewhere. Among the native taxa, 533 (28%) are endemic to the State. Forty-eight of the State’s exotic taxa are considered sparingly naturalised, and are known only from a small number of populations. Twenty-three native taxa are recognised as extinct, whereas eight naturalised taxa are considered to have either not persisted in Tasmania or have been eradicated. -
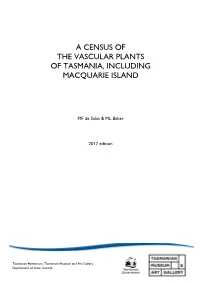
2017 Census of the Vascular Plants of Tasmania
A CENSUS OF THE VASCULAR PLANTS OF TASMANIA, INCLUDING MACQUARIE ISLAND MF de Salas & ML Baker 2017 edition Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery Department of State Growth Tasmanian Vascular Plant Census 2017 A Census of the Vascular Plants of Tasmania, including Macquarie Island. 2017 edition MF de Salas and ML Baker Postal address: Street address: Tasmanian Herbarium College Road PO Box 5058 Sandy Bay, Tasmania 7005 UTAS LPO Australia Sandy Bay, Tasmania 7005 Australia © Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery Published by the Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery GPO Box 1164 Hobart, Tasmania 7001 Australia www.tmag.tas.gov.au Cite as: de Salas, M.F. and Baker, M.L. (2017) A Census of the Vascular Plants of Tasmania, including Macquarie Island. (Tasmanian Herbarium, Tasmanian Museum and Art Gallery, Hobart) www.tmag.tas.gov.au ISBN 978-1-921599-84-2 (PDF) 2 Tasmanian Vascular Plant Census 2017 Introduction The classification systems used in this Census largely follow Cronquist (1981) for flowering plants (Angiosperms) and McCarthy (1998) for conifers, ferns and their allies. The same systems are used to arrange the botanical collections of the Tasmanian Herbarium and by the Flora of Australia series published by the Australian Biological Resources Study (ABRS). For a more up-to-date classification of the flora, refer to The Flora of Tasmania Online (Duretto 2009+) which currently follows APG II (2003). To determine the families in which genera are placed, refer to Appendix 2 at the end of this document. This census also serves as an index to The Student’s Flora of Tasmania (Curtis 1963, 1967, 1979; Curtis & Morris 1975, 1994). -

Element Stewardship Abstract for Senecio Jacobaea
ELEMENT STEWARDSHIP ABSTRACT for Senecio jacobaea Tansy Ragwort, Tansy Butterweed To the User: Element Stewardship Abstracts (ESAs) are prepared to provide The Nature Conservancy's Stewardship staff and other land managers with current management-related information on those species and communities that are most important to protect, or most important to control. The abstracts organize and summarize data from numerous sources including literature and researchers and managers actively working with the species or community. We hope, by providing this abstract free of charge, to encourage users to contribute their information to the abstract. This sharing of information will benefit all land managers by ensuring the availability of an abstract that contains up-to-date information on management techniques and knowledgeable contacts. Contributors of information will be acknowledged within the abstract and receive updated editions. To contribute information, contact the editor whose address is listed at the end of the document. For ease of update and retrievability, the abstracts are stored on computer at the national office of The Nature Conservancy. This abstract is a compilation of available information and is not an endorsement of particular practices or products. Please do not remove this cover statement from the attached abstract. Authors of this Abstract: Cathy Macdonald, Mary J. Russo (Revision) © THE NATURE CONSERVANCY 1815 North Lynn Street, Arlington, Virginia 22209 (703) 841 5300 The Nature Conservancy Element Stewardship Abstract For Senecio jacobaea I. IDENTIFIERS Common Name: Tansy Ragwort, Tansy Butterweed General Description: The following description of Senecio jacobaea is adapted from Munz and Keck (1973). Senecio jacobaea is a member of the Groundsel Tribe (Senecioneae) of the Sunflower Family (Asteraceae=Compositae).