Carte Communale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
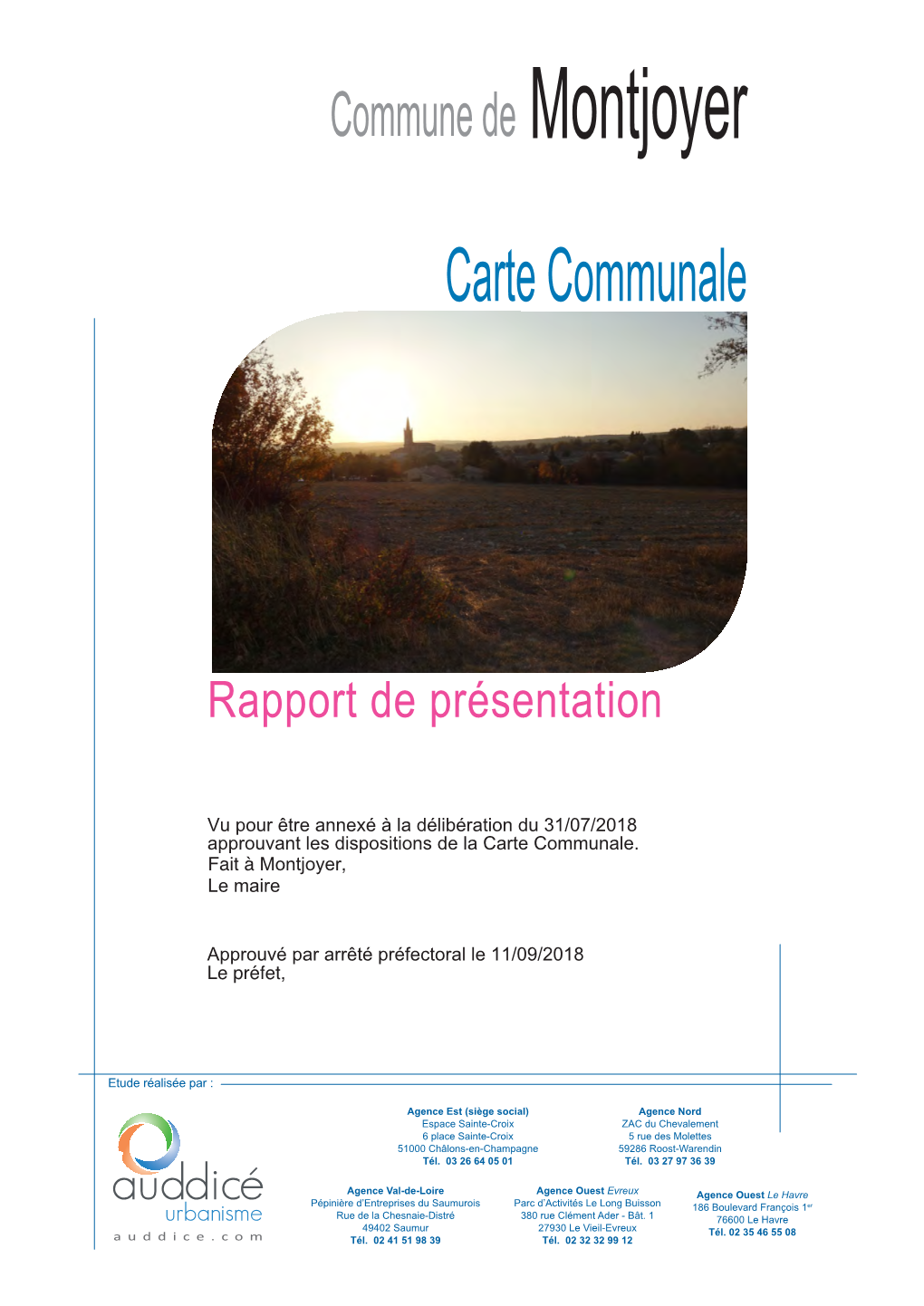
Load more
Recommended publications
-

Harmony Is in Its Nature Montélimar Valence
Harmony is in its nature Montélimar Valence Marsanne DIEULEFIT Ruoms Allan Châteauneuf du-Rhône Sortie 18 Roche-Saint- VIVIERS Montélimar Sud Secret-Béconne Montbrison Roussas Donzère Valaurie GRIGNAN Les Granges-Gontardes Saint-Pantaléon Pierrelatte La Garde- Chantemerle Chamaret les Vignes Adhémar les-Grignan VALRÉAS Montségur- BOURG-ST-ANDÉOL Clansayes sur-Lauzon Nyons ST-PAUL Richerenches TROIS-CHÂTEAUX La Baume-de-Transit Saint-Restitut Visan Vinsobres Sortie 19 Bollène Suze-la-Rousse Tulette BOLLÈNE Orange Rochegude Sainte-Cécile-les-Vignes 2 Nestling in the heart of the Rhone valley on the left bank, are the 1800 hectares of vineyards of Grignan-les-Adhémar in the Drôme Provençale. Flourishing in a land of plenty, the vineyards alternate with aromatic herbs, lavender fields, truffle oaks and olive groves. Its wines are refined and delicious, mainly reds, with a range of savours from berry and plum through to spices and on to the more sophisticated notes of pepper, violet and truffle, signs of wines which will age well. Its fresh, fruity and elegant white wines and rosés play on delightful seduction. TABLE OF CONTENTS THE HISTORY OF THE AOC …………………………………………… 04 IN THE VINEYARDS ………………………………………………… 06 IN THE GLASS ……………………………………………………… 08 ADDRESS BOOK ……………………………………………………… 10 3 THE HISTORY OF THE AOC Secret garden of the Drôme Provençale. A secret wine garden lies in the heart of the Rhone Valley: the Grignan-les-Adhémar appellation. Its vineyards intermingle with lavender fields and truffle oak plantations, amidst a landscape of picturesque villages dating back hundreds of years with magnificent chateaux from the era of the cape and the sword. Here the wines combine the refined style of the north with the ripe, full-bodied fruitiness of the Drôme. -

Zones Infra : Classement Par Ordre Alphabetique De Communes
DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 ZONES INFRA : CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES COMMUNES ZONE INFRA ALBON NORD DROME ALIXAN GRAND ROMANS ALLAN RHODANIEN ALLEX VALLEE DROME ANCONE RHODANIEN ANDANCETTE NORD DROME ANNEYRON NORD DROME AOUSTE SUR SYE VALLEE DROME AUBRES DROME MERIDIONALE AUREL DROME EST AUTICHAMP VALLEE DROME BARBIERES GRAND ROMANS BARSAC DROME EST BEAUFORT SUR GERVANNE VALLEE DROME BEAUMONT LES VALENCE GRAND VALENCE BEAUMONT MONTEUX GRAND VALENCE BEAUREGARD BARET GRAND ROMANS BEAUSEMBLANT NORD DROME BEAUVALLON GRAND VALENCE BELLEGARDE EN DIOIS DROME EST BESAYES GRAND ROMANS BONLIEU SUR ROUBION VALLEE DROME BOUCHET RHODANIEN BOULC DROME EST BOURDEAUX RHODANIEN BOURG DE PEAGE GRAND ROMANS BOURG LES VALENCE GRAND VALENCE BREN NORD DROME BUIS LES BARONNIES DROME MERIDIONALE CHABEUIL GRAND VALENCE CHABRILLAN VALLEE DROME CHAMARET RHODANIEN CHANOS CURSON NORD DROME CHANTEMERLE LES BLES NORD DROME CHARMES SUR L HERBASSE NORD DROME CHAROLS VALLEE DROME CHARPEY GRAND ROMANS CHATEAUDOUBLE GRAND VALENCE CHATEAUNEUF DE GALAURE NORD DROME CHATEAUNEUF DU RHONE RHODANIEN CHATEAUNEUF SUR ISERE GRAND VALENCE CHATILLON EN DIOIS DROME EST CHATILLON ST JEAN GRAND ROMANS CHATUZANGE LE GOUBET GRAND ROMANS CHAVANNES NORD DROME CLAVEYSON NORD DROME DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 COMMUNES ZONE INFRA CLEON D ANDRAN VALLEE DROME CLERIEUX GRAND ROMANS CLIOUSCLAT VALLEE DROME COBONNE VALLEE DROME COLONZELLE RHODANIEN COMBOVIN GRAND VALENCE CONDORCET DROME MERIDIONALE CREST VALLEE DROME CROZES HERMITAGE NORD DROME CURNIER DROME MERIDIONALE DIE DROME -

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental Des Risques Majeurs
LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental des Risques Majeurs PRÉFECTURE DE LA DRÔME DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 2004 Éditorial Depuis de nombreuses années, en France, des disposi- Les objectifs de ce document d’information à l’échelle tifs de prévention, d'intervention et de secours ont été départementale sont triples : dresser l’inventaire des mis en place dans les zones à risques par les pouvoirs risques majeurs dans la Drôme, présenter les mesures publics. Pourtant, quelle que soit l'ampleur des efforts mises en œuvre par les pouvoirs publics pour en engagés, l'expérience nous a appris que le risque zéro réduire les effets, et donner des conseils avisés à la n'existe pas. population, en particulier, aux personnes directement Il est indispensable que les dispositifs préparés par les exposées. autorités soient complétés en favorisant le développe- Ce recueil départemental des risques majeurs est le ment d’une « culture du risque » chez les citoyens. document de référence qui sert à réaliser, dans son pro- Cette culture suppose information et connaissance du longement et selon l’urgence fixée, le Dossier risque encouru, qu’il soit technologique ou naturel, et Communal Synthétique (DCS) nécessaire à l’informa- 1 doit permettre de réduire la vulnérabilité collective et tion de la population de chaque commune concernée individuelle. par au moins un risque majeur. Cette information est devenue un droit légitime, défini Sur la base de ces deux dossiers, les maires ont la par l’article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 responsabilité d’élaborer des documents d’information relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protec- communaux sur les risques majeurs (DICRIM), qui ont tion de la forêt contre l'incendie et à la prévention des pour objet de présenter les mesures communales d’a- lerte et de secours prises en fonction de l’analyse du risques majeurs. -

Arts Et Divertissements 21
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE VOUS INVITE AUX 21 - 22 septembre 2019 © PLAYGROUND / MC JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE Arts et Divertissements Pré-programme arrêté à la date du 28 juin 2019. Programme complet sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 2 3 Théâtres antiques et amphithéâtres romains, salles et Editorial lieux de spectacles dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du cirque…, pratiques festives (fêtes foraines, carnavals, processions, défilés…), jeux traditionnels ou encore lieux accueillant les pratiques physiques (hippodromes, piscines, stades et ensembles sportifs…) c’est tout un pan de notre patrimoine qui se dévoilera pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le patrimoine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin Je vous souhaite à toutes et tous de très belles Journées du génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre européennes du patrimoine. pays. Le tragique incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris nous rappelle cruellement que nous devons chaque jour le protéger, l’entretenir, le restaurer, le valoriser pour enfin Franck Riester, ministre de la Culture le transmettre. Je souhaite que les Journées européennes du patrimoine soient cette année davantage encore un grand moment de communion nationale, que chaque Française, chaque Français, chaque jeune ou chaque adulte qui entrera dans une Soudin © Patrice cathédrale, dans un château, dans un monument historique ressente cette émotion propre à ces lieux chargés d’histoire, de notre histoire. Si ces journées sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les fleurons de nos plus beaux bâtiments civils, religieux, militaires, lieux de pouvoir… elles mettent également chaque année l’accent sur une thématique nouvelle. -

Plan De Prévention Des Risques Naturels Inondations
maître d’ouvrage Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION Bassin versant du Lez approuvé le 18/12/2006 Rapport de présentation maître d’œuvre Direction Départementale de l’Équipement Vaucluse Drôme Service Eau Environnement et Bases Aériennes Service Aménagement Sud Cite administrative – BP 1045 4 place Laënnec – BP 1013 84098 Avignon cedex 09 26015 Valence cedex Tél. : 04.90.80.87.50 Fax : 04.90.80.87.51 Tél. : 04.75.79.75.19 Fax : 04.75.42.87.75 e-mail : [email protected] e-mail : [email protected] http://www.vaucluse.equipement.gouv.fr http://www.drome.equipement.gouv.fr Préfectures de la Drôme et du Vaucluse Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation du bassin versant du LEZ TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION 3 1.1. OBJET DU PPR 3 1.2. CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL 3 1.2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 3 1.2.2. DEMOGRAPHIE 4 1.2.3. HABITAT 4 1.3. PRESCRIPTION DU PPRI DU LEZ 4 1.3.1. ARRETE DE PRESCRIPTION 4 1.3.2. RAISONS DE LA PRESCRIPTION DU PPR 5 2. CADRE LEGISLATIF DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 6 3. DEMARCHE DE CONCERTATION 7 4. TYPOLOGIE DES INONDATIONS CONSIDEREES 12 4.1. LES INONDATIONS DITES « PLUVIALES » 12 4.2. LE DEBORDEMENT DES PRINCIPAUX COURS D’EAU 12 4.2.1. LES CRUES TORRENTIELLES 13 4.2.2. LES EMBACLES ET RUPTURES D’EMBACLES 13 4.2.3. CRUES HISTORIQUES 14 5. ETUDE ET DEFINITION DES ALEAS 16 5.1. -

Maquis PIERRE) 23 Premier Parachutage D'armes Le 13/10/43 24
TERRE D'EYGUES O!Ché x_ N° 13-1994 SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES TERRE D'EYGUES Bulletin N ° 13 de la Société d'Etudes Nyonsaises Prix du numéro: 50 F. (6'0 f. franco) Règkment :à la Société d'Erudes Nyonsaises Cpte l résorerie Générale de la Drôme~ 8218 Dépôt légal ~ 1828C 87 - ISSN N° 1245-382X SOMMAIRE Le mot du président 2 1ère partie Le Nyonsais de la défaite à la libération 3 Ilème partie : Chronologie succinte 11 Illè partie : Témoi~ages et documents Fondation par A. lèna de l'organisation de résistanHce du aut ComNtat et du yonsais 13 L'arrivée au maquis ck la Lance 15 Le maquis A.S. des plaines (làulignan) v Le maquis de la Bessonne (Condorcet) 20 Maquis AS du Bamier (Maquis PIERRE) 23 Premier parachutage d'armes le 13/10/43 24 Résistance et dépôt d'armes qua nier des Blaches, Nyons 25 Anaque des maquis de la Lance 28 Evénements survenus fin novemb. 194 3 à EsteUon et Nyons 30 Félix MAURENT 32 Mon tragique du Dr Jean BOURDONGLE 33 Circonstances de la mort deL DUCOL 36 CoUège Roumanille da·ns la Résistance 37 Agent de liaison F.T.PF. 39 Embauchée sur k Champ de Mars 41 Bataille de Saint Pierre 43 Arrivée des américains - Guet-apens à Novezan 44 ·lemoignage j. M.KfOUT - La Compagnie M.KIDUT 46 Blessé à SAUZET 50 Directeur de la publication : Jean LAGET Ediœur :. Société d'Etudes Nyonsaises Conception, Impression : Bip.- Bip_ Copycréa - 10 Place des Arcades Nyons - Tél 75 26 60 06 Légende photo couverture f:liché X_) : Des résistanJs nyonsais en armes, au moment de la bataille de Nyons De gauche à droite : assis : RAYNAUD Fernand, LESLING !Jqjen, FIEU Romarn, HAD7NNER, AUGIS Calme/. -

Télechargez Dès Maintenant La Carte Touristique Du
Tirage à 22 000 exemplaires, édition 2018-2019 édition exemplaires, 000 22 à Tirage Publication : Parc naturel régional des Baronnies provençales Baronnies des régional naturel Parc : Publication www.twitter.com/pnr_baronnies www.facebook.com/baronnies.provencales www.baronnies-provencales.fr 26510 SAHUNE 26510 randonneurs des chemin 45 des Baronnies provençales Baronnies des CARTE régional naturel Parc D’IDENTITÉ Contact Création du Parc naturel régional : OFFICES DE TOURISME OFFICES DE TOURISME 26 janvier 2015 & Bureaux d’accueil et d’information touristique DES VILLES-PORTES DU PARC Superficie : 1 787 Km2 RELAIS DU PARC Montélimar Agglomération Tourisme 2 régions : Auvergne-Rhône-Alpes et Montélimar : 33(0)4 75 01 00 20 www.montelimar-tourisme.com Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur Si vous souhaitez des informations touristiques, Pays de Dieulefit-Bourdeaux n’hésitez pas à consulter les Offices de Tourisme 2 départements : Drôme et Hautes-Alpes Dieulefit : 33(0)4 75 46 42 49 www.paysdedieulefit.eu et Bureaux d’accueil touristique, relais du Parc : 19 Offices de Tourisme et bureaux d’accueil touristique Pays de Grignan-Enclave des Papes relais du Parc Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Grignan : 33(0)4 75 46 56 75 www.tourisme-paysdegrignan.com www.baronnies-tourisme.com Valréas : 33(0)4 90 35 04 71 www.ot-valreas.fr Des productions locales de qualité AOP-IGP : Sisteron Buëch huile essentielle de lavande de Haute-Provence, olive • Buis-les-Baronnies : 33 (0)4 75 28 04 59 Sisteron : 33(0)4 92 61 36 50 www.sisteron-buech.fr -

Le Réseau Viaire Antique Du Tricastin Et De La Valdaine : Relecture Des Travaux Anciens Et Données Nouvelles Cécile Jung
Le réseau viaire antique du Tricastin et de la Valdaine : relecture des travaux anciens et données nouvelles Cécile Jung To cite this version: Cécile Jung. Le réseau viaire antique du Tricastin et de la Valdaine : relecture des travaux anciens et données nouvelles. Revue archéologique de Narbonnaise, Presse universitaire de la Méditerranée, 2009, pp.85-113. hal-00598526 HAL Id: hal-00598526 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598526 Submitted on 7 Jun 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Le réseau viaire antique du Tricastin et de la Valdaine : relecture des travaux anciens et données nouvelles Cécile JUNG Résumé: À partir de travaux de carto-interprétation, de sondages archéologiques et de collectes de travaux anciens, le tracé de la voie d’Agrippa entre Montélimar et Orange est ici repris et discuté. Par ailleurs, l’analyse des documents planimétriques (cartes anciennes et photographies aériennes) et les résultats de plusieurs opérations archéologiques permettent de proposer un réseau de chemins probablement actifs dès l’Antiquité. Mots-clés: voie d’Agrippa, vallée du Rhône, analyse cartographique, centuriation B d’Orange, itinéraires antiques. Abstract: The layout of the Via Agrippa, between Montélimar and Orange, is studied and discussed in this article. -

Carte Administrative De La Drôme
CARTE ADMINISTRATIVE DE LA DRÔME lapeyrouse- Périmètre des arrondissements 2017 mornay epinouze manthes saint-rambert- lens-lestang moras- d'albon saint-sorlin- en-valloire en-valloire le anneyron grand-serre hauterives andancette chateauneuf- Préfecture albon de-galaure montrigaud saint-martin- fay-le-clos d'aout saint-christophe- mureils et-le-laris Sous-Préfecture beausemblant tersanne la motte- saint-bonnet- laveyron de-galaure saint-avit miribel montchenu de-valclerieux saint-uze bathernay saint-laurent- d'onay Arrondissement de Valence saint-vallier ratieres crepol claveyson montmiral saint-barthelemy- charmes-sur- ponsas de-vals l'herbasse le chalon saint-michel- sur-savasse Arrondissement de Die serves- bren arthemonay sur-rhone saint-donat-sur- marges chantemerle- geyssans erome les-bles marsaz l'herbasse parnans gervans Arrondissement de Nyons larnage chavannes peyrins triors crozes- chatillon- hermitage Saint- saint-jean veaunes bardoux genissieux la baume-saint-nazaire- mercurol mours-saint- en-royans Communes transférées dans clerieux d'hostun Sainte- Saint- tain-l'hermitage eusebe Saint Thomas eulalie- julien- Chanos- saint-paul- eymeux En Royans les-romans en-royans le nouvel arrondissement curson en-vercors granges-les- romans-sur-isere La Motte beaumont Fanjas Beaumont- jaillans hostun la roche- monteux echevis saint-martin- rochechinard saint-laurent- de-glun en-vercors bourg-de-peage en-royans Pont-de- saint-jean- l'isere chatuzange-le-goubet oriol- en-royans en-royans chateauneuf-sur-isere beauregard- baret saint-martin- -

LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 Itineraries in the Drôme
LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 itineraries in the Drôme ladrometourisme.com Entre la Drôme et vous, une belle histoire commence… Cette histoire pourrait démarrer comme ceci : « Il était une fois 12 itinéraires à suivre pour découvrir les incontournables de cette terre de contrastes. Prenez le temps d’apprécier le paysage, d’échanger avec les habitants, de flâner dans les villes et villages, de visiter les monuments et musées incontournables (Palais Idéal du Facteur Cheval, Tour de Crest, châteaux de Montélimar, Grignan et Suze-la-Rousse, cité du chocolat Valrhona Musée International de la chaussure…), de savourer les produits du terroir de la Drôme, à la ferme, au détour des routes thématiques (lavande, olivier, vin…) ou sur les marchés colorés, de pratiquer toutes sortes d’activités sportives dont la randonnée pédestre, équestre, en raquettes, le ski, le vélo, le VTT, l’escalade, la via ferrata... … la Drôme vous livrera ses plus beaux secrets à travers ses paysages les plus sauvages. » La morale de cette histoire : Faîtes une pause dans la Drôme pour la découvrir plus intimement. Champ de lavande • Poët-Sigillat Between the Drôme and you, a wonderful story-line may emerge. The story could start like this: Vous aussi devenez fan de « Once upon a time there were 12 itineraries to follow to discover the key features of this land of contrasts. Take the time to appreciate the landscape, to have a chat with local people, to stroll about the towns and villages, la page Facebook de la Drôme to visit the main monuments and museums (‘Palais Idéal du Facteur Cheval’, Crest tower, the châteaux of Tourisme et racontez Montélimar, Grignan and Suze-la-Rousse, ‘cité du chocolat Valrhona’ and the ‘Musée International de la vos vacances dans la Drôme Chaussure [shoes]), to taste the products of the Drôme at the farm itself, along the themed routes (lavender, olives, wines …), on the colourful markets, to practice all kinds of sporting activity including walking, riding, rackets, skiing, cycling, mountain-biking, climbing, the via ferrata, etc. -

Grignan Info N° 86
Bulletin municipal BULLETIN n° 86 Le mot du Maire p 1 Réunions du Conseil p 2 à 5 Intercommunalité p 6 à 7 Vie du village p 8 à 13 Culture & vie associative p 14 à 20 État civil - Urbanisme p 21 «Veritas temporis filia est » (locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps) “infos” Octobre 2015 LE MOT DU MAIRE numéro 86 Si la saison qui et la surcharge de nos services publics qui en résulte. s’est achevée a été Je tiens à rendre hommage à leur engagement et à riche d’évènements, leur compétence. si Grignan s’est Il y a encore le travail de vos élus. Je suis fier de de nouveau révélé leur disponibilité, de leur proximité, de l’attachement comme un village qu’ils montrent et démontrent à Grignan. Ils vous recherché pour sa diront qu’ils ne font que leur devoir. Je peux vitalité, sa gaieté et témoigner qu’ils font bien plus que cela. son hospitalité, c’est Il y a enfin le travail des Grignanaises et qu’une nouvelle des Grignanais, agriculteurs, artisans, commerçants, fois, les bénévoles de Grignan ont beaucoup restaurateurs, hôteliers ou, simplement, habitants donné. Que l’on pense aux succès qu’ont été la heureux de croiser, renseigner, guider les hôtes Fiero au Païs, le National de Pétanque, le Festival du village, de leur montrer notre patrimoine. Leur de la Correspondance, les marchés nocturnes, la accueil, leur hospitalité, font l’image de Grignan, les fête votive et son vide grenier, sans omettre les souvenirs que garderont nos visiteurs, leur désir de rencontres sportives, les expositions et les nombreux revenir dans nos rues, nos places, nos hameaux, nos et remarquables concerts, et le marché du mardi, qui campagnes. -

Signes De Qualité : La Drôme, Terre D'excellence
RECONNAISSANCE ET PROTECTION PRODUCTEURS D'EXCELLENCE INAO Thierry Crouzet Institut national de l’origine et de la qualité Producteur de picodon LA DRÔME L’INAO est un établissement public qui assure la reconnaissance et la protection AOP Picodon • Saillans des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) des produits Médaille d’or au Salon agricoles, agroalimentaires et forestiers en collaboration avec les professionnels regroupés au sein d’organismes de défense et de gestion (ODG), les organismes international de l’agriculture 2017 de contrôles agréés, les services de l’État et l’Institut. TERRE « Dans notre fromagerie nous misons sur inao.fr l’AOP picodon. Nous produisons un lait de qualité, cru, comme cela est imposé par le ODG cahier des charges du signe de qualité et nous D'EXCELLENCE Organismes de défense et de gestion le transformons en fromage de caractère. Par crainte de ne plus pouvoir défendre une SIGNES DE QUALITÉ Au nombre de 23 dans la Drôme, composés d’agriculteurs et d’entreprises production locale et la typicité gastronomique agroalimentaires habilités à produire l’AOC-AOP ou IGP, les ODG (qui peuvent être des syndicats, des associations ou regroupés en fédérations) gèrent un ou d’un terroir, nous avons créé une fromagerie au plusieurs signes de qualité et en assurent la défense et la promotion. Ils sont cœur de la zone AOP picodon ». reconnus et contrôlés par l’INAO et rassemblent obligatoirement tous les opé- rateurs du SIQO. ladrome.fr Stéphane Boutarin Producteur d’ail IGP Ail de la Drôme • Crest « Ce qu’apporte à nos produits le signe de qualité IGP Ail de la Drôme ? Cela rassure le consommateur quand on lui explique le principe de la traçabilité.