Commune De SIBIRIL RAPPORT DE PRESENTATION
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
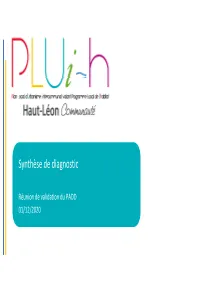
Synthèse De Diagnostic
Synthèse de diagnostic Réunion de validation du PADD 01/12/2020 SOMMAIRE 1. Les dynamique territoriales et la structuration du territoire 2. Le profil socio-démographique 3. L’habitat 4. Les modes d’urbanisation 5. L’économie 6. L’offre commerciale et d’équipements 7. Les zones d’activités sur le territoire 8. L’environnement 9. Les défis du territoire PLUi-h HLC 2 1. Les dynamiques territoriales et la structuration du territoire PLUi-h HLC 3 Ce que dit le SCoT . Le renforcement des villes et des bourgs : le développement démographique du territoire devra permettre de maintenir, voire de renforcer, le poids démographique des villes et bourgs, et éviter le report vers les villages. Les constructions nouvelles seront prioritairement implantées à l’intérieur des zones urbanisées (dents creuses, renouvellement urbain) ou en continuité directe de ces dernières, de sorte à prolonger la trame urbaine existante et la proximité avec les commerces et services. Les centralités urbaines offrant les principaux services et équipements seront renforcées, notamment les villes : Plouescat, Saint-Pol de Léon et Roscoff . Les communes favoriseront le report de l’urbanisation du front de mer dans les bourgs rétro-littoraux, de sorte à préserver les espaces naturels sensibles. Les communes favoriseront un développement perpendiculaire à la côte, de façon à ne pas élargir la façade urbaine de la mer, et favoriseront des formes urbaines denses dans le cas d’éventuelles extensions. PLUi-h HLC 4 Ce que dit le SCoT Le SCoT nomme les agglomérations et les villages -

Mairie De Lanhouarneau
2016 Lanhouarneau Magazine de la Municipalité w w .fr w au .lanhouarne 8 août 2015 : une partie de campagne un calendrier détachable avec le planning des activités Planning des festivités 2016 Manifestation Lieu et horaire Organisation Contact JANVIER Mardi 12 Réunion de secteur . .Ty-Placemeur à 9h30 . .Amicale des Ainés . .E PESQUEUR du 15 au 30 Quinzaine Culturelle "L'Inde" . .Bibliothèque . .Ensemble . .MF FAVE Vendredi 15 Ouverture de la Quinzaine culturelle . .Ty-Placemeur à 18h30 . .Ensemble . .MF FAVE Samedi 16 Assemblée Générale . .Ty-Placemeur 18h . .Comité de Jumelage . .A EMILY Lundi 18 Assemblée Générale . .Plounevez-lochrist . .1,2,3 boutchous . .C CHATAIGNER Mardi 19 Concours intercom de Dominos . .Ty-Placemeur à 13h30 . .Amicale des Ainés . .E PESQUEUR Samedi 23 Assemblée Générale . .Ty-Placemeur à 16h . .UNC . .J SIOHAN Mardi 26 Concours de Belote . .Ty-Placemeur à 13h30 . .Amicale des ainés . .E PESQUEUR Samedi 30 Forum des associations . .Salle polyvalente à 16h . .Municipalité . .MAIRIE suivi des Vœux de la Municipalité FEVRIER Jeudi 4 Assemblée générale . .Ecole Ste Thésèse, à 20h30 . .OGEC, APEL . .AS ROUÉ Mardi 9 Concours de dominos . .Ty-Placemeur à 13h30 . .Amicale des ainés . .E PESQUEUR Mercredi 24 Qualification départementale Belote . .Ty-Placemeur à 13h30 . .Amicale des ainés . .E PESQUEUR Dimanche 28 KIG HA FARZ . .Salle polyvalente 12h . .Ecole Sainte-Thérèse . .F BERNARD - E TANNÉ MARS Mardi 8 Mardi Gras . .Ty-Placemeur à 13h30 . .Amicale des ainés . .E PESQUEUR Vendredi 11 Assemblée générale . .Ty-Placemeur à 18h30 . .Les amis randonneurs . .JY LE SAINT Dimanche 13 Vide grenier/Foire à la puériculture . .Plounevez-Lochrist . .1,2,3 boutchous . .C CHATAIGNER Mercredi 16 Repas des bénévoles . -

Vedettes De L'île De Batz
PROMENADES EN MER COMMENTÉES AU DÉPART DE ROSCOFF G.I.E. La Flottille SAISON 2020 Vedettes de l’île de Batz 2020 VISITE DE LA BAIE VISITE DU CHÂTEAU G.I.E. ADHARA 117 PLACES DE MORLAIX DU TAUREAU Vedettes de l’île de Batz DURÉE 2 H DURÉE 3 H LE PHARE - BP 5 - 29253 ILE DE BATZ Lors de cette excursion, nous vous ferons découvrir Balade en Baie de Morlaix (2 h) RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS l’Île Callot, l’Île Louët avec son phare et sa maison avec arrêt d’une heure pour une visite guidée 07.62.61.12.12 de gardien construits sur un promontoire de granit, à l’intérieur du Château du Taureau, DEMANDES DE DEVIS : [email protected] le Château du taureau et son histoire, Uniquement sur réservation, Places limitées, chien interdit. l’Île noire, Ricard... lieux de résidences de plus SITE : www.vedettes-ile-de-batz.com Plein Tarif 12 ans et plus ... 29 € ENEZ VAZ de 50 espèces d’oiseaux. Tarifs Aller Retour : Tarifs de groupe à partir de 20 personnes 135 PLACES Enfant 4 - 11 ans ............ 19 € Pensez à réserver, places limitées ! La compagnie se réserve le droit d’annuler ou de modifier les départs Enfant de moins de 4 ans ... 5 € 07 62 61 12 12 suivant les conditions météorologiques ou autres cas. RÉSERVATIONS AU : 07 62 61 12 12 N° Siret 839 393 121 00018 DÉPART DE ENTREE RETOUR SUR LES DÉPARTS DE ROSCOFF SE FONT DEPUIS : Tarifs Aller Retour : Plein Tarif 12 ans et plus ... 19 € Dates (saison 2020) - L’estacade à marée basse, ROSCOFF CHATEAU ROSCOFF Enfant 4 - 11 ans ........... -

Cercle De Travail « Environnement Naturel, Patrimoine Et Paysage » - 27 Février 2019
Celtic Interconnector La liaison électrique entre la France et l’Irlande Compte rendu du cercle de travail « Environnement naturel, patrimoine et paysage » - 27 février 2019 Affluence : 14 participants (cf. émargement joint) Garante de la concertation (Commission Nationale du Débat Public) : Marie GUICHOUA Représentants de RTE : Gaëlle CHEVREAU, responsable de la concertation Ophélie CALLONNEC, responsable de projet Caroline BRIGANT, chargée de concertation Delphine BENOIT, service Concertation Environnement Tiers Représentant des bureaux d’études TBM Environnement et ACRI-IN: Gaël BOUCHERY, responsable de projet Fabrice PLUQUET, responsable (ACRI-IN) Durée : 2 h 50 Déroulement : - Introduction : o présentation des intervenants de RTE et présentation des participants o présentation des objectifs du cercle de travail - Présentation du projet et des propositions de fuseaux de moindre impact - Échanges avec les participants (questions- réponses) - Travail sur les cartes des fuseaux - Conclusion CERCLE DE TRAVAIL « ENVIRONNEMENT NATUREL, PATRIMOINE ET PAYSAGE » 27 FÉVRIER 2019 1 – CELTIC INTERCONNECTOR 1. Présentation du projet et des propositions de fuseaux de moindre impact Cf. diaporama de présentation CARTE DE SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE FUSEAUX (partie terrestre) CERCLE DE TRAVAIL « ENVIRONNEMENT NATUREL, PATRIMOINE ET PAYSAGE » 27 FÉVRIER 2019 2 – CELTIC INTERCONNECTOR 2. Retranscription synthétique des échanges Sur l’énergie transportée Un participant : L’objectif du projet est-il bien de faire passer à 40 % la production d’énergie renouvelable en Irlande ? Gaëlle CHEVREAU : Le câble n’est pas ce qui va permettre d’atteindre cet objectif, les 40 % de production en énergies renouvelables sont les objectifs affichés par l’Irlande. Un participant : Mais il y a besoin de cette liaison pour soutenir le développement des énergies renouvelables, c’est cela ? La production d’énergie est-elle constante ? Gaëlle CHEVREAU : Oui, il y a besoin de la liaison pour cela. -

Été 2021 Ligne Horaires Valables Du 7 Juillet Au 1Er Septembre 2021 25 Lesneven - Roscoff
Été 2021 ligne Horaires valables du 7 juillet au 1er septembre 2021 http://www.breizhgo.bzh 25 Lesneven - Roscoff Jours de circulation D/F LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe JVS JV JVS JVSD/F JVS JVS JVS JVS BREST Gare Routière SNCF | | 07:10 | 09:00 10:00 | 13:15 | Ligne 21 au départ de Brest (Lesneven) puis correspondance pour la ligne 25 à Lesneven arrêt "Carmarthen" LESNEVEN Carmarthen | | 08:05 | 09:55 10:57 | 14:12 | LANHOUARNEAU Bourg | | 08:13 | 10:03 11:06 | 14:21 | PLOUNÉVEZ-LOCHRIST Bourg | | 08:20 | 10:10 11:13 | 14:28 | PLOUNÉVEZ-LOCHRIST Kerdelant | | 08:22 | 10:12 11:15 | 14:30 | PLOUESCAT Casino | | 08:24 | 10:14 11:17 | 14:32 | PLOUESCAT Place Wanfried | | 08:28 | 10:18 11:21 | 14:36 | PLOUESCAT Place de l'Europe | | 08:30 | 10:20 11:23 | 14:38 | CLÉDER Kerider | | 08:32 | 10:22 11:25 | 14:40 | CLÉDER Bourg | | 08:35 | 10:25 11:28 | 14:43 | SIBIRIL Bourg | | 08:41 | 10:31 11:34 | 14:49 | PLOUGOULM Croissant | | 08:44 | 10:34 11:37 | 14:52 | SAINT-POL-DE-LÉON Office de Tourisme 07:45 08:15 08:53 09:26 10:43 11:48 12:16 15:02 15:23 ROSCOFF Ferry 07:53 08:23 09:01 09:34 10:52 11:56 12:24 15:10 15:31 ROSCOFF Quai d'Auxerre 08:00 08:30 09:09 09:41 11:00 12:05 12:31 15:18 15:38 Service accessible aux personnes à mobilité réduite. -

Saint Pol De Léon, Roscoff, Île De Batz, Santec, Sibiril, Plougoulm, Plouénan, Mespaul, Taulé, Penzé, Henvic, Locquénolé
Bulletin paroissial N° 72 / 3 juillet 2021 Saint Pol de Léon, Roscoff, Île de Batz, Santec, Sibiril, Plougoulm, Plouénan, Mespaul, Taulé, Penzé, Henvic, Locquénolé, Carantec, Cléder, Plouescat, Tréflez, Plounevez- Lochrist, Lanhouarneau, Tréflaouénan. ……………………………………………………………………………………………………………………… …… Je suis bien plus que ce que vous croyez ! Les administrations et les sites internet essaient de nous situer, pour nous joindre et nous évaluer. C’est la loi de toute société de répertorier et de classer ses membres, pour des raisons de police, de fiscalité ou de commerce. Même les parents de Jésus se sont fait recenser, au temps de l’empereur Octave Auguste. On devrait ainsi savoir ‘qui est qui’ et pourtant Jésus a un vrai problème quand il revient prêcher dans son village familial. Pour tous, il reste le charpentier du coin, le fils de Marie ; mais sa prédication ne correspond plus à l’homme qu’ils connaissaient. Il y a comme un malaise, un constat d’échec que signale l’évangile : « Ils étaient profondément choqués à cause de lui ». (Mc 6, 3) Deux leçons, où se révèle un chemin pour notre accomplissement en Dieu : 1) Que d’énergies découragées par des jugements trop définitifs sur des personnes que nous disons connaître. Il faudrait pouvoir annoncer à quelqu’un : « Je me réjouis que tu sois différent de ce que je pensais ; continue de m’étonner ! ». Toute personne a été créée à l’image et à la ressemblance de Dieu pour croître vers sa véritable dimension divine. C’est une faute de bloquer quelqu’un dans ce qu’on connaît de lui. Personne ne correspond à sa caricature. -

Naufrage Du Hilda Le 18 Novembre 1905
“ HILDA “ · 18 / 19 Novembre 1905 · 18 / 19 / 20 Novembre 2005 · Commémorer le naufrage · Les Johnnies par commune · et par compagnie · La relation des faits · les sources écrites d'information · La mémoire des familles En commémorant, on édifie avec le passé une relation vivante. On confirme par là que cette relation a un sens pour aujourd'hui et pour demain. Guy COQ, philosophe - "Le Monde" 12-10-05 Le présent document vise à donner une information sur le drame du naufrage de l'HILDA, survenu dans la nuit du 18 au 19 novembre 1905. Il appelle la population actuelle à la commémoration. Sur les 80 Johnnies embarqués sur l'HILDA, il y eut seulement 5 rescapés. 70 Johnnies décédés sont ici identifiés, avec leur commune d'origine et leur compagnie de rattachement. Les faits sont relatés. L'ensemble est accompagné des sources écrites d'information. Enfin, la mémoire des populations a été sollicitée pour la continuité historique, pour aussi reconstituer et communiquer aux descendants et apparentés leurs liens avec les naufragés ; pour, enfin, donner aux populations d'aujourd'hui, par la connaissance de leurs relations de proximité et du mode de vie de celles-ci, plus de sens à leurs émotions et une plus grande possibilité de partage.* CLEDER fut la commune la plus touchée : 27 disparus. Les pertes de PLOUESCAT, SIBIRIL, PLOUGOULM, ROSCOFF étaient de l'ordre de 10. Des communes limitrophes : TREFLAOUENAN, TREFLEZ, PLOUENAN eurent 1 ou 2 disparus et la FEUILLEE, commune des Monts d'Arrée, eut aussi 2 morts. Les hommes se répartissaient entre 5 compagnies, qualifiées par le nom et la commune d'appartenance du "patron". -

Roscoff (Bloscon) St Pol De Léon / SIBIRIL Location
Rêves de Mer, c’est… réser Roscoff location vez 11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne en ligne Combinaisons incluses sauf en char à voile. (bloscon) et en Vendée. Location de vélo Uniquement à Santec Pour les particuliers : locations de chalets, nuitées Vélo en auberge, activités sportives et de découverte… Durée Vélo électrique Âge Location mini. Tarif et durée Pour les groupes : séjours sur-mesure, séminaires, classes de découvertes, locations de salles… 2h 7€ 15€ Surf/Bodyboard 8 ans 10 € > 2h 3h 10€ 20€ Kayak de vagues 10 ans 12€ > 1 h Centre de Glisse de l’Île-de-Batz Char à voile monoplace Centre de Glisse Journée 15€ 30€ 10 ans 22 € > 1 h Village vacances de Santec (encadré par un moniteur) « Le Jardin Colonial » Plage du dossen Penn ar C’hleguer 585 rue Theven Bras 29253 Île-de-Batz Semaine 75€ 110€ 29250 Santec 02 98 61 76 76 Char à voile biplace 02 98 29 40 78 [email protected] (encadré par un moniteur) 4 ans 38 € > 1 h [email protected] 2 semaines 120€ 200€ Point de départ Paddle géant 10 ans 40€ > 1h Voilier Point d’accueil de Roscoff Pêche en mer Uniquement à l’Île-de-Batz Port de plaisance du Bloscon, 29680 Roscoff 06 07 45 49 41 ou 02 97 50 15 04 Stages de voile [email protected] Planche à voile 10 ans 20€ > 1h Sensation ! Wing Foil Catamaran 14 pieds 16 ans 35€ > 1h Île de Batz Santec Pleumeur-Bodou Plounéour- Découvrez de nouvelles sensations, une voile dans les mains et les pieds Catamaran 16 pieds 16 ans 45€ > 1h Brignogan-Plages Pléneuf-Val-André au-dessus de l’eau, sur une planche de Foil. -

Guide Des Hébergements 2021-2022
2021 DE LA CÔTE DES SABLES AUX ENCLOS PAROISSIAUX DES SABLES AUX ENCLOS CÔTE DE LA WWW.ROSCOFF-TOURISME.COM CLÉDER / ÎLE DE BATZ / PAYS DE LANDIVISIAU / PLOUESCAT / ROSCOFF / SAINT-POL-DE-LÉON HÉBERGEMENTS TRANSPORTS ET SOMMAIRE Transports and summary Transport und Zusammenfassung Aéroport Brest Bretagne Lignes de bus Vols directs Direct flights Drektflüge Bus lines Buslinien Paris CDG + Orly, Lyon, Toulon, Marseille, Bordeaux, L.21 : Brest - Lesneven Montpellier, Toulouse, Ajaccio, Bastia, Lilles, Londres, L.25 : Lesneven - Plouescat - Cléder - Saint-Pol-de- Amsterdam, Barcelona. Navettes régulières avec Brest Léon - Roscoff gare SNCF L.29 : Morlaix - Saint-Pol-de-Léon - Roscoff Regular shuttles with Brest Shuttles bis Brest Bahnhof L.80A : Sizun - Landivisiau L.80B : Plouzévédé - Landivisiau www.breizhgo.com Gares Liaisons maritimes vversers l'île de Batz Railway stations Bahnhof Sea links to île de Batz Maritime Verbindungen nach île de TGV : Morlaix Batz TER : Landivisiau - Guimiliau Roscoff - Île de Batz : toute l’année Moguériec - Île de Batz : juin / septembre FFerryerry : GrGrandeande Bretagne, Irlande, Espagne United Kingdom, Ireland, Spain Grossbritannien, Irland, Spanien Brittany Ferries. Tél. 0 825 828 828 www.brittanyferries.fr Roscoff - Plymouth (GB), Cork (Irl.), Bilbao et Santander (Esp.) HÔTELS / P.4 CHAMBRES D'HÔTES / P.12 CAMPING-CARS / P.19 CAMPINGS / P.20 LOCATIONS DE VACANCES / P.26 RÉSIDENCES / P.68 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS / P.70 Chez vous ou sur place, organisez votre séjour : Idées, sorties, balades, expériences : www.roscoff-tourisme.com blog.roscoff-tourisme.com Retrouvez nous sur facebook : Tous nos offices de tourisme sont équipés du wifi ou Tourisme Roscoff et Plouescat Tourisme de connexions internet gratuites. -

Liste Des Maires 2020
PREFECTURE DU FINISTERE Cabinet 02.98.76.27.60 Mme Code Commune Arrondissement Prénom NOM Adresse mairie Tél. mairie M. postal Argol Châteaulin M. Henri LE PAPE Place des Anc. Combattants 29560 02 98 27 75 30 Arzano Quimper Mme Anne BORRY 1 place de la mairie 29300 02 98 71 74 67 Audierne Quimper M. Gurvan KERLOCH 12 quai Jean Jaurès 29770 02 98 70 08 47 Bannalec Quimper M. Christophe LE ROUX 1 place Charles de Gaulle 29380 02 98 39 57 22 Baye Quimper M. Pascal BOZEC 44 route de l'Isle 29300 02 98 96 80 12 Bénodet Quimper M. Christian PENNANECH Place du G al de Gaulle 29950 02 98 57 05 46 Berrien Châteaulin M. Hubert LE LANN 1 rue des écoliers 29690 02 98 99 01 14 Beuzec-Cap-Sizun Quimper M. Gilles SERGENT 6 place de la mairie 29790 02 98 70 40 79 Bodilis Morlaix M. Guy GUEGUEN 10 rue Notre Dame 29400 02 98 68 07 01 Bohars Brest M. Armel GOURVIL 1 rue Prosper Salaün 29820 02 98 03 59 63 Bolazec Châteaulin Mme Coralie JEZEQUEL Place de la mairie 29640 02 98 78 10 95 Botmeur Châteaulin M. Eric PRIGENT Le Salou 29690 02 98 26 10 22 Botsorhel Morlaix M. Hervé CILLARD Bourg 29650 02 98 72 85 43 Bourg-Blanc Brest M. Bernard GIBERGUES Place de l'Etang 29860 02 98 84 58 13 Brasparts Châteaulin Mme Anne ROLLAND 18 rue de la Mairie 29190 02 98 81 41 25 Brélès Brest M. Guy COLIN 1 rue du stade 29810 02 98 04 31 03 Brennilis Châteaulin M. -

Plan-Guide De Cléder-Sibiril
LES NUMÉROS UTILES / USEFUL NUMBERS / NÜTZLICHE ADRESSEN HÉBERGEMENTS COMMERCES & SERVICES / SHOPS & SERVICES / GESCHÄFTE & DIENSTLEISTUNGEN PAUSES GOURMANDES / PAUSES OF TASTING / SCHLEMMERPAUSEN ACCOMODATION / UNTERKÜNFTE Informations pratiques MÉDECINS - DOCTORS - ÄRZTE Bâtiment-artisans RÉALISATION AUDIOVISUELLE Marchés - Markets - Märkte SUPÉRETTE DE PROXIMITÉ ALIMENTAIRE Centre Médical Ollivier - Nicolas - Pacot MINIMARKET - MINISUPERMARKT Practical information Camping de PoulennouHH Building trade - Bauarbeiten AUDIOVISUAL PRODUCTION Place Ashburton, Cléder, tél. 02 98 69 01 02 AUDIOVISUELLE PRODUKTION Tous les jeudis (juillet-août) de 17h à 19h / Au Bon Marché Praktische Information Poulennou, Cléder Dr Renaudin 50 rue Losquedic-Plougoulm AGENCEMENT D’INTÉRIEURS Aurore Média Production Pierre-Édouard VIOLLET Thursdays (july-august) from 5 to 7 PM / 3 Place Charles de Gaulle, Cléder, tél. 02 98 69 48 37 (02 98 69 40 09, mairie) ESPACE NUMÉRIQUE tél. 02 98 24 78 93 LAYOUT - ORDNUNG 13 rue de Provence, Cléder, tél. 06 77 53 05 91 Donnerstags (Juli-August) von 17.00 bis 19.00 : tél. 02 98 69 40 02 www.camping-poulennou.fr SERVICES EN LIGNE Dr Uguen 14 rue Varquez, Plougoulm LVL Agencement [email protected] Conseiller en immobilier Port de Moguériec, Sibiril Magasin de proximité ouvert 7/7 l’été (juillet-août) pour vos courses, vos coffrets cadeaux avec une DIGITAL SPACE - ONLINE SERVICES tél. 02 98 29 83 61 Ouvert du 19/06 au 31/08 42 route de Saint-Pol, Cléder www.aurore-media-production.com sur votre commune Tous les vendredis matins (toute l’année) / offre, des produits locaux et de qualité. DIGITALE RAUM - ONLINE DIENSTE Le Theven, hôtellerie de plein air tél. -

Île-De-Batz Enez
Page 1 sur 9 GNE : Sortie du mardi 2 au jeudi 4 Avril 2019. Mercredi 28 novembre 2018 Île de Batz On dit ‘’BA’’. Et pas que l’Île de Batz, puisqu’il y a aussi : Morlaix, Carantec, Roscoff, Belle-Isle-en-Terre. C’est un vrai plaisir, d’avoir autant de matière à traiter sur un même document et de recourir à divers ouvrages de la bibliothèque d’abord. Voici ce qu’il en est, à commencer par le but principal de notre sortie, l’île de Batz. Mercredi 3 avril 2019. Île-de-Batz Enez Vaz Quinze îles sont associées sous le vocable « Îles du Ponant », le mot ‘’ponant’’ désignant la forme ancienne de couchant (du soleil). L’association crée en 1971 s’est donnée pour but de maintenir les communautés insulaires actives aux îles remplissant trois caractéristiques : 1) Avoir une population permanente ; 2) Être assez importante pour être constituée en commune ; 3) Ne pas être reliée au continent par un lien fixe (Noirmoutier, Ré, Oléron, ne remplissent pas ces critères). L’Île de Batz, appartient aux îles de la Manche (Chausey, Bréhat, Batz), alors que les douze autres se situent sur la façade atlantique. Et comme il s’agit d’une île, je donne en premier ses coordonnées, avant de parler du reste : 48° 44’ 43’’ nord 4° 00’ 35 ouest La commune d’Île de Batz appartient aussi à la Communauté de communes du « Haut-Léon Communauté », créée le 1er janvier 2017, comptant 31 505 habitants et regroupant les communes suivantes : Saint-Pol-de-Léon (6 584 habitants), Cléder (3 770), Île-de-Batz (470), Lanhouarneau (1 323), Mespaul (930), Pouénan (2 490), Plouescat (3 471), Plougoulm (1 772), Plonévez-Lochrist (2 333), Roscoff (3 354), Santec (2 350), Sibiril (1220), Tréflaouénan (507), Tréflez (931).