MAURRAS ET LA CONTRE-RÉVOLUTION Entretiens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ouvrages De Charles Maurras Réédités. De 1940 À Nos Jours
CHARLES MAURRAS. SON ŒUVRE RÉÉDITÉE 1° partie : ouvrages Informations mises à jour le 23 août 2021. Page 4 : ouvrages édités de 1940 à nos jours Ordre chronologique, puis alphabétique dans chaque année d'édition. – Prendre, avant tout, connaissance des Conditions d'utilisation du site. – Les titres disponibles sont en caractères noirs, suivis des ‘boutons’ Édit. 'papier' (fond jaune) ou Édit. numérique (fond bleu), bouton comportant un ‘lien’ vers une page donnant toutes informations pour l’acquisition de l’ouvrage ‘papier’, ou vers le site de consultation ou de téléchargement de l’ouvrage numérique. – Les titres et textes non-disponibles (épuisés, à consulter en bibliothèque ou à acquérir d'occasion) sont en caractères gris. – Les titres et textes non-disponibles (épuisés, à consulter en bibliothèque ou à acquérir d'occasion) sont en caractères gris. – Les travaux universitaires (mémoires, thèses) sont en caractères verts. – Pour les "boutons" SUDOC WorldCat BNF BAnQ Open-Library OCLC CCFr DUMAS THÈSES.fr & THÈSES.ca , voir les explications en tête de la Page 1. La collaboration. Paris [France], "L'Action française", 1° novembre 1940. SUDOC WorldCat BNF BAnQ OCLC CCFr ✓ Réédition numérique du périodique (téléchargement gratuit) : – Paris [France], Gallica-B.N.F. Mis en ligne le 18 janvier 2011. Format Pdf. Gallica - BNF ✓ Repris dans : La Seule France. Chronique des jours d'épreuve, 1941 (pages 287-290). L’Allemagne et nous, 1945 (pages 67-68) et sa réédition Déclaration de Charles Maurras à la Cour de Justice du Rhône les 24 et 25 janvier 1945, 1945 (pages 78-80). Stéphane Giocanti & Axel Tisserand (édit.), Maurras (Cahier de l’Herne), 2011 ("La Collaboration", pages 346-347). -

3:HIKLKJ=XUXUUU:?C@H@M@K@A;
2 N° 2720 L‘ACTION 0 61e année du 1er au 0 14 mars 2007 Prix : 3s (20 F) FRANÇAISE 0 paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois 10, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris Téléphone : 01-40-39-92-06 Fax : 01-40-26-31-63 Site Internet : www.actionfrancaise.net Tout ce qui est national est nôtre DOSSIER VAUBAN, UN GRAND SERVITEUR QUAND SÉGOLÈNE DE L’ÉTAT par Anne BERNET Michel FROMENTOUX René PILLORGET Romain VINDEX materne pages 7 à 10 L'ESSENTIEL Pages 2, 4 et 5 POLITIQUE FRANÇAISE – Quand l’euro les Français... taille un “costard” au commerce extérieur par Henri LETIGRE L’éditorial de Pierre PUJO (page 3) – La France a-t-elle encore une constitution ? par Aristide LEUCATE – Papon privé de justice Airbus, pomme de discorde par Pierre PUJO acques Chirac et le chance- le nombre des salariés, mais aussi Page 6 lier Angela Merkel se sont franco-allemande répartir autrement les sites de POLITIQUE ÉTRANGÈRE Jrencontrés le 23 février près production. Opérations délicates, de Berlin. Ils se sont entretenus Selon M. Chirac ce plan Ainsi, Airbus, montré comme car elles ne doivent pas désor- – Un conflit armé pourra-t-il du sort d‘Airbus qui est devenu « respectait en gros » le prin- une entreprise —européenne“ ganiser les chaînes de montage... être évité en Iran ? pour les deux pays une affaire cipe d‘équité entre Français et exemplaire, est-elle une source On s‘aperçoit qu‘il n‘est pas d‘État. Faute de trouver un ac- Allemands, les premiers étant de querelles entre Français et Al- facile de faire vivre une entre- par Pascal NARI cord sur la restructuration de même « un peu plus pénali- lemands. -

Sommaire De P. Pujo (Dir.) ; Le Trésor De L'action Française
Sommaire de l'ouvrage : Pierre PUJO (dir.) LE TRÉSOR DE L'ACTION FRANÇAISE Paris / Lausanne : L'Âge d'Homme, 2006. – In-8°, 138 pages. ____________ Depuis qu'elle a été fondée, en 1899, l'école d'Action française a produit un nombre considérable d'ouvrages de critique historique, politique, littéraire, qui, ensemble, constituent un trésor. Ils contiennent une abondante matière de réflexions qui permettent de comprendre non seulement l'histoire du XX` siècle mais aussi les événements que nous vivons aujourd'hui. Ces ouvrages sont parfois difficile à trouver. On peut néanmoins les découvrir dans les bibliothèques familiales ou chez des libraires d'occasion. En outre, certains d'entre eux ont été réédités dans les années récentes. Trente et un de ces ouvrages ont été sélectionnés pour faire l'objet d'articles qui ont été publiés dans ''L'Action Française 2000'' en 2004 et 2005. Ont été privilégiés ceux qui permettent d'approfondir la pensée politique de l'Action française en soulignant leur actualité. Ce choix n'est pas exhaustif, et il n'est pas interdit de trouver son bien dans beaucoup d'autres livres d'A.F. Surtout, les études publiées ici ne dispensent pas de lire les ouvrages eux-mêmes. En quelque sorte, elles sont destinées à mettre le lecteur en appétit. Tel quel, ce recueil d'articles permet de comprendre l'originalité de la pensée politique de l'Action française dont les années ont confirmé la solidité et qui continue à séduire nombre de représentants des nouvelles générations... dans la mesure où on leur donne l'occasion d'en prendre connaissance. -

À Jeanne D'arc
2 N° 2699 0 e L‘ACTION 60 année du 20 avril 0 au 3 mai 2006 Prix : 3s (20 F) FRANÇAISE 0 paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois 10, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris Téléphone : 01-40-39-92-06 Fax : 01-40-26-31-63 Site Internet : www.actionfrancaise.net Tout ce qui est national est nôtre Notre dossier IL Y A 150 ANS LA CRISE DU CPE PHILIPPE PÉTAIN par Grégoire DUBOST Michel FROMENTOUX le général (c.r.) Jacques LE GROIGNEC Philippe PRÉVOST La facture Pierre PUJO (pages 7 à 10) L'ESSENTIEL Page 2 POLITIQUE FRANÇAISE – Chronique judiciaire : la montagne, la souris et l’échevin est salée ! par Aristide LEUCATE – Vers un retour L’éditorial de Pierre PUJO (page 3) aux corporations par Henri LETIGRE Pages 4, 5 et 6 POLITIQUE FRANÇAISE ON EST SOULAGÉ : – Inoubliable Algérie par René PILLORGET IMANCHE PAS DE TRAITÉ – Italie : bouffonneries D démocratiques par Guy C. MENUSIER AVEC L’ALGÉRIE – Belgique : menaces sur la Couronne hilippe Douste-Blazy s‘est rendu à Alger le 9 avril, es- par Michel FROMENTOUX 14 MAI pérant décider Abdelaziz – Pérou : P Bouteflika à conclure le —traité le troisième homme d‘amitié“ entre la France et l‘Al- – Palestine : gérie qui devait être signé déjà fermeté européenne en 2005. Mais le président algé- par Pascal NARI rien n‘a rien laissé espérer au mi- Pages 11 et 12 nistre des Affaires étrangères HISTOIRE TOUS français qui est reparti en rem- – La fable et la farce ballant son offre d‘un « parte- par Jacques Le GROIGNEC nariat privilégié ». -

Hommage À Pierre Pujo
2 N° 2737 L’ACTION 0 61e année du 29 novembre 0 au 19 décembre 2007 Prix : 3s (20 F) FRANÇAISE 0 paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois 10, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris – Téléphone : 01-40-39-92-06 – Fax : 01-40-26-31-63 – Site Internet : www.actionfrancaise.net Tout ce qui est national est nôtre Prochain numéro BANLIEUES,BANLIEUES, TRANSPORTS,TRANSPORTS, UNIVERSITÉSUNIVERSITÉS de L’AF 2000 : jeudi 20 décembre 2007 L'ESSENTIEL Intérêt national Page 2 POLITIQUE FRANÇAISE – Sarkozy flingue Chirac L’ÉDITORIAL par Aristide LEUCATE OMENTOUX DE MICHEL FR – Le pouvoir d’achat (PAGE 3) dans l'impasse de l’euro par Henri LETIGRE d’abord ! Page 4 POLITIQUE ÉTRANGÈRE – Comment sortir de l'impasse au Liban ? – Le retour de Nawas Sharif au Pakisan HOMMAHOMMAGEGE par Pascal NARI ÀÀ PIERREPIERRE PUJOPUJO DIMANCHE PAR 2 DÉCEMBRE 2007 Mgr LE DUC DE VENDÔME PIERRE LAFARGE KOMNEN BECIROVIC SÉBASTIEN LAPAQUE GRAND DIDIER BÉOUTIS ARISTIDE LEUCATE BANQUET STÉPHANE BERN JEAN-BAPTISTE MORVAN DES AMIS ANNE BERNET HOUCHANG NAHAVANDI DE STÉPHANE BLANCHONNET THIBAUD PIERRE L’ACTION BERNARD BONNAVES RENÉ PILLORGET FRANÇAISE THIERRY BOUCLIER PHILIPPE DE SAINT-ROBERT ÉDOUARD BOULOGNE JOSEPH SANTA-CROCE EN HOMMAGE À PIERRE CHAUMEIL JEAN DUTOURD ABBÉ GUILLAUME DE TANOÜARN PIERRE PUJO JEAN-PHILIPPE CHAUVIN DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE ROMAIN VINDEX Palais de la Mutualité, PAUL-MARIE COÛTEAUX MICHEL FROMENTOUX 24, rue Saint-Victor, PAGES 5 À 14 Paris 5e. JEAN-PHILLIPE DELLUS ÉLIE HATEM GRÉGOIRE DUBOST TONY KUNTER M 01093 - 2737 - F: 3,00 E Voir page 16 3:HIKLKJ=XUXUUU:?m@h@n@h@a; POLITIQUE FRANÇAISE BIOÉTHIQUE Coup de tonnerre ! Sarkozy Le pouvoir d’achat ■ C’est certainement la meilleure nouvelle des dix der- flingue Chirac dans l’impasse de l’euro nières années. -

249 Theatrum Historiae 1, Pardubice 2006 Aleš VRBATA Charles Maurras
Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Aleš VRBATA Charles Maurras – osobnost a l´Action française Hledáme-li původ francouzského fašismu a snažíme-li se nahlédnout jeho domácí kořeny, zdroje a inspirace, není možné si nevšimnout klíčových postav, jakými byli Charles Maurras nebo Maurice Barrès. Jejich vztah k pozdějšímu fašismu není rozhodně jednoznačný. Nakolik oba svým myšlením předznamenali příchod fašismu a nakolik se hlásili k tradicionalismu a konzervativismu,1 je stále předmě- tem řady studií. Nemůžeme však nijak zpochybnit jejich vliv na mladší generace, generace k fašismu se hlásících spisovatelů.2 Mnozí z těch, kteří se ve 20. letech ocitají v čelných řadách francouzského fašismu, prošli Maurrasovou l‘Action française či Camelots du Roi, případně (tak jako Drieu La Rochelle) pravidelně četli díla Barrèsova a stali se vyznavači jeho „l‘homme drapeau“ či „l‘homme national“. Nebudeme zde diskutovat otázku, nakolik byl fašismus do Francie importován a nakolik byl domácí provenience, ale působení a mimořádný vliv Barrèsův a Maurrasův se zdá hovořit spíš ve prospěch druhého názoru. Proto se také pokusíme stručně přiblížit působení Maurrasovo. Maurras své dětství strávil v provensálském Martigues.3 Školní docházka a tradiční výchova na něj měly tak zásadní vliv, že při pozdějším mapování jeho života spatřovalo mnoho autorů determinantu Maurrasova myšlení právě v poutu k rodné provincii.4 Maurras je jednou z hlavních postav francouzského naciona- lismu, ale podobně jako Barrès v případě Lotrinska je u Maurrase na prvním místě nejprve Provence sama, a teprve pak Francie. Maurras popíral, že by se „narodil jako royalista“, ale ve skutečnosti byli někteří z jeho předků s monarchií velmi úzce spjati. -
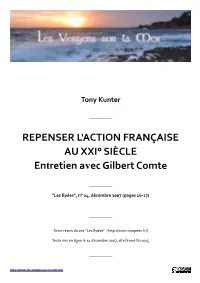
Tony Kunter. Entretien Avec Gilbert Comte. 2007
Tony Kunter ____________ REPENSER L'ACTION FRANÇAISE AU XXI° SIÈCLE Entretien avec Gilbert Comte ____________ "Les Épées", n° 24, décembre 2007 (pages 16-17) ____________ Texte repris du site "Les Épées" (http://www.lesepees.fr/) Texte mis en ligne le 24 décembre 2007, site fermé fin 2015 ____________ http://www.les-vergers-sur-la-mer.net Entretiens avec Gilbert Comte Par Tony Kunter, titulaire d’un master d’histoire des idées politiques (Université Toulouse II) Avec le décès de son « chef » Pierre Pujo, Monde Gilbert Comte. Nous relatant son le 10 novembre dernier, l’Action française parcours, il témoigne de la grande diversité historique s’apprête à tourner une page, à de la galaxie maurrassienne. Il nous livre moins que ce soit le chapitre du mouvement également ses inquiétudes face au forgé par Charles Maurras qui soit en train phénomène de sclérose et d’essoufflement de se refermer définitivement. Tel est le dont souffre depuis plusieurs décennies le sens de cette synthèse de nos deux mouvement néoroyaliste français. entrevues avec l’ancien journaliste du 1 – Parcours d’un libre penseur maurrassien1 : Je suis né en 1932. Le hasard veut que ce soit le même jour que CHIRAC2. J’appartiens à un milieu très marqué par les guerres contre l’Allemagne. Notamment, mon père avait été gravement blessé durant la saignée de 14. Aussi, la politique était omniprésente sous forme de souvenirs guerriers. Á cela s’ajoutait un vieux fonds de royalisme populaire, très ancien. Dès la toute petite enfance, de même que certains enfants sont doués pour la musique ou l’arithmétique, j’avais des dispositions pour la politique. -

Quelle Tradition ? «Le Prétendant»
ISSN 0150-4428 LYS novembre 1984 ROUGE R E V U E T R I M E S T R I E L L E D E L I B R E E X P R E S S I O N - N ° 2 1 - 1 3 F AUTOUR D'UN REMARIAGE ; fNous voulons donc changer de roi. L'histoire est pleine de ces tentatives intrépides où des hommes de race se sentent le devoir de sacrifier le principe d'hérédité au principe royal. » Vniias de l'Isle-Adam Quelle Tradition ? «Le Prétendant» La grande presse nous avait infor le comte de Paris et le général de prince soit en conformité avec le droit més depuis longtemps du fiasco du Gaulle paraissent aujourd'hui bien de l'Eglise et par exemple qu'il ne se couple royal pour le mariage duquel lointains... remarie pas sans autorisation. L'his tant de militants royalistes avaient été On pourra dire que dans notre pays toire de France montre qu'aucun de mobilisés car il s'était agi d'un évé l'accession aux plus hautes fonctions nos rois n'a contrevenu bien longtemps nement politique. Et il en est de même de l'Etat semble exiger une vie de aux prescriptions de l'Eglise sur cette de ce remariage, même si les espoirs couple en apparence unie (1), mais question du contrat de mariage. Alors fondés sur le comte de Clermont dans n'est-ce pas là céder à des préjugés bê il faudrait attendre la fin d'une longue un contexte de relations serrées entre tement bourgeois ? De tels préjugés, ne procédure auprès d'instances romai peut-on les vaincre ? Oui - encore nes.. -

Histoire De L'extrême Droite En France Centre Social De Montbrison, Village De Forez
Histoire de l'extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison Collection Espace citoyen et Village de Forez 2002 Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez L’Histoire de l’extrême droite en France reprend le texte d’une conférence faite par Claude Latta au Centre social de Montbrison le 10 mars 1998 dans le cadre de la semaine nationale d’éducation contre le racisme. Ce texte a été mis à jour et complété à l'occasion de la reprise de cette conférence organisée par le Centre social de Montbrison et faite le 1 er mai 2002 à la salle des fêtes de la mairie de Montbrison entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002. Le tirage a été réalisé par le CDDP Centre Départemental de Documentation Pédagogique à Saint-Etienne (Loire). Village de Forez Centre social de Montbrison Place Pasteur, 42600 Montbrison supplément au n° 89-90 de Village de Forez Directeur de la publication : Claude Latta Dépôt légal : mai 2002 2 Histoire de l’extrême droite en France Centre social de Montbrison, Village de Forez Le Front national n'est pas apparu brusquement en 1984. En fait, l'extrême droite est, sous des noms différents, l'une des composantes de notre paysage politique depuis deux siècles. Son corps de doctrine s'est formé par accumulation de strates successives, au fur et à mesure des crises que la France a connues. L'extrême droite a ainsi donné naissance à des fidélités qui nous étonnent : fidélité au roi Louis XVI et à la Vendée, fidélité à Maurras et à l'Action française, fidélité à Vichy, fidélité aux « martyrs » de l'Algérie française. -

De L'extrémisme Politique À La Pensée Radicale
Pieuvre géante, Golem envahissant, fan- tasme collectif et nouvelle grande peur des bien-pensants, l’extrémisme sculpte l’actualité. Mais qui sont les extrémistes ? Les mécontents, les ennemis du système, les contestataires, les destructeurs, les nihi- listes, les terroristes, les rebelles ? Extrémistes, les militants du Front natio- nal, les néo-royalistes, les catholiques intégristes ? Extrémistes, les trotskystes, les maoïstes, les nos- talgiques de Staline, les nationaux-communistes ? Toujours invoqué mais rarement défini, l’extrémisme serait-il la nou- velle hydre de Lerne des sciences politiques ? En répondant à ces questions, et à beaucoup d’autres, Christophe Bourseiller décrypte un phénomène politique majeur. Il montre que les extrémistes se distinguent par leur incapacité à tolérer l’ambiguïté et l’incertitude. Fascinés par la violence, allergiques au présent, ils militent pour un chan- gement radical de société et perçoivent leurs adversaires comme intrinsèquement maléfiques. Et, par-delà les pro- grammes, les manifestes, les excommunications, en appellent à l’avènement d’authentiques contre-cultures. Christophe Bourseiller est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels Les Ennemis du système, Vie et Mort de Guy Debord, Les Maoïstes ou Extrême Droite. Il est par ailleurs maître de conférence à Sciences Po. L’extrémisme Une grande peur contemporaine Du même auteur Les Ennemis du système, Robert Laffont, 1989. Extrême Droite, François Bourin Éditeur, 1991 (2e éd. : La Nouvelle Extrême Droite, Éditions du Rocher, 2002). Les Faux Messies, Fayard, 1993. Message Reçu, Éditions Spengler, 1995. Les Maoïstes, Plon, 1996 (2e éd., Points Seuil, 2008). Cet Étrange Monsieur Blondel, Bartillat, 1997. Le Guide de l’Autre Paris, Bartillat, 1999. -

3:HIKLKJ=XUYUU\:?M@I@D@P@A; Saisit, Fruit De L'effroi
LIBERTÉS ET CIVILISATION EN RÉGRESSION : ENTRETIEN AVEC J.-Y. LE GALLOUxxxP. 16 L’ACTION FRANÇAISE2000 4 s ❙ N° 2835 ❙ 66e année ❙ Du 1er au 14 mars 2012 ❙ Paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois ❙ www.actionfrancaise.net Les Français Page 3 otages de la république L'ESSENTIEL 3 ÉCONOMIE Renault à Tanger : regards croisés . p. 2 3 POLITIQUE Bayrou en rase campagne . p. 4 Marine Le Pen contre le mondialisme . p. 4 3 SOCIÉTÉ Internet sous surveillance . p. 5 Gendarmerie et Renseignement dans la tourmente . p. 5 Vote des étrangers et citoyenneté . p. 6 3 MONDE L'humiliant sauvetage de la Grèce . p. 7 L'appel pressant de l'Amérique latine . p. 8 Un président consensuel au Yémen ? . p. 9 Treize contre un au Sénégal . p. 9 3 ARTS & LETTRES Le monde de Claude Debussy . p. 10 Appels d'hier Il y a dans ce spectacle pathétique, qui première démarche, sans jamais voir la et d'aujourd'hui . p. 11 Grand oral met en scène un élève et son jury dubita- seconde. Il procède de ce spectacle sans 3 HISTOIRE tif, d'où ne ressortira pas indemne grandeur un déclin toujours plus profond VOUS ÊTES COMME MOI. Parfois, vous re- l'homme qui croit pourtant l'avoir maî- de la République, ce qui ne serait pas 1701 : La chance ne sourit gardez encore la télévision. Lundi 27 fé- trisé, un compromis de plus à la déesse pour nous déplaire si ce genre de procédé qu'aux audacieux . p. 12 vrier au soir, TF1 présentait François Hol- démocratie, et qui a pour vrai nom sacri- n'entachait également la France même. -

Action Française JUILLET 2016
4,50 s - N° 2935 - 70e année – Du 7 au 20 juillet 2016 - Paraît provisoirement les premier et troisième jeudis de chaque mois - www.actionfrancaise.net Numéro spécial Les conséquences du Brexit Pages 2, 3, 7 et 9 «T OUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE » NOUS AUSSI, ■ POLITIQUE La loi Égalité et Citoyenneté met les citoyens au pas ... p. 4 RETROUVONS ■ IDÉES Les droits de l’homme, NOTRE INDÉPENDANCE ! une véritable religion ... p. 10 ■ SOCIÉTÉ L’État brade nos données numériques ... p. 5 Éditorial La belle insolence des peuples Sale temps pour l’oligarchie. En huit jours à peine, voici que les Britanniques ont voté pour sortir de l’Union européenne et que son candidat à la tête de l’Autriche a vu son élection invalidée pour « irrégularités ». Si différents soient ces deux évé- nements, ils n’en reflètent pas moins les lézardes grandissantes qui fissurent cette Europe dont les peuples ne veulent ouvertement plus ou qui ne sait plus faire élire ses thuriféraires qu’en truquant les élections. Belle leçon de démocratie ! Fort heureu- sement pour les Autrichiens, leur Cour constitu- tionnelle n’est pas le Conseil constitutionnel fran- çais. Elle ne valide pas des élections dont le dépouillement s’est déroulé dans des conditions discutables. L’ancien président du Conseil consti- tutionnel Roland Dumas ne se disait-il pas, lui, « convaincu d’avoir sauvé la République » – rien que moins ! – en ayant validé, en 1995, les comptes de campagne présidentielle « manifeste- ment irréguliers » de Jacques Chirac ? Autres Suite page 3 »»» Page 16 QUÉBEC : L’IDENTITÉ AU CŒUR M 01093 - 2935 - F: 4,50 E DE LA VOLONTÉ D’INDÉPENDANCE 3’:HIKLKJ=XUYZUW:?m@j@n@f@a"; Ils ont dit Billet «PASSAGE EN REVUE » La peau Où le Brexit a, plus que jamais, démontré la réalité de la ligne de fracture de la fessée entre les élites urbaines mondialisées et les laissés-pour-compte de l’utopie du marché transfrontiarisé.