Thèse De Doctorat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
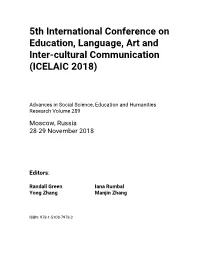
Use Style: Paper Title
5th International Conference on Education, Language, Art and Inter-cultural Communication (ICELAIC 2018) Advances in Social Science, Education and Humanities Research Volume 289 Moscow, Russia 28-29 November 2018 Editors: Randall Green Iana Rumbal Yong Zhang Manjin Zhang ISBN: 978-1-5108-7978-2 Printed from e-media with permission by: Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 Some format issues inherent in the e-media version may also appear in this print version. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Licence details: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Conference Website: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icelaic-18 Printed by Curran Associates, Inc. (2019) For permission requests, please contact the publisher: Atlantis Press Amsterdam / Paris Email: [email protected] Additional copies of this publication are available from: Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA Phone: 845-758-0400 Fax: 845-758-2633 Email: [email protected] Web: www.proceedings.com TABLE OF CONTENTS FORMATION OF SYSTEMATIC MANAGEMENT KNOWLEDGE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF MODERN POLITICAL EDUCATION...........................................................................................................................................................1 Kulinchenko Alexander, Mamaeva Yulia, Ageeva Elena, Sedykh Nikolay HUMANITARIAN MEASUREMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND ECUADOR ..........................................................................................................................................................................................................6 -

Citizenship and Government in Transition in Nationalist China, 1927±1937Ã
IRSH 46 (2001), Supplement, pp. 185±207 DOI: 10.1017/S0020859001000372 # 2001 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ``Begging the Sages of the Party-State'': Citizenship and Government in Transition in Nationalist China, 1927±1937à Rebecca Nedostup and Liang Hong-ming The premise of the Nationalist government at Nanjing (1927±1937) rested on a precarious balance of democracy and paternalism. The Nationalists drew their power from China's citizens, but they also subjected them to a regimen of training and control. Petitions from the ``Nanjing decade'' highlight the resulting tensions between government and the governed. Citizens from all walks of life accepted the ruling party's invitation to participate in the construction of the republic. Yet they also used petitions to seek redress when they believed the Nationalists had fallen short of their obligations. These documents mark a turbulent period of transition from imperial rule to representative democracy. They also characterize an era when new political ideas, new media, and new social organizations helped people take an old device and transform it into a useful weapon for asserting their rights as modern citizens. TUTELARY GOVERNMENT AND THE EVOLUTION OF THE MODERN PETITION The ®nal Chinese dynasty had been overthrown in 1911 because it was unresponsive to the changing opinions of its subjects. The imperial government had maintained a tradition of court memorials circulated between local and higher of®cials, all the way up to the Emperor.1 But this à The materials used in this article were gathered with support from the Center for Chinese Studies (Taipei, Taiwan), the Fulbright Foundation, the Chiang-Ching Kuo Foundation, the Committee on Scholarly Communication with China, and the American Council of Learned Societies. -

Has Man a Future? Dialogues with the Last Confucian China Academic Library
China Academic Library Shu Ming Liang Guy S. Alitto Has Man a Future? Dialogues with the Last Confucian China Academic Library For further volumes: http://www.springer.com/series/11562 Academic Advisory Board: Researcher Geng, Yunzhi, Institute of Modern History, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Han, Zhen, Beijing Foreign Studies University, China Researcher Hao, Shiyuan, Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Li, Xueqin, Department of History, Tsinghua University, China Professor Li, Yining, Guanghua School of Management, Peking University, China Researcher Lu, Xueyi, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Tang, Yijie, Department of Philosophy, Peking University, China Professor Wong, Young-tsu, Department of History, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA Professor Yu, Keping, Central Compilation and Translation Bureau, China Professor Yue, Daiyun, Department of Chinese Language and Literature, Peking University, China Zhu, Yinghuang, China Daily Press, China Shu Ming Liang • Guy S. Alitto Has Man a Future? Dialogues with the Last Confucian Shu Ming Liang (deceased) Guy S. Alitto East Asian Languages and Civilizations The University of Chicago Chicago, IL, USA ISSN 2195-1853 ISSN 2195-1861 (electronic) ISBN 978-3-642-35815-9 ISBN 978-3-642-35816-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-642-35816-6 Springer Heidelberg New York Dordrecht London Library of Congress Control Number: 2013933021 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, speci fi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on micro fi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

Engaging with Socialism in China: the Political Thought and Activities of Chen Gongbo and Tan Pingshan, 1917-1928
Engaging with Socialism in China: The Political Thought and Activities of Chen Gongbo and Tan Pingshan, 1917-1928 Xuduo Zhao PhD University of York History May 2019 1 Abstract This thesis investigates Chen Gongbo (1892-1946) and Tan Pingshan (1886-1956), two significant Cantonese Marxists who helped found the Chinese Communist Party (CCP) in 1921. I use Chen and Tan as a lens to re-examine the dissemination of Marxism in May Fourth China and the underlying tensions in 1920s Chinese revolution. My study demonstrates that it was in the changing educational system in the early 20th century that Chen and Tan gradually improved their positions in the cultural field and participated in the intellectual ferment during the May Fourth period. At Peking University they became familiarised with Marxism. Their understanding of Marxism, however, was deeply influenced by European social democracy, as opposed to many other early communist leaders who believed in Bolshevism. This divergence finally led to the open conflict within the CCP between Guangzhou and Shanghai in the summer of 1922, which also embodied the different social identities among early Chinese Marxists. After the quarrel, Chen quit while Tan remained within the party. During the Nationalist Revolution, both Tan and Chen became senior leaders in the Kuomintang, but they had to face yet another identity crisis of whether to be a revolutionary or a politician. Meanwhile, they had to rethink the relationship between socialism and nationalism in their political propositions. This study of Chen and Tan’s political thought and activities in the late 1910s and 1920s offers a different picture of Chinese radicalism and revolution in the early Republican period. -

Proclaiming Intellectual Authority Through Classification: the Case of the Seven Epitomes
Knowl. Org. 38(2011)No.1 25 H.-L. Lee and W.-Ch. Lan. Proclaiming Intellectual Authority Through Classification: The Case of the Seven Epitomes Proclaiming Intellectual Authority Through Classification: The Case of the Seven Epitomes Hur-Li Lee* and Wen-Chin Lan** * School of Information Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, 3210 N. Maryland Ave., Bolton Hall #510, Milwaukee, WI 53211, USA, <[email protected]> **Department of Library and Information Science, National Taiwan University, No.1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei 106, Taiwan, Republic of China, [email protected] Hur-Li Lee is an Associate Professor in the School of Information Studies at the University of Wis- consin-Milwaukee. Her major research interests include classification theory; users’ interactions with structures of information systems; and social and cultural aspects of information and information ser- vices. In 2006, she received a Fulbright Scholar Research Award to study traditional Chinese bibliog- raphy at Peking University (Beijing, China) for five months. The long-term research project, “Tradi- tional Chinese Bibliographic Classification,” on which she and Dr. Wen-Chin Lan have since collabo- rated, is in a Website available online at https://pantherfile.uwm.edu/hurli/www/Chinese.htm. Wen-Chin Lan is an assistant professor of the Department of Library and Information Science, Na- tional Taiwan University. He earned his doctoral degree from the School of Information and Library Science, University of North Carolina at Chapel Hill. His research interests include information or- ganization, metadata, Chinese bibliography, classification theory, and history of books. Lee, Hur-Li and Lan, Wen-Chin. Proclaiming Intellectual Authority Through Classification: The Case of the Seven Epitomes. -

Contemporary Confucianism, the 'Reorganization of the National Heritage,' and Non-Western Histories of Thought in a Global Age
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by LSE Research Online Leigh Jenco How should we use the Chinese past? Contemporary Confucianism, the 'reorganization of the national heritage,' and non-western histories of thought in a global age Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Jenco, Leigh (2017) How should we use the Chinese past? Contemporary Confucianism, the 'reorganization of the national heritage,' and non-western histories of thought in a global age. European Journal of Political Theory . ISSN 1474-8851 © 2017 The Author This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/72832/ Available in LSE Research Online: April 2017 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. How Should We Use the Chinese Past? -

Wei Yuan and the Chinese Totalistic Iconoclasm: the Demise of Confucianism in Matter and in Form
Illinois Wesleyan University Digital Commons @ IWU Honors Projects History Department Spring 4-22-2011 Wei Yuan and the Chinese Totalistic Iconoclasm: The Demise of Confucianism in Matter and in Form Chao Ren Illinois Wesleyan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.iwu.edu/history_honproj Part of the Asian History Commons, and the Intellectual History Commons Recommended Citation Ren, Chao, "Wei Yuan and the Chinese Totalistic Iconoclasm: The Demise of Confucianism in Matter and in Form" (2011). Honors Projects. 48. https://digitalcommons.iwu.edu/history_honproj/48 This Article is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by Digital Commons @ IWU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this material in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This material has been accepted for inclusion by faculty at Illinois Wesleyan University. For more information, please contact [email protected]. ©Copyright is owned by the author of this document. Wei Yuan and the Chinese Totalistic Iconoclasm The Demise of Confucianism in Matter and in Form Chao Ren Department of History Illinois Wesleyan University Bloomington, IL, USA ABSTRACT This paper attempts to explore the historical origins of the “totalistic iconoclasm” that was characteristic of Chinese intellectual history in the twentieth century. By examining Wei Yuan’s historical writings, the paper argues that the conceptual connection between the civilization of the majority Han ethnicity (“the Chinese tradition”) and the idea of a political entity of China had already broken down by mid-nineteenth century. -

Academia Sinica Balanced Corpus (Sinica Corpus) Contains 5,345,871 Characters, Equivalent to 3.5 Million Words.” (Chen Et Al., “Sinica Corpus”, 167)
QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF DIGITAL CHINESE CLASSICS: A PRELIMINARY STUDY Sergey Zinin Warring States Project University of Massachusetts, Amherst To the memory of Prof. Tatiana Grigoryeva Abstract1 The study analyzes quantitative aspects of digital versions of fifteen pre-Qin classical Chinese texts2, such as text length and number of character types. These parameters are critical for the analysis of character frequencies, but they vary in existing digital corpora. This article analyzes the available data (collected for the first time), beginning from the pre-digital period. It delineates the evolution of digital resources of classical Chinese and provides an up-to-date review of major available online resources as well as offline research corpora. The paper demonstrates the scope of variation and discusses the inherent inaccuracy of digital texts (“digital content gap,” i.e., the discrepancy between printed and digital versions of the same text). The digital content gap could affect traditional philological studies, but it 1 An earlier version of this article was published as Zinin, Sergey. “Pre-Qin Digital Classics: Study of Text Length Variations”. This material is an extended version of the former material. 2 All texts, except Zhuangzi, are from the “Thirteen Classics” (Shisanjing), and are available through a web-based concordancer Warring States Workshop Ctexts (thereafter, “WSW Ctexts”, to discern it from another project with similar name, Donald Sturgeon’s “Chinese Text Project (CTP)”). 1 may not be very significant for a quantitative analysis. The article presents a comparative analysis of length statistics, and concludes that because of the existing variety in text characteristics, any quantitative study of Chinese classics will be corpus-specific. -

"Confucian" Classics, by Michael Nylan Endnotes
Copyright 2001 Yale University The Five "Confucian" Classics, by Michael Nylan Endnotes Page ¶ Chapter 1— Introduction to the Five Classics 1 1 "…the Chinese system"—In Korea, a national university dedicated to classical education in Chinese was established in AD 372 in Koguryô, one of the Three Kingdoms absorbed into Unified Silla, but it was not until the fourteenth century that the Yi dynasty designated Zhu Xi's teachings as Korea's official state ideology (for 500 years). In Japan, elements of Chinese-style classicism were first promoted by the fourth and fifth shoguns of Tokugawa (from 1651), and fully systematized only in Meiji. See Kurozumi Makoto (1994). In Vietnam, Van Mieu, a university on the Chinese model, with classes conducted in Mandarin Chinese, was in operation after AD 1070. For more information on Vietnam, see Alexander Woodside (1971). For Zhu Xi (1130-1200), see below in the introduction and Key Terms. 2 1 "…well worth revisiting"—Thomas Wilson (Hamilton College, private communication) reminds us that the modernists disputed the view that the world is iinherently moral; the postmodernists, that the world is intelligible. For the phrase "real science of men," see Charles Calia (1998), p. 139. 2 1 "…squander their riches"—Of course, Zhu Xi once scoffed at this ardent desire, which he ascribed to the Han classical masters, to fully comprehend thhe Supreme Sage: "Short of recalling Confucius's soul (hun) so that he can explain in person, I do not know what is to be done" about interpreting the past. See ZZYL 83, no. 44 (VI, p. -
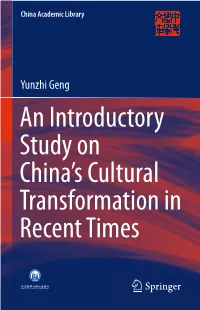
An Introductory Study on China's Cultural Transformation in Recent
China Academic Library Yunzhi Geng An Introductory Study on China’s Cultural Transformation in Recent Times China Academic Library Academic Advisory Board: Researcher Geng, Yunzhi, Institute of Modern History, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Han, Zhen, Beijing Foreign Studies University, China Researcher Hao, Shiyuan, Institute of Ethnology and Anthropology, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Li, Xueqin, Department of History, Tsinghua University, China Professor Li, Yining, Guanghua School of Management, Peking University, China Researcher Lu, Xueyi, Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences, China Professor Tang, Yijie, Department of Philosophy, Peking University, China ProfessorWong, Young-tsu, Department of History, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA Professor Yu, Keping, Central Compilation and Translation Bureau, China Professor Yue, Daiyun, Department of Chinese Language and Literature, Peking University, China Zhu, Yinghuang, China Daily Press, China Series Coordinators: Zitong Wu, Foreign Language Teaching and Research Press, China Yan Li, Springer More information about this series at http://www.springer.com/series/11562 Yunzhi Geng An Introductory Study on China’s Cultural Transformation in Recent Times Yunzhi Geng Chinese Academy of Social Sciences & Institute of Modern History Beijing China Sponsored by Chinese Fund for the Humanities and Social Sciences (本书中华社会科学基 金资助) ISSN 2195-1853 ISSN 2195-1861 (electronic) ISBN 978-3-662-44589-1 ISBN 978-3-662-44590-7 (eBook) DOI 10.1007/978-3-662-44590-7 Springer Heidelberg New York Dordrecht London Library of Congress Control Number: 2014952659 © Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 This work is subject to copyright. -

Transcript-Of-China-S-South-Changing
The Sin Wai-Kin Distinguished Visiting Professorship in the Humanities Lecture delivered at The University of Hong Kong on 12 November 2018. China’s South: Changing Perspective* Wang Gungwu When I took my first course in Chinese history, I thought everybody knew where China was and saw the 5,000 years of history of China as straight forward. That was at the National Central University 中央大學 in Nanjing in 1947, where one of the compulsory subjects for first-year students was General History of China, Zhongguo tongshi 中國通史. The three volumes by Miao Fenglin 繆鳳林 covered some 5,000 years down to the 20th century. I also read another three volumes of the Cultural History of China, Zhongguo wenhua shi 中國文化史 by Liu Yizheng 柳詒徵. They were both leading historians of the time and I took for granted that reading these two books was more than enough. It took me sometime to realize how wrong I was. Literature had been my first love and I did not expect to be a historian. After my first year, the civil war was going badly for the Kuomintang and the People’s Liberation Army reached the north banks of the Yangzi. In November 1948, the university was disbanded and I went back to Malaya. A year later, I went to the new University of Malaya in Singapore. Its Arts Faculty was very small and only four subjects were available. For the three-year BA General degree, we did three subjects. I chose English literature and economics. For the third subject, I did not want to take geography and thought that history would be more interesting. -

Proquest Dissertations
RICE UNIVERSITY Chen Duxiu's Early Years: The Importance of Personal Connections in the Social and Intellectual Transformation of China 1895-1920 by Anne Shen Chap A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE Doctor of Philosophy APPROVED, THESIS COMMITTEE: Richar^TTSmith, Chair, Professor History, George and Nancy Rupp Professor of Humanities Nanxiu Qian,Associate Professor" Chinese Literature '^L*~* r^g^- ^J-£L&~^T Sarah Thai, Associate Professor History, University of Wisconsin- Madison HOUSTON, TEXAS APRIL 2009 UMI Number: 3362139 INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI® UMI Microform 3362139 Copyright 2009 by ProQuest LLC All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI48106-1346 ABSTRACT Chen Duxiu's Early Years: The Importance of Personal Connections in the Social and Intellectual Transformation of China 1895-1920 by Anne Shen Chao Chen Duxiu (1879-1942), is without question one of the most significant figures in modern Chinese history. Yet his early life has been curiously neglected in Western scholarship. In this dissertation I examine the political, social and intellectual networks that played such an important role in his early career—a career that witnessed his transformation from a classical scholar in the Qing dynasty (1644-1912), to a reformer, to a revolutionary, to a renowned writer and editor, to a university dean, to a founder of the Chinese Communist Party, all in the space of about two decades.