D a K a R 2 0
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BANK of AFRICA SENEGAL Prie Les Personnes Dont Les Noms Figurent
COMMUNIQUE COMPTES INACTIFS BANK OF AFRICA SENEGAL prie les personnes dont les noms figurent sur la liste ci- dessous de bien vouloir se présenter à son siège (sis aux Almadies, Immeuble Elan, Rte de Ngor) ou dans l’une de ses agences pour affaire les concernant AGENCE DE NOM NATIONALITE CLIENT DOMICILIATION KOUASSI KOUAME CELESTIN COTE D'IVOIRE ZI PARTICULIER 250383 MME SECK NDEYE MARAME SENEGAL INDEPENDANCE 100748 TOLOME CARLOS ADONIS BENIN INDEPENDANCE 102568 BA MAMADOU SENEGAL INDEPENDANCE 101705 SEREME PACO BURKINA FASO INDEPENDANCE 250535 FALL IBRA MBACKE SENEGAL INDEPENDANCE 100117 NDIAYE IBRAHIMA DIAGO SENEGAL ZI PARTICULIER 251041 KEITA FANTA GOGO SENEGAL INDEPENDANCE 101860 SADIO MAMADOU SENEGAL ZI PARTICULIER 250314 MANE MARIAMA SENEGAL INDEPENDANCE 103715 BOLHO OUSMANE ROGER NIGER INDEPENDANCE 103628 TALL IBRAHIMA SENEGAL INDEPENDANCE 100812 NOUCHET FANNY J CATHERINE SENEGAL MERMOZ 104154 DIOP MAMADOU SENEGAL INDEPENDANCE 100893 NUNEZ EVELYNE SENEGAL INDEPENDANCE 101193 KODJO AHIA V ELEONORE COTE D'IVOIRE PARCELLES ASSAINIES 270003 FOUNE EL HADJI MALICK SENEGAL MERMOZ 105345 AMON ASSOUAN GNIMA EMMA J SENEGAL HLM 104728 KOUAKOU ABISSA CHRISTIAN SENEGAL PARCELLES ASSAINIES 270932 GBEDO MATHIEU BENIN INDEPENDANCE 200067 SAMBA ALASSANE SENEGAL ZI PARTICULIER 251359 DIOUF LOUIS CHEIKH SENEGAL TAMBACOUNDA 960262 BASSE PAPE SEYDOU SENEGAL ZI PARTICULIER 253433 OSENI SHERIFDEEN AKINDELE SENEGAL THIES 941039 SAKERA BOUBACAR FRANCE DIASPORA 230789 NDIAYE AISSATOU SENEGAL INDEPENDANCE 111336 NDIAYE AIDA EP MBAYE SENEGAL LAMINE GUEYE -

Dakar's Municipal Bond Issue: a Tale of Two Cities
Briefing Note 1603 May 2016 | Edward Paice Dakar’s municipal bond issue: A tale of two cities THE 19 MUNICIPALITIES OF THE CITY OF DAKAR Central and municipal governments are being overwhelmed by the rapid growth Cambérène Parcelles Assainies of Africa’s cities. Strategic planning has been insufficient and the provision of basic services to residents is worsening. Since the 1990s, widespread devolution has substantially shifted responsibility for coping with urbanisation to local Ngor Yoff Patte d’Oie authorities, yet municipal governments across Africa receive a paltry share of Grand-Yoff national income with which to discharge their responsibilities.1 Responsible and SICAP Dieuppeul-Derklé proactive city authorities are examining how to improve revenue generation and Liberté Ouakam HLM diversify their sources of finance. Municipal bonds may be a financing option for Mermoz Biscuiterie Sacré-Cœur Grand-Dakar some capital cities, depending on the legal and regulatory environment, investor appetite, and the creditworthiness of the borrower and proposed investment Fann-Point Hann-Bel-Air E-Amitié projects. This Briefing Note describes an attempt by the city of Dakar, the capital of Senegal, to launch the first municipal bond in the West African Economic and Gueule Tapée Fass-Colobane Monetary Union (WAEMU) area, and considers the ramifications of the central Médina Dakar-Plateau government blocking the initiative. Contested capital Sall also pressed for the adoption of an African Charter on Local Government and the establishment of an During the 2000s President Abdoulaye Wade sought African Union High Council on Local Authorities. For Sall, to establish Dakar as a major investment destination those closest to the people – local government – must and transform it into a “world-class” city. -

Carte Administrative De La Région De Dakar
Carte administrative de la région de Dakar Extrait du Au Senegal http://www.au-senegal.com Dakar Carte administrative de la région de Dakar - Français - Découvrir le Sénégal, pays de la teranga - Sénégal administratif - Date de mise en ligne : vendredi 24 aot 2007 Description : Le Sénégal géographique • Gorée Un quart dheure seulement en chaloupe suffit pour relier Gorée au reste du continent. (...) • Toubab Diallao Entre plages de sable fin, falaises dargile et collines de pierres, Toubab Dialaw est (...) • Dakar Copyright © Au Senegal Page 1/5 Carte administrative de la région de Dakar Ancien village de pêcheurs Lebou et Wolof, Dacar ou Dahar qui signifie « tamarinier » (...) • Cap-vert La presquîle du Cap-Vert, qui abrite Dakar, la capitale du pays, constitue le point le (...) • Petite Côte La Petite Côte sétend sur près de 70 km au sud-est de Dakar, entre Rufisque et Joal (...) • Région centre Le Centre-Ouest du Sénégal, doté dune très forte population, présente un paysage sahélien (...) • Sine Saloum Dune grande richesse historique et culturelle, la région naturelle du Sine Saloum, au (...) • Casamance La région naturelle de la Casamance a des limites qui tiennent à la fois de la nature (...) • Saint-Louis et le delta du fleuve La zone du delta du fleuve comprend plusieurs sites naturels remarquables. Grâce à la (...) • Vallée du fleuve Le fleuve Sénégal sécoule paisiblement en marquant la frontière avec le Mali à lEst et (...) • Sénégal Oriental La région orientale du Sénégal est certainement la plus riche en surprises et en (...) -

Region De Dakar
Annexe à l’arrêté déterminant la carte électorale nationale pour les élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l’Education et de la Formation REGION DE DAKAR DEPARTEMENT DE DAKAR COMMUNE OU LOCALITE LIEU DE VOTE BUREAU DE VOTE IEF ALMADIES YOFF LYCEE DE YOFF ECOLE JAPONAISE SATOEISAT 02 ECOLE DIAMALAYE YOFF ECOLE DEMBA NDOYE 02 LYCEE OUAKAM 02 NGOR -OUAKAM ECOLE MBAYE DIOP 02 LYCEE NGALANDOU DIOUF 01 MERMOZ SACRE-COEUR ECOLE MASS MASSAER DIOP 01 TOTAL : 08 LIEUX DE VOTE 10 BUREAUX DE VOTE IEF GRAND DAKAR CEM HANN 01 HANN BEL AIR EL HOUDOU MABTHIE 01 KAWABATA YASUNARI 01 HLM CEM DR SAMBA GUEYE 01 OUAGOU NIAYES 3/A 01 HLM 4 /B 01 CEM LIBERTE 6/C 01 DIEUPEUL SICAP / LIBERTE LIBERTE 6/A 01 DERKLE 2/A 01 CEM EL H BADARA MBAYE KABA 01 BSCUITERIE / GRAND - AMADOU DIAGNE WORE 01 DAKAR BSCUITERIE 01 TOTAL 11 lieux de vote 12 BUREAUX DE VOTE IEF PARCELLES ASSAINIES PA 1/ PA2 LYCEE PA U13 03 LYCEE SERGENT MALAMINE CAMARA 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U8 02 ECOLE ELEMENTAIRE PAC /U3 02 LYCEE TALIBOU DABO 02 ECOLE ELEMENTAIRE P.O. HLM 02 GRAND YOFF ECOLE ELEMENTAIRE SCAT URBAM 02 LYCEE PATTE D’OIE BUILDERS 02 PATTE DOIE / CAMBARENE ECOLE ELEMENTAIRE SOPRIM 01 TOTAL LIEUX DE VOTE : 09 18 BUREAUX DE VOTE IEF /DAKAR PLATEAU LYCEE BLAISE DIAGNE 03 LYCEE FADHILOU MBACKE 01 A AHMADOU BAMBA MBACKE DIOP 01 LYCEE JOHN FITZGERALD KENNEDY 03 LYCEE MIXTE MAURICE DELAFOSSE 05 B ECOLE ELEMENTAIRE COLOBANE 2 02 ECOLE MANGUIERS 2 01 ECOLE ELEMENTAIRE SACOURA BADIANE 02 LYCEE LAMINE GUEYE 02 LYCEE EL HADJI MALICK SY 01 C ECOLE ELEMENTAIRE MOUR -

Rapport D'evaluation Des Besoins POST
71334 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Rapport d’Evaluation des besoins Public Disclosure Authorized POST Catastrophe Inondations urbaines à Dakar 2009 Préparé par le gouvernement de la République du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale, du système des Nations Unies et de la Commission Européenne Rapport final Juin 2010 Public Disclosure Authorized Rapport d’Evaluation des besoins POST Catastrophe Inondations urbaines à Dakar 2009 Préparé par le gouvernement de la République du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale, du système des Nations Unies et de la Commission Européenne Rapport final Juin 2010 TABLE DES MATIÈRES Abréviations ............................................................................................................................ ix Remerciements ......................................................................................................................... xiii Avant Propos ............................................................................................................................ xv EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................. 1 1. Context of the 2009 flooding ............................................................................................ 2 2. Impacts of the 2009 flooding ................................................................................................ 3 2.1 Summary of damage and losses by sector ...................................................................... -

6.5.2 Formulation Du Plan D'occupation Du
Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 Rapport Final : Volum e I Écologisation des espaces ouverts : il y a des espaces ouverts qui ne sont pas adaptés pour le bâtiment. Ces espaces incluent les zones à risque, les bords de rivière, les terres agricoles, les forêts et les cimetières. Dans les zones à risque, la meilleure façon de se prémunir est de les laisser à l'abri de l'urbanisation. Toutefois, elles peuvent servir d'espaces verts et de parcs. Le nombre d'agriculteurs diminuera à l'avenir puisque beaucoup d'entre eux cherchent à tirer de meilleurs profits des terres par le biais d'usages urbains. Il pourrait s'avérer nécessaire de mettre en œuvre des programmes d'appui à l'amélioration de la productivité agricole pour encourager les agriculteurs à continuer l'agriculture et à obtenir un appui de la politique de préservation de l'agriculture. Ces espaces ouverts seront reliés entre eux par des couloirs de verdure pour créer les équipements urbains d'un réseau vert. Les couloirs de verdure sont constitués de voies piétonnes aménagées le long des routes à l’intérieur des zones commerciales et de voies piétonnes aménagées le long des rivières et des canaux. Source: Mission d'Etude de la JICA. Figure 6.5.2 Plan du réseau vert 6.5.2 Formulation du plan d’occupation du sol (1) Portée du plan d’occupation du sol Dans d'autres pays en général, différents plans d'occupation du sol sont formulés à différentes fins telles qu'indiquées dans le Tableau 6.5.2. -

Dakar Regional Express Train (Ter)
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : DAKAR REGIONAL EXPRESS TRAIN (TER) COUNTRY : SENEGAL SUMMARY OF FULL RESETTLEMENT PLAN (FRP) Project Team: A.I. MOHAMED, Principal Transport Economist, OITC1/SNFO M. A. WADE, Infrastructure Specialist, SNFO/OITC1 M.MBODJ, Consultant Economist, OITC 2 M. L.KINANE, Principal Environmentalist, ONEC.3 S. BAIOD, Consultant Environmentalist, ONEC.3 Project Team Sector Director : A. OUMAROU Regional Director : A. BERNOUSSI Acting Resident Representative : A. NSIHIMYUMUREMYI Division Manager : J.K. KABANGUKA 1 Regional Express Train (TER) Dakar Summary of Full Resettlement Plan Project Name : DAKAR REGIONAL EXPRESS TRAIN (TER) Country : SENEGAL Project Reference No. : P-SN-DC0-003 Department : OITC Division: OITC.1 ___________________________________________________________________________ INTRODUCTION This paper is the summary of the Full Resettlement Plan (FRP) designed in accordance with Senegalese national procedures as well as those of the Bank. It aims to ensure that project affected persons (PAPs) are compensated and settled. Its objectives are three-fold: (i) minimise involuntary resettlement as much as possible; (ii) avoid to the extent possible the destruction of assets; and (iii) compensate affected persons to offset the loss of residential and agricultural lands, buildings and equipment as well as loss of revenue. The Dakar-Diamniadio-AIBD (Blaise Diagne International Airport) Regional Express Train (TER) Project is composed of two phases. The first extends from Dakar to Diamniadio and the second from Diamniadio to Diass where the new Dakar internationnal airport is situated. This FRP concerns works that will be implemented during the project’s first phase and specifically works to be undertaken in the Districts of Dakar, Pikine and Rufisque. -
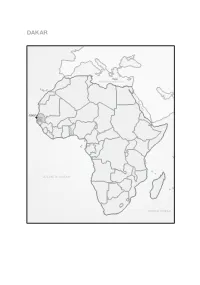
Chapter 3: Dakar
DAKAR Capital cities 1.indd 31 9/22/11 4:20 PM DAKAR 3 Amadou Diop During the 20th century, the city of Dakar figured as the capital city of several territories, including countries such as Mali and Gambia. This attests to the central role it has played, and continues to play, in West Africa. Today, Dakar is firmly established as the capital of Senegal. A port city with a population of over 2.5 million and a location on a peninsula which continues to attract people from the country’s hinterland, Dakar has grown rapidly. It is administratively known as the Dakar Region, and comprises four départements (administrative districts) (see Figure 3.1) – Dakar, the original old city with a population of 1 million; Pikine, a large, sprawling department with a population of some 850 000; and Guédiawaye and Rufisque, two smaller departments of some 300 000 residents each (Diop 2008). The latter two represent the most recent peri-urban incorporation of settlements in the Dakar Region. Each of the four departments, in turn, comprise a number of communes, or smaller administrative units. This chapter is divided into two main parts. The first, ‘The urban geology of Dakar’, commences with a short history of the establishment and growth of the city, its economy and population. Subsequent sections discuss urban-planning activities before and after independence, government attempts through policy and practice to address the urban housing and urban transport challenges, and attempts to plan secondary commercial centres in the Dakar Region as more and more urban settlements are developed at some distance from the city centre of Dakar. -
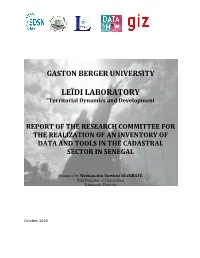
LEÏDI LABORATORY "Territorial Dynamics and Development
GASTON BERGER UNIVERSITY LEÏDI LABORATORY "Territorial Dynamics and Development REPORT OF THE RESEARCH COMMITTEE FOR THE REALIZATION OF AN INVENTORY OF DATA AND TOOLS IN THE CADASTRAL SECTOR IN SENEGAL Presented by Mouhamadou Mawloud DIAKHATÉ Full Professor of Universities Laboratory Director October, 2020 CONTENTS ACRONYMS AND ABBREVIATIONS INTRODUCTION I/ HISTORY OF THE EVOLUTION OF THE ORGANIZATION OF STATE STRUCTURES II/ INVENTORY OF STAKEHOLDERS AND EXISTING DATA III/ RESPONSIBILITIES AND COMMITMENT OF THE ACTORS IN THE COLLECTION OF CADASTRAL DATA IV/ RELIABLE CADASTRAL DATA AND MONITORING OF ODDS V/ ROADMAP FOR STRENGTHENING THE CADASTRAL ECOSYSTEM V.1 Objectives of strengthening the cadastral ecosystem V.2 Contribution of spatial remote sensing and geographic information systems (GIS) and statistics to the modernization of the national cadastre V.2.1. Implementation of a multi-purpose cadastre in Senegal V.2.2. Thematic maps V.2.3. 2D and 3D Carto. V.2.4. Statistical modelling V.2.5. Methodology for the elaboration of the comic book V.3 Content of the roadmap V.4. Priority and Roadmap Agenda CONCLUSION BIBLIOGRAPHY ITEMS 2 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ANDS : National Agency of Statistics and Demography ArcGIS: Suite of geographic information software developed by Esri ADB: African Development Bank BAGDOC: Office of General Affairs and Documentation BD TOPO: Topographic data bank BLC: Office of Legislation and Litigation PRB: Public Relations Office CAGF: Framework for analysis of land governance CGE: Center for Large Enterprises -

Repertoire Structures Privees.Pdf
REPERTOIRE STRUCTURES PRIVEES EN SANTE LOCALISATION Nom de la structure TYPE Adresse Fatick FATICK DEPOT DE DIAOULE Dépôt COMMUNE DE DIAOULE Kolda VELINGARA DEPOT PHARMACIE BISSABOR Dépôt BALLANA PAKOUR PRES DU NOUVEAU MARCHE Kolda VELINGARA DEPOT BISSABOR /WASSADOU Dépôt CENTRE EN FACE SONADIS Ziguinchor ZIGUINCHOR DEPOT ADJAMAAT Dépôt NIAGUIS PRES DE LA PHARMACIE Kédougou SALEMATA DEPOT SALEMATA Dépôt KOULOUBA SALEMATA Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE DE L'EMMANUEL Pharmacie GRAND DAKAR A COTE GARAGE CASAMANCE OU ECOLE XALIMA Ziguinchor ZIGUINCHOR PHARMACIE NEMA Pharmacie GRAND DAKAR PRES DU MARCHE NGUELAW Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE NOUROU DAREYNI Pharmacie RUE 1 CASTOR DERKHELE N 25 Kédougou KEDOUGOU PHARMACIE YA SALAM Pharmacie MOSQUE KEDOUGOU PRES DU MARCHE CENTRAL Dakar DAKAR SUD PHARMACIE DU BOULEVARD Pharmacie RUE 22 X 45 MEDINA QUARTIER DAGOUANE PIKINE TALLY BOUMACK N545_547 PRES DE Dakar PIKINE PHARMACIE PRINCIPALE Pharmacie LA POLICE Dakar GUEDIAWAYE PHARMACIE DABAKH MALICK Pharmacie DAROU RAKHMANE N 1981 GUEDIAWAYE SOR SAINT LOUIS MARCHE TENDJIGUENE AVENUE GENERALE DE Saint-Louis SAINT-LOUIS PHARMACIE MAME MADIA Pharmacie GAULLE BP 390 Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE NDOSS Pharmacie AVENUE CHEIKH ANTA DIOP RUE 41 DAKAR FANN RANDOULENE NORD AVENUE EL HADJI MALICK SY PRES PLACE DE Thies THIES PHARMACIE SERIGNE SALIOU MBACKE Pharmacie FRANCE Dakar DAKAR SUD PHARMACIE LAT DIOR Pharmacie ALLES PAPE GUEYE FALL Dakar DAKAR SUD PHARMACIE GAMBETTA Pharmacie 114 LAMINE GUEYE PLATEAU PRES DE LOFNAC Louga KEBEMER PHARMACIE DE LA PAIX Pharmacie -

The Study of Infrastructure Information Management System of the Dakar Metropolitan Area in the Republic of Senegal
Chapter 2-3 The Study of Infrastructure Information Management System of the Dakar Metropolitan Area in the Republic of Senegal Kazumi Suwabe Asia Air Survey Co., Ltd. Shinjuku-Kofu Bldg 4-2-18 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022 Japan [email protected] Abstract The Dakar Metropolitan Area has urban problems caused by rapidly increasing population, illegal housing, traffic problem, flooding etc. Individual effort by responsible organizations has not yielded desired results bacause data preparation effort is duplicated among different organizations, their data collection by them are often mutually incompatible. It was desired to establish an information management system in the provision of social infrastructure utilizing GIS in order to support the development of urban facilities and services in the Dakar Metropolitan Area. JICA implemented the technical cooperation programs to establish a working system actually utilized by related organizations in Senegal through technology transfer. 1. Background evaluation and analysis of phenomenon in urban planning and The rate of population increase in the Dakar Metropolitan Area consider the potentiality of GIS application as a solution of urban (its population projection of 1999 was 1,900,000) is 4 percents issues. As a result of consideration, at first, it was designed both per year. The population density in the city is too high and the of a database and system, which structured information capacity for accommodating its population is too small to catch management system associated with infrastructure, and then up to develop infrastructure and maintain environment. As a established the system and a constitution of its management and consequence, random urban sprawl and deterioration of maintenance. -

Natural Hazards and Climate Change Risks in Dakar, Sénégal
PREPARING TO MANAGE Natural Hazards AND Climate Change Risks IN DAKAR, SÉNÉGAL LA BANQUE MONDIALE A Spatial and Institutional Approach Pilot Study Report Hyoung Gun Wang, Marisela Montoliu-Munoz, Institut Africain de Gestion Urbaine the Geoville Group and Ndèye Fatou D. Gueye Dakar_Final Report engl.indd 1 23.07.09 14:51 Preparing to Manage Natural Hazards and Climate Change Risks in Dakar, Senegal A Spatial and Institutional Approach Pilot Study Report June 2009 Hyoung Gun Wang Economist, Spatial team FEU, SDN, The World Bank Marisela Montoliu-Munoz Head, Spatial team FEU, SDN, The World Bank The Geoville Group Ndèye Fatou D. Gueye African Urban Management Institute The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 U.S.A June 2009 This study has been prepared by the World Bank. The judgements expressed here do not necessarily reflect the views of the Board of Executive Directors or of the governments they represent. TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS .................................................................................................... I ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ............................................................................... II EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................... 1 1. Introduction .................................................................................................................. 9 2. Natural Disasters in Dakar, Senegal .......................................................................