Bulletin De L'association Des Anciens Élèves De L'institut National Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
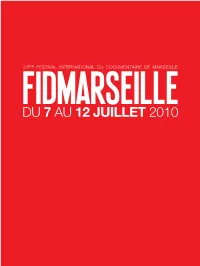
Catafid2010.Pdf
LES VARIÉTÉS partenaire de la 21e édition du FIDMARSEILLE 5 salles classées art & essai / recherche | café - espace expositions 37, rue Vincent Scotto - Marseille 1er | tél. : 04 91 53 27 82 Sommaire / Contents PARTENAIRES / PARTNERS & SPONSORS 005 ÉDITORIAUX / EDITORIALS 006 PRIX / PRIZES 030 JURYS / JURIES 033 Jury de la compétition internationale / International competition jury 034 Jury de la compétition française / French competition jury 040 Jury GNCR, jury Marseille Espérance, jury des Médiathèques GNCR jury, Marseille Espérance jury and Public libraries jury 046 SÉLECTION OFFICIELLE / OFFICIAL SELECTION 047 Éditorial / Editorial 048 Film d’ouverture / Opening film 052 Compétition internationale / International competition 053 Compétition premier / First film competition 074 Compétition française / French competition 101 ÉCRANS PARALLÈLES / PARALLEL SCREENS 117 Rétrospective Ritwik Ghatak 119 Anthropofolies 125 Du rideau à l’écran 157 Paroles et musique 177 Les sentiers 189 SÉANCES SPÉCIALES / SPECIAL SCREENS 221 TABLES RONDES - RENCONTRES / ROUND TABLES - MASTER CLASSES 231 FIDMarseille AVEC / FIDMarseille WITH 235 VIDÉOTHÈQUE / VIDEO LIBRARY 241 FIDLab 251 ÉQUIPE, REMERCIEMENTS, INDEX TEAM, ACKNOWLEGMENTS, INDEXES 255 C.A. et équipe FIDMarseille / FIDMarseille management committee and staff 256 Remerciements / Thanks to 257 Index des films / Film index 258 Index des réalisateurs / Filmmaker index 260 Index des contacts / Contact index 261 Partenaires / Partners & sponsors Le Festival International du Documentaire de Marseille -

Été Indien 10E Édition 100 Ans De Cinéma Indien
Été indien 10e édition 100 ans de cinéma indien Été indien 10e édition 100 ans de cinéma indien 9 Les films 49 Les réalisateurs 10 Harishchandrachi Factory de Paresh Mokashi 50 K. Asif 11 Raja Harishchandra de D.G. Phalke 51 Shyam Benegal 12 Saint Tukaram de V. Damle et S. Fathelal 56 Sanjay Leela Bhansali 14 Mother India de Mehboob Khan 57 Vishnupant Govind Damle 16 D.G. Phalke, le premier cinéaste indien de Satish Bahadur 58 Kalipada Das 17 Kaliya Mardan de D.G. Phalke 58 Satish Bahadur 18 Jamai Babu de Kalipada Das 59 Guru Dutt 19 Le vagabond (Awaara) de Raj Kapoor 60 Ritwik Ghatak 20 Mughal-e-Azam de K. Asif 61 Adoor Gopalakrishnan 21 Aar ar paar (D’un côté et de l’autre) de Guru Dutt 62 Ashutosh Gowariker 22 Chaudhvin ka chand de Mohammed Sadiq 63 Rajkumar Hirani 23 La Trilogie d’Apu de Satyajit Ray 64 Raj Kapoor 24 La complainte du sentier (Pather Panchali) de Satyajit Ray 65 Aamir Khan 25 L’invaincu (Aparajito) de Satyajit Ray 66 Mehboob Khan 26 Le monde d’Apu (Apur sansar) de Satyajit Ray 67 Paresh Mokashi 28 La rivière Titash de Ritwik Ghatak 68 D.G. Phalke 29 The making of the Mahatma de Shyam Benegal 69 Mani Ratnam 30 Mi-bémol de Ritwik Ghatak 70 Satyajit Ray 31 Un jour comme les autres (Ek din pratidin) de Mrinal Sen 71 Aparna Sen 32 Sholay de Ramesh Sippy 72 Mrinal Sen 33 Des étoiles sur la terre (Taare zameen par) d’Aamir Khan 73 Ramesh Sippy 34 Lagaan d’Ashutosh Gowariker 36 Sati d’Aparna Sen 75 Les éditions précédentes 38 Face-à-face (Mukhamukham) d’Adoor Gopalakrishnan 39 3 idiots de Rajkumar Hirani 40 Symphonie silencieuse (Mouna ragam) de Mani Ratnam 41 Devdas de Sanjay Leela Bhansali 42 Mammo de Shyam Benegal 43 Zubeidaa de Shyam Benegal 44 Well Done Abba! de Shyam Benegal 45 Le rôle (Bhumika) de Shyam Benegal 1 ] Je suis ravi d’apprendre que l’Auditorium du musée Guimet organise pour la dixième année consécutive le festival de films Été indien, consacré exclusivement au cinéma de l’Inde. -

Questions for Kumar Shahani- Interview
Questions for Kumar Shahani by Aparna Franki umar Shahani is an internationally renowned filmmaker, who studied under Ritwik Ghatak and apprenticed with Robert Bresson. He is a K recipient of the prestigious Prince Claus Award (1998). His films have won several Indian Filmfare Awards and his film ‘Khayal Gatha’ won the FIPRESCI Prize at the Rotterdam International Film Festival in 1990. Mr. Shahani’s essays have been published in the journals Framework and Social Scientist and he co-edited Cinema and Television: Fifty years of Reflection in France with Jacques Kermabon. Aparna Frank: In your many past interviews and essays, you have questioned simple definitions of “identity” and “culture”, including the term “multiculturalism”; hence, I am curious, what does a phrase like “Indian cinema” mean to you? Kumar Shahani: The question of identity and culture was, as you know, the product of fascism, Nazism and imperial constructs. Right up to 1961, I remember filling up forms, which asked me not only what my nationality was, but also what my race, caste, etcetera were. Therefore, I have rejected these notions totally, fundamentally and I do not ever wish to build any ideology including that of multiculturalism upon notions that have brutalised millions of people. Corporate multiculturalism and state terror are the greatest threat to humanity—they work against the very ethos of individuation. So, what does Indian cinema mean to me or to you, or to anyone else, who has fought for freedom, be it from one sort of hegemony or another? For me, and my gurus, Ritwik Ghatak, D.D Kosambiii, Jal Balaporiaiii and their gurus-Eisenstein, Einstein, Rahmat Khaniv, anything with a geographical name like “Indian” meant self- liberation. -

Two Films: Devi and Subarnarekha and Two Masters of Cinema / Partha Chatterjee
Two Films: Devi and Subarnarekha and Two Masters of Cinema / Partha Chatterjee Satyajit Ray and Ritwik Ghatak were two masters from the Bengali cinema of the 1950s. They were temperamentally dissimilar and yet they shared a common cultural inheritance left behind by Rabindranath Tagore. An inheritance that was a judicious mix of tradition and modernity. Ray’s cinema, like his personality, was outwardly sophisticated but with deep roots in his own culture, particularly that of the reformist Brahmo Samaj founded by Raja Ram Mohan Roy to challenge the bigotry of the upper caste Hindu Society in Bengal in the early and mid-nineteenth century. Ghatak’s rugged, home- spun exterior hid an innate sophistication that found a synthesis in the deep-rooted Vaishnav culture of Bengal and the teachings of western philosophers like Hegel, Engels and Marx. Satyajit Ray’s Debi (1960) was made with the intention of examining the disintegration of a late 19th century Bengali Zamidar family whose patriarch (played powerfully by Chabi Biswas) very foolishly believes that his student son’s teenaged wife (Sharmila Tagore) is blessed by the Mother Goddess (Durga and Kali) so as able to cure people suffering from various ailments. The son (Soumitra Chatterjee) is a good-hearted, ineffectual son of a rich father. He is in and out of his ancestral house because he is a student in Calcutta, a city that symbolizes a modern, scientific (read British) approach to life. The daughter-in-law named Doyamoyee, ironically in retrospect, for she is victimized by her vain, ignorant father-in-law, as it to justify the generous, giving quality suggested by her name. -

The Cinema of MF Husain,Water As a Metaphor in Indian
The Cinema of M.F. Husain M.F. Husain’s two feature length fiction films, Gaja Gamini and Meenaxi are classic examples of having one’s cake and eating it too. In each case, the cake is delectable. True that the two films are not for a mass audience whatever that may mean, but that there is a sizeable audience for them, mainly urban, is beyond dispute. Had they been promoted properly, there would have been jam for the distributors and exhibitors. These two films are genuinely experimental and also eminently accessible to those with open minds-not necessarily intellectual or in tune with European Cinema-but just receptive to new ideas. They share certain avant-garde qualities with Ritwik Ghatak’s ‘Komal Gandhar’ (1961) and are even more advanced in terms of ideas and equally fluid in execution. It is both unfair and unrealistic to compare Husain’s achievements with that of other artists – painters and sculptures – who have also made films. In 1967, his Short, Through The Eyes of a Painter won the top prize in its category at the Berlin Film Festival. Shortly afterwards, an illustrious colleague Tyeb Mehta also made a Short for the same producer, Films Division of India (Government run) in which a slaughterhouse figured prominently. It too was widely appreciated. Then Gopi Gajwani, a painter who also worked with Span Magazine an organ of the United States Information Service, made from his own pocket two abstract short films in 35mm. They were shown once or twice and disappeared for nearly 30 years only to surface during the recent Golden Jubilee Celebrations of Lalit Kala Akademi. -

PAUL THOMAS ANDERSON RITWIK GHATAK 21:00 RITWIK 1GHATAK 18:30 PAUL THOMAS ANDERSON2 DER VAGABUND the LONG GOODBYE S.20 Indien 1958 S.16 USA 1973 102 Min
PROGRAMMINFORMATION NR.235 MÄRZ 2018 SPECIAL PREMIERE HAARIG S.23 In Anwesenheit der Regisseurin März Anka Schmid Klostergasse 5 Im Sputnik Liestal 4051 Basel / beim Kunsthallengarten Im Fachwerk Allschwil www.stadtkinobasel.ch Im Marabu Gelterkinden Tel. 061 272 66 88 www.landkino.ch SÉLECTION LE BON FILM S.12 LANDKINO S.27 «HELLE NÄCHTE» S.24 PAUL THOMAS VON THOMAS ARSLAN PAUL THOMAS ANDERSON | PREMIERE SÉLECTION S.23 «HAARIG» ANDERSON LE BON FILM VON ANKA SCHMID THE MASTER AND HIS MASTERS SPEZIALPROGRAMM S.22 BRENNPUNKT S.18 BANGLADESCH RITWIKBENGALISCHES KINO GHATAK VON EPISCHER SCHÖNHEIT UND KRAFT DER FLUSS TITASH / S.21 WOCHE 9 MÄRZ W OCHE 9 MÄRZ 2018 2018 DONNERSTAG FREITAG 18:15 PAUL THOMAS ANDERSON 16:00 RITWIK GHATAK INHERENT VICE E-MOLL S.16 USA 2014 S.20 Indien 1961 148 Min. Farbe. DCP. E/d/f 133 Min. sw. 35 mm. Bengali/d/f PAUL THOMAS ANDERSON RITWIK GHATAK 21:00 RITWIK GHATAK 18:30 PAUL THOMAS ANDERSON2 1 DER VAGABUND THE LONG GOODBYE S.20 Indien 1958 S.16 USA 1973 102 Min. sw. 35 mm. Bengali/d 112 Min. Farbe. 35 mm. E/d/f RITWIK GHATAK ROBERT ALTMANN 21:00 LANDKINO IM SPUTNIK PAUL THOMAS ANDERSON 20:15 PAUL THOMAS ANDERSON MAGNOLIA S.14 USA 1999 THERE WILL BE BLOOD 188 Min. Farbe. 35 mm. E/d/f S.24 USA 2007 158 Min. Farbe. 35 mm. E/d PAUL THOMAS ANDERSON PAUL THOMAS ANDERSON SAMSTAG 14:45 PAUL THOMAS ANDERSON INHERENT VICE S.16 USA 2014 148 Min. Farbe. DCP. E/d/f PAUL THOMAS ANDERSON 17:30 PAUL THOMAS ANDERSON3 REBECCA S.17 USA 1940 130 Min. -
Ritwik Ghatak: Istenmeyen Bir Yönetmen*
---- BİYOGRAF İ ---- RİTWİK GHATAK: İSTENMEYEN BİR YÖNETMEN* Shaji Chennai Çeviri: İlker Mutlu Bugün yönetmenlerin yönetmeni kabul edilen Rus yönetmen Andrei Tarkovsky’ye birkaç izleyici tarafından filmleri için giriş biletlerinin yanında baş ağrısı hapı verilmesi önerildi! Jean Renoir’nın Oyunun Kuralı filmini izlemeye gelmiş olan seyircilerin bazıları sinema salonunu ateşe vermeye varacak derecede tahrik olmuşlardı. Eleştirmenler bugün bu filmi dünyada şimdiye kadar yapılan en iyi on film arasında saymaktalar. Tarihi bir meseledir ki Fransız dahi yönetmen François Truffaut, Satyajit Ray’in Pather Panchali’si için dayanılması çok zor yorumunu yapmıştır! Ünlü Bengalli şair ve film yönetmeni Buddhadeb Dasgupta, bir zamanlar şöyle demişti: Bazı filmlerin film makaraları ardına saklanan fantezi ve realitesinin bize ulaşması biraz zaman alabilir. Bazı zamanlar, belli filmler izleyiciden nispeten daha fazla ilgiye, dikkate gereksinim duyabilirler. İzleyiciler onları seyretmek için sabra ve zihniyete sahip değilseler böyle filmleri kolayca reddedebilirler. * Chennai, Shaji. (2011) "Ritwik Ghatak – An Unwanted Film Maker " (link) SEKANS Sinema Kültürü Dergisi Ekim 2016 | Sayı e3 : 105-111 Bu gerçekten de böyle olagelmiştir. Bugün büyük sanatsal yaratılar olarak kabul edilen pek çok film, gösterildikleri dönemde yıkıcı finansal felaketlere sebep oldular. Bu, duyguları zihnimizin derinliklerine yavaşça sokan duyarlı sanat filmlerinin kaderidir çoğunlukla. Aynı makalesinde, Dasgupta özellikle bir noktayı vurgular. Bir filmin kültürel arka planı, -

El Ciclo Se Iniciará El 11 De Febrero Con La Presentación De La Publicación Editada En Torno a Este Programa, Con La Presenci
La Casa Encendida INDIA. Cine de autor, El ciclo se iniciará el 11 de febrero con la Ronda de Valencia, 2 El ciclo presentación de la publicación editada en 28012 Madrid documental independiente y videocreación T 902 430 322 (1899-2008) torno a este programa, con la presencia de www.lacasaencendida.com recupera, agrupa y saca a la luz Alberto Elena, Sonia Khurana y un buen número de trabajos cinematográficos, Horario del centro Juan Guardiola. Del 12 al 22 de febrero De lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h en la mayoría de los casos nunca exhibidos se proyectará cada día un programa diferente en nuestro país, que dan testimonio de las INDIA. Cine de autor, documental independiente en loop de las 12.00 a las 22.00 h en el y videocreación (1899-2008) experiencias audiovisuales de India a lo largo Torreón 1 de la Terraza. Todas las proyecciones se realizarán en loop. de los 100 años que han transcurrido desde Fechas: Del 11 al 22 de febrero de 2009 Hora: De 12.00 a 22.00 h el mismo origen del cine. La pujante y original Lugar: Torreón 1 de la Terraza escena del arte indio contemporáneo, y de su Precio: Actividad gratuita cine y vídeo en concreto, no es un caso aislado, INDIA. Cine de autor, sino que forma parte de una sólida y rica La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas documental independiente y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos y videocreación tradición artística que tiene sus raíces en su sus espectáculos. -

Film-Utsav Schedule
The Museum of Modern Art Department of Film 11 West 53 Street, New York, N.Y. 10019 Tel: 212-708-9400 Cable: MODERNART Telex: 62370 MODART FILM-UTSAV INDIA Part I: PROFILES; October 25 - December 15, 1985 Schedule Unless otherwise noted, all films will be screened in The Roy and Niuta Titus Theater 1 and wTl 1 be spoken in Hindi with English subtitled Friday, October 25 at 2:00 p.m.: Aag (Fire). 1948. Raj Kapoor. With Raj Kapoor, Nargis. 140 min. Friday, October 25 at 6:00 p.m.: Awara (The Vagabond). 1951. Raj Kapoor. With Raj Kapoor, Nargis, Prithviraj Kapoor. 170 min. TOTAPOOR WILL INTRODUCE THE FILM. Saturday, October 26 at 1:00 p.m.: Awara (The Vagabond). See Friday, October 25 at 6:00 p.m. Saturday, October 26 at 5:00 p.m.: Aag (Fire). See Friday, October 25 at 6:00 p.m. Sunday, October 27 at 1:00 p.m.: Shree 420 (Mr. 420). 1955. Raj Kapoor. With Raj Kapoor, Nargis, Nadira. 169 min. Sunday, October 27 at 5:00 p.m.: Boot Polish. 1954. Produced by Raj Kapoor, directed by Prakash Arora. With Baby Naaz, Ratan Kumar, and David. 140 min. Monday, October 28 at 2:30 p.m.: Boot Polish. See Sunday, October 27 at 5:00 p.m. Monday, October 28 at 6:00 p.m.: Shree 420 (Mr. 420). See Sunday, October 27 at 1:00 p.m. Saturday, November 2 at 1:00 p.m.: Barsaat (Monsoon). 1949. Raj Kapoor. With Raj Kapoor, Nargis, Premnath. 164 min. Saturday, November 2 at 5:00 p.m.: Satyam Shivam Sundaram (Love Sublime/Love Truth and Beauty). -

Indische Filme
Indische Filme Titel Jahr Regie Länge 102 Not Out 2018 Umesh Shukla 102 Min. 1942 - A Love Story 1994 Vidhu Vinod Chopra 159 Min. 1983 2014 Abrid Shine 138 Min. 2 States 2014 Abhishek Varman 149 Min. 3 Deewarein 2003 Nagesh Kukunoor 115 Min. 3 Idiots 2009 Rajkumar Hirani 165 Min. 36 Chowringhee Lane 1981 Vanraj Bhatia 122 Min. 7 Khoon Maaf 2011 Vishal Bhardwaj 148 Min. 99 2009 Raj Nidimoru 133 Min. A Wednesday 2008 Neeraj Pandey 104 Min. Aaja Nachle 2007 Anil Mehta 153 Min. Aakrosh 2010 Priyadarshan 146 Min. Aamir 2008 Raj Kumar Gupta 96 Min. Aar-Paar 1954 Guru Dutt 146 Min. Aarakshan 2011 Prakash Jha 158 Min. Aashayein 2010 Nagesh Kukunoor 125 Min. Aashiqui 2 2013 Mohit Suri 132 Min. ABCD 2 2015 Remo D'Souza 154 Min. Abhijan 1962 Satyajit Ray 145 Min. Abhimaan 1973 Hrishikesh Mukherjee 122 Min. Adaminte Makan Abu 2011 Salim Ahmed 105 Min. Ae Dil Hai Mushkil 2016 Karan Johar 157 Min. Afsana Pyar Ka 1991 Shahjahan 143 Min. Agantuk 1991 Satyajit Ray 120 Min. Agneepath 2012 Karan Malhotra 174 Min. Agneepath 1990 Mukul S. Anand 167 Min. Airlift 2016 Raja Menon 130 Min. Aisha 2010 Rajshree Ojha 126 Min. Aiyaary 2016 Neeraj Pandey 157 Min. Aiyyaa 2012 Sachin Kundalkar 146 Min. Ajaana Anjaani 2010 Siddharth Anand 152 Min. Akele Hum Akele Tum 1995 Mansoor Khan 154 Min. Akira 2016 A. R. Murugadoss 138 Min. Aligarh 2016 Hansal Mehta 120 Min. All Is Well 2015 Umesh Shukla 215 Min. Allah Ke Banday 2010 Faruk Kabir 132 Min. Amal 2007 Richie Mehta 101 Min. -

Issn 0972-3587 ---Stamps Of
ISSN 0972-3587 -------------- STAMPS OF INDIA COLLECTORS COMPANION --------------- The News, Views, & Features on Philately & Postal Services of India Issue # 322 – January 3, 2008. Published Every Thursday Edited by Madhukar and Savita Jhingan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I N T H I S I S S U E Stamp Poll 2007 Forthcoming Stamp Issues New Stamps Released New Postal Stationery New Stamp Booklet New Max Cards 1857 Through Indian Postage Stamps Recent & Forthcoming Events Readers Forum: R Howard Courtney ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ To SUBSCRIBE, please visit www.stampsofindia.com To UNSUBSCRIBE, click on the second link at the end of this message. BACK ISSUES http://www.stampsofindia.com/newssite/Download/archives.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JHINGANS JOTTINGS Hi We are in Chennai from January 1 to 7, 2008 to cover INPEX 08. Mr Krishnan informs that the January 2008 update for PhilSensex will be ready for publication in the forthcoming issue as he would like incorporate and analyze the data collected during INPEX 08. Until next week, please enjoy the rest of the newsletter. - M&SJ Our thanks to the Contributors and Sources to this issue: Anil Reddy We invite your inputs, please email to [email protected] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ If you've found this newsletter useful, recommend it to a friend. Better still, forward a copy of this issue. Also, please mention this newsletter when contacting other philatelists. Report the philatelic activities in your area for publication here. We shall reimburse the costs incurred on images, philatelic items issued, publications, courier and other agreed charges. Please send your queries in detail (images welcome) on all matters related to Philately and Postal History of India and Indian States. -
Arsenal Institut Für Film Und Videokunst E.V
januar februar märz april mai juni juli august september oktober november 16 dezember arsenal institut für film und videokunst e.V. 2 november 16 inhalt editorial november 16 3 Zukunft der Erinnerung > 24 FilmDokument > 25 In memoriam Peter Liechti: DEDICATIONS > 25 AFRIKAMERA 2016: African Queers – African Movies – African Cultures > 4 FU-Vorlesungsreihe: Die Filmwissenschaft, das Archiv und die Differenz > 22 Berliner Premiere: AUS WESTLICHEN RICHTUNGEN > 26 Ritwik Ghatak > 8 Großes Kino, kleines Kino #7: Filmkomödien > 26 DAAD-Stipendiatin Filmspotting. Erkundungen Mira Fornay zu Gast > 23 im Filmarchiv der Deutschen Kinemathek > 27 Filme von Clemens Klopfenstein > 12 Die DEFA-Stiftung präsentiert > 24 Klassiker nicht nur für Kinder > 27 CINEMA FUTURES > 28 Magical History Tour The Wild Ones > 16 2 november 16 inhalt editorial november 16 3 Positionen des aktuellen afrikanischen Films, eine Werk- schau des indischen Regisseurs Ritwik Ghatak, der in sei- nen Filmen wie kaum ein anderer Regisseur seiner Zeit Revolution und Melodram, Politik und Musik zusammen- führte, sowie eine Auswahl der Arbeiten des veritablen Universal-Filmemachers, künstlerischen Freigeists und ironischen Reisenden durch Raum und Zeit Clemens Klopfenstein, bilden die drei höchst unterschiedlichen Pro- Berlin-Premiere: TWO DAYS AT THE FALLS > 28 gramm-Schwerpunkte des Novembers im Arsenal. Was auf den ersten Blick als Monat der Fliehkräfte erscheint, spie- gelt doch die Rotationsachse Arsenal: unsere kontinuierli- Dikhen hach Dschiwa – Seht, wie wir leben > 29 che Auseinandersetzung mit dem afrikanischen Kino past and present, mit dem politischen Filmschaffen und last but certainly not least, mit Clemens Klopfenstein, der seit Ende der 70er Jahre und der Aufführung seiner halluzinatori- schen Odyssee GESCHICHTE DER NACHT (1978) im Forum der Berlinale ein regelmäßiger und überaus gerngesehe- ner Gast beim Forum und im Arsenal ist, wo wir ihn vom 24.