00061126 Prodoc Faguibine Norvège Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport Annuel 2016 Etat D'execution Des Activites
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE REPUBLIQUE DU MALI L’ASSAINISSEMENT ET DU ****************** DEVELOPPEMENT DURABLE ************* Un Peuple –Un But – Une Foi AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (AEDD) ************* PROGRAMME D’APPUI A L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES COMMUNES LES PLUS VULNERABLES DES REGIONS DE MOPTI ET DE TOMBOUCTOU (PACV-MT) RAPPORT ANNUEL 2016 PACV-MT ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES Octobre 2016 ACRONYMES AEDD : Agence de l’Environnement et du Développement Durable AFB : Fonds d’Adaptation CCOCSAD : Comité Communale d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement CLOCSAD : Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement CROCSAGD : Comité Régionale d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Gouvernance et de Développement CEPA : Champs Ecoles Paysans Agroforestiers CEP : Champs Ecoles Paysans CNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique DAO : Dossier d’Appel d’Offres DCM : Direction de la Coopération Multilatérale DGMP : Direction Générale des Marchés Publics MINUSMA : Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali OMVF : Office pour le Mise en Valeur du système Faguibine PAM : Programme Alimentaire Mondial PDESC : Plan de développement Economique, Social et Culturel PTBA : Plan de Travail et de Budget Annuel PACV-MT : Programme d‘Appui à l‘Adaptation aux Changements Climatiques dans les Communes les plus Vulnérables des Régions de Mopti et de Tombouctou PK : Protocole de Kyoto PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement TDR : Termes de références UGP : Unité de Gestion du Programme RAPPORT ANNUEL 2016 DU PACV-MT Page 2 sur 47 TABLE DES MATIERES ACRONYMES ............................................................................................................... -

Rapport De Mission Evaluation Rapide Dans Les Cercles De Goundam, Niafunke Et Tombouctou, Region De Tombouctou
RAPPORT DE MISSION EVALUATION RAPIDE DANS LES CERCLES DE GOUNDAM, NIAFUNKE ET TOMBOUCTOU, REGION DE TOMBOUCTOU TABLES BANCS DEBARRASSES DE LEURS BOIS PAR LES GROUPES ARMES ECOLES DES COMMUNES DE TOMBOUCTOU, ALAFIA, GOUNDAM, TONKA, NIAFUNKE ET SARAFERE REGION DE TOMBOUCTOU MAI 2013 Informations complémentaires : Mamoudou Abdoulaye DIALLO, IMADEL : 66 78 73 85 Codé CISSE, INTERSOS : 66 75 51 15 Rapport de mission INTERSOS/IMADEL dans les écoles des cercles de Tombouctou, Goundam et Niafunké Page 1 Introduction Du 22 au 30 Avril 2013, une équipe des ONG IMADEL et INTERSOS au Mali, ont effectué une mission d’évaluation multisectorielle rapide dans les écoles et ménages des personnes déplacées des cercles de Goundam, Niafunké et Tombouctou. L’évaluation a été menée dans deux communes de chaque cercle. La mission avait pour objectifs d’avoir une idée globale des besoins et des problèmes humanitaires, spécialement dans le domaine de l’éducation, afin d’informer les décideurs pour une prise des décisions stratégiques. I. Contexte La rébellion touareg ayant abouti à l’enlisement de toutes les régions nord du pays et entrainé une crise humanitaire sans précédent au Mali, a provoqué un déplacement massif des populations de toutes les régions du nord et le retrait de tous les enseignants, les services techniques de l’Etat et les partenaires au développement. Les cercles de Goundam, Niafunké et Tombouctou ont été durement frappés par ce phénomène. Le déclenchement des hostilités au mois de janvier 2013 a davantage accentué le déplacement des populations avec leurs enfants (élèves) qui ont continué à quitter la zone du nord et du nord ouest. -

FORESIGHT SCIENCE DIVISION1 Brief FORESIGHT August 2017 Brief 001 Early Warning, Emerging Issues and Futures Saving Lake Faguibine Background
FORESIGHT SCIENCE DIVISION1 Brief FORESIGHT August 2017 Brief 001 Early Warning, Emerging Issues and Futures Saving Lake Faguibine Background The UN Environment Foresight Briefs are published by UN Environment to, among others, highlight a hotspot of environmental change; feature an emerging science topic; or discuss a contemporary environmental issue. The public is thus provided with the opportunity to find out what is happening to their changing environment and the consequences of everyday choices; and to think about future directions for policy. Introduction 1994 -1978 1987 2001 2016 The Faguibine system, located in the Tombouktou region Dark color is wetland. One can see significant difference in extent of water in the lake between 1990 and 2010. After rehabilitation efforts initiated in 2009, there seems to be no recovery as can be seen in the 2016 image. in Mali is a series of five interlinked lakes (Télé, Takara, Gouber, Kamango and Faguibine) (Figure 1). The system is fed from the overflows of the Niger river during the Figure 1: The Faguibine system of 280 metres and drains Why is this issue important rains; and when full, it was among the largest lakes in a watershed of 8,200 km2 2 West Africa, covering approximately 590 km with a total Lake Kamango The decline of the Faguibine is an important issue shore line of 213 kilometers (Lakepedia 2017). Tin Aïcha because of its impacts on livelihood’s, food security Lake Faguibine Lake Gouber and the resulting collapse of the natural ecosystem. In Ras El Ma Bintagoungou Lake Takara The annual flooding was key to renewing the fertility of Mbouna 2009, 43.6 per cent of the Malian population was living the area and supported fishing, pasture and over 60,000 below the national poverty line (World Bank 2017). -

FEWS Country Report MALI
Report Number 8 Jaiuary 1987 FEWS Country Report MALI Africa Bureau U.S. Agency for International Development M&P 1: MALI Summary Map Bourem Cercle At--Rixk: 60,000 Immediate Food Aid Need: 2,700 wr Monake Cercle At-Risk: 18,000 Immediate Food Aid Need: 800 Ir Douentza Cercle At-Risk: 162,000 (131,000) Nara Cercl.eI At-Risk: 140,0005 Immnediate FFood Aid 2,700 1T Need: Youverou Cercier At-Risk 9(,OOA At-Ri-k: 94.000 5 YouvertuCerc l S Bandiagara Cercie At-Risk: 141,000 At-Risk- 180,000 N Immediate food aid need computed at 42kg per person for 3 month period. FEWS/PWA, January 1957 Famine Early Warning System Country Report MALI At-Risk Update: Focus on Gao Prepared for the Africa Bureau of the U.S. Agency for International Development Prepared by Price, Williams & Associates, Inc. January 1987 Contents Page i Introduction 1 Summary 2 Population At-Risk 6 Displaced Persons 6 Health and Nutrition 7 Market Prices 7 Food Aid List of Fipurc-s Pa ge 2 Map 2 Gao At-Risk 4 Map 3 Tombouctou At-Risk 5 Map 4 Mopti At-Risk Back Map 5 Administrative Units Cover a series of monthly reports issued INTRODUCTION This is the eighth of by the Famine Early Warning System (FEWS) on Mali, to current as of January 10, 1987. it is designed and provide decisionmakers with current infor-mation analysis on existi.ng and potential nutrition emergency in situations. Each situation identified is described of people terms of geographical extent and the number insofar as involved, or at-risk, and the proximate causes they have been discerned. -

Mali Livestock for Growth (L4g) Monthly Report No
MALI LIVESTOCK FOR GROWTH (L4G) MONTHLY REPORT NO. 52 MALI LIVESTOCK FOR GROWTH (L4G) MONTHLY REPORT NO. 52 Date: February 2019 Contract Number: AID-688-C-14-00004 Submitted to: USAID | Mali Prepared by: AECOM International Development DISCLAIMER: The authors’ views expressed in this document do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. Monthly Report No. 52 | Mali Livestock for Growth (L4G) i TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS.................................................................................................................................................. 2 LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS........................................................................................................ 3 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................ 4 COMPONENT 1: INCREASED livestock PRODUCTIVITY.................................................................................. 4 SUB IR 1.1. ENHANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT, DISSEMINATION, AND MANAGEMENT ................................................................................................................................................ 4 SUB-IR 1.2 INCREASE ACCESS TO QUALITY INPUTS AND SERVICES ......................................... 6 SUB-IR 1.3 IMPROVED PASTURELAND AND WATER RESOURCES MANAGEMENT.............. 7 SUB-IR 1.4 IMPROVED COMMUNITY LITERACY, NUMERACY AND -

Plan De Securite Alimentaire Commune Rurale De Bintagoungou
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) ----------------------- Projet de Mobilisation des Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali (PROMISAM) REGION DE TOMBOUCTOU Cercle de Goundam Commune rurale de Bintagoungou PLAN DE SECURITE ALIMENTAIRE COMMUNE RURALE DE BINTAGOUNGOU 2006 - 2009 Elaboré avec l’appui technique et financier de l’USAID-Mali à travers le projet d’appui au CSA, le PROMISAM Juin 2006 1 I CONTEXE ET JUSTIFICATION La commune rurale de Bintagoungou fait partie de ce lot de communes qui se trouvant placées sur le long du lac Faguibine connaissent aujourd’hui de sérieux problèmes imputables surtout à l’assèchement du lac Faguibine qui n’est pas alimenté depuis 1973 mettant en cause toute activité agricole, situation qui a engendré le départ de la majeure partie des bras valides. Cette commune fait aussi partie de ces communes dont les populations connaissent une instabilité pendant de longues périodes de l’année : d’abord très enclavée, avec un terrain très difficile à pratiquer, et surtout la mobilité des jeunes qui sont presque à 90% à l’exode à la recherche de la survie. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la commune présentement le sont grâce à l’assistance quotidienne de ceux qui sont à l’exode. Dans la commune il n’y a pas de sources de revenu. Il n’existe pas d’activités à mener pour se faire de l’argent. Dans des conditions de ce genre, il va de soit que la mobilisation de ressources nécessaires (humaines, financières et matérielles) sans lesquelles le développement est impossible, pose des problèmes. -
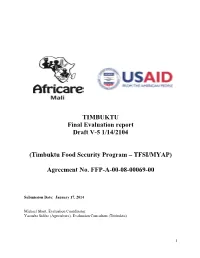
Timbuktu Food Security Program – TFSI/MYAP)
TIMBUKTU Final Evaluation report Draft V-5 1/14/2104 (Timbuktu Food Security Program – TFSI/MYAP) Agreement No. FFP-A-00-08-00069-00 Submission Date: January 17, 2014 Michael Short, Evaluation Coordinator Yacouba Sidibe (Agriculture), Evaluation Consultant (Timbuktu) 1 Executive Summary This report presents an assessment of the residual beneficial impacts of Africare/Mali’s Timbuktu Food Security Initiative Multi-Year Activity Program (TFSI/MYAP) that was conducted 20 months after the forced evacuation of project staff from the Timbuktu Region and the suspension of all program activities during Implementation Year (IY4) of this five-year program. Due to extraordinary conditions of insecurity at the end of the project period (IY4), a more complete final evaluation that would have included a random survey and targeted interview could not be completed. This report is based on a limited series of individual and group interviews with local Government of Mali (GoM) officials, community-based volunteers, producer organizations, and beneficiary groups in the Naifunké and Goundam Cercles in November 2013. The interviews were conducted over a five-day period (November 2-8, 2013) by an independent expert, Mr. Yacouba Sidibe, based on a USAID-approved Terms of Reference (included as Annex 5.1) and using standardized interview formats developed by a three person evaluation team working in collaboration with senior Africare/Mali program staff previously assigned to the TFSI/MYAP program. (Sample interview forms included as Annex 5.6) The programmatic -

Report of the Independent Expert on the Situation of Human Rights in Mali
United Nations A/HRC/31/76 General Assembly Distr.: General 21 January 2016 English Original: French Human Rights Council Thirty-first session Agenda item 10 Technical assistance and capacity-building Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali Note by the Secretariat The Secretariat has the honour to transmit to the Human Rights Council the report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali, Suliman Baldo, which covers the period from 1 May to 29 December 2015. The report is based on the information made available to the Independent Expert during his fifth visit to Mali, from 10 to 19 October 2015, by the Government of Ma li, the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali and other sources, including civil society organizations. GE.16-00837 (E) 120216 150216 *1600837* A/HRC/31/76 Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Mali Contents Page I. Introduction .................................................................. 3 II. General situation in the country .................................................. 3 A. The political situation ...................................................... 3 B. The security situation ...................................................... 4 C. The ongoing challenge of the fight against impunity .............................. 6 III. The human rights situation ...................................................... 8 A. Civil and political rights ................................................... -

Et Les Hommes Autour Du Lac Télé
L eau, la terre et les hommes autour du lac Télé Région de Tombouctou, Mali Cissouma Diama Togola Géographe Le lac Télé fait partie de cet ensemble de lacs situés tout à fait au Nord et en rive gauche du delta intérieur du Niger. C'est une région humide aux confins du Sahara, qui a connu une histoire troublée entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires, entre agriculteurs et pêcheurs, et entre les différents groupes d'éleveurs, tous se disputant la gestion des ressources naturelles que sont l'eau et les pâturages. Cette situation s'est aggravée depuis les grandes sécheresses que la région a connue en 1968 et 1972, et qui a vue l'eau du lac et les pâturages s'assécher. A cela s'ajoutent d'autres facteurs comme l'introduction des cultures de contre-saison, qui pose l'épineux problème du partage de l'espace entre les agriculteurs. Avant la sécheresse, la production était suffisante pour les besoins locaux : dès la récolte, les champs et les pâturages du lac étaient abandonnés aux éleveurs. Avec la sécheresse, la production a baissé, ce qui a fait naître chez les agriculteurs le besoin de rechercher d'autres sources de revenus ; les terres jadis abandonnées aux éleveurs sont maintenant cultivées et les recettes issues de la vente des produits de contre-saison servent à acheter les compléments de céréales nécessaires à la consommation familiale. L'assèchement des pâturages fait aussi que les éleveurs descendent plus tôt que d'habitude dans le lac. Les conflits entraînent des recours en justice qui, malheureusement, se font presque toujours 62 T Gestion intégrée des zones inondables tropicales au détriment des agriculteurs. -

No. ICC-01/12-01/18 1/19 20 March 2019 Redaction of Official Court Translation ICC-01/12-01/18-289-Red-Teng 13-06-2019 2/19 RH PT
ICC-01/12-01/18-289-Red-tENG 13-06-2019 1/19 RH PT Original: French No.: ICC-01/12-01/18 Date: 20 March 2019 PRE-TRIAL CHAMBER I Before: Judge Péter Kovács, Single Judge SITUATION IN THE REPUBLIC OF MALI IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. AL HASSAN AG ABDOUL AZIZ AG MOHAMED AG MAHMOUD PUBLIC REDACTED VERSION Decision on Principles Applicable to Victims’ Applications for Participation, to Legal Representation of Victims, and to the Manner of Victim Participation in the Proceedings No. ICC-01/12-01/18 1/19 20 March 2019 Redaction of Official Court Translation ICC-01/12-01/18-289-Red-tENG 13-06-2019 2/19 RH PT Decision to be notified in accordance with regulation 31 of the Regulations of the Court to: Office of the Prosecutor Counsel for the Defence Ms Fatou Bensouda Mr Yasser Hassan Mr James Stewart Legal Representatives of Victims Legal Representatives of Applicants Unrepresented Victims Unrepresented Applicants for Participation/Reparations States’ Representatives Office of Public Counsel for the Defence REGISTRY Registrar Counsel Support Section Mr Peter Lewis Victims and Witnesses Section Detention Section Mr Nigel Verrill Victims Participation and Reparations Other Section Mr Philipp Ambach No. ICC-01/12-01/18 2/19 20 March 2019 Redaction of Official Court Translation ICC-01/12-01/18-289-Red-tENG 13-06-2019 3/19 RH PT Judge Péter Kovács, who was designated on 28 March 2018 by Pre-Trial Chamber I (“Chamber”) of the International Criminal Court (“Court”) as the Single Judge responsible for carrying out the functions of the Chamber in the case of The Prosecutor v. -

Mali Livestock for Growth (L4g) Quarterly Report Fy2018 Quarter 3
MALI LIVESTOCK FOR GROWTH (L4G) QUARTERLY REPORT FY2018 QUARTER 3 MALI LIVESTOCK FOR GROWTH (L4G) QUARTERLY REPORT FY2018 QUARTER 3 Contract Number: AID-688-C-14-00004 Submitted to: USAID | Mali Prepared by: AECOM International Development DISCLAIMER: The authors’ views expressed in this document do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. Quarterly Report FY2018 Quarter 3 / Mali Livestock for Growth (L4G) i TABLE OF CONTENTS List of Acronyms and Abbreviations .......................................................................................... iii Introduction ................................................................................................................................... 1 Executive Summary ...................................................................................................................... 1 Component 1. Increased Livestock Production ......................................................................... 2 1.1 Enhanced Technology Innovation, Dissemination, and Management ................................................... 2 1.3 Improved Pastureland and Water Resources Management .................................................................. 12 Component II. Increased Domestic and Export Trade ........................................................... 16 2.1 Strengthened Market Linkages and Access .............................................................................................. 16 2.2 Decreased -

Stratégies D'adaptation À La Variabilité Climatique Des Exploitations
Stratégies d’adaptation à la variabilité climatique des exploitations agricoles de la zone du Système Faguibine au Mali Strategies for Adapting Farms to Climate Variability in the Faguibine System Area in Mali Sissoko Penda1*, Diaby Mohamed1, Gry Synnevåg2, Kouriba Aly3 1Institut d’Économie Rurale, Centre Régional de Recherche Agronomique de Sotuba - BP 262, Bamako, Mali. 2 Université des Sciences de la vie, Ås, Norvège. 3Institut d’Économie Rurale - BP 258, Bamako, Mali. *Auteur pour la correspondance : [email protected] Résumé Le Système Faguibine est un ensemble de cinq lacs interconnectés par des chenaux naturels desservant la zone où l’agriculture de décrue constitue une pratique séculaire en fonction du retrait de la crue. Les récents cycles de sécheresses ont profondément affecté son fonctionnement et provoqué une baisse importante de son hydraulicité qui ne permet plus une inondation convenable des lacs. Pour apprécier la perception paysanne sur la variabilité climatique et les différentes stratégies mises en œuvre pour y faire face, une enquête a été conduite dans cinq communes du cercle de Goundam sur 326 exploitations de juin à octobre 2011. Les focus groupes discussions au niveau des villages, les interviews semi-structurées (ISS) au niveau des exploitations agricoles familiales et les interviews des personnes ressources et des structures techniques de la zone ont été utilisés pour collecter les informations. Les résultats ont montré que la variabilité climatique est perçue par les communautés de la zone du système Faguibine à travers l’insuffisance et l’irrégularité des pluies et de la crue dans les lacs, et la dégradation de l’environnement (sécheresse, désertification).