Thèse Coccidiose Du Poulet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Libros Sobre Enfermedades Autoinmunes: Tratamientos, Tipos Y Diagnósticos- Profesor Dr
- LIBROS SOBRE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: TRATAMIENTOS, TIPOS Y DIAGNÓSTICOS- PROFESOR DR. ENRIQUE BARMAIMON- 9 TOMOS- AÑO 2020.1- TOMO VI- - LIBROS SOBRE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: TRATAMIENTOS, TIPOS Y DIAGNÓSTICOS . AUTOR: PROFESOR DR. ENRIQUE BARMAIMON.- - Doctor en Medicina.- - Cátedras de: - Anestesiología - Cuidados Intensivos - Neuroanatomía - Neurofisiología - Psicofisiología - Neuropsicología. - 9 TOMOS - - TOMO VI - -AÑO 2020- 1ª Edición Virtual: (.2020. 1)- - MONTEVIDEO, URUGUAY. 1 - LIBROS SOBRE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: TRATAMIENTOS, TIPOS Y DIAGNÓSTICOS- PROFESOR DR. ENRIQUE BARMAIMON- 9 TOMOS- AÑO 2020.1- TOMO VI- - Queda terminantemente prohibido reproducir este libro en forma escrita y virtual, total o parcialmente, por cualquier medio, sin la autorización previa del autor. -Derechos reservados. 1ª Edición. Año 2020. Impresión [email protected]. - email: [email protected].; y [email protected]; -Montevideo, 15 de enero de 2020. - BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD del S. M.U. del URUGUAY; y BIBLIOTECA DEL COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY. 0 0 0 0 0 0 0 0. 2 - LIBROS SOBRE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: TRATAMIENTOS, TIPOS Y DIAGNÓSTICOS- PROFESOR DR. ENRIQUE BARMAIMON- 9 TOMOS- AÑO 2020.1- TOMO VI- - TOMO V I - 3 - LIBROS SOBRE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: TRATAMIENTOS, TIPOS Y DIAGNÓSTICOS- PROFESOR DR. ENRIQUE BARMAIMON- 9 TOMOS- AÑO 2020.1- TOMO VI- - ÍNDICE.- - TOMO I . - - ÍNDICE. - PRÓLOGO.- - INTRODUCCIÓN. - CAPÍTULO I: -1)- GENERALIDADES. -1.1)- DEFINICIÓN. -1.2)- CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO. -1.2.1)- FACTORES EMOCIONALES. -1.2.2)- FACTORES AMBIENTALES. -1.2.3)- FACTORES GENÉTICOS. -1.3)- Enterarse aquí, como las 10 Tipos de semillas pueden mejorar la salud. - 1.4)- TIPOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES. -1.4.1)- Remedios Naturales. -1.4.1.1)- Mejorar la Dieta. -

Molecular Detection of Eimeria Stiedae in an Angora Rabbit
Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 2015; 26 (2): 41-44 Case Report / Olgu Sunumu Molecular detection of Eimeria stiedae in an Angora rabbit Armağan Erdem ÜTÜK1, Fatma Çiğdem PİŞKİN2, İbrahim BALKAYA3, Mehmet Çağrı KARAKURUM4 1 Çukurova University, Faculty of Ceyhan Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Adana, Turkey 2 Veterinary Control Central Research Institute, Parasitology and Bee Diseases Laboratory, Ankara, Turkey 3 Ataturk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Erzurum, Turkey 4 Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Burdur, Turkey Geliş Tarihi / Received: 04.09.2015, Kabul Tarihi / Accepted: 16.10.2015 Abstract: Hepatic coccidiosis caused by Eimeria stiedae, results in severe infection, outbreaks and deaths in young rabbits. Disease is diagnosed by time consuming methods like fecal examination, oocyst sporulation and necropsy. The aim of this study was to detect E.stiedae with species specific Polymerase Chain Reaction (PCR), without waiting oocyst sporulation and necropsy. Impression smears were prepared from liver nodules and stained with giemsa. Fecal samples were collected from the intestines and examined by centrifugal flotation with salt solution to detectEimeria spp. oocysts. Then oocysts were sporulated in 2.5% (w/v) aqueous potassium dichromate (K2Cr207). Primers specific to E.stiedae were used in PCR reaction. Eimeria spp. oocysts were detected after the examination of impression smears and bowel content. E.stiedae was diagnosed after the measurement of sporulated oocyst and PCR. At the end of the study, we think that; PCR will be very valuable for the rapid and true diagnosis of hepatic coccidiosis in rabbits. Key words: Angora rabbit, Eimeria stiedae, Molecular detection, Turkey. -

Some Protozoa Found in the Faeces of Cattle
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Northern Iowa Proceedings of the Iowa Academy of Science Volume 34 Annual Issue Article 117 1927 Some Protozoa Found in the Faeces of Cattle Elery R. Becker Iowa State College W. W. Frye Iowa State College Copyright ©1927 Iowa Academy of Science, Inc. Follow this and additional works at: https://scholarworks.uni.edu/pias Recommended Citation Becker, Elery R. and Frye, W. W. (1927) "Some Protozoa Found in the Faeces of Cattle," Proceedings of the Iowa Academy of Science, 34(1), 331-333. Available at: https://scholarworks.uni.edu/pias/vol34/iss1/117 This Research is brought to you for free and open access by the Iowa Academy of Science at UNI ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Proceedings of the Iowa Academy of Science by an authorized editor of UNI ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. Becker and Frye: Some Protozoa Found in the Faeces of Cattle SOME PROTOZOA FOUND IN THE FAECES OF CATTLE ELERY R. BECKER AND w. w. FRYE A microscopic investigation of the faeces of cattle was under taken in search of possible cyst forms of the numerous species of ciliates which inhabit the rumen and reticulum of these animals. Of the various workers who have searched for the cysts of these protozoa only one, Liebetanz ( 1910), reports success. His tech nique, however, was so open to adverse criticism, and his figures so unconvincing, that it is doubtful if even he really saw cystic forms. -
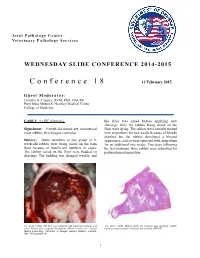
WSC 14-15 Conf 18 Layout
Joint Pathology Center Veterinary Pathology Services WEDNESDAY SLIDE CONFERENCE 2014-2015 Conference 18 11 February 2015 Guest Moderator: Timothy K. Cooper, DVM, PhD, DACVP Penn State Milton S. Hershey Medical Center College of Medicine CASE I: A (JPC 4048645). the floor was limed before applying new shavings. Only the rabbits being raised on the Signalment: 9-week-old mixed sex commercial floor were dying. The rabbits were initially treated meat rabbits, Oryctolagus cuniculus. with amprolium for two weeks because of bloody diarrhea but the rabbits developed a bloated History: Some members of this group of 9- appearance, and so were retreated with amprolium week-old rabbits were being raised on the barn for an additional two weeks. Two days following floor because of insufficient numbers of cages. the last treatment, three rabbits were submitted for The rabbits raised on the floor were bedded on postmortem examination. shavings. The bedding was changed weekly, and 1-1. Liver, rabbit: The liver was enlarged with numerous tortuous and 1-2. Liver, rabbit: Biliary ducts are tortuous and markedly ectatic, cystic biliary duct scattered throughout. (Photo courtesy of: Animal replacing large amounts of hepatic parenchyma. (HE 6X) Health Laboratory, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada. http://ahl.uoguelph.ca) 1 WSC 2014-2015 large numbers of a mixture of Eimeria spp. oocysts. Histopathologic Description: Liver: There is generalized marked dilation of bile d u c t s c a u s i n g compression of the surrounding hepatic p a r e n c h y m a . Hyperplastic biliary epithelium forms papillary projections into duct lumens. -
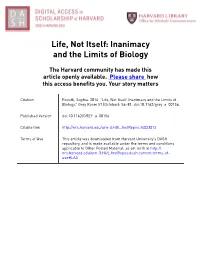
Life, Not Itself: Inanimacy and the Limits of Biology
Life, Not Itself: Inanimacy and the Limits of Biology The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Roosth, Sophia. 2014. “Life, Not Itself: Inanimacy and the Limits of Biology.” Grey Room 57 (October): 56–81. doi:10.1162/grey_a_00156. Published Version doi:10.1162/GREY_a_00156 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:14023015 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Ernst Haeckel. Bathybius haeckelii . Plate 17 from “ Beitrage zur Plastidentheorie,” Jenaische Zeitschrift für Medizin und Naturwissenschaft , vol. 5, 1870. 56 doi:10.1162/GREY_a_00156 Life, Not Itself: Inanimacy and the Limits of Biology SOPHIA ROOSTH Origins: Mud and Slime Something that for three months had looked like a rock got up and moved about a foot, then settled down again and looked like a rock for three more months. Another rocklike thing sprouted an arm and waved it about for twelve hours, then remained motionless for the rest of the six months. Life proceeds without haste in the deep. So the New York Times reported on time-lapse photographers seeking valuable minerals on the Pacific seafloor in 1977. 1 How quickly must life proceed to count as life? What defines life when the animating processes that mark the living slow into imperceptibility, as life deanimates, slackening or pausing from the temporalities of biological phenomena into epochs geological? Such an uncanny discovery, made possible by the temporal disruptions of stop-motion photography, tests the limits of the organic and the inorganic, the living and the lifeless, in the silty beds of a salty sea. -

Redalyc.Studies on Coccidian Oocysts (Apicomplexa: Eucoccidiorida)
Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária ISSN: 0103-846X [email protected] Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária Brasil Pereira Berto, Bruno; McIntosh, Douglas; Gomes Lopes, Carlos Wilson Studies on coccidian oocysts (Apicomplexa: Eucoccidiorida) Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, vol. 23, núm. 1, enero-marzo, 2014, pp. 1- 15 Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária Jaboticabal, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=397841491001 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Review Article Braz. J. Vet. Parasitol., Jaboticabal, v. 23, n. 1, p. 1-15, Jan-Mar 2014 ISSN 0103-846X (Print) / ISSN 1984-2961 (Electronic) Studies on coccidian oocysts (Apicomplexa: Eucoccidiorida) Estudos sobre oocistos de coccídios (Apicomplexa: Eucoccidiorida) Bruno Pereira Berto1*; Douglas McIntosh2; Carlos Wilson Gomes Lopes2 1Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, Seropédica, RJ, Brasil 2Departamento de Parasitologia Animal, Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, Seropédica, RJ, Brasil Received January 27, 2014 Accepted March 10, 2014 Abstract The oocysts of the coccidia are robust structures, frequently isolated from the feces or urine of their hosts, which provide resistance to mechanical damage and allow the parasites to survive and remain infective for prolonged periods. The diagnosis of coccidiosis, species description and systematics, are all dependent upon characterization of the oocyst. Therefore, this review aimed to the provide a critical overview of the methodologies, advantages and limitations of the currently available morphological, morphometrical and molecular biology based approaches that may be utilized for characterization of these important structures. -

Biology • Environment • Chemistry MEMORABLE TEACHING MADE EASY!
3bscientific.com Biology • Environment • ChemistryBiology • Environment NATURAL SCIENCES NATURAL 3B SCIENTIFIC® NATURAL SCIENCES 3bscientific.com 9000953 EN MEMORABLE TEACHING MADE EASY! Dear customer, Discover the variety of possibilities for making your teaching even more memorable and exciting. We have assembled a wide range of products and experiments for you for teaching various course content in biology. We can offer you detailed models, high-quality preparations and realis- tic replicas that illustrate the structures of plants, animals, humans and the earth as well as numerous experiment sets to aid independent study, practicing and learning. From page 104 onwards, you can browse through the selection of products relating to the earth sciences, ecology and chemistry. These include models of the structure of the earth, rock collections, measuring equipment for water and soil analysis, molecule construction kits and chemical measuring instruments. New and worthy of particular mention are the powerful and comprehensive Coach 7 measuring and analysis software, the VinciLab data logger and the €lab lab interface, as well as the numerous sensors for the measurement of biological and chemical para- meters (page 152 onwards). Representing a further innovation in our range are the devices for neurophysiological studies on intact earthworms. You can find these on page 94 onwards. Let yourself be inspired by our wide range. It’s well worth a look! Our competent team will be happy to advise you personally and is looking forward to receiving your suggestions and orders! We look forward to hearing from you! The 3B Scientific team ›NEW IN ZOOLOGY Limbs of various mammals The dissected real limbs enable scientific comparison of the anatomy of the front or rear legs of selected mammals and allow conclusions to be drawn about their walking and running behavior. -

Veterinary Parasitology
Andrei Daniel MIHALCA Textbook of Veterinary Parasitology Introduction to parasitology. Protozoology. AcademicPres Andrei D. MIHALCA TEXTBOOK OF VETERINARY PARASITOLOGY Introduction to parasitology Protozoology AcademicPres Cluj-Napoca, 2013 © Copyright 2013 Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nici o formă, prin nici un mijloc mecanic sau electronic, sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Mihalca Andrei Daniel Textbook of Veterinary Parasitology: Introduction to parasitology; Protozoology / Andrei Daniel Mihalca. Cluj-Napoca: AcademicPres, 2013 Bibliogr. Index ISBN 978-973-744-312-0 339.138 Director editură – Prof. dr. Carmen SOCACIU Referenţi ştiinţifici: Prof. Dr. Vasile COZMA Conf. Dr. Călin GHERMAN Editura AcademicPres Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel. 0264-596384 Fax. 0264-593792 E-mail: [email protected] Table of contents 1 INTRODUCTION TO PARASITOLOGY ..................................................................................... 1 1.1 DEFINING PARASITOLOGY. DIVERSITY OF PARASITISM IN NATURE. ................................................. 1 1.2 PARASITISM AS AN INTERSPECIFIC INTERACTION ............................................................................... 2 1.3 AN ECOLOGICAL APPROACH TO PARASITOLOGY ................................................................................... 5 1.4 -

Histopathology of Protozoal Infection in Animals
Veterinaria Italiana, 2012, 48 (1), 99‐107 Histopathology of protozoal infection in animals: a retrospective study at the University of Philippines College of Veterinary Medicine (1972‐2010) Abigail M. Baticados & Waren N. Baticados Summary Istopatologia da infezione The authors describe the first parasitological survey of protozoal infections on tissue slide protozoaria negli animali: uno sections of field cases processed at the studio retrospettivo (1972‐2010) histopathology laboratory of the College of presso l’Università delle Veterinary Medicine (CVM) at the University of the Philippines Los Baños (UPLB). Over 80% Filippine nel College di of the field cases were from Region 4 Medicina Veterinaria (CALABARZON) and the rest were equally distributed from other areas of the Philippines, Riassunto namely: Region 2 (Cagayan Valley), Gli autori descrivono la prima indagine Metropolitan Manila (National Capital Region), parassitologica delle infezioni protozoarie su vetrino Region III (Central Luzon) and Region VI attraverso sezioni di tessuto, di casi trattati in (Western Visayas). Histopathological analyses campo, presso il laboratorio di istopatologia del of tissue sections from 51 archived cases (1972‐ Collegio di Medicina Veterinaria (CVM) attivo 2010) of parasitic aetiology were performed. nell’ Università delle Filippine a Los Baños (UPLB). Microscopic examination of a total of Oltre lʹ80% dei casi provenivano dalla Regione 4 286 histopathological slides revealed the (CALABARZON) e il resto dei casi proveniva presence of several protozoa, including equamente da altre zone delle Filippine, e precisa‐ sarcosporidiosis, hepatic coccidiosis, intestinal mente: dalla Regione 2 (Cagayan Valle), coccidiosis, balantidiosis and leucocyto‐ Metropolitan Manila (National Capital Region), zoonosis. In addition, the finding of Balantidium dalla Regione III (Central Luzon) e dalla Regione and Sarcocystis may have zoonotic implications VI (Western Visayas). -

HOMOTECIA Nº 4-15 Abril 2017
HOMOTECIA Nº 4 – Año 15 Lunes , 3 de Abril de 2017 1 Considerando que estamos aun viviendo en los años de inicio del Siglo XXI, nos encontramos con un significativo número de jóvenes que egresan como profesionales de la educación, profesión a la cual la sociedad venezolana actual exige al docente involucrado en esta labor, participar en un proceso de cambio. Pero un cambio que está más allá del momento coyuntural político que se vive a nivel nacional, que aunque afecta con grave intensidad al país, es transitorio. Un cambio contextualizado no en la popularizad a globalización, comidilla coloquial actual de los llamados intelectuales , sino a una mundialización cultural que, surgiendo por consenso natural total, afecta con mucha fuerza a todas las naciones del planeta. Pero se sucede estructurado organizacional y curricularmente en principios muy diferentes a los que tuvimos que enfrentar las generaciones docentes que ya pasamos. En aquel entonces, el mercado laboral que ofrecía el llamado Ministerio de Educación, presentaba programas de asignaturas ya BENJAMIN OLINDE RODRIGUES elaborados y sólo exigía al docente esforzarse en reproducir estos saberes, situación (1795 – 1851) que aparentemente ocurría de igual manera en una gran mayoría de países en el Nació el 6 de octubre de 1795 en Bordeaux , y murió el 17 de diciembre mundo la cual llevó a la UNESCO tomar cartas en el asunto y opinar como de 1851, a los 56 años, en París ; ambas localidades en Francia. conclusión a su estudio del caso , que la educación impartida así producía una Matemático conocido por su fórmula para los polinomios de Legendre. -
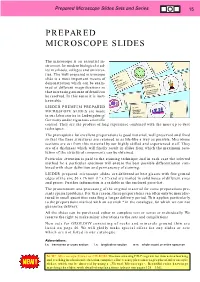
Prepared Microscope Slides in Sets
Prepared Microscope Slides Sets and Series 15 PREPARED MICROSCOPE SLIDES The microscope is an essential in- strument for modern biological stud- ies in schools, colleges and universi- ties. The well prepared microscope slide is a most important means of Nr. 519c Mais . Zea mays demonstration which can be exam- Nr. 610d Stengel, quer onokotyledonen- Honigbiene M m ellifica ined at different magnifications so stam Apis m kend-saugende, lec erkzeuge that increasing amount of detail can Mundw at be resolved. In this sense it is inex- Totalpräpar haustible. LIEDER PREMIUM PREPARED Nr. 626c Dünndarm MICROSCOPE SLIDES are made der Katze Felis domestica in our laboratories in Ludwigsburg/ Querschnitt Germany under rigourous scientific control. They are the product of long experience combined with the most up to date techniques. The prerequisite for excellent preparations is good material, well preserved and fixed so that the finer structures are retained in as life-like a way as possible. Microtome sections are cut from this material by our highly skilled and experienced staff. They are of a thickness which will finally result in slides from which the maximum reso- lution of the structural components can be obtained. Particular attention is paid to the staining technique and in each case the selected method for a particular specimen will ensure the best possible differentiation com- bined with clear definition and permanency of staining. LIEDER prepared microscope slides are delivered on best glasses with fine ground edges of the size 26 x 76 mm (1'’ x 3'’) and are mailed in solid boxes of different sizes and prices. -

Many Protozoa Undergo Encystment. the Cysts Have the Following Function
Encystment in protozoa :- Many protozoa undergo encystment. The cysts have the following function: 1 protection against unfavorable environment eg. Entamoeba histolytica. 2 Nuclear division which is followed by multiplication at the time of encystment eg. E. histolytica. 3 They may function in attachment eg. Ciliates of certain fish. 4 Serve as means of transmission from one end to another eg. E. histolytic and Giardia intestinalis. Factors contribute towards cyst formation :- Nutrient deficiency, desiccation, increase concentration of dissolved salts in the medium, H changes in temp, low P , decreased O2 supply, accumulation of waste products in the medium, crowding phenomenon etc. But the conditions for encystment are not uniform for all the protozoa . Enzymes : Microorganisms liberate enzymes that breakdown the tissue of the host into soluble material, which they can utilize. The enzyme are protease, amylase, lipase etc or oxidase, dehydrogenase etc. Differences between protozoa and protophyta : Protozoa Protophyta Posses a well defined nucleus. Nuclear material is scattered through out the cytoplasm as granules, which are somewhat difficult to detect. Bounded by a delicate non-rigid Bounded by a most rigid wall made of membrane called periplast. cellulose The way of nutrition is holozoic ie. they The way of nutrition is holophytic ie most require ready made food material. of them have green pigment chlorophyll carried is pigment cells called chromatophores Asexual reproduction is usually by binary Asexual reproduction by transverse binary fission is longitudinal axis (except B. fission coli.) Differences between bacteria and protozoa : Bacteria Protozoa Prokaryotic cells Eukaryotic cells. Have no distinct nucleus, disperse nuclear Have distinct nucleus. material.