Editions De L'universite De Bruxelles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Working Paper March 2021 #12
GIP W O R K I N G P A P E R MARCH 2021 #12 GOVERNMENTAL ENTITIES OF ABKHAZIA AND THE FORMER AUTONOMOUS DISTRICT OF SOUTH OSSETIA IN TBILISI: POWER AND LEGITIMACY IN EXILE Tornike Zurabashvili P I GEORGIAN INSTITUTE G OF POLITICS GIP WORKING PAPER MARCH 2021 #12 ABOUT THE AUTHOR Tornike Zurabashvili has a lengthy experience of working for non-governmental organizations and think tanks in Georgia and abroad. In 2017-2019, he was the Chief Editor of Civil.Ge, a trilingual online outlet on politics of Georgia. In 2019-2020, Tornike was a fellow of the Eurasia Democratic Security Network at the Center for Social Sciences in Tbilisi. He is currently the Programs Manager at the International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED), an elections and democracy watchdog in Georgia. Tornike holds a Bachelor’s degree from Tbili si State University (International Affairs), and Master’s degrees from Ilia State University (Public Administration) and Trinity College Dublin (Political Science). He has also completed exchange and short-term programs at Charles, Tartu and Georgetown universities. He is currently pursuing a PhD in political science at Tbilisi State University. The original text is published in Georgian; Available here >> Georgian Institute of Politics (GIP) is a Tbilisi-based non-profit, non-partisan, research and analysis organization. GIP works to strengthen the organizational backbone of democratic institutions and promote good governance and development through policy research and advocacy in Georgia. This publication was produced as part of the research project Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia’s strategic path — GEOPATH funded by the Research Council of Norway. -

Russian-Speaking
NOVEMBER 2017 ‘RUSSIAN-SPEAKING’ FIGHTERS IN SYRIA, IRAQ AND AT HOME: CONSEQUENCES AND CONTEXT FULL REPORT Mark Youngman and Dr Cerwyn Moore Centre for Russian, European and Eurasian Studies Department of Political Science and International Studies University of Birmingham This report was produced out of the Actors and Narratives programme, funded by CREST. To find out more information about this programme, and to see other outputs from the team, visit the CREST website at: https://crestresearch.ac.uk/projects/actors-and-narratives/ About the authors: Mark Youngman is an ESRC-funded doctoral student and Cerwyn Moore a Senior Lecturer in the Centre for Russian, European and Eurasian Studies at the University of Birmingham. Disclaimer: This report has been part funded by an ESRC IAA award and part funded by the Centre for Research and Evidence on Security Threats (ESRC Award: ES/N009614/1). It draws on the existing work of the authors, and supplements their work with original research and ongoing data collection of Russian-speaking foreign fighters.www.crestresearch.co.uk The cover image, Caucasus Emirate, is a remixed derivative ofProposed divisions of the Caucasus Emirate by ArnoldPlaton, under CC BY-SA 3.0. Caucasus Emirate is licensed under CC BY-NC-SA 4.0. by R. Stevens, CREST. ©2017 CREST Creative Commons 4.0 BY-NC-SA licence. www.crestresearch.ac.uk/copyright CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ...............................................................................................................4 PART I: ASSESSING THE ‘RUSSIAN-SPEAKING’ -

Kadyrovism: Hardline Islam As a Tool of the Kremlin?
Notes de l’Ifri Russie.Nei.Visions 99 Kadyrovism: Hardline Islam as a Tool of the Kremlin? Marlène LARUELLE March 2017 Russia/NIS Center The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non-governmental, non-profit organization. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Taking an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. With offices in Paris and Brussels, Ifri stands out as one of the few French think tanks to have positioned itself at the very heart of European and broader international debate. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. This text is published with the support of DGRIS (Directorate General for International Relations and Strategy) under “Observatoire Russie, Europe orientale et Caucase”. ISBN: 978-2-36567-681-6 © All rights reserved, Ifri, 2017 How to quote this document: Marlène Laruelle, “Kadyrovism: Hardline Islam as a Tool of the Kremlin?”, Russie.Nei.Visions, No. 99, Ifri, March 2017. Ifri 27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15—FRANCE Tel.: +33 (0)1 40 61 60 00—Fax : +33 (0)1 40 61 60 60 Email: [email protected] Ifri-Bruxelles Rue Marie-Thérèse, 21 1000—Brussels—BELGIUM Tel.: +32 (0)2 238 51 10—Fax: +32 (0)2 238 51 15 Email: [email protected] Website: Ifri.org Russie.Nei.Visions Russie.Nei.Visions is an online collection dedicated to Russia and the other new independent states (Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan and Kyrgyzstan). -

Volume VIII, Issue 27 JULY 8, 2010
VOLUME VIII, ISSUE 27 u JULY 8, 2010 IN THIS ISSUE: BRIEFS...................................................................................................................................1 JIHADI VIEWS ON GENERAL MCCHRYSTAL’s RESIGNATION By Abdul Hameed Bakier.........................................................................................3 PKK INTENSIFIES VIOLENCE TO BRING TURKEY INTO CONFRONTATION WITH THE EUROPEAN UNION Members of PKK By Emrullah Uslu..............................................................................................................4 SALAFI-JIHADIS AND THE NORTH CAUCASUS: IS THERE A NEW PHASE OF WAR Terrorism Monitor is a publication IN THE MAKING? of The Jamestown Foundation. By Murad Batal al-Shishani....................................................................................6 The Terrorism Monitor is designed to be read by policy- makers and other specialists yet be accessible to the general public. The opinions expressed within are solely those of the authors and do not necessarily reflect those of The Jamestown DEFIANT AQIM CHALLENGES NEW REGIONAL COUNTERTERRORIST Foundation. COMMAND WITH DEADLY CROSS-BORDER RAID Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) answered the formation of a Unauthorized reproduction or redistribution of this or any multinational counterterrorism center in the southern Algerian town of Jamestown publication is strictly Tamanrasset by ambushing a patrol of Algerian border gendarmes close to Tin prohibited by law. Zaouatine, roughly 40 km from the border with Mali -

ICC-01/15 13 October 2015 Original
ICC-01/15-4 13-10-2015 1/160 EO PT Original: English No.: ICC-01/15 Date: 13 October 2015 PRE-TRIAL CHAMBER I Before: Judge Joyce Aluoch, Presiding Judge Judge Cuno Tarfusser Judge Péter Kovács SITUATION IN GEORGIA Public Document with Confidential, EX PARTE, Annexes A,B, C, D.2, E.3, E.7, E.9, F H and Public Annexes 1, D.1, E.1, E.2, E.4, E.5, E.6, E.8,G ,I, J Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15 Source: Office of the Prosecutor ICC-01/15 1/160 13 October 2015 ICC-01/15-4 13-10-2015 2/160 EO PT Document to be notified in accordance with regulation 31 of the Regulations of the Court to: The Office of the Prosecutor Counsel for the Defence Mrs Fatou Bensouda Mr James Stewart Legal Representatives of the Victims Legal Representatives of the Applicants Unrepresented Victims Unrepresented Applicants The Office of Public Counsel for The Office of Public Counsel for the Victims Defence States’ Representatives Amicus Curiae REGISTRY Registrar Defence Support Section Mr Herman von Hebel Victims and Witnesses Unit Detention Section No. ICC-01/15 2/160 13 October 2015 ICC-01/15-4 13-10-2015 3/160 EO PT Table of Contents with Confidential, EX PARTE, Annexes C, D,E.3, E.7,E.9 H and Public Annexes, A, B,D, E.1, E.2, E.4, E.5, E.6, E.8, F,G,I,J................................................................................................1 Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15 ....................................1 I. -

Pdf | 406.42 Kb
! GEORGIA: Newly installed cattle water troughs in Shida Kartli region ! ! Geri ! !Tsiara Klarsi ! Klarsi Andaisi Kintsia ! ! ! Zalda RUSSIAN FEDERATION ! !Mipareti Maraleti Sveri ! I ! Tskaltsminda ! Sheleuri ! Saboloke V ! H Gvria K ! A AG Marmazeti Eltura I M Didkhevi ! ! L Kemerti ! O ! A SA Didkhevi V ! Ortevi R L ! A E Kekhvi Tliakana T Black Sea T'bilisi ! Dzartsemi ! Guchmasta A T ! ! Marmazeti Khoshuri ! ! ! P ! Beloti F ! Tsilori Satskheneti Atsriskhevi ! !\ R Jojiani ! ! ! O Rustavi ! Zemo Zoknari ! N Kurta Snekvi Chachinagi Dzari Zemo Monasteri ! Vaneti ! ! ! ! ! Kvemo Zoknari E Brili Mamita ! ! ! Isroliskhevi AZERBAIJAN !Kvemo Monasteri ! !Brili Zemo Tsorbisi !Zemo Kornisi ! ARMENIA ! Mebrune Zemo Achabeti Kornisi ! ! ! ! Snekvi ! Zemo Dodoti Dampaleti Zemo SarabukiKokhat!i ! Tsorbisi ! ! ! ! TURKEY ! Charebi ! Akhalisa Vakhtana ! Kheiti Benderi ! ! Kverneti ! ! Zemo Vilda P! atara TsikhiataBekmeri Kvemo Dodoti ! NA ! ! ! ! Satakhari REB ULA ! Bekmari Zemo Ambreti Kverne!ti ! Sabatsminda Kvemo Vilda Didi Tsikhiata! ! ! Dmenisi ! ! Kvasatali!Grubela Grubela ! ! ! ! Eredvi ! !Lisa Tormanauli ! ! Ksuisi Legend Khodabula ! Zemo Ambreti ! ! ! ! Berula !Zardiantkari Kusireti ! ! Chaliasubani Malda Tibilaani Arkinareti ! Elevation ! ! Argvitsi ! Teregvani ! Galaunta ! Khelchua ! Zemo Prisi ! ! ! Pirsi Kvemo Nanadakevi Tbeti ! Disevi ! ! ! ! Water trough location m ! ! Zemo Mokhisi ! ! ! Kroza Tbeti Arbo ! !Akhalsheni Arkneti ! Tamarasheni ! ! Mereti ! Sadjvare ! ! ! K ! Khodi Beridjvari Koshka ! -27 - 0 Chrdileti Tskhinvali ! ! -
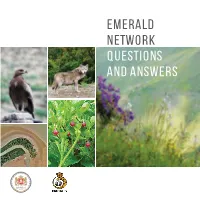
Emerald Network Questions and Answers
Emerald Network Questions and Answers © Photos Giorgi Darchiashvili Teimuraz Popiashvili Irakli Shavgulidze Kakha Artsivadze Otar Abdaladze Christian Gönner GIZ NACRES This publication has been prepared by the NGO NACRES, in the frame of the ‘Integrated Biodiversity Management in South Caucasus’ (IBiS) programme implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The information and views set out in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of GIZ and/or BMZ. The second updated edition. Tbilisi, 2020 Foreword This brochure is an attempt to inform the public, especially decision-makers, about the establishment, official designation, and management of the Emerald Network. Our goal is to provide detailed answers to as many as possible questions that have occurred to the stakeholders since 2009, after Georgia initiated the process of the development of the Emerald Network, as stipulated by the Bern Convention. Particularly more questions have been raised within the last few years, because the establishment of the Emerald Network also became an obligation under the EU-Georgia Association Agreement. It is also important to note that this publication should not be expected to clarify all possible issues and questions regarding Emerald Network development and management - many aspects are yet to be defined and the existing experience of other countries and adaption to the national context of Georgia will be examined. Our intention was to ensure as much as possible that the brochure be useful and informative for the general public and decision-makers alike. -

Reserved Domains
Countries: (.ge; .edu.ge; .org.ge; .net.ge; .pvt.ge; .school.ge) afghanistan cameroon ghana lebanon nigeria spain zambia albania canada greece lesotho norway srilanka zimbabwe algeria centralafricanrepublic grenada liberia oman sudan andorra chad guatemala libya pakistan suriname angola chile guinea liechtenstein palau swaziland antiguaandbarbuda china guinea-bissau lithuania palestina sweden argentina colombia guyana luxembourg panama switzerland armenia comoros haiti macau papuanewguinea syria aruba congo honduras macedonia paraguay taiwan australia costarica hongkong madagascar peru tajikistan austria croatia hungary malawi philippines tanzania azerbaijan cuba iceland malaysia poland thailand bahama curacao india maldives portugal timor-leste bahrain cyprus indonesia mali qatar togo bangladesh czechia iran malta romania tonga barbados denmark iraq marshallislands russia trinidadandtobago belarus djibouti ireland mauritania rwanda tunisia belgium dominica israel mauritius saintlucia turkey belize dominicanrepublic italy mexico samoa turkmenistan benin ecuador jamaica micronesia sanmarino tuvalu bhutan egypt japan moldova saudiarabia uganda birma elsalvador jordan monaco senegal ukraine bolivia equatorialguinea kazakhstan mongolia serbia unitedarabemirates bosniaandherzegovina eritrea kenya montenegro seychelles uk botswana estonia kiribati morocco sierraleone england brazil ethiopia northkorea mozambique singapore unitedkingdom brunei fiji korea namibia sintmaarten uruguay bulgaria finland southkorea nauru slovakia uzbekistan burkinafaso -

Center for Nonproliferation Studies
Monterey Terrorism Research and Education Program (MonTREP) Monterey Institute for International Studies Islam, Islamism and Politics in Eurasia Report No. 19, July 28, 2010 CONTENTS: CAUCASUS EMIRATE (CE) TERRORISM STATISTICS FROM JUNE AND JANUARY-JUNE 2010 DAGESTAN’S MUJAHEDIN DISCUSS CONFIDENCE, DUAL POWER, AND PARALLEL STATE-BUILDING DAGESTAN VILAIYAT’S QADIS ACTIVIZED FIVE RADICAL RUSSIAN LIBERALS SUPPORT CE’S JIHAD ANZOR ASTEMIROV – SEIFULLAH: A PROFILE (PART 1) ANNOUNCEMENT: NEW NON-PROLIFERATION/TERRORISM STUDIES MASTER OF ARTS DEGREE AND TERRORISM STUDIES CERTIFICATE PROGRAMS * IIPER is written and edited by Dr. Gordon M. Hahn unless otherwise noted. Research assistance is provided by Leonid Naboishchikov, Daniel Painter, Fabian Sievert, and Daria Ushakova. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CE TERRORISM STATISTICS FROM JUNE AND JANUARY-JUNE 2010 June 2010 saw at least approximately 66 terrorist attacks and jihad-related violent incidents in Russia. These 66 attacks/incidents have led to approximately at least 28 state agents killed and 40 wounded, 10 civilians killed and 33 wounded. This brings the total for the first six months of this year to at least some 213 attacks/incidents, the overwhelming majority of which were attacks initiated by mujahedin. These 213 attacks/incidents have led to approximately at least 104 state agents killed and 195 wounded, 66 civilians killed and 209 wounded. It remains unclear whether the May 26th car bomb explosion in Stavropol, which killed 7 and 41 civilians, was a CE operation; neither the mujahedin nor the authorities have thus far claimed so. According to non- jihadi Russian sources, some 42 mujahedin were killed in June. According to non-jihadi Russian sources, in the first six months of 2010 Russian security and police forces have killed 173-178, wounded 4-6, and captured 43-51 mujahedin. -

GEORGIA: UN Security Phases 23 Dec 2008
South Ossetia & Area Adjacent to South Ossetia GEORGIA: UN Security Phases 23 Dec 2008 K K N U Gveleti N ! U ShoviCHAN Glola ! CH ! AK HI LEGEND Tsdo NARI ! I N O International Boundary I R O U HD NI NK MIK MA Resi ! Setepi ! Kazbegi RUSSIANSOUTH OSSETIA FEDERATION ZAKA Phase VI ! Phase III (Area Adjacent to South Ossetia - AA to SO) TE Pansheti R ! G NK ! I Suatisi U ! Toti ! ! ! Tsotsilta Karatkau ! Achkhoti GaiboteniArsha! ! ! S H! City N O Tkarsheti ST ! Mna U ! Garbani S ! ! K A N A GARUL K Sioni L Abano ! I ! ! Sno ! Pkh!elshe Vardisubani Khurtisi ! ! Village Ketrisi ! ! Kvadja U ! N Kanobi ! K ! Shua Kozi Zemo Okrokana ! ! ! Shua Sba Sevardeni ! ! ! Road Network Kvemo Kozi ! Kvemo Okrokana ! !Kvemo Jomaga Nogkau Zemo Roka ! ! Zemo Jomaga Kvemo Sba ! Shua Roka ! Railway Kvedi ! Artkhmo ! Kobi ! Cheliata ! ! Almasiani Ukhati ! ! Leti ! Non-seasonal river Zgubiri Skhanari Kvemo Roka ! ! Kevselta ! Vezuri ! ! A Kabuzta OR Edisa ! Khodzi J ! ! Tsedisi Tamagini JE ! ! ! Bzita Lakes ! Zaseta Kiro!vi ! Nadarbazevi! Chasavali ! Nakreba ! Kvaisi ! Kobeti Akhsagrina ! ! ! Britata Iri ! Sagilzazi ! ! Sheubani ! ! Kvemo Ermani ! Shua Ermani ! PHASE I Shembuli ! Zemo Bakarta Khadisari ! ! Batra Martgajina Kvemo Bakarta ! ! Duodonastro ! ! Litsi Tlia ! Kasagini ! ! Nogkau ! A Zamtareti S Lesora ! Kvemo Machkhara T ! ! A Tlia P ! Tskere Tsarita Palagkau ! ! ! Keshelta !Gudauri Kola ! Mugure Khugata ! !Bajigata ! ! Chagata Shiboita ! Saritata ! ! Kvemo Koshka Benian-Begoni ! ! Biteta !Tsona Vaneli ! ! Samkhret Chifrani Korogo Iukho !Soncho U Muldarta -

Causes of War Prospects for Peace
Georgian Orthodox Church Konrad-Adenauer-Stiftung CAUSES OF WAR PROS P E C TS FOR PEA C E Tbilisi, 2009 1 On December 2-3, 2008 the Holy Synod of the Georgian Orthodox Church and the Konrad-Adenauer-Stiftung held a scientific conference on the theme: Causes of War - Prospects for Peace. The main purpose of the conference was to show the essence of the existing conflicts in Georgia and to prepare objective scientific and information basis. This book is a collection of conference reports and discussion materials that on the request of the editorial board has been presented in article format. Publishers: Metropolitan Ananya Japaridze Katia Christina Plate Bidzina Lebanidze Nato Asatiani Editorial board: Archimandrite Adam (Akhaladze), Tamaz Beradze, Rozeta Gujejiani, Roland Topchishvili, Mariam Lordkipanidze, Lela Margiani, Tariel Putkaradze, Bezhan Khorava Reviewers: Zurab Tvalchrelidze Revaz Sherozia Giorgi Cheishvili Otar Janelidze Editorial board wishes to acknowledge the assistance of Irina Bibileishvili, Merab Gvazava, Nia Gogokhia, Ekaterine Dadiani, Zviad Kvilitaia, Giorgi Cheishvili, Kakhaber Tsulaia. ISBN 2345632456 Printed by CGS ltd 2 Preface by His Holiness and Beatitude Catholicos-Patriarch of All Georgia ILIA II; Opening Words to the Conference 5 Preface by Katja Christina Plate, Head of the Regional Office for Political Dialogue in the South Caucasus of the Konrad-Adenauer-Stiftung; Opening Words to the Conference 8 Abkhazia: Historical-Political and Ethnic Processes Tamaz Beradze, Konstantine Topuria, Bezhan Khorava - A -

World Bank Document
SFG4136 V3 Public Disclosure Authorized Environmental Management Plan Public Disclosure Authorized for Rehabilitation of secondary road Agara-Kornisi-Tskhinvali km 1 – km 4 and km 9 – km 16 Public Disclosure Authorized Tbilisi, Georgia 2014 Public Disclosure Authorized 1 PART 1: GENERAL PROJECT AND SITE INFORMATION INSTITUTIONAL & ADMINISTRATIVE Country Georgia Rehabilitation of secondary road Agara-Kornisi-Tskhinvali km 1 – km 4 and km 9 – km 16 Project title Scope of project and Actual condition of asphalt concrete road pavement is unsatisfactory at present. The activity edges are broken, there are longitudinal and transverse cracks, frequent potholes, cross fall is disturbed. Project road crosses the river Ptsa with a reinforced concrete bridge. The bridge is in an unsatisfactory condition. Rehabilitation of the bridge is not envisaged in the design under the agreement with the Roads Department of Georgia. Existing culverts of various cross-sections are mianly used for irrigation. They mainly do not ensure proper water discharge and shall be replaced. Length of the road section is 3.931 km. Section km 5 – km 8 of Agara-Kornisi-Tskhinvali road has been recently rehabilitated. Project section km 9 – km 16 starts at the exit of the village Abisi which represents the end of the rehabilitated section and corresponds to PK 0+00. The road passes the villages Tseronisi, Avlevi, Knolevi and ends at PK76+78 at the Police Post at the end of the village Knolevi (village Knolevi is bordering conflict zone). Length of the road section is 7.678 km. Asphalt concrete pavement is actually missing on the mentioned section (rare fragments exist).