La Mescaline
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inclusion of People of Color in Psychedelic-Assisted Psychotherapy
Michaels et al. BMC Psychiatry (2018) 18:245 https://doi.org/10.1186/s12888-018-1824-6 RESEARCH ARTICLE Open Access Inclusion of people of color in psychedelic- assisted psychotherapy: a review of the literature Timothy I. Michaels1* , Jennifer Purdon1,2, Alexis Collins1 and Monnica T. Williams1,2 Abstract Background: Despite renewed interest in studying the safety and efficacy of psychedelic-assisted psychotherapy for the treatment of psychological disorders, the enrollment of racially diverse participants and the unique presentation of psychopathology in this population has not been a focus of this potentially ground-breaking area of research. In 1993, the United States National Institutes of Health issued a mandate that funded research must include participants of color and proposals must include methods for achieving diverse samples. Methods: A methodological search of psychedelic studies from 1993 to 2017 was conducted to evaluate ethnoracial differences in inclusion and effective methods of recruiting peopple of color. Results: Of the 18 studies that met full criteria (n = 282 participants), 82.3% of the participants were non-Hispanic White, 2.5% were African-American, 2.1% were of Latino origin, 1.8% were of Asian origin, 4.6% were of indigenous origin, 4.6% were of mixed race, 1.8% identified their race as “other,” and the ethnicity of 8.2% of participants was unknown. There were no significant differences in recruitment methodologies between those studies that had higher (> 20%) rates of inclusion. Conclusions: As minorities are greatly underrepresented in psychedelic medicine studies, reported treatment outcomes may not generalize to all ethnic and cultural groups. -

Peakal: Protons I Have Known and Loved — Fifty Shades of Grey-Market Spectra
PeakAL: Protons I Have Known and Loved — Fifty shades of grey-market spectra Stephen J. Chapman* and Arabo A. Avanes * Correspondence to: Isomer Design, 4103-210 Victoria St, Toronto, ON, M5B 2R3, Canada. E-mail: [email protected] 1H NMR spectra of 28 alleged psychedelic phenylethanamines from 15 grey-market internet vendors across North America and Europe were acquired and compared. Members from each of the principal phenylethanamine families were analyzed: eleven para- substituted 2,5-dimethoxyphenylethanamines (the 2C and 2C-T series); four para-substituted 3,5-dimethoxyphenylethanamines (mescaline analogues); two β-substituted phenylethanamines; and ten N-substituted phenylethanamines with a 2-methoxybenzyl (NBOMe), 2-hydroxybenzyl (NBOH), or 2,3-methylenedioxybenzyl (NBMD) amine moiety. 1H NMR spectra for some of these compounds have not been previously reported to our knowledge. Others have reported on the composition of “mystery pills,” single-dose formulations obtained from retail shops and websites. We believe this is the first published survey of bulk “research chemicals” marketed and sold as such. Only one analyte was unequivocally misrepresented. This collection of experimentally uniform spectra may help forensic and harm-reduction organizations identify these compounds, some of which appear only sporadically. The complete spectra are provided as supplementary data.[1] Keywords: 1H NMR, drug checking, grey markets, research chemicals, phenylethanamines, N-benzyl phenylethanamines, PiHKAL DOI: http://dx.doi.org/10.16889/isomerdesign-1 Published: 1 August 2015 Version: 1.03 “Once you get a serious spectrum collection, Nevertheless, an inherent weakness of grey markets is the the tendency is to push it as far as you can.”1 absence of regulatory oversight. -

Programme & Abstracts
The 57th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists. 2nd - 6th September 2019 BIRMINGHAM, UK The ICC Birmingham Broad Street, Birmingham B1 2EA Programme & Abstracts 1 Thank You to our Sponsors PlatinUm Gold Silver Bronze 2 3 Contents Welcome message 5 Committees 6 General information 7 iCC maps 8 exhibitors list 10 Exhibition Hall 11 Social Programme 14 opening Ceremony 15 Schedule 16 Oral Programme MONDAY 2 September 19 TUESDAY 3 September 21 THURSDAY 5 September 28 FRIDAY 6 September 35 vendor Seminars 42 Posters 46 oral abstracts 82 Poster abstracts 178 4 Welcome Message It is our great pleasure to welcome you to TIAFT Gala Dinner at the ICC on Friday evening. On the accompanying pages you will see a strong the UK for the 57th Annual Meeting of scientific agenda relevant to modern toxicology and we The International Association of Forensic thank all those who submitted an abstract and the Toxicologists Scientific Committees for making the scientific programme (TIAFT) between 2nd and 6th a success. Starting with a large Young Scientists September 2019. Symposium and Dr Yoo Memorial plenary lecture by Prof Tony Moffat on Monday, there are oral session topics in It has been decades since the Annual Meeting has taken Clinical & Post-Mortem Toxicology on Tuesday, place in the country where TIAFT was founded over 50 years Human Behaviour Toxicology & Drug-Facilitated Crime on ago. The meeting is supported by LTG (London Toxicology Thursday and Toxicology in Sport, New Innovations and Group) and the UKIAFT (UK & Ireland Association of Novel Research & Employment/Occupational Toxicology Forensic Toxicologists) and we thank all our exhibitors and on Friday. -

Colorimetric Approaches to Drug Analysis and Applications – a Review
REVIEW ARTICLE Am. J. PharmTech Res. 2019; 9(01) ISSN: 2249-3387 Journal home page: http://www.ajptr.com/ Colorimetric Approaches To Drug Analysis And Applications – A Review Sowjanya Gummadi*, Mohana Kommoju Department of Pharmaceutical Analysis, Institute of Pharmacy, GITAM (Deemed to be University), Visakhapatnam-530045, Andhra Pradesh, India ABSTRACT The main purpose of this review is to highlight the importance of colorimetric approaches to drug analysis both in dosage forms as well as biological samples. Colorimetric methods using colorimetric reagents are highly sensitive, specific and an easy way of determining various analytes in a variety of matrices within a short time. The colorimetric procedures discussed are statistically validated and reported in various quality control laboratories. Hence in the present review significance of colorimetric procedures, various reagents used along with principles and applications are mentioned. Key words: Colorimetric approaches, sensitive, matrices, quality control, applications. *Corresponding Author Email: [email protected] Received 01 November 2018, Accepted 23 December 2018 Please cite this article as: Gummadi S et al., Colorimetric Approaches To Drug Analysis And Applications – A Review. American Journal of PharmTech Research 2019. Gummadi et. al., Am. J. PharmTech Res. 2019; 9(01) ISSN: 2249-3387 INTRODUCTION Colorimetry is a technique which involves the quantitative estimation of colors frequently used in biochemical investigation. Color can be produced by any substance when it binds with color forming chromogens. The difference in color intensity results in difference in the absorption of light. The intensity of color is directly proportional to the concentration of the compound being measured.1 Wavelength between 380 nm to 780 nm forms the visible band of light in electromagnetic spectrum. -

The Effects of Low Dose Lysergic Acid Diethylamide Administration in a Rodent Model of Delay Discounting
Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 6-2020 The Effects of Low Dose Lysergic Acid Diethylamide Administration in a Rodent Model of Delay Discounting Robert J. Kohler Western Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/dissertations Part of the Biological Psychology Commons Recommended Citation Kohler, Robert J., "The Effects of Low Dose Lysergic Acid Diethylamide Administration in a Rodent Model of Delay Discounting" (2020). Dissertations. 3565. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/3565 This Dissertation-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. THE EFFECTS OF LOW DOSE LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE ADMINISTRATION IN A RODENT MODEL OF DELAY DISCOUNTING by Robert J. Kohler A dissertation submitted to the Graduate College In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Psychology Western Michigan University June 2020 Doctoral Committee: Lisa Baker, Ph.D., Chair Anthony DeFulio, Ph.D. Cynthia Pietras, Ph.D. John Spitsbergen, Ph.D. Copyright by Robert J. Kohler 2020 THE EFFECTS OF LOW DOSE LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE ADMINISTRATION IN A RODENT MODEL OF DELAY DISCOUNTING Robert J. Kohler, Ph.D. Western Michigan University, 2020 The resurgence of Lysergic Acid Diethylamide (LSD) as a therapeutic tool requires a revival in research, both basic and clinical, to bridge gaps in knowledge left from a previous generation of work. Currently, no study has been published with the intent of establishing optimal microdose concentrations of LSD in an animal model. -

Virginia Acts of Assembly -- 2021 Special Session I
VIRGINIA ACTS OF ASSEMBLY -- 2021 SPECIAL SESSION I CHAPTER 110 An Act to amend and reenact §§ 3.2-4112, 3.2-4113, 3.2-4114.2, 3.2-4115, 3.2-4116, 3.2-4118, 3.2-4119, 18.2-247, 18.2-251.1:3, 54.1-3401, and 54.1-3446 of the Code of Virginia, relating to industrial hemp; emergency. [H 2078] Approved March 12, 2021 Be it enacted by the General Assembly of Virginia: 1. That §§ 3.2-4112, 3.2-4113, 3.2-4114.2, 3.2-4115, 3.2-4116, 3.2-4118, 3.2-4119, 18.2-247, 18.2-251.1:3, 54.1-3401, and 54.1-3446 of the Code of Virginia are amended and reenacted as follows: § 3.2-4112. Definitions. As used in this chapter, unless the context requires a different meaning: "Cannabis sativa product" means a product made from any part of the plant Cannabis sativa, including seeds thereof and any derivative, extract, cannabinoid, isomer, acid, salt, or salt of an isomer, whether growing or not, with a concentration of tetrahydrocannabinol that is greater than that allowed by federal law. "Deal" means to buy temporarily possess industrial hemp grown in compliance with state or federal law and to sell such industrial hemp to a person who that (i) processes industrial hemp in compliance with state or federal law or has not been processed and (ii) sells industrial hemp to a person who processes industrial hemp in compliance with state or federal law was not grown and will not be processed by the person temporarily possessing it. -
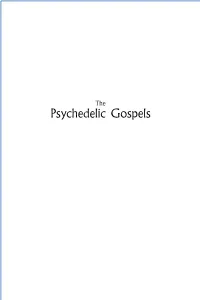
Psychedelic Gospels
The Psychedelic Gospels The Psychedelic Gospels The Secret History of Hallucinogens in Christianity Jerry B. Brown, Ph.D., and Julie M. Brown, M.A. Park Street Press Rochester, Vermont • Toronto, Canada Park Street Press One Park Street Rochester, Vermont 05767 www.ParkStPress.com Park Street Press is a division of Inner Traditions International Copyright © 2016 by Jerry B. Brown and Julie M. Brown All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Note to the Reader: The information provided in this book is for educational, historical, and cultural interest only and should not be construed in any way as advocacy for the use of hallucinogens. Neither the authors nor the publishers assume any responsibility for physical, psychological, legal, or any other consequences arising from these substances. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data [cip to come] Printed and bound in XXXXX 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Text design and layout by Priscilla Baker This book was typeset in Garamond Premier Pro with Albertus and Myriad Pro used as display typefaces All Bible quotations are from the King James Bible Online. A portion of proceeds from the sale of this book will support the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Founded in 1986, MAPS is a 501(c)(3) nonprofit research and educational organization that develops medical, legal, and cultural contexts for people to benefit from the careful uses of psychedelics and marijuana. -

Hallucinogens: an Update
National Institute on Drug Abuse RESEARCH MONOGRAPH SERIES Hallucinogens: An Update 146 U.S. Department of Health and Human Services • Public Health Service • National Institutes of Health Hallucinogens: An Update Editors: Geraline C. Lin, Ph.D. National Institute on Drug Abuse Richard A. Glennon, Ph.D. Virginia Commonwealth University NIDA Research Monograph 146 1994 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Public Health Service National Institutes of Health National Institute on Drug Abuse 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 ACKNOWLEDGEMENT This monograph is based on the papers from a technical review on “Hallucinogens: An Update” held on July 13-14, 1992. The review meeting was sponsored by the National Institute on Drug Abuse. COPYRIGHT STATUS The National Institute on Drug Abuse has obtained permission from the copyright holders to reproduce certain previously published material as noted in the text. Further reproduction of this copyrighted material is permitted only as part of a reprinting of the entire publication or chapter. For any other use, the copyright holder’s permission is required. All other material in this volume except quoted passages from copyrighted sources is in the public domain and may be used or reproduced without permission from the Institute or the authors. Citation of the source is appreciated. Opinions expressed in this volume are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions or official policy of the National Institute on Drug Abuse or any other part of the U.S. Department of Health and Human Services. The U.S. Government does not endorse or favor any specific commercial product or company. -
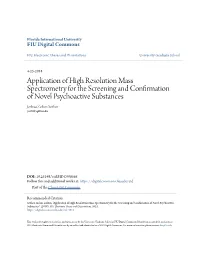
Application of High Resolution Mass Spectrometry for the Screening and Confirmation of Novel Psychoactive Substances Joshua Zolton Seither [email protected]
Florida International University FIU Digital Commons FIU Electronic Theses and Dissertations University Graduate School 4-25-2018 Application of High Resolution Mass Spectrometry for the Screening and Confirmation of Novel Psychoactive Substances Joshua Zolton Seither [email protected] DOI: 10.25148/etd.FIDC006565 Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/etd Part of the Chemistry Commons Recommended Citation Seither, Joshua Zolton, "Application of High Resolution Mass Spectrometry for the Screening and Confirmation of Novel Psychoactive Substances" (2018). FIU Electronic Theses and Dissertations. 3823. https://digitalcommons.fiu.edu/etd/3823 This work is brought to you for free and open access by the University Graduate School at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Miami, Florida APPLICATION OF HIGH RESOLUTION MASS SPECTROMETRY FOR THE SCREENING AND CONFIRMATION OF NOVEL PSYCHOACTIVE SUBSTANCES A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in CHEMISTRY by Joshua Zolton Seither 2018 To: Dean Michael R. Heithaus College of Arts, Sciences and Education This dissertation, written by Joshua Zolton Seither, and entitled Application of High- Resolution Mass Spectrometry for the Screening and Confirmation of Novel Psychoactive Substances, having been approved in respect to style and intellectual content, is referred to you for judgment. We have read this dissertation and recommend that it be approved. _______________________________________ Piero Gardinali _______________________________________ Bruce McCord _______________________________________ DeEtta Mills _______________________________________ Stanislaw Wnuk _______________________________________ Anthony DeCaprio, Major Professor Date of Defense: April 25, 2018 The dissertation of Joshua Zolton Seither is approved. -
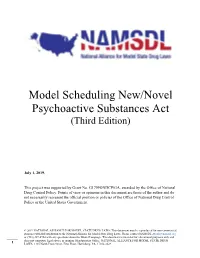
Model Scheduling New/Novel Psychoactive Substances Act (Third Edition)
Model Scheduling New/Novel Psychoactive Substances Act (Third Edition) July 1, 2019. This project was supported by Grant No. G1799ONDCP03A, awarded by the Office of National Drug Control Policy. Points of view or opinions in this document are those of the author and do not necessarily represent the official position or policies of the Office of National Drug Control Policy or the United States Government. © 2019 NATIONAL ALLIANCE FOR MODEL STATE DRUG LAWS. This document may be reproduced for non-commercial purposes with full attribution to the National Alliance for Model State Drug Laws. Please contact NAMSDL at [email protected] or (703) 229-4954 with any questions about the Model Language. This document is intended for educational purposes only and does not constitute legal advice or opinion. Headquarters Office: NATIONAL ALLIANCE FOR MODEL STATE DRUG 1 LAWS, 1335 North Front Street, First Floor, Harrisburg, PA, 17102-2629. Model Scheduling New/Novel Psychoactive Substances Act (Third Edition)1 Table of Contents 3 Policy Statement and Background 5 Highlights 6 Section I – Short Title 6 Section II – Purpose 6 Section III – Synthetic Cannabinoids 13 Section IV – Substituted Cathinones 19 Section V – Substituted Phenethylamines 23 Section VI – N-benzyl Phenethylamine Compounds 25 Section VII – Substituted Tryptamines 28 Section VIII – Substituted Phenylcyclohexylamines 30 Section IX – Fentanyl Derivatives 39 Section X – Unclassified NPS 43 Appendix 1 Second edition published in September 2018; first edition published in 2014. Content in red bold first added in third edition. © 2019 NATIONAL ALLIANCE FOR MODEL STATE DRUG LAWS. This document may be reproduced for non-commercial purposes with full attribution to the National Alliance for Model State Drug Laws. -

Volume 33, Issue 11 Virginia Register of Regulations January 23, 2017 1181 PUBLICATION SCHEDULE and DEADLINES
VOL. 33 ISS. 11 PUBLISHED EVERY OTHER WEEK BY THE VIRGINIA CODE COMMISSION JANUARY 23, 2017 VOL TABLE OF CONTENTS Register Information Page ......................................................................................................................................... 1181 Publication Schedule and Deadlines ....................................................................................................................... 1182 Petitions for Rulemaking ............................................................................................................................................ 1183 Notices of Intended Regulatory Action ................................................................................................................. 1184 Regulations ....................................................................................................................................................................... 1186 8VAC20-22. Licensure Regulations for School Personnel (Final) ........................................................................................ 1186 9VAC25-720. Water Quality Management Planning Regulation (Final) .............................................................................. 1190 12VAC5-481. Virginia Radiation Protection Regulations (Final) ......................................................................................... 1199 12VAC30-30. Groups Covered and Agencies Responsible for Eligibility Determination (Final) ........................................ 1217 12VAC30-50. -

Förordning Om Ändring I Förordningen (1992:1554) Om Kontroll Av Narkotika;
Príloha 11 k rozhodnutiu švédskych úradov vlády 22. februára 2018 § 79 1. ------IND- 2018 0079 S-- SK- ------ 20180302 --- --- PROJET Zbierka zákonov Švédska SFS Published on issued on 1 March 2018. The government hereby lays down1 that Annex 1 to the Ordinance (1992:1554) on the control of narcotic drugs2 shall read as set out below. This ordinance shall enter into force on 10 April 2018. On behalf of the Government ANNIKA STRANDHÄLL Lars Hedengran (Ministry of Health and Social Affairs) 1 See Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services. 2 Ordinance reprinted as 1993:784. 1 SFS Annex 13 List of substances to be considered narcotic drugs according to the Narcotic Drugs Punishments Act Stimulants of the central nervous system ethylamphetamine (2-ethylamino-1-phenylpropane) fenethylline [1-phenyl-1-piperidyl-(2)-methyl]acetate 1-phenyl-2-butylamine N-hydroxyamphetamine propylhexedrine 4-methylthioamphetamine (4-MTA) modafinil 4-methoxy-N-methylamphetamine (PMMA, 4-MMA) 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine (2C-T-2) 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine (2C-T-7) 4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine (2C-I) 2,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA-2) 4-methylmethcathinone (mephedrone) 4-fluoramphetamine 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one (methedrone) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (MDPV) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one