Rapport De Présentation ACHENHEIM
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LETTRE CIRCULAIRE N° 2017-0000023
LETTRE CIRCULAIRE n° 2017-0000023 Montreuil, le 07/07/2017 DRCPM OBJET Sous-direction production, Modification du champ d'application et du taux de versement gestion des comptes, transport (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités fiabilisation Territoriales VLU-grands comptes et VT Texte(s) à annoter : LCIRC-2015-0000039 Affaire suivie par : ANGUELOV Nathalie A compter du 1er janvier 2017, le périmètre de transports urbains de l’Eurométropole de Strasbourg (9306701) est étendu aux communes d’ACHENHEIM, BREUSCHWICKERSHEIM, HANGENBIETEN, KOLBSHEIM et OSTHOFFEN. Par une délibération du 3 mars 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d'étendre le taux de versement transport de 2 % à toutes les communes de son périmètre de transports urbains à compter du 1er juin 2017. Par un arrêté du 26 octobre 2016, la Préfecture du Bas Rhin a autorisé l'adhésion des communes d’ACHENHEIM, BREUSCHWICKERSHEIM, HANGENBIETEN, KOLBSHEIM et OSTHOFFEN. à l’Eurométropole de Strasbourg (9306701) à compter du 1er janvier 2017. Par une délibération du 3 mars 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d'étendre le taux de versement transport de 2 % à toutes les communes de son périmètre de transports urbains à compter du 1er juin 2017. Les informations relatives au champ d’application, au taux, au recouvrement et au reversement du versement transport sont regroupées dans le tableau ci-joint. 1/1 CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG IDENTIFIANT -
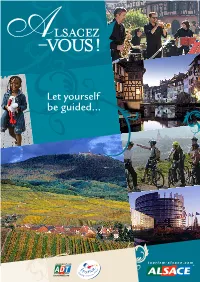
Let Yourself Be Guided…
Let yourself be guided… tourism-alsace.com Contents Introduction 4 to 7 Strasbourg Colmar and Mulhouse Escape into a natural paradise 8 to 17 Discover nature Parks and gardens Well-being and health resorts Wildlife parks and theme parks Hiking Cycle touring, mountain biking, high wire adventure parks, climbing Horseback packing Golf and mini-golf courses Waterborne tourism Water sports, swimming Airborne sports Fishing Winter sports Multi-activity holidays Taste unique local specialities! 18 to 25 Gastronomy, wine seminar, cookery classes Visit the markets Museums of arts and traditions Towns and villages “in bloom”, handicraft Half-timbered houses, traditional Alsatian costume Festivals and traditions Lay siege to history! 26 to 35 Museums Land of fortified castles Memorial sites Religious heritage Practical information about Alsace 36 to 45 Access Accommodation Disabled access Alsace without the car Family holidays in Alsace Weekend and mini-breaks French lessons Festivals, shows and events Tourist Information Offices Tourist trails and routes Map of Alsace The guide to your stay in Alsace Nestling between the Vosges and the Rhine, Alsace is a charming little region with a big reputation. At the crossroads of the Germanic and Latin worlds, it is passionate about its History, yet firmly anchored in modern Europe and open to the world. Rated as among the most beautiful in France, the Alsatian towns and cities win the “Grand prix national de fleurissement”, “Towns in Bloom” prices every year. Through their festivals and their traditions, they have managed to preserve a strong identity based on a particular way of living. World famous cuisine, a remarkably rich history, welcoming and friendly people: in this jewel of a region there really is something for everyone. -

Fiche Fort De Mutzig RRR Grand
FICHE EXPERIENCE Le Fort de Mutzig Feste Kaiser Wilhelm II La forteresse géante TITRE DU PROJET : Commémoration du centenaire 1914-18 Thématiques au Fort de Mutzig - Spectacle « Rouge Horizon » Soutien aux actions de sensibilisation et de découverte OBJECTIFS du patrimoine culturel Dans le cadre des commémorations du centième anniversaire de la Première Guerre mondiale et pour initier une démarche de tourisme de Territoire mémoire, de nombreuses actions et projets ont été mis en place par ALSACE / Bas-Rhin (67) l’ensemble des acteurs locaux du tourisme. Plusieurs manifestations ont GAL Bruche Mossig Piémont ainsi été proposées au Fort de Mutzig, notamment un spectacle trilingue de théâtre vivant en plein-air « Rouge Horizon ». Ce spectacle a permis de Nom des porteurs de projets sensibiliser et de faire découvrir sous un autre angle ce lieu emblématique, Association Fort de Mutzig - en présentant une approche du vécu des riverains de la région du fort Feste Kaiser Wilhelm II durant cette guerre et en mettant en avant les ressentis différents des citoyens en fonction de leur origine ou leur culture. Restauré par des bénévoles allemands et français depuis 30 ans, le Fort est aujourd’hui un lieu de mémoire de la réconciliation, tout en révélant une intéressante muséographie des techniques de pointe de l’époque. CONTEXTE DU PROJET Le Fort de Mutzig a été édifié de 1893 à 1916 par l’empire allemand, sous le nom de « Feste Kaiser Wilhelm II » (Littéralement : « Groupe fortifié empereur Guillaume II »). En liaison avec les fortifications de Strasbourg, Coût du projet le fort (Feste) avait pour rôle de barrer la plaine du Rhin contre toute Montant total : 37 685,69 € HT offensive française en Alsace. -

Commune Arrondissement Judiciaire Achenheim Strasbourg Adamswiller Saverne Albé/Erlenbach Colmar Allenwiller Saverne Alteckendo
Répartition des communes du Bas-Rhin par arrondissement judiciaire Commune Arrondissement judiciaire Achenheim Strasbourg Adamswiller Saverne Albé/Erlenbach Colmar Allenwiller Saverne Alteckendorf Strasbourg Altenheim Saverne Altenstadt Strasbourg Altorf Saverne Altwiller Saverne Andlau Colmar Artolsheim Colmar Aschbach Strasbourg Asswiller Saverne Auenheim Strasbourg Avenheim Strasbourg Avolsheim Saverne Baerendorf Saverne Balbronn Saverne Baldenheim Colmar Barembach Saverne Barr Colmar Bassemberg Colmar Batzendorf Strasbourg Behlenheim Strasbourg Beinheim Strasbourg Bellefosse Saverne Belmont Saverne Benfeld Strasbourg Berg Saverne Bergbieten Saverne Bernardswiller Saverne Bernardvillé Colmar Bernolsheim Strasbourg Berstett Strasbourg Berstheim Strasbourg Bettwiller Saverne Biblisheim Strasbourg Bietlenheim Strasbourg Bilwisheim Strasbourg Bindernheim Colmar Birkenwald Saverne Birlenbach Strasbourg Bischheim Strasbourg Bischholtz Saverne Bischoffsheim Saverne Commune Arrondissement judiciaire Bischwiller Strasbourg Bissert Saverne Bitschhoffen Strasbourg Blaesheim Strasbourg Blancherupt Saverne Blienschwiller Colmar Boersch Saverne Boesenbiesen Colmar Bolsenheim Strasbourg Boofzheim Strasbourg Bootzheim Colmar Bosselshausen Saverne Bossendorf Strasbourg Bourg-Bruche Saverne Bourgheim Saverne Bouxwiller Saverne Breitenau Colmar Breitenbach Colmar Bremmelbach Strasbourg Breuschwickersheim Strasbourg Brumath Strasbourg Buhl Strasbourg Burbach Saverne Bust Saverne Buswiller Saverne Butten Saverne Châtenois Colmar Cleebourg Strasbourg Climbach -

Bulletin Municipal
Le village en action Bulletin municipal - Janvier 2019 Sommaire 1 Le mot du maire 2 Conseil Municipal et Nouvelles de la Mairie 3 Infos Eurométropole 4 État civil 5 Affaires scolaires et enfance 6 Urbanisme et Bâtiments 7 Voirie, Espaces verts et Environnement 9 Projets et travaux réalisés 10 Vie associative 19 Évènements 22 Renseignements et autres informations 24 Retour sur 2018 Responsable de la publication : Conception et impression : Michel BERNHARDT Imprimerie Sostralib - 03 88 04 17 24 Membres de la commission « communication » : Dépôt légal : janvier 2019 Richard HOFMANN, Doris TERNOY, Jean MEYER, Daniel SEIFERT, Anne SCHAUB, Denis LEJEUNE, Jean-Louis NIEDERST, Lucien KRATZ. Numéro imprimé à 650 exemplaires Vente et reproduction interdite Par respect de l’environnement ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et sans chlore Le motLe motdu maire du maire ESSAYER avant Depuis la rentrée 2018, la commission voirie s’est d’INSTAURER réunie à de multiples reprises pour parvenir à un L’ambiance dans accord avec les techniciens de l’Eurométropole. En la petite Mairie de prévision d’une circulation sans cesse croissante Breuschwickersheim sur les artères principales, la Commune réalisera les est en général au beau travaux nécessaires à divers aménagements. Nous fixe, mais ne jubilons attendons la réponse de la Préfecture pour faire pas trop vite, l’humain, passer la circulation à 40 km/h dans le village. (dans toute sa diversité) Afin d’en mesurer les effets, des écluses en poteaux est très présent à cet endroit de la Commune. Les plastiques sont prévues aux entrées : Ouest du critiques comme les encouragements passent village entrée Ernolsheim/Kolbsheim, Osthoffen et sur nos bureaux, nos réponses étant discutées entrée sud vers Hangenbieten. -

Le Canal De La Marne Au Rhin
CANAUX ET VÉLOROUTES D’ALSACE Wasserwege und Fernradwege im Elsass Waterways and Cycle routes in Alsace Waterwegen en Fietspaden in de Elzas 5 Sarre-UnionLe canal de la Marne au Rhin | 86 km 3.900 KM 4 km EUROVÉLO 5 : Harskirchen (Section Réchicourt > Strasbourg)(Abschnitt Réchicourt > Straßburg) 17 km (Section Réchicourt > Strasbourg) Sarrewerden Der Rhein Marne Kanal Ecluse 16 /Altviller 16 The Rhine-Marne canal(stuk Réchicourt > Straatsburg) 5 Marne-Rijnkanaal PARC NATUREL 2H30 Diedendorf RÉGIONAL 13 km 14 ALSACE BOSSUE DES VOSGES DU NORD HAGUENAU Mittersheim 13 Fénétrange Schwindratzheim 10,7 km 64 Mutzenhouse Bischwil St-Jean-de-Bassel 11,5 km 6 H 20 km Niederschaeffolsheim Albeschaux Steinbourg Waltenheim 5 H Hochfelden 87 2H 44 sur Zorn Henridorff 37 Rhodes Langatte 41 en cana SAVERNE 4,3 km Brumath nci l 4,8 km A liger Ka ma na 5 km 1 SARREBOURG e er can l 8,2 km 4 h rm al 20 3 H 30 11 km e o F 31 Zornhoff Dettwiller 3H30 6,5 km Monswiller Lupstein Wingersheim Niderviller Vendenheim Kilstett 10 km 5 H Houillon Lutzelbourg Mittelhausen Reichstett Arzviller Saint-Louis 5 km GONDREXANGE 2H45 Guntzviller Marmoutier 2H30 Plaine-de-Walsch Souffelweyersheim 18 Hesse Hohatzenheim 3,8 km Xouaxange Bischheim La Landange 1H15 RÉCHICOURT Schiltigheim KOCHERSBERG 51 15,8 km 15,8 5 km 15,8 Kehl 6 9 km 857 Offe STRASBOURG 85 Bas-Rhin 1 2 3 5 6 7 LORRAINE (F) 9,2 km LOTHRINGEN 2H30 Neuried (D) PFALZ (D) Lauterbourg 6,7 km BAS-RHIN Plobsheim ALSACE 1H Réchicourt Strasbourg LORRAINE 3 km 80 BADENKrafft Colmar SCHWARZWALD (D) Fribourg (DE) Mulhouse -

Hangenbieten Aujourd'hui DECEMBRE 2014
HANGENBIETEN Aujourd’hui Journal d’informations municipales n° 45 décembre 2014 1 Sommaire Le mot du Maire p.3 Délibérations du conseil municipal p.4-6 Etat civil p. 6 Grands anniversaires p. 7 Très haut débit est arrivé p. 9 Nouvelle incursion des gens du voyage p.9 Circulation / Éclairage public p.10 Maison et cours fleuries p.11 Travaux p.13-14 Vie scolaire p. 15-16 Médiathèque p. 17 Urbanisme p. 18-19 Pélerinage à Saint-Nicolas-de-Port et à Rome p. 20 Parroisse protestante / théâtre d’expression p. 21 Le groupe théâtral de HAngenbieten p. 22 Commémoration du 11 novembre p. 24 stage découverte p. 24 Travaux du réseau d’assainissement de la Bruche p.24 Amicale des Sapeurs Pompiers - MESSTi 2014 p. 25 Nouveautés sportives p. 26 Ush / Gymnase et détente / Self-défense p. 27 Sécurité p. 28 Calendrier des manifestations p. 29 Renseignements utiles p. 30 La Commune de Hangenbieten remercie ses fidèles annonceurs pour leur soutien à la réalisation de ce bulletin municipal. Diffusion gratuite : Mairie de Hangenbieten Tél : 03 88 96 01 27 Email : [email protected] Site : www.cc-leschateaux.fr Directeur de publication : André BIETH Numéro tiré à 750 exemplaires Reproduction et vente interdites Composition et impression : Imprimerie JUNG 14 rue de l’Ill – 67118 GEISPOLSHEIM Tél. 03 88 66 20 34 Ce bulletin couvre la période du 20 juin 2014 au 12 décembre 2014 2 Le mot du Maire Nous voici à la veille des fêtes de Noël et du Nouvel an, les illuminations de Noël de nos rues et places nous donnent matière à réfléchir et à rêver. -

(M Supplément) Administration Générale Et Économie 1800-1870
Archives départementales du Bas-Rhin Répertoire numérique de la sous-série 15 M (M supplément) Administration générale et économie 1800-1870 Dressé en 1980 par Louis Martin Documentaliste aux Archives du Bas-Rhin Remis en forme en 2016 par Dominique Fassel sous la direction d’Adélaïde Zeyer, conservateur du patrimoine Mise à jour du 19 décembre 2019 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) Page 2 sur 204 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) XV. ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE COMPLEMENT Sommaire Introduction Répertoire de la sous-série 15 M Personnel administratif ........................................................................... 15 M 1-7 Elections ................................................................................................... 15 M 8-21 Police générale et administrative............................................................ 15 M 22-212 Distinctions honorifiques ........................................................................ 15 M 213 Hygiène et santé publique ....................................................................... 15 M 214-300 Divisions administratives et territoriales ............................................... 15 M 301-372 Population ................................................................................................ 15 M 373 Etat civil ................................................................................................... 15 M 374-377 Subsistances ............................................................................................ -

Réseau D'assainissement
PLU - Plan Local d'Urbanisme - Commune d' ACHENHEIM NOTE RELATIVE AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT Elaboration le 21/06/1993 Révision n°1 le 18/03/2002 le 09/03/2009 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN – ARRONDISSEMENT DE STRASBOURG-CAMPAGNE COMMUNES D’ACHENHEIM – BREUSCHWICKERSHEIM –HANGENBIETEN – KOLBSHEIM - OSTHOFFEN COMMUNAUTE DE COMMUNES LES CHATEAUX P.L.U. Plan Local d’Urbanisme COMMUNE D’ACHENHEIM ANNEXE SANITAIRE ASSAINISSEMENT Note relative à l’assainissement 2ère phase MARS 2013 1. GENERALITE 1.1 Structure administrative L’assainissement de la commune d’Achenheim est géré par la Communauté de Communes Les Châteaux. Cette collectivité compte 6 552 habitants d’après les derniers recensements, dont 2 209 habitants pour la Commune. Elle s’étend d’Osthoffen à l’ouest, à Hangenbieten et Kolbsheim au sud et à Achenheim à l’est. 1.2 Domaine de compétence La Communauté de Communes est le maître d’ouvrage de l’ensemble des réseaux et ouvrages d’assainissement. La station d’épuration est gérée en régie et la collectivité fait appel à un prestataire pour l’entretien des réseaux. La commune de Dahlenheim est raccordée à la station d’épuration de la Communauté de Communes Les Châteaux tandis que la Commune de Kolbsheim est actuellement raccordée à la station d’épuration du SIVU de la Petite Bruche. La population réellement raccordée actuellement à la station d’épuration est de 6 405 habitants. 2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 2.1 Station d’épuration Le traitement des eaux usées de la commune est réalisé par la station d’épuration de la Communauté de Communes située sur le ban communal d’Achenheim. -

Commune Nom D'arrêt Adresse Complément D'informations Date De
Liste des arrêts Flex'hop au 8 mars 2021 Commune Nom d'arrêt Adresse Complément d'informations Date de mise en service ACHENHEIM Achenheim Ouest Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 ACHENHEIM Achenheim Ouest Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 ACHENHEIM Bourgend 14a Rue Bourgend arrêt flex'hop uniquement Mise en service courant 2021 ACHENHEIM Erables 12 Rue de la Montée arrêt flex'hop uniquement Mise en service courant 2021 ACHENHEIM Soleil Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 ACHENHEIM Soleil Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 ACHENHEIM Tuilerie Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 ACHENHEIM Tuilerie Route de Strasbourg arrêt des lignes de bus : 41 et 240 En service à compter du : 1er mars 2021 BISCHHEIM Atome Avenue de l'Energie arrêt flex'hop uniquement En service à compter du : 1er mars 2021 BISCHHEIM Bischheim ZA Rue de l'Atome arrêt flex'hop uniquement En service à compter du : 1er mars 2021 BISCHHEIM Espace Européen de l'Entreprise Carrefour de l'Europe arrêt de la ligne de bus : G En service à compter du : 1er mars 2021 BISCHHEIM Pôle Automobile 10 Rue Emile Mathis arrêt flex'hop uniquement En service à compter du : 1er mars 2021 BLAESHEIM Blaesheim Ouest Rue du Maréchal Foch arrêt de la ligne de bus : 57 En service à compter du : 1er -

Bulletin Départemental D'information 07/2020
Bulletin Départemental d’Information n° 07/2020 Modalités de mise à disposition du public En application de l’article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales et selon les termes du décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993, sont publiés dans le recueil des actes administratifs, le dispositif des délibérations du Conseil Départemental et des délibérations de la Commission Permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du Conseil Départemental, à caractère réglementaire. *** L’intégralité des délibérations et des annexes aux délibérations de l’Assemblée Plénière et de la Commission Permanente, ainsi que la retranscription intégrale des débats de l’Assemblée Plénière, peuvent être consultées : - Au Service des Ressources Info-Documentaires à l’Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc 67964 STRASBOURG Cedex - Sur le site Internet www.bas-rhin.fr>rubrique « Le Conseil Départemental » ISSN 2554-7976 Bulletin Départemental d’Information n° 07/2020 SOMMAIRE DELIBERATIONS COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - Réunion du 10 juillet 2020 . Délibérations ............................................................................................................................................ 2 ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT ADMINISTRATION - Arrêté portant attribution de subventions aux associations ........................................................................ 94 - Arrêté portant modification des modalités d’attribution de subventions aux associations .......................... 132 - -

504107 E. Bleue Achenheim Achenheim 3 521633 Asi Avenir Football Adamswiller 5 519491 U.S
Bureaux par localité LISTE DES CLUBS 67+68 PAR BUREAUX D'INSCRIPTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22.06.17 A ERSTEIN Numéro Club Localité Bureau 504107 E. BLEUE ACHENHEIM ACHENHEIM 3 521633 ASI AVENIR FOOTBALL ADAMSWILLER 5 519491 U.S. ALBE ALBE 13 535588 F.C. ALTECKENDORF ALTECKENDORF 12 523624 F.C. ALTENSTADT ALTENSTADT 10 500198 A.S. ALTKIRCH ALTKIRCH 5 563900 MJC COM COM ALTKIRCH FUTSAL ALTKIRCH 14 504110 A.S. ALTORF ALTORF 5 518513 F.C. ANDLAU ANDLAU 14 508937 A.S. ANDOLSHEIM ANDOLSHEIM 1 513888 F.C. ARTOLSHEIM ARTOLSHEIM 10 526915 U.S. ARTZENHEIM ARTZENHEIM 10 522585 A.S. ASCHBACH ASCHBACH 10 581795 F.C. ASPACH LE BAS ASPACH LE BAS 14 504111 A.S. ASPACH LE HAUT ASPACH LE HAUT 3 529503 F.C. AVOLSHEIM AVOLSHEIM 10 521624 F.C. BALBRONN BALBRONN 12 522984 U.S. BALDENHEIM BALDENHEIM 3 503977 F.C. BALDERSHEIM BALDERSHEIM 3 522377 F.C. BALLERSDORF BALLERSDORF 12 520393 F.C. BALSCHWILLER BALSCHWILLER 7 504027 F.C. BANTZENHEIM BANTZENHEIM 5 552740 F. A. BRUCHE BAREMBACH BAREMBACH 7 503985 F.C. BARR BARR 7 524444 F.C. BARTENHEIM BARTENHEIM 1 523130 F.C. BATTENHEIM BATTENHEIM 12 849421 F. ALSACE NORD BATZENDORF 14 508931 STE S. BEINHEIM BEINHEIM 10 500207 A.S. BENFELD BENFELD 10 521635 F.C. BENNWIHR BENNWIHR 3 529482 A.S. BERGBIETEN BERGBIETEN 12 517398 S. REUNIS BERGHEIM BERGHEIM 7 554123 BERGHOLTZ F. C. BERGHOLTZ 10 514412 CERCLE S. BERNARDSWILLER BERNARDSWILLER 12 521283 A.S. BERRWILLER HARTMANNSWILLER BERRWILLER 1 526641 A.S.L.C. BERSTETT BERSTETT 7 504010 A.S.