RCT Le Vote Final Du Senat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal Officiel Du 29 Juin 2017
Année 2017 ISSN 0242-6765 Mardi 4 juillet 2017 JOURNAL DOFFICIELE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES CONGRÈS DU PARLEMENT Lundi 3 juillet 2017 Compte rendu intégral 2 CONGRÈS DU PARLEMENT – SÉANCE DU 3 JUILLET 2017 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS DE RUGY Mme Virginie Duby-Muller M. Didier Guillaume 1. Constitution du Parlement en Congrès (p. 3) M. Marc Fesneau 2. Hommage à Simone Veil (p. 3) M. Vincent Capo-Canellas 3. Déclaration de M. le Président de la République (p. 3) M. Franck Riester M. Emmanuel Macron, Président de la République M. François Patriat Suspension et reprise de la séance (p. 13) M. Olivier Faure 4. Débat sur la déclaration du Président de la République (p. 13) M. Gilbert Barbier M. Richard Ferrand M. Philippe Adnot M. Bruno Retailleau 5. Clôture de la session du Congrès (p. 25) CONGRÈS DU PARLEMENT – SÉANCE DU 3 JUILLET 2017 3 COMPTE RENDU INTÉGRAL PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS DE RUGY 3 M. le président. La séance est ouverte. DÉCLARATION DE M. LE PRÉSIDENT DE (La séance est ouverte à quinze heures.) LA RÉPUBLIQUE M. le président. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. M. Emmanuel Macron, Président de la République. 1 Monsieur le président du Congrès, monsieur le président du Sénat, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, CONSTITUTION DU PARLEMENT EN CONGRÈS en son article 18, la Constitution permet au Président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à M. le président. -
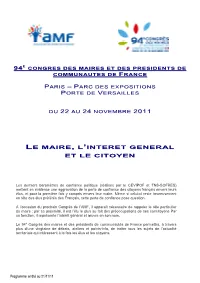
Pré Programme Congrès 2011
E 94 CONGRES DES MAIRES ET DES PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE FRANCE PARIS – PARC DES EXPOSITIONS PORTE DE VERSAILLES DU 22 AU 24 NOVEMBRE 2011 LE MAIRE, L’INTERET GENERAL ET LE CITOYEN Les derniers baromètres de confiance politique (réalisés par le CEVIPOF et TNS-SOFRES) mettent en évidence une aggravation de la perte de confiance des citoyens français envers leurs élus, et pour la première fois y compris envers leur maire. Même si celui-ci reste heureusement en tête des élus préférés des Français, cette perte de confiance pose question. A l’occasion du prochain Congrès de l’AMF, il apparaît nécessaire de rappeler le rôle particulier du maire : par sa proximité, il est l’élu le plus au fait des préoccupations de ses concitoyens Par sa fonction, il représente l’intérêt général et œuvre en son nom. Le 94 e Congrès des maires et des présidents de communautés de France permettra, à travers plus d’une vingtaine de débats, ateliers et points-info, de traiter tous les sujets de l’actualité territoriale qui intéressent à la fois les élus et les citoyens. Programme arrêté au 21/11/11 AMF Page 2 21/11/2011 Lundi 21 novembre 2011 ////////////////////////////// Réunion annuelle des maires d’Outre-mer à l’Hôtel de Ville de Paris 9h30 - Ouverture par Bertrand Delanoë , maire de Paris et Jacques Pélissard , président de l’AMF En présence de Ghislaine Arlie , maire de Farino (988), présidente de l’association française des maires de Nouvelle- Calédonie, Ibrahim Amédi Boinahery , maire de Tsingoni (976), président de l’association des maires de Mayotte, -
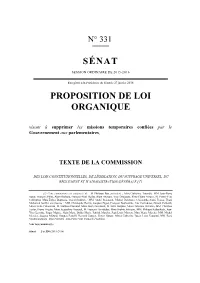
TA Suppr Missions Temp
N° 331 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 janvier 2016 PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE visant à supprimer les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires , TEXTE DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES , DE LÉGISLATION , DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1) (1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean- Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . Voir le(s) numéro(s) : Sénat : 3 et 330 (2015-2016) - 3 - PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE VISANT À SUPPRIMER LES MISSIONS TEMPORAIRES CONFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT AUX PARLEMENTAIRES Article 1 er I. – Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L.O. 144 est abrogé ; 2° Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ». -

Sénat Proposition De Résolution
N° 428 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 2009 PROPOSITION DE RÉSOLUTION tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat, TEXTE DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1), (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. Voir le(s) numéro(s) : Sénat : 377 et 427 (2008-2009) - 3 - PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DU SÉNAT POUR METTRE EN ŒUVRE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE, CONFORTER LE PLURALISME SÉNATORIAL ET RÉNOVER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU SÉNAT Article 1er Composition du Bureau du Sénat I. -

Du Premier Au Second Gouvernement Temaru: Une Annee De Crise Politique Et Institutionnelle
1 DU PREMIER AU SECOND GOUVERNEMENT TEMARU: UNE ANNEE DE CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE EmmanuelPie Guiselin * Il arrive parfois que le temps politique s’accélère. Pour la Polynésie française, une page clef de l’histoire vient de s’écrire avec le retour au pouvoir de l’Union pour la démocratie (UPLD) et de son leader Oscar Temaru. Ce retour est intervenu à la faveur des élections partielles du 13 février 2005, moins de cinq mois après que le premier gouvernement Temaru ait été renversé par une motion de censure. Entre l’UPLD et le Tahoeraa Huiraatira, entre Oscar Temaru et Gaston Flosse, le cadre statutaire et le mode de scrutin ont constitué la toile de fond d’un combat plus profond mettant aux prises légalité et légitimité. Sometimes the political tempo of a country speeds up. In the case of French Polynesia, a major chapter in its history was written with the return to power of the Union for Democracy party (UPLD) and its leader Oscar Temaru. This came about as a result of the partial elections of 13 February 2005, that is less than 5 months after the first Temaru government had been ousted by a censure motion. Between UPLD and Tahoeraa Hiuraatira, between Oscar Temaru and Gaston Flosse, the legal framework and the voting system created the backdrop for a significant battle concerning legality and legitimacy. 27 février 2004, 7 mars 2005 1. Un peu plus de douze mois séparent ces deux dates, la première marquant la promulgation de la loi organique relative au nouveau statut d’autonomie de la Polynésie française 2, la seconde portant présentation du second gouvernement constitué par Oscar Temaru. -
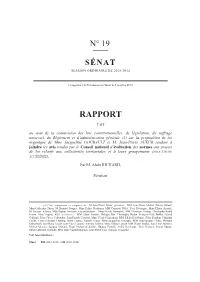
1 Rapport (Modrap2012) PPLO Normes Richard
N° 19 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 octobre 2013 RAPPORT FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur la proposition de loi organique de Mme Jacqueline GOURAULT et M. Jean-Pierre SUEUR tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs groupements (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE), Par M. Alain RICHARD, Sénateur (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur, président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains, vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès, secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre -

Format Acrobat
N° 130 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 2008 RAPPORT D’INFORMATION FAIT au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) à la suite d’une mission d’information effectuée en Polynésie française du 21 avril au 2 mai 2008, Par MM. Christian COINTAT et Bernard FRIMAT, Sénateurs. (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas, secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. - 3 - SOMMAIRE Pages EXAMEN EN COMMISSION..................................................................................................... -

Les Contrats De Partenariat : Des Bombes À Retardement ?
N° 733 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2014 RAPPORT D´INFORMATION FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur les partenariats publics -privés , Par MM. Jean-Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI, Sénateurs. (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Vincent Capo- Canellas, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Mme Isabelle Lajoux, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . - 3 - S O M M A I R E Pages LISTE DES RECOMMANDATIONS ..................................................................................... 5 AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 7 I. LE CONTRAT DE PARTENARIAT : UN OUTIL EN VOIE DE BANALISATION ....... 9 A. UN OUTIL D’INSPIRATION BRITANNIQUE ................................................................... 9 B. À L’ORIGINE, UN OUTIL DÉROGATOIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE .............. 10 1. Le recours à un contrat global justifié par la complexité ou l’urgence d’un projet ................ -
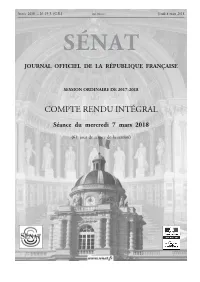
Et Au Format
o Année 2018. – N 19 S. (C.R.) ISSN 0755-544X Jeudi 8 mars 2018 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du mercredi 7 mars 2018 (61e jour de séance de la session) 1974 SÉNAT – SÉANCE DU 7 MARS 2018 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE DALLIER Article additionnel avant l’article 1er A (p. 1990) o Secrétaires : Amendement n 9 de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait. Mme Agnès Canayer, M. Yves Daudigny. Article 1er A (nouveau) – Adoption. (p. 1990) 1. Procès-verbal (p. 1976) Article 1er (supprimé) (p. 1990) 2. Rappel au règlement (p. 1976) Amendement no 1 rectifié de M. Franck Montaugé. – Rejet. Mme Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE ; L’article demeure supprimé. M. Philippe Bas, président de la commission des lois ; Mme Nathalie Goulet ; M. Olivier Dussopt, secrétaire Article 1er bis (nouveau) – Adoption. (p. 1991) d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ; M. Marc Daunis : M. Jean-Claude Requier, Article 1er ter (nouveau) (p. 1992) président du groupe du RDSE ; M. Philippe Bas, prési- dent de la commission des lois ; M. le président. Mme Élisabeth Lamure Suspension et reprise de la séance (p. 1978) Amendement no 10 de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption. 3. Qualité des études d’impact des projets de loi. – Discussion d’une proposition de loi organique dans le texte de la Adoption de l’article modifié. commission (p. 1978) Article 2 (p. 1993) Discussion générale : M. Franck Montaugé M. Franck Montaugé, auteur de la proposition de loi organique Amendement no 7 de M. -

Changes and Continuities in the Formation of the 2017 French Government
Fr Polit (2017) 15:340–359 DOI 10.1057/s41253-017-0042-9 ORIGINAL ARTICLE A mould-breaking cabinet? Changes and continuities in the formation of the 2017 French government Cristina Bucur1 Published online: 1 August 2017 Ó Macmillan Publishers Ltd 2017 Abstract Emmanuel Macron’s election as President of the Republic and the for- mation of a government that includes a mix of politicians from parties on the left and right of the political spectrum, as well as a significant share of non-partisan ministers, has been hailed by numerous commentators as an unprecedented overhaul of France’s political life. This article examines how the two cabinets formed under prime minister E´ douard Philippe in the shadow of the 2017 presidential and par- liamentary elections compare to previous governments in the Fifth Republic. The analysis reveals a less than revolutionary break with previous patterns of govern- ment size, channels of ministerial recruitment, portfolio allocation, gender balance, and ethnic diversity. Keywords France Á Cabinet Á Ministers Á Political parties Á Gender Á Ethnic diversity The president and the prime minister appointment The Constitution of the Fifth Republic places the president at the centre of the government formation process. Article 8 grants the head of state unconstrained power to select the prime minister and to appoint all other cabinet members on his or her proposal. Thus, favourable circumstances, such as the support of a majority in parliament, allow the head of state to appoint a loyal and/or at least subordinate prime minister and take control over the government (Elgie 2013: 20). -

Sénateurs Département Email M
Sénateurs Département Email M. Jacques BERTHOU Ain [email protected] M. Rachel MAZUIR Ain [email protected] Mme Sylvie GOY-CHAVENT Ain [email protected] M. Antoine LEFÈVRE Aisne [email protected] M. Pierre ANDRÉ Aisne [email protected] M. Yves DAUDIGNY Aisne [email protected] M. Gérard DÉRIOT Allier [email protected] Mme Mireille SCHURCH Allier [email protected] M. Claude DOMEIZEL Alpes de Haute-Provence [email protected] M. Jean-Pierre LELEUX Alpes-Maritimes [email protected] M. Louis NÈGRE Alpes-Maritimes [email protected] M. Marc DAUNIS Alpes-Maritimes [email protected] M. René VESTRI Alpes-Maritimes [email protected] Mme Colette GIUDICELLI Alpes-Maritimes [email protected] M. Michel TESTON Ardèche [email protected] M. Yves CHASTAN Ardèche [email protected] M. Benoît HURÉ Ardennes [email protected] M. Marc LAMÉNIE Ardennes [email protected] M. Jean-Pierre BEL Ariège [email protected] M. Philippe ADNOT Aube [email protected] M. Yann GAILLARD Aube [email protected] M. Marcel RAINAUD Aude [email protected] M. Roland COURTEAU Aude [email protected] M. Stéphane MAZARS Aveyron [email protected] M. Alain FAUCONNIER Aveyron [email protected] M. André REICHARDT Bas-Rhin [email protected] M. Francis GRIGNON Bas-Rhin [email protected] M. Roland RIES Bas-Rhin [email protected] Mme Esther SITTLER Bas-Rhin [email protected] Mme Fabienne KELLER Bas-Rhin [email protected] M. -

Élections Sénatoriales
Lundi 29 septembre 2014 DIRECTION DE LA SÉANCE ÉLECTIONS SÉNATORIALES SCRUTIN DU 28 SEPTEMBRE 2014 SÉRIE 2 R É SUL TA TS OFFICIELS DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 2 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES Nuances politiques individuelles des candidats LIBELLÉ SIGNIFICATION EXG Extrême gauche FG Front de gauche PG Parti de gauche COM Parti Communiste Français SOC Parti Socialiste RDG Parti Radical de Gauche DVG Divers gauche VEC Europe Ecologie Les Verts ECO Ecologiste REG Régionaliste DIV Divers MDM Mouvement démocrate UDI Union des démocrates et indépendants UMP Union pour un Mouvement Populaire DLR Debout la République DVD Divers droite FN Front National EXD Extrême droite 3 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES Nuances politiques des listes LIBELLÉ SIGNIFICATION LEXG Liste d'extrême gauche LFG Liste présentée par le Front de gauche LCOM Liste présentée par le PCF, hors Front de gauche LPG Liste du Parti de gauche, hors Front de gauche LSOC Liste du Parti Socialiste LVEC Liste présentée par Europe Ecologie Les Verts LRDG Liste présentée par le Parti Radical de Gauche LDVG Liste divers gauche LUG Liste d'union de la gauche LDIV Autre liste LREG Liste régionaliste LMDM Liste présentée par le MoDem LUDI Liste présentée par l'UDI LCEN Liste d'union du centre LUD Liste d'union de la droite et du centre LUMP Liste de l'UMP LDLR Liste Debout la République LDVD Liste divers droite LFN Liste du Front National LEXD Liste d'extrême droite 4 I. – FRANCE MÉTROPOLITAINE 5 01 - AIN Sénateurs sortants : 3 3 sièges à pourvoir M. Jacques BERTHOU (App. Soc.) Représentation proportionnelle Mme Sylvie GOY-CHAVENT (UDI-UC) M.