Universite D'antananarivo Faculte Des Sciences
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Western Madagascan Vegetation
Plant Formations in the Western Madagascan BioProvince Peter Martin Rhind Western Madagascan Dry Deciduous Forests of Lateritic Clay These soils support the most luxuriant forests of east Madagascar and are usually characterized by endemic species such as Cordyla madagascariensis and Givotia madagascariensis, and a variety of endemic species of the genera Dalbergia and Ravensara. Other important trees include Stereospermum euphorioides and Xylia hildebrandtii. Most of the lianas belong to the Asclepiadaceae or genera such as Combretum, Dichapetalum, Landolphia and Tetracena, while most of the under story is characterized by species of the Euphorbiaceae, Fabaceae and Rubiaceae. A feature unique to these forests is the presence of a species Dracaena and a bamboo that have deciduous leaves. Western Madagascan Dry Deciduous Forests of Sandy Soils The soils of these forests are derived from Jurassic and Cretaceous sandstones, but where they are very dry the forests are reduced to thicket. In the more fully developed forests the arborescent species usually display a three-layered structure. The upper layer or canopy consists of trees taller than 12 m, but comparatively few species are capable of reaching these heights. They normally include mainly endemic species such as Adansonia grandidieri, A. rubrostipa, A. za, (Malvaceae), Capurodendron greveanum (Sapotaceae), Cedrelopsis grevei (Rutaceae), Commiphora arafy, C. mafaidoha (Burseraceae), Cordyla madagascariensis (Fabaceae), Dalbergia purpuresens (Fabaceae), Delonix boiviniana (Fabaceae) and Hazomalania voyroni (Hernandiaceae). The middle layer grows to between 6-21 m high and frequently includes a number of evergreen species. Among the common taxa are endemic species such as Cedrelopsis gracilos, C. microfoliolata (Rutaceae), Fernandoa madagascariensis (Bignoniaceae), Operculicarya gummifera (Anacardiaceae) and Tetrapterocarpon geayi (Fabaceae). -

Bulletin Juin 2012
MISSIONS TECHNIQUES Intervenants : Daniel LE DIASCORN et Jean-Guy MOREAU. BULLETIN INFOS Les missions techniques ont pour but d’équiper des CSB situés dans la région de Diego Suarez, d’installations électriques solaires. Ces installations sont composées de panneaux solaires et de batteries 12 volts qui distribuent la JUIN 201 2 lumière dans le bâtiment et fournissent une source de 220 v par l’intermédiaire d’un convertisseur 12 v – 220 v. Depuis 2006 les missions techniques ont permis d’équiper cinq CSB de Mahavanona, Berafia, Ankétrakabé, Joffreville et Mangaoka. Suivant les disponibilités financières et techniques de l'association, il est possible d’équiper un centre par an, tout en assurant la maintenance et l’amélioration de ceux existants. Les programmes d’intervention sont élaborés en accord avec la Direction Régionale de la Santé, représentée par le Dr Romeline et le bureau du Conseil EDITO Général du Finistère à Diego. Une mission technique est prévue pour la période d'octobre – novembre 2012. Le Dr Romeline et le CG29 nous ont proposé pour la prochaine mission de réhabiliter des sites équipés il y a plusieurs Réflexions… années, mais dont les installations sont hors d’usage à la suite de la défaillance de certains éléments (généralement les batteries). Voici venu le temps du bulletin de l’été. Les annonces faites lors du dernier se sont réalisées. Le repas malgache du 4 février a été un succès : la cuisine d’Anne et ses copines était, comme toujours, bonne Les sites proposés sont : et l’ambiance fort amicale. Nous avons participé à bien des manifestations organisées par ou pour les associations brestoises. -

Memoire : Master En Physique Et Applications
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION PHYSIQUE ET APPLICATIONS PARCOUR S EN INGENIERIE EN ENERGIES RENOUVELABLES MEMOIRE : MASTER EN PHYSIQUE ET APPLICATIONS E LECTRIFICATION DU VILLAGE D ’ANTSATSAKA PAR ÉNERGIES RENOUVELABLES ET REALISATION DE COMMANDE D’ELECTRIFICATION PAR MICROCONTROLEUR Présenté par : NOVY FLAVIE Membres du jury Président de jury : Mme RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo Professeur Titulaire Rapporteur : M. RAMANANTSOA Ravo Maître de Conférences Examinateur : Mme RAKOTO JOSEPH Onimihamina Maître de Conférences : M.RASAMIMANANA François de Salle Maître de Conférences 27 Octobre 2016 Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master d’Ingénierie en Energie Renouvelable Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master d’Ingénierie en Energie Renouvelable UNIVERSITE D’ANTANANARIVO DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION PHYSIQUE ET APPLICATIONS PARCOUR S EN INGENIERIE EN ENERGIES RENOUVELABLES MEMOIRE : MASTER EN PHYSIQUE ET APPLICATIONS ELECTRIFICATION DU VILLAGE D ’ANTSATSAKA PAR ÉNERGIES RENOUVELABLES ET REALISATION DE COMMANDE D’ELECTRIFICATION PAR MICROCONTROLEUR Présenté par : NOVY FLAVIE Membres du jury Président de jury : Mme RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo Professeur Titulaire Rapporteur : M. RAMANANTSOA Ravo Maître de Conférences Examinateur : Mme RAKOTO JOSEPH Onimihamina Maître de Conférences : M.RASAMIMANANA François de Salle Maître de Conférences RAZANAMANAMPISOA Harimalala Mémoire pour l’obtention du diplôme de Master d’Ingénierie en Energie Renouvelable REMERCIEMENTS Tout particulièrement, je tiens à exprimer mes vifs remerciements : A Monsieur RAHERIMANDIMBY Marson Professeur titulaire, Responsable de domaine science et technologie, de m’avoir acceptée en tant qu’étudiante au sein de la faculté des sciences. A Monsieur RAKOTONDRAMIHARANA Hery Tiana, Docteur Habilité à diriger des Recherches, Responsable de la mention. A Madame RAMANANTANY Zely Arivelo Professeur Titulaire, qui a bien voulu accorder l’honneur de présider le jury de ma soutenance. -

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Dry Forest Trees of Madagascar
The Red List of Dry Forest Trees of Madagascar Emily Beech, Malin Rivers, Sylvie Andriambololonera, Faranirina Lantoarisoa, Helene Ralimanana, Solofo Rakotoarisoa, Aro Vonjy Ramarosandratana, Megan Barstow, Katharine Davies, Ryan Hills, Kate Marfleet & Vololoniaina Jeannoda Published by Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK. © 2020 Botanic Gardens Conservation International ISBN-10: 978-1-905164-75-2 ISBN-13: 978-1-905164-75-2 Reproduction of any part of the publication for educational, conservation and other non-profit purposes is authorized without prior permission from the copyright holder, provided that the source is fully acknowledged. Reproduction for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission from the copyright holder. Recommended citation: Beech, E., Rivers, M., Andriambololonera, S., Lantoarisoa, F., Ralimanana, H., Rakotoarisoa, S., Ramarosandratana, A.V., Barstow, M., Davies, K., Hills, BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL (BGCI) R., Marfleet, K. and Jeannoda, V. (2020). Red List of is the world’s largest plant conservation network, comprising more than Dry Forest Trees of Madagascar. BGCI. Richmond, UK. 500 botanic gardens in over 100 countries, and provides the secretariat to AUTHORS the IUCN/SSC Global Tree Specialist Group. BGCI was established in 1987 Sylvie Andriambololonera and and is a registered charity with offices in the UK, US, China and Kenya. Faranirina Lantoarisoa: Missouri Botanical Garden Madagascar Program Helene Ralimanana and Solofo Rakotoarisoa: Kew Madagascar Conservation Centre Aro Vonjy Ramarosandratana: University of Antananarivo (Plant Biology and Ecology Department) THE IUCN/SSC GLOBAL TREE SPECIALIST GROUP (GTSG) forms part of the Species Survival Commission’s network of over 7,000 Emily Beech, Megan Barstow, Katharine Davies, Ryan Hills, Kate Marfleet and Malin Rivers: BGCI volunteers working to stop the loss of plants, animals and their habitats. -

First Steps Towards a Floral Structural Characterization of the Major Rosid Subclades
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2006 First steps towards a floral structural characterization of the major rosid subclades Endress, P K ; Matthews, M L Abstract: A survey of our own comparative studies on several larger clades of rosids and over 1400 original publications on rosid flowers shows that floral structural features support to various degrees the supraordinal relationships in rosids proposed by molecular phylogenetic studies. However, as many apparent relationships are not yet well resolved, the structural support also remains tentative. Some of the features that turned out to be of interest in the present study had not previously been considered in earlier supraordinal studies. The strongest floral structural support is for malvids (Brassicales, Malvales, Sapindales), which reflects the strong support of phylogenetic analyses. Somewhat less structurally supported are the COM (Celastrales, Oxalidales, Malpighiales) and the nitrogen-fixing (Cucurbitales, Fagales, Fabales, Rosales) clades of fabids, which are both also only weakly supported in phylogenetic analyses. The sister pairs, Cucurbitales plus Fagales, and Malvales plus Sapindales, are structurally only weakly supported, and for the entire fabids there is no clear support by the present floral structural data. However, an additional grouping, the COM clade plus malvids, shares some interesting features but does not appear as a clade in phylogenetic analyses. Thus it appears that the deepest split within eurosids- that between fabids and malvids - in molecular phylogenetic analyses (however weakly supported) is not matched by the present structural data. Features of ovules including thickness of integuments, thickness of nucellus, and degree of ovular curvature, appear to be especially interesting for higher level relationships and should be further explored. -

Nosy Be Et Diégo I Qui Sont Caractéristiques Par Composante Du Les Pôles De La Région
TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES Introduction : Le SRAT un projet du territoire..... 4 Variables influençant l’espace physique et Chapitre 1: La Diana en 2010 .......................... 7 les ressources naturelles ....................... 53 1. La Diana, un résumé de l’espace Malgache Variables influençant l’évolution de la 9 société ................................................. 55 2. L’espace régional de la Diana : une Variables influençant le développement mosaïque de contrastes… ............................... 9 économique ......................................... 57 3. L’organisation actuelle du territoire ......... 13 Variables influençant la structure du Une population hétérogène selon la territoire ............................................... 59 structure ethnique ................................. 13 8. Les hypothèses d’évolution ................... 60 La question de la formation et l’éducation Evolution de l’espace physique et de la société : les facteurs influents ........ 14 ressources naturelles ............................ 60 Le mode de gouvernance du territoire .... 14 Evolution de la société .......................... 61 Des systèmes d’activités différenciés et Evolution du développement économique localisés .............................................. 19 ........................................................... 65 Des structures territoriales anciennes et Evolution de la structure du territoire ...... 69 résistantes. .......................................... 25 9. Les différents scénarios possibles de la -

583–584 Angiosperms 583 *Eudicots and Ceratophyllales
583 583 > 583–584 Angiosperms These schedules are extensively revised, having been prepared with little reference to earlier editions. 583 *Eudicots and Ceratophyllales Subdivisions are added for eudicots and Ceratophyllales together, for eudicots alone Class here angiosperms (flowering plants), core eudicots For monocots, basal angiosperms, Chloranthales, magnoliids, see 584 See Manual at 583–585 vs. 600; also at 583–584; also at 583 vs. 582.13 .176 98 Mangrove swamp ecology Number built according to instructions under 583–588 Class here comprehensive works on mangroves For mangroves of a specific order or family, see the order or family, e.g., mangroves of family Combretaceae 583.73 .2 *Ceratophyllales Class here Ceratophyllaceae Class here hornworts > 583.3–583.9 Eudicots Class comprehensive works in 583 .3 *Ranunculales, Sabiaceae, Proteales, Trochodendrales, Buxales .34 *Ranunculales Including Berberidaceae, Eupteleaceae, Menispermaceae, Ranunculaceae Including aconites, anemones, barberries, buttercups, Christmas roses, clematises, columbines, delphiniums, hellebores, larkspurs, lesser celandine, mandrake, mayapple, mayflower, monkshoods, moonseeds, wolfsbanes For Fumariaceae, Papaveraceae, Pteridophyllaceae, see 583.35 See also 583.9593 for mandrakes of family Solanaceae .35 *Fumariaceae, Papaveraceae, Pteridophyllaceae Including bleeding hearts, bloodroot, celandines, Dutchman’s breeches, fumitories, poppies See also 583.34 for lesser celandine .37 *Sabiaceae * *Add as instructed under 583–588 1 583 Dewey Decimal Classification -
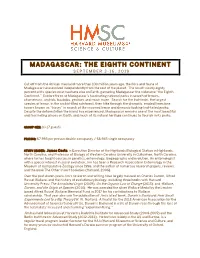
Madagascar Have Evolved Independently from the Rest of the Planet
M ADAGASCAR: THE EIGHTH CONTINENT SEPTEMBER 3 - 16, 2019 Cut off from the African mainland more than 100 million years ago, the flora and fauna of Madagascar have evolved independently from the rest of the planet. The result: nearly eighty percent of its species exist nowhere else on Earth, garnering Madagascar the nickname “the Eighth Continent.” Explore three of Madagascar’s fascinating national parks in search of lemurs, chameleons, orchids, baobabs, geckoes and much more. Search for the Indri indri, the largest species of lemur, in the orchid-filled rainforest, then hike through the dramatic, eroded limestone towers known as “tsingy” in search of the crowned lemur and demonic-looking leaf-tailed gecko. Despite the deforestation the island has experienced, Madagascar remains one of the most beautiful and fascinating places on Earth, and much of its natural heritage continues to flourish in its parks. GROUP SIZE: 10-17 guests PRICING: $7,995 per person double occupancy / $8,945 single occupancy STUDY LEADER: James Costa, is Executive Director of the Highlands Biological Station in Highlands, North Carolina, and Professor of Biology at Western Carolina University in Cullowhee, North Carolina, where he has taught courses in genetics, entomology, biogeography and evolution. An entomologist with a special interest in social evolution, Jim has been a Research Associate in Entomology in the Museum of Comparative Zoology since 1996, and the author of numerous research papers, reviews, and the book The Other Insect Societies (Harvard, 2006). Over the past dozen years Jim's research and writing have largely focused on Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, and the history of evolutionary biology, including three books with Harvard University Press: The Annotated Origin (2009), On the Organic Law of Change (2013), and Wallace, Darwin, and the Origin of Species (2014). -

T T Elodie 2011
UNIVERSITÉ DE TOAMASINA FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION **************************** DÉPARTEMENT DE GESTION MÉMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAÎTRISE ÈS SCIENCES DE GESTION PROJET DE CRÉATION D’UNE DÉCORTIQUERIE-PROVENDERIE Dans le District d’Antsiranana I, RÉGION DIANA Présenté et soutenu par : Thérèse Elodie TSANGAMBELO Option: Finances et Comptabilité Promotion 200 8 - 20 09 Sous la direction de : Monsieur LEMIARY Monsieur JAOSARA Enseignant chercheur à l’Université de Chef de service provincial du génie rurale Toamasina d’Antsiranana Encadreur Enseignant Encadreur Professionnel 18 Avril1 : 2011 UNIVERSITÉ DE TOAMASINA FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION ****************************** DÉPARTEMENT DE GESTION MÉMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAÎTRISE ÈS SCIENCES DE GESTION PROJET DE CRÉATION D’UNE DÉCORTIQUERIE-PROVENDERIE Dans le District d’Antsiranana I, RÉGION DIANA Présenté et soutenu par : Thérèse Elodie TSANGAMBELO Option: Finances et Comptabilité Promotion 200 8 - 20 09 Sous la direction de : Monsieur LEMIARY Monsieur JAOSARA Enseignant chercheur à l’Université de Chef de service provincial du génie rurale Toamasina d’Antsiranana Encadreur Enseignant Encadreur Professionnel 18 Avril2 : 2011 SOMMAIRE REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................4 LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET ACRONYMES ........................................................5 GLOSSAIRE ................................................................................................................................................6 -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Flowering Plant Systematics
Angiosperm Phylogeny Flowering Plant Systematics woody; vessels lacking dioecious; flw T5–8, A∞, G5–8, 1 ovule/carpel, embryo sac 9-nucleate 1 species, New Caledonia 1/1/1 Amborellaceae AMBORELLALES G A aquatic, herbaceous; cambium absent; aerenchyma; flw T4–12, A1–∞, embryo sac 4-nucleate seeds operculate with perisperm but endosperm reduced or small R mucilage; alkaloids (no benzylisoquinolines) 3/6/74 YMPHAEALES Cabombaceae Hydatellaceae Nymphaeaceae A N N woody, vessels solitary D flw T>10, A , G ca.9, embryo sac 4-nucleate ∞ Austrobaileyaceae Schisandraceae (incl. Illiciaceae) Trimeniaceae tiglic acid, aromatic terpenoids 3/5/100 E AUSTROBAILEYALES A lvs opposite, interpetiolar stipules flw small T0–3, A1–5, G1, 1 apical ovule/carpel A 1/4/75 Chloranthaceae E nodes swollen CHLORANTHALES N woody; foliar sclereids A K and C distinct G aromatic terpenoids 2/10/125 CANELLALES Canellaceae Winteraceae R idioblasts spherical in I nodes trilacunar ± herbaceous; lvs two-ranked, leaf base sheathing single adaxial prophyll L Aristolochiaceae (incl. Hydnoraceae) Piperaceae Saururaceae O nodes swollen 4/17/4170 IPERALES P Y sesquiterpenes S woody; lvs opposite flw with hypanthium, staminodes frequent Calycanthaceae Hernandiaceae Monimiaceae tension wood + wood tension (pellucid dots) (pellucid ethereal oils ethereal P anthers often valvate; carpels with 1 ovule; embryo large 7/91/2858 AURALES Gomortegaceae Lauraceae Siparunaceae L E MAGNOLIIDS woody; pith septate; lvs two-ranked ovules with obturator Annonaceae Eupomatiaceae Magnoliaceae endosperm