Les Parasites De Poisson : Agents De Zoonoses
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Variations Spatio-Temporelles De La Structure Taxonomique Et La Compétition Alimentaire Des Poissons Du Lac Tonlé Sap, Cambodge Heng Kong
Variations spatio-temporelles de la structure taxonomique et la compétition alimentaire des poissons du lac Tonlé Sap, Cambodge Heng Kong To cite this version: Heng Kong. Variations spatio-temporelles de la structure taxonomique et la compétition alimentaire des poissons du lac Tonlé Sap, Cambodge. Ecologie, Environnement. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2018. Français. NNT : 2018TOU30122. tel-02277574 HAL Id: tel-02277574 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02277574 Submitted on 3 Sep 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE En vue de l’obtention du DOCTORAT DE L’UNIVERSITE DE TOULOUSE Délivré par : Université Toulouse 3 Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier) Présentée et soutenue par : Heng KONG Le 03 Juilet 2018 Titre : Variations spatio-temporelles de la structure taxonomique et la compétition alimentaire des poissons du lac Tonlé Sap, Cambodge Ecole doctorale et discipline ou spécialité : ED SDU2E : Ecologie fonctionnelle Unité de recherche : Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (EcoLab) UMR 5245, CNRS – -

Hung:Makieta 1.Qxd
DOI: 10.2478/s11686-013-0155-5 © W. Stefan´ski Institute of Parasitology, PAS Acta Parasitologica, 2013, 58(3), 231–258; ISSN 1230-2821 INVITED REVIEW Global status of fish-borne zoonotic trematodiasis in humans Nguyen Manh Hung1, Henry Madsen2* and Bernard Fried3 1Department of Parasitology, Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam; 2Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C, Denmark; 3Department of Biology, Lafayette College, Easton, PA 18042, United States Abstract Fishborne zoonotic trematodes (FZT), infecting humans and mammals worldwide, are reviewed and options for control dis- cussed. Fifty nine species belonging to 4 families, i.e. Opisthorchiidae (12 species), Echinostomatidae (10 species), Hetero- phyidae (36 species) and Nanophyetidae (1 species) are listed. Some trematodes, which are highly pathogenic for humans such as Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, O. felineus are discussed in detail, i.e. infection status in humans in endemic areas, clinical aspects, symptoms and pathology of disease caused by these flukes. Other liver fluke species of the Opisthorchiidae are briefly mentioned with information about their infection rate and geographical distribution. Intestinal flukes are reviewed at the family level. We also present information on the first and second intermediate hosts as well as on reservoir hosts and on habits of human eating raw or undercooked fish. Keywords Clonorchis, Opisthorchis, intestinal trematodes, liver trematodes, risk factors Fish-borne zoonotic trematodes with feces of their host and the eggs may reach water sources such as ponds, lakes, streams or rivers. -

Molecular Detection of Human Parasitic Pathogens
MOLECULAR DETECTION OF HUMAN PARASITIC PATHOGENS MOLECULAR DETECTION OF HUMAN PARASITIC PATHOGENS EDITED BY DONGYOU LIU Boca Raton London New York CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742 © 2013 by Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business No claim to original U.S. Government works Version Date: 20120608 International Standard Book Number-13: 978-1-4398-1243-3 (eBook - PDF) This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint. Except as permitted under U.S. Copyright Law, no part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers. For permission to photocopy or use material electronically from this work, please access www.copyright.com (http://www.copyright.com/) or contact the Copyright Clearance Center, Inc. -

Fishborne Trematode Metacercariae in Luang Prabang, Khammouane, and Saravane Province, Lao PDR
ISSN (Print) 0023-4001 ISSN (Online) 1738-0006 Korean J Parasitol Vol. 51, No. 1: 107-114, February 2013 http://dx.doi.org/10.3347/kjp.2013.51.1.107 Fishborne Trematode Metacercariae in Luang Prabang, Khammouane, and Saravane Province, Lao PDR 1 2, 3 4 5 6 Han-Jong Rim , Woon-Mok Sohn *, Tai-Soon Yong , Keeseon S. Eom , Jong-Yil Chai , Duk-Young Min , Soon-Hyung Lee7, Eui-Hyug Hoang7, Bounlay Phommasack8 and Sithat Insisiengmay8 1Department of Parasitology, Korea University College of Medicine, Seoul 136-705, Korea; 2Department of Parasitology and Institute of Health Sciences, Gyeongsang National University School of Medicine, Jinju 660-751, Korea; 3Department of Environmental Medical Biology and Institute of Tropical Medicine, Yonsei University College of Medicine, Seoul 120-752, Korea; 4Department of Parasitology and Medical Research Institute, Chungbuk National University School of Medicine, Cheongju 361-763, Korea; 5Department of Parasitology and Tropical Medicine, Seoul National University College of Medicine, Seoul 110-799, Korea; 6Department of Microbiology and Immunology, Eulji University College of Medicine, Daejeon 301-746, Korea; 7Korea Association of Health Promotion, Seoul 157-704, Korea; 8Department of Hygiene and Prevention, Ministry of Public Health, Vientiane, Lao PDR Abstract: Fishborne trematode (FBT) metacercariae were investigated in fish from 3 Provinces of Lao PDR. Total 242 freshwater fish of 40 species were collected in local markets of Luang Prabang (59 fish of 16 species), Khammouane (81 fish of 19 species), and Saravane (97 fish of 14 species), and each of them was examined by artificial digestion method. Four species of metacercariae (Opisthorchis viverrini, Haplorchis taichui, Haplorchis yokogawai, and Centrocestus formo- sanus) were detected. -

A Functional-Morphological Study on the Attachment, Respiration and Feeding Mechanisms in Balitorinae (Balitoridae, Teleostei)
Faculty of Sciences Department of Biology Research group: Evolutionary Morphology of Vertebrates Academic year 2012-2013 A functional-morphological study on the attachment, respiration and feeding mechanisms in Balitorinae (Balitoridae, Teleostei) De Meyer Jens Supervisor: Dr. Tom Geerinckx Thesis submitted to obtain the degree of Tutor: Dr. Tom Geerinckx Master in Biology II © Faculty of Sciences – Evolutionary Morphology of Vertebrates Deze masterproef bevat vertrouwelijk informatie en vertrouwelijke onderzoeksresultaten die toebehoren aan de UGent. De inhoud van de masterproef mag onder geen enkele manier publiek gemaakt worden, noch geheel noch gedeeltelijk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van de UGent vertegenwoordiger, in casu de promotor. Zo is het nemen van kopieën of het op eender welke wijze dupliceren van het eindwerk verboden, tenzij met schriftelijke toestemming. Het niet respecteren van de confidentiële aard van het eindwerk veroorzaakt onherstelbare schade aan de UGent. Ingeval een geschil zou ontstaan in het kader van deze verklaring, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent uitsluitend bevoegd daarvan kennis te nemen. All rights reserved. This thesis contains confidential information and confidential research results that are property to the UGent. The contents of this master thesis may under no circumstances be made public, nor complete or partial, without the explicit and preceding permission of the UGent representative, i.e. the supervisor. The thesis may under no circumstances be copied or duplicated in any form, unless permission granted in written form. Any violation of the confidential nature of this thesis may impose irreparable damage to the UGent. In case of a dispute that may arise within the context of this declaration, the Judicial Court of© All rights reserved. -

Vet February 2017.Indd 85 30/01/2017 09:32 SMALL ANIMAL I CONTINUING EDUCATION
CONTINUING EDUCATION I SMALL ANIMAL Trematodes in farm and companion animals The comparative aspects of parasitic trematodes of companion animals, ruminants and humans is presented by Maggie Fisher BVetMed CBiol MRCVS FRSB, managing director and Peter Holdsworth AO Bsc (Hon) PhD FRSB FAICD, senior manager, Ridgeway Research Ltd, Park Farm Building, Gloucestershire, UK Trematodes are almost all hermaphrodite (schistosomes KEY SPECIES being the exception) flat worms (flukes) which have a two or A number of trematode species are potential parasites of more host life cycle, with snails featuring consistently as an dogs and cats. The whole list of potential infections is long intermediate host. and so some representative examples are shown in Table Dogs and cats residing in Europe, including the UK and 1. A more extensive list of species found globally in dogs Ireland, are far less likely to acquire trematode or fluke and cats has been compiled by Muller (2000). Dogs and cats infections, which means that veterinary surgeons are likely are relatively resistant to F hepatica, so despite increased to be unconfident when they are presented with clinical abundance of infection in ruminants, there has not been a cases of fluke in dogs or cats. Such infections are likely to be noticeable increase of infection in cats or dogs. associated with a history of overseas travel. In ruminants, the most important species in Europe are the In contrast, the importance of the liver fluke, Fasciola liver fluke, F hepatica and the rumen fluke, Calicophoron hepatica to grazing ruminants is evident from the range daubneyi (see Figure 1). -
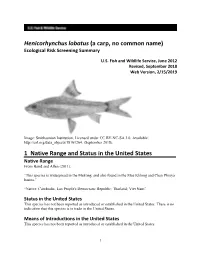
Henicorhynchus Lobatus Ecological Risk Screening Summary
Henicorhynchus lobatus (a carp, no common name) Ecological Risk Screening Summary U.S. Fish and Wildlife Service, June 2012 Revised, September 2018 Web Version, 2/15/2019 Image: Smithsonian Institution. Licensed under CC BY-NC-SA 3.0. Available: http://eol.org/data_objects/18161264. (September 2018). 1 Native Range and Status in the United States Native Range From Baird and Allen (2011): “This species is widespread in the Mekong, and also found in the Mae Khlong and Chao Phraya basins.” “Native: Cambodia; Lao People's Democratic Republic; Thailand; Viet Nam” Status in the United States This species has not been reported as introduced or established in the United States. There is no indication that this species is in trade in the United States. Means of Introductions in the United States This species has not been reported as introduced or established in the United States. 1 Remarks The synonym Gymnostomus lobatus was also used when researching in preparation of this report. From Baird and Allen (2011): “Scientific Name: Gymnostomus lobatus (Smith, 1945)” “Considered by some authors to be in the genus Henicorhynchus, or Cirrhinus.” 2 Biology and Ecology Taxonomic Hierarchy and Taxonomic Standing From ITIS (2018): “Kingdom Animalia Subkingdom Bilateria Infrakingdom Deuterostomia Phylum Chordata Subphylum Vertebrata Infraphylum Gnathostomata Superclass Actinopterygii Class Teleostei Superorder Ostariophysi Order Cypriniformes Superfamily Cyprinoidea Family Cyprinidae Genus Henicorhynchus Species Henicorhynchus lobatus Smith, 1945” From Fricke et al. (2018): “Current status: Valid as Henicorhynchus lobatus Smith 1945. Cyprinidae: Labeoninae.” Size, Weight, and Age Range From Froese and Pauly (2018): “Max length : 15.0 cm SL male/unsexed; [Baird et al. -

Freshwater Fishes of Gegas Dam, South Sumatra Indonesia: Composition and Diversity
Eco. Env. & Cons. 27 (1) : 2021; pp. (216-221) Copyright@ EM International ISSN 0971–765X Freshwater fishes of Gegas Dam, South Sumatra Indonesia: composition and diversity Dian Samitra1,3*, Harmoko1, Sepriyaningsih1, Zico Fakhrur Rozi1, Arum Setiawan2 and Indra Yustian2 1STKIP PGRI Lubuklinggau, Jalan. Mayor Toha Kec. Lubuklinggau Timur 1, Lubuklinggau, South Sumatra, Indonesia 2Departement of Biology, Faculty of Science, Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang- Prabumulih km 32, Indralaya, South Sumatra, 30662, Indonesia. 3Zoology Division, Generasi Biologi Indonesia Fundation (Genbinesia), Jalan Swadaya Barat No.4, Gersik 61171, East Java, Indonesia (Received 5 July, 2020; accepted 11 August, 2020) ABSTRACT Fish studies can be essential information about the health of aquatic ecosystems as well as a basis for policy making management of fish resources. Study of fishes in the Gegas Dam has never been reported.This study aims to determine the diversity of fish in the Gegas Dam. Data collection was conducted during rainy season in March 2020 at the Gegas Dam, Musi Rawas Regency, South Sumatra. Fish samples were caught with fish bait, cast net, gill net, and hexagonal fish trap. The fish obtained are tabulated based on species, genus and family. Data analysis included the index of Shannon diversity, Pielou’s evenness index and Simpson dominance index. Total fishes collected during the study were 414 individuals. The composition of the fish consists of 25 species representing 19 genera, and 12 families. Desmopuntius gemellus is the species most caught during the study. The results of diversity index analysis were 3.01, evenness index was 0.93 and dominance index was 0.05. -

Patterns of Evolution in Gobies (Teleostei: Gobiidae): a Multi-Scale Phylogenetic Investigation
PATTERNS OF EVOLUTION IN GOBIES (TELEOSTEI: GOBIIDAE): A MULTI-SCALE PHYLOGENETIC INVESTIGATION A Dissertation by LUKE MICHAEL TORNABENE BS, Hofstra University, 2007 MS, Texas A&M University-Corpus Christi, 2010 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in MARINE BIOLOGY Texas A&M University-Corpus Christi Corpus Christi, Texas December 2014 © Luke Michael Tornabene All Rights Reserved December 2014 PATTERNS OF EVOLUTION IN GOBIES (TELEOSTEI: GOBIIDAE): A MULTI-SCALE PHYLOGENETIC INVESTIGATION A Dissertation by LUKE MICHAEL TORNABENE This dissertation meets the standards for scope and quality of Texas A&M University-Corpus Christi and is hereby approved. Frank L. Pezold, PhD Chris Bird, PhD Chair Committee Member Kevin W. Conway, PhD James D. Hogan, PhD Committee Member Committee Member Lea-Der Chen, PhD Graduate Faculty Representative December 2014 ABSTRACT The family of fishes commonly known as gobies (Teleostei: Gobiidae) is one of the most diverse lineages of vertebrates in the world. With more than 1700 species of gobies spread among more than 200 genera, gobies are the most species-rich family of marine fishes. Gobies can be found in nearly every aquatic habitat on earth, and are often the most diverse and numerically abundant fishes in tropical and subtropical habitats, especially coral reefs. Their remarkable taxonomic, morphological and ecological diversity make them an ideal model group for studying the processes driving taxonomic and phenotypic diversification in aquatic vertebrates. Unfortunately the phylogenetic relationships of many groups of gobies are poorly resolved, obscuring our understanding of the evolution of their ecological diversity. This dissertation is a multi-scale phylogenetic study that aims to clarify phylogenetic relationships across the Gobiidae and demonstrate the utility of this family for studies of macroevolution and speciation at multiple evolutionary timescales. -

(Liver) Flukes Intestinal Flukes Lung Flukes F
HEPATIC (LIVER) FLUKES INTESTINAL FLUKES LUNG FLUKES F. Gigantica & F.Hepatica Fasciolopsis Buski (LI) Heterophyes Heterophyes Paragonimus Westermani Distribution common parasite of common in Far East especially in Common around brackish watr lakes (North Far East especially in Japan, Korea herbivorous animals. China. Egypt, Far East) and Taiwan. Human infection reported from many regions including Egypt , Africa & Far East . Adult morphology Size & shape - Large fleshy leaf like worm largest trematode parasite to Like trematodes (flattened) Ovoidal, thick, reddish brown. - 3-7 cm infect man Elongated, pyriform/ pear shape. Cuticles is covered w spines - Lateral borders are parallel. 7× 2cm. Rounded posterior end Rounded anteriorly oval in shape covered with small Pointed anterior end Tapering posteriorly spines. some scales like spines cover the 1cm x 5mm thickness cuticle especially anteriorly , help to “pin” the parasite between the villi of small intestine where it lives 1.5 – 3mm x 0.5mm Suckers Oral s. smaller than vs No cephalic cone, the oral sucker Small oral sucker Oral & ventral suckers are equal is ¼ the ventral sucker Larger ventral sucker Digestive intestinal caeca have compound two simple undulating intestinal Simple intestinal caeca Simple tortous blind intestinal system lateral branches and medial caeca. caeca extending posteriorly branches T and Y shaped. Genital system Testes 2 branched middle of the body in Two branched testes in the Two ovoid in the posterior part of the body. (Hermaphrodite) front of each other. posterior half Deeply lobed situated nearly side by side Ovary Branched & anterolateral to testes. A branched ovary in the middle single globular in front of the testes. -

Digeneans (Trematoda) Parasitic in Freshwater Fishes (Osteichthyes) of the Lake Biwa Basin in Shiga Prefecture, Central Honshu, Japan
Digeneans (Trematoda) Parasitic in Freshwater Fishes (Osteichthyes) of the Lake Biwa Basin in Shiga Prefecture, Central Honshu, Japan Takeshi Shimazu1, Misako Urabe2 and Mark J. Grygier3 1 Nagano Prefectural College, 8–49–7 Miwa, Nagano City, Nagano 380–8525, Japan and 10486–2 Hotaka-Ariake, Azumino City, Nagano 399–8301, Japan E-mail: [email protected] 2 Department of Ecosystem Studies, School of Environmental Science, The University of Shiga Prefecture, 2500 Hassaka, Hikone City, Shiga 522–8533, Japan 3 Lake Biwa Museum, 1091 Oroshimo, Kusatsu City, Shiga 525–0001, Japan Abstract: The fauna of adult digeneans (Trematoda) parasitic in freshwater fishes (Osteichthyes) from the Lake Biwa basin in Shiga Prefecture, central Honshu, Japan, is studied from the literature and existing specimens. Twenty-four previously known, 2 new, and 4 unidentified species in 17 gen- era and 12 families are recorded. Three dubious literature records are also mentioned. All 30 con- firmed species, except Sanguinicolidae gen. sp. (Aporocotylidae), are described and figured. Life cy- cles are discussed where known. Philopinna kawamutsu sp. nov. (Didymozoidae) was found in the connective tissue between the vertebrae and the air bladder near the esophagus of Nipponocypris tem- minckii (Temminck and Schlegel) (Cyprinidae). Genarchopsis yaritanago sp. nov. (Derogenidae) was found in the intestine of Tanakia lanceolata (Temminck and Schlegel) (Cyprinidae). Asymphylodora innominata (Faust, 1924) comb. nov. is proposed for A. macrostoma Ozaki, 1925 (Lissorchiidae). A key to the families, genera, and species of these digeneans is provided. Host-parasite and parasite- host lists are given. Key words: adult digeneans, Trematoda, parasites, morphology, life cycle, Philopinna kawamutsu sp. -

Metacercariae of Centrocestus Formosanus
Research Note Rev. Bras. Parasitol. Vet., Jaboticabal, v. 21, n. 3, p. 334-337, jul.-set. 2012 ISSN 0103-846X (impresso) / ISSN 1984-2961 (eletrônico) Metacercariae of Centrocestus formosanus (Trematoda: Heterophyidae) in Australoheros facetus (Pisces: Cichlidae) in Brazil Metacercárias de Centrocestus formosanus (Trematoda: Heterophyidae) em Australoheros facetus (Pisces: Cichlidae) no Brasil Hudson Alves Pinto1; Alan Lane de Melo1* 1Laboratório de Taxonomia e Biologia de Invertebrados, Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil Received December 1, 2011 Accepted March 14, 2012 Abstract Heterophyid metacercariae were found in the gills of Australoheros facetus (Jenyns, 1842) collected from the Pampulha reservoir, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil, between February and April 2010. The cysts were counted and used to perform experimental studies (artificial excystment and infection of mice). Fifty specimens ofA. facetus were analyzed and it was found that the prevalence of infection was 100% and mean infection intensity was 134 metacercariae/fish (range: 4-2,510). Significant positive correlations were seen between total fish length and intensity of infection; between fish weight and intensity of infection, and between parasite density and fish length. Morphological analyses on metacercariae and adult parasites obtained from experimentally infected mice made it possible to identify Centrocestus formosanus (Nishigori, 1924). This is the first report ofC. formosanus in A. facetus in Brazil. Keywords: Heterophyidae, fish parasites, metacercariae, trematodes, Minas Gerais, Brazil. Resumo Metacercárias de Heterophyidae foram encontradas nas brânquias de Australoheros facetus (Jenyns, 1842) coletados na represa da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, entre fevereiro e abril de 2010.