N° 9 Folklore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guillaume Fort of Montaillou Confession 36
Guillaume Fort of Montaillou Confession 36 Confession of Guillaume Fort of Montaillou In the year 1321, the Monday before Palm Sunday (April 6, 1321) a letter of citation was sent by the Reverend Father in Christ my lord Jacques, by the grace of God bishop of Pamiers, the tenor of which follows: !“Brother Jacques, by divine grace the bishop of Pamiers, to his dear vicar in Christ in Montaillou, Raimond Trilhe, greetings in the Lord. !Since for very plausible causes and strong presumptions we hold the following strongly suspect of heresy: Bernard Clergue, Guillaume Fort, Guillemette Benet, Esclarmonde, the wife of Raimond Clergue, Vuissane, the wife of Bernard Testanière and Raimonde, the wife of the said Bernard Clergue and since we wish and intend, insofar as we are charged to do so, to investigate them concerning the faith, we order you to cite these named persons at once to appear before us this coming Saturday in our episcopal seat of Pamiers before tierce, to answer concerning the above-mentioned facts concerning the faith, and there to proceed in this matter as is appropriate, signifying to them that if they do not appear on this day before us, we will proceed against them as against those suspect in heresy, according to the law, notwithstanding their absence. !Given in our episcopal seat, the Monday before Palm Sunday, the year of the Lord 1321. Return the letter with a seal as a sign of this accomplished mandate.” !On the Saturday assigned in this letter of citation, appearing were Guillaume Fort, Esclarmonde, the wife of Raimond Clergue, and Vuissane, the wife of Bernard Testanière, who had been cited by the vicar of Montaillou for this Saturday, conforming to the content of the above-mentioned letter, since this citation was completed by the placement of the seal of the vicar, put onto this letter as a sign of the accomplishment of his mandate. -

Annexe1 RETENUES COLLINAIRES 2020.Pdf
ANNEXE 1 – Plan de Répartition 2020 – Période d’étiage – Retenues collinaires – Sous-bassin Ariège Identification du Identification Surface Volume Nom Prénom Commune Type de préleveur (nom Adresse C.P Commune Lieu dit Département de la déclarée Autorisé bénéficiaire bénéficiaire prélèvement prélèvement de l'exploitation) ressource 2020 (ha) 2020 (m3) 694 chemin BEAUMONT- BEAUMONT- pompage sur ASA DE LA LANTINE CHIBARIE Jean Claude 31870 Lac de la Lantine Haute-Garonne retenue collinaire 50,00 180 000 d'espinaouet SUR-LEZE SUR-LEZE plan d'eau champs de la pompage sur ASA DE SEIGNALENS VERISSE Alexandre 11420 SEIGNALENS Le barry SEIGNALENS Aude retenue collinaire 76 000 ville plan d'eau champs de la pompage sur ASA DE SEIGNALENS VERISSE Alexandre 11420 SEIGNALENS Fontassaut SEIGNALENS Aude retenue collinaire 69 000 ville plan d'eau ASA DES IRRIGANTS ADELLACH – pompage sur Mairie 09100 UNZENT Lac de la Laure LESCOUSSE Ariège retenue collinaire 75 000 DE LA LAURE VEROT plan d'eau Saint-Geniès, pompage sur ASL CANTO CLAOU DE SOLAN André Saint-Geniès 09130 CARLA-BAYLE ruisseau de canto CARLA-BAYLE Ariège retenue collinaire 25,00 200 000 plan d'eau claou SICA Irrigation est CASTELNAUD PECHARIC-ET- pompage sur ASL DU RIEUTORD Loudès 11451 Rieutord Aude retenue collinaire 250 000 audois ARY LE-PY plan d'eau 716, chemin de BEAUMONT- BEAUMONT- pompage sur ASL LE PORT GERBER Christian 31870 Ribonnet Haute-Garonne retenue collinaire 147,00 45 000 Ribaunet SUR-LEZE SUR-LEZE plan d'eau Joulé, ruisseau de pompage sur BONADEI Francis Joulé 09130 CARLA-BAYLE -
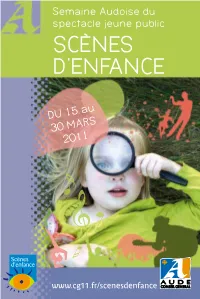
Scènes D'enfance
Semaine Audoise du spectacle jeune public ScèneS d’enfAnce du 15 au S 30 mAr 2011 www.cg11.fr/scenesdenfance Théâtre d’ombres uit TArIf le 15 Grat UNIQUE ArS l’ENF leS m AnT d’Él AnS 5€ ÉPhAn d S eT AuTRE T iathèque 150 places S cOn Éd rÉSERVATIO Te m n durée : 1h mardi 15 marsS - 18h30 - Édition 2011 CoN Pennautier - Théâtre na l SeILLÉe u à partir de 6 ans ÉdITO oba Spectacle composé à partir de 4 histoires : l’enfant Ouvrir de nouveauxconseil horizons Général aux de jeunes l’Aude Audois, au travers tel de nfance initiée en 2007. d’éléphant, Pierre et le est l’objectif du loup, histoire de la belle l’opération Scènes d’e grenouille et du jeune depuis, chaque édition permet à de nombreux jeunes crapaud et “la grenouille spectateurs d’assister à des représentations de théâtre, qui se veut faire aussi musique, cirque, danse, marionnettes et de rencontrer des grosse que le boeuf” (fable artistes. de la fontaine). Grâce à un partenariat exemplaire avec les acteurs des scènes et réseaux de diffusion audois et les médiathèques compagnie le Théâtre des Ombres. et bibliothèques de l’Aude, le spectacle vivant donne rendez- vous aux jeunes et aux moins jeunes du 15 au 30 mars pour partir à la découverte de 31 spectacles présentés partout dans l’Aude à l’occasion des 46 séances tout public. 50 places Il y a forcément un joli moment artistique à vivre près de durée :1 h leS 17, chez vous. Je m’associe à tous les organisateurs de cette u à partir de 6 ans Théâtre nouvelle édition pour vous souhaiter bonne découverte, 18 eT belles émotions et grands plaisirs. -

ANNEXE 1 - Plan De Répartition 2021 - Période Étiage - Retenues Collinaires -Périmètre 66 1/57
ANNEXE 1 - Plan de répartition 2021 - Période étiage - Retenues collinaires -Périmètre 66 1/57 Identification du Surface Volume Commune identification de Volume de la préleveur (nom de Nom Prénom Adresse C.P Commune Lieu-dit Département déclarée 2021 Attribué 2021 prélèvement la ressource retenue (m3) l'exploitation) (ha) (m3) Jean- 694 chemin BEAUMONT-SUR- Lac de la BEAUMONT-SUR- retenue ASA DE LA LANTINE CHIBARIE 31870 Haute-Garonne 180 000 50,00 180 000 Claude d'espinaouet LEZE Lantine LEZE collinaire champs de la retenue ASA DE SEIGNALENS Vénisse Alexandre 11420 SEIGNALENS Le barry SEIGNALENS Aude 76 000 23,70 76 000 ville collinaire Adellach, ASA DES IRRIGANTS Lac de la retenue Vérot, Petit, Mairie 09100 UNZENT LESCOUSSE Ariège 75 000 40,00 75 000 DE LA LAURE Laure collinaire Egay, Delrieu Saint- Geniès, retenue ASL CANTO CLAOU GIORDANO Gaël Icart 09130 SIEURAS CARLA-BAYLE Ariège 200 000 15,00 200 000 ruisseau de collinaire canto claou SICA irrigation PECHARIC-ET-LE- retenue ASL DU RIEUTORD Loudès 11451 CASTELNAUDARY Rieutord Aude 250 000 104,00 250 000 ouest-audois PY collinaire 716, chemin de BEAUMONT-SUR- BEAUMONT-SUR- retenue ASL LE PORT GERBER Christian 31870 Ribonnet Haute-Garonne 45 000 147,00 45 000 Ribaunet LEZE LEZE collinaire Joulé, retenue BONADEI FRANCIS BONADEI Francis Joulé 09130 CARLA-BAYLE ruisseau de CARLA-BAYLE Ariège 45 000 5,00 45 000 collinaire Panissa Mécail, retenue BONADEI FRANCIS BONADEI Francis Joulé 09130 CARLA-BAYLE ruisseau de CARLA-BAYLE Ariège 75 000 30,00 75 000 collinaire la Fount BOSSUT BOSSUT retenue -

L'ouest Audois, Un Territoire Sous Influence Méditerranéenne Et Toulousaine
n° 23 Décembre2005 L’OUESTAUDOIS, UNTERRITOIRESOUSINFLUENCE MÉDITERRANÉENNEETTOULOUSAINE L'aireurbaine(1) deToulouseexploseavecunepopulationd'unmillion d’habitantsetunrenforcementconstantdesoninfluence.Elleagagné87 communesen10ans,dont2communesdudépartementdel'Aude. Cettecroissances'esttraduiteparuneaugmentationdelapopulationde 14000habitantsparandepuis10ans,soitl'équivalentdelavillede Castelnaudary,villesituéedansl'Audeàmoinsde30minutesdeToulouse. L'Ouestaudois,àdominanterurale,doitdoncs'organiserpourtirerbénéficede cettesituation,toutenassurantundéveloppementdurabledesonterritoire JérômeBonavent-DDEdel'Aude serviceAménagementetTerritoires L'Ouestaudois, territoire composéde deuxpays(2) -le Carcassonnaiset leLauragais- s'articuleentre unsillonattractif etunefrange ruraleen mutation. Ilestengrande partiestructuré parses infrastructures routières. (1)Aireurbaine,ausensdeladéfinitionINSEE,soitlepôleurbainetlacouronnepéri-urbaine,constituéeparlescommunesdont40%desactifs travaillentdanslepôleurbainoudanslescommunesattiréesparcelui-ci. (2)Ledécoupagedel'Audeen5Paysestreprisdanscetteétude.L’OuestAudoiscomprendlapartieAudoiseduPaysLauragais,lePays Carcassonnaisetl'agglomérationdeCarcassonne.LePaysdelaHauteVallée,aveclepôleurbaindeLimoux,n'estdoncpastraitédanscette étudecibléesurlesillonAudois,malgrélesliensimportantsentreLimouxetCarcassonne,maisaussiavecCastelnaudary. UNESTRUCTURATIONDEL’ESPACEQUIRÉPONDAUXLOGIQUESDEDÉPLACEMENTSEST-OUEST L'axeprincipalEst-Ouest (envertclairsurla Cesdeuxentitéscoexistentavecdespôles carte)estlevecteurdelamajoritédeséchanges. -

Pays Des Quatre Vents.Indd
Pays des Quatre Vents Liste des villes d’intervention de l’HAD Pays des Quatre Vents à Carcassonne Aigues Vives Cailhavel Cuxac cabardes Airoux Cailla Donazac Ajac Cambieure Douzens Alaigne Campagna de Sault Esceuillens Alairac Campagne sur Aude Escouloubre Alet les Bains Camps sur l’Agly Esperaza Alzonne Camurac Espezel Antugnac Capendu Fa Aragon Carcassonne Fajac en Val Arques Carcassonne Fajac la Relenque Arquettes en Val Carlipa Fanjeaux Artigues Cassaignes Fendeille Arzens Castans Fenouillet du Razes Aunat Castelnaudary Ferran Axat Castelnaudary Festes et Saint André Azille Castelreng Floure Badens Caudebronde Fontanes de Sault Bagnoles Caudeval Fonters du Razes Baraigne Caunes Minervois Fonties Cabardes Barbaira Caunette sur Lauquet Fonties d’Aude Belcaire Caunettes en Val Fournes Cabardes Belcastel et le Buc Caux et Sauzens Fourtou Belflou Cavanac Fraisse Cabardes Belfort sur Rebenty Cazalrenoux Gaja et Villedieu Bellegarde du Razes Cazilhac Gaja la Selve Belpech Cenne monestiers Galinagues Belveze du Razes Cepie Gardie Belvianes et Cavirac Chalabre Generville Belvis Citou Gincla Berriac Clermont sur Lauquet Ginoles Bessede de Sault Cominge Gourvieille Blomac Comus Gramazie Bouilhomac Conilhac de la Montagne Granes Bouriege Conques sur Orbiel Greffeil Bourigeole Corbieres Gueytes et labastide Bram Coudons Hounoux Brenac Couffoulens Issel Brezilhac Couiza Joucou Brousses et Villaret Counozouls la bezole Brugairolles Cournanel La Cassaigne Bugarach Courtauly La Courtete Cabrespine Coustaussa La Digne d’Amont cahuzac Cubiéres sur -

Cheeses Part 2
Ref. Ares(2013)3642812 - 05/12/2013 VI/1551/95T Rev. 1 (PMON\EN\0054,wpd\l) Regulation (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: Art. 5 ( ) Art. 17 (X) PDO(X) PGI ( ) National application No 1. Responsible department in the Member State: I.N.D.O. - FOOD POLICY DIRECTORATE - FOOD SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD Address/ Dulcinea, 4, 28020 Madrid, Spain Tel. 347.19.67 Fax. 534.76.98 2. Applicant group: (a) Name: Consejo Regulador de la D.O. "IDIAZÁBAL" [Designation of Origin Regulating Body] (b) Address: Granja Modelo Arkaute - Apartado 46 - 01192 Arkaute (Álava), Spain (c) Composition: producer/processor ( X ) other ( ) 3. Name of product: "Queso Idiazábaľ [Idiazábal Cheese] 4. Type of product: (see list) Cheese - Class 1.3 5. Specification: (summary of Article 4) (a) Name: (see 3) "Idiazábal" Designation of Origin (b) Description: Full-fat, matured cheese, cured to half-cured; cylindrical with noticeably flat faces; hard rind and compact paste; weight 1-3 kg. (c) Geographical area: The production and processing areas consist of the Autonomous Community of the Basque Country and part of the Autonomous Community of Navarre. (d) Evidence: Milk with the characteristics described in Articles 5 and 6 from farms registered with the Regulating Body and situated in the production area; the raw material,processing and production are carried out in registered factories under Regulating Body control; the product goes on the market certified and guaranteed by the Regulating Body. (e) Method of production: Milk from "Lacha" and "Carranzana" ewes. Coagulation with rennet at a temperature of 28-32 °C; brine or dry salting; matured for at least 60 days. -

RADIATIONS DU 1Er AU 31 JUILLET 2020 11890 CARCASSONNE Cédex
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aude Affichage du 1er au 31 août 2020 20 Avenue du Mal Juin - CS 70051 RADIATIONS DU 1er AU 31 JUILLET 2020 11890 CARCASSONNE cédex Date Siret Nom / Dénomination Entreprise radiation Numéro de gestion Activité artisanale Adresse du siège Dirigeants, libellé fonction Forme juridique cessation code APRM 29/07/2020 400.058.079.00049 30/06/2020 5 AVENUE KARL MARX Mohamed AOURIA EXPLOITANT AOURIA MOHAMED 0023917110 SNACK, RESTAURATION RAPIDE 11100 NARBONNE INDIVIDUEL 5610CQ 28/07/2020 348.631.136.00036 3 RUE DE L'ECOLE 29/05/2020 TAXI - LOCATION DE FONDS ET DE Regis ARMENGAUD EXPLOITANT ARMENGAUD REGIS 0079207110 LE SEGALA VEHICULES TAXI INDIVIDUEL 4932ZA 11320 LABASTIDE D'ANJOU 10/07/2020 795.366.400.00013 01/07/2020 SERVICES ADMINISTRATIFS COMBINES 11 RUE DES AMANDIERS Lucette ASTRE EXPLOITANT ASTRE LUCETTE 0034018110 DE BUREAU 11250 ROUFFIAC D AUDE INDIVIDUEL 8211ZP 30/07/2020 27/07/2020 812.468.049.00034 ASSISTANCE, MAINTENANCE, 6 RUE DU MARCHE Tristan BERENGER EXPLOITANT BERENGER TRISTAN 0064915110 REPARATIONS D'ORDINATEURS, 11400 CASTELNAUDARY INDIVIDUEL 9511ZZ TABLETTES ET TELEPHONES 10/07/2020 328.172.010.00014 30/06/2020 1 RUE BAPTISTE LIMOUZY Jean-Francois BIELSA EXPLOITANT BIELSA JEAN-FRANCOIS 0055883110 RECHAPAGE REP.INDUS.PNEUMATIQUE 11100 NARBONNE INDIVIDUEL 2211ZZ 15/07/2020 BORDE ET FILS 752.068.759.00014 25/02/2020 4 RUE DU PORT AUTRE SOCIETE A 0085412110 SANS ACTIVITE Philippe BORDE LIQUIDATEUR 11120 GINESTAS RESPONSABILITE LIMITEE 5610CQ 24/07/2020 449.200.211.00034 ROUTE DE FONTIERS -

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2460
Changes to legislation: There are currently no known outstanding effects for the Commission Implementing Decision (EU) 2015/2460. (See end of Document for details) Commission Implementing Decision (EU) 2015/2460 of 23 December 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in France (notified under document C(2015) 9818) (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance) COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/2460 of 23 December 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in France (notified under document C(2015) 9818) (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market(1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market(2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Avian influenza is an infectious viral disease in birds, including poultry. Infections with avian influenza viruses in domestic poultry cause two main forms of that disease that are distinguished by their virulence. The low pathogenic form generally only causes mild symptoms, while the highly pathogenic form results in very high mortality rates in most poultry species. -

STAATSCOURANT 2020 Officiële Uitgave Van Het Koninkrijk Der Nederlanden Sinds 1814
Nr. 47134 11 september STAATSCOURANT 2020 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, productdossier BGA “HARICOT DE CASTELNAUDARY” Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongs- benamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie(s) in Publicatieblad C 281 van 26 augustus 2020 van de Europese Unie bekend. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in verband met door de Europese Commissie voorgenomen registratie(s) van bijgaand productdossier(s), kan tot uiterlijk 26 oktober 2020 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, secretariaat AGOS, Postbus 93119, 2509 AC Den Haag Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (2020/C 281/02) Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad1 uiterlijk drie maanden na deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. ENIG DOCUMENT “HARICOT DE CASTELNAUDARY” EU-nr.: PGI-FR-02450 – 8.3.2019 BOB ( ) BGA (X) 1. Naam/namen “Haricot de Castelnaudary” 2. Lidstaat of -
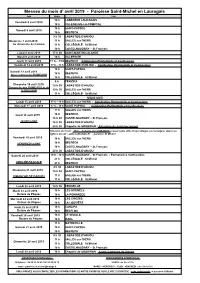
Messes Du Mois D' Avril 2019
Messes du mois d' avril 2019 - Paroisse Saint-Michel en Lauragais Jour Heure Lieu 18 h LABÉCÈDE LAURAGAIS Vendredi 5 avril 2019 18 h VILLENEUVE-LA-COMPTAL 18 h SAINT-PAPOUL Samedi 6 avril 2019 18 h BELPECH 9 h 30 LABASTIDE D'ANJOU Dimanche 7 avril 2019 11 h SALLES sur l'HERS 5e dimanche de Carême 11 h COLLÉGIALE St Michel 18 h CASTELNAUDARY – St François Lundi 8 avril 2019 17 h 30 SAINT-MARTIN LALANDE Mardi 9 avril 2019 18 h VILLEPINTE Jeudi 11 avril 2019 17 h – 19 h BELPECH - Célébration Pénitentielle et Confessions Vendredi 12 avril 2019 17 h – 19 h LABASTIDE D'ANJOU - Célébration Pénitentielle et Confessions 18 h SAINT-PAPOUL Samedi 13 avril 2019 18 h BELPECH Messe anticipée des RAMEAUX 18 h COLLÉGIALE St Michel 9 h PEXIORA Dimanche 14 avril 2019 10 h 30 LABASTIDE D'ANJOU Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION 10 h 30 SALLES sur l'HERS 11 h COLLÉGIALE St Michel SEMAINE SAINTE Lundi 15 avril 2019 17 h – 19 h SALLES sur l'HERS - Célébration Pénitentielle et Confessions Mercredi 17 avril 2019 17 h – 19 h SAINT-PAPOUL - Célébration Pénitentielle et Confessions 17 h SALLES sur l'HERS 'Jeudi 18 avril 2019 18 h BELPECH 18 h 30 CASTELNAUDARY – St François JEUDI SAINT 18 h 30 LABASTIDE D'ANJOU 20 h 30 Chapelle de SOUBIRAN : Adoration du Saint-Sacrement Chemins de Croix : 15 h - Calvaire de LAURABUC et pour votre ville et vos villages se renseigner dans vos églises ou sur : aude.catholique.fr → paroisse St Michel Vendredi 19 avril 2019 18 h SALLES sur l'HERS VENDREDI SAINT 18 h BELPECH 18 h CASTELNAUDARY – St François 20 h 30 LABASTIDE D'ANJOU -

Mémo Pratique Annuaire Ccplm
Les permanences Centre intercommunal d’action Maison des services au public (MSAP) sociale (CIAS) Uniquement sur RDV 04 68 76 69 40 - [email protected] Service d’aide à domicile Bram : mercredi et vendredi 9h-12h -siège CCPLM Belpech : mardi et jeudi 8h-12h 13h30- Villepinte : lundi matin - Mairie MÉMO PRATIQUE 17h vendredi 8h-12h Mairie Pexiora : lundi matin - Mairie Bram : lundi 13h30-17h siège CCPLM Montréal : mardi 9h-12h salle annexe Mairie Montréal : lundi et jeudi 8h-12h annexe Mairie ANNUAIRE CCPLM Belpech : mardi 13h30-16h30 - Mairie Villasavary : lundi au jeudi 8h-12h 13h30- Fanjeaux : jeudi 9h-12h - Mairie 17h et vendredi 8h-12h 13h30-16h30 Villasavary : jeudi 13h30-16h30 - Mairie Sans RDV - 04 68 24 72 35 Une question ? Un conseil ? Une problématique du quotidien ? Centre médico social de Service instructeur des Castelnaudary (CMS) Conseil départemental Consultez nos services pour trouver ensemble autorisations du droit du sol Lieu d’écoute et d’information des- d’accès aux droits (CDAD 11) la meilleure solution. Permis de construire tiné aux personnes en difficulté Consultations juridiques gratu- 1er et 3ème mardi du mois Sur RDV 04 68 23 55 82 : ites d’un agent de justice De nouvelles permanences sont ouvertes depuis la 14h30-16h30 Bram : vendredi Tous les 3èmes mercredis du rentrée au siège de la CCPLM ! sur RDV 04 68 76 69 40 Belpech : 1er jeudi du mois mois 9h-12h Ouverture des permanences Sans RDV : Sur RDV 04 68 76 69 40 fin 2018 Montréal : jeudi 9h-11h CONTACT [email protected] - 04 68 76 69 40 www.ccplm.fr - @CDCPLM Mon